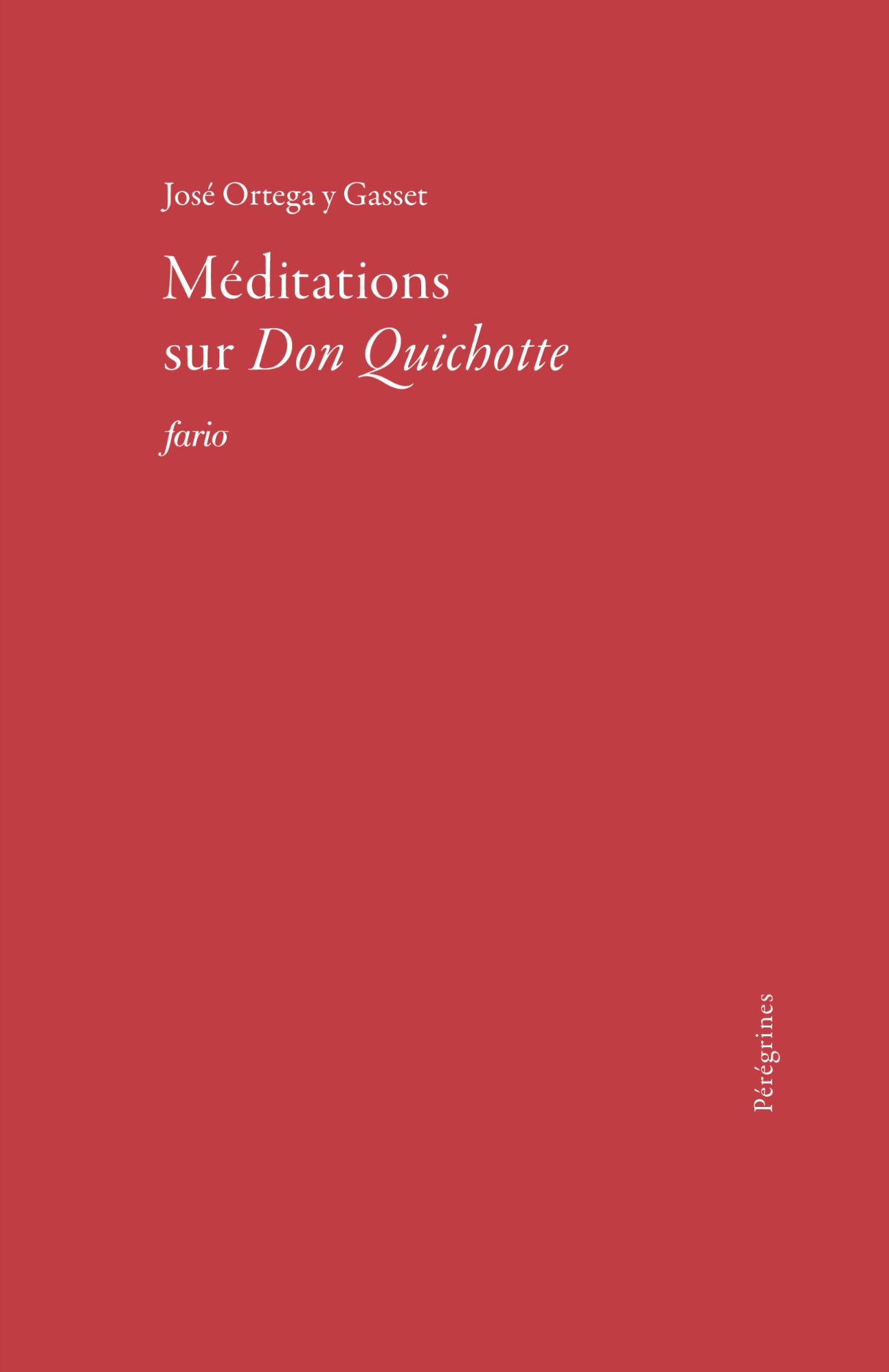
Traduit de l'espagnol, par Mikaël Gómez-Guthart
Publié en 1914, Méditations sur Don Quichotte est le premier livre d’Ortega y Gasset. S’il lui a fallu plusieurs décennies pour se voir reconnu dans toute son importance, on peut avancer aujourd’hui qu’il constitue à la fois la naissance et le cœur de la démarche philosophique d’Ortega, en particulier en ce qui concerne l’art et la littérature.
La méditation constitue une forme singulière de la pensée, en ce qu’elle s’accorde un libre cours susceptible d’errance mais aussi d’attention, de contemplation, de surprise et de détours. On concevra alors aisément que l’œuvre de Cervantès soit un point de départ, un quai où s’arrimer sans pour autant fixer les bornes du voyage. Don Quichotte est ici au sens propre un prétexte à une réflexion profonde sur notre « être dans le monde » dont l’aventure de l’hidalgo serait un des moments fondateurs. Les chemins empruntés par Ortega sont multiples et si le livre s’ouvre sur une promenade en forêt, c’est à la fois pour y éprouver la diversité innombrable des arbres et la fugacité des sensations mais aussi pour y poursuivre, dans un geste amoureux, et dans la solitude, dans l’étrangeté de notre condition, les nymphes invisibles que sont les concepts.
Le roman de Cervantes, que l’on a pu situer comme le premier roman moderne, ouvre en effet pour Ortega à la question de notre ancrage ou de notre errance dans une forêt de signes et d’œuvres qui verrait s’opposer le modèle espagnol d’une culture adamique, vouée à l’impression et aux sens, toujours labile et à réinitier, éternel combat contre les moulins de notre imaginaire, et une visée germanique rivée aux essences mais privée de la concrétude du corps et de ce que le monde y imprime. Le défi étant, au seuil d’un vingtième siècle dont le penchant catastrophique est ici pressenti, de faire leur place à ces deux pôles dans un avenir qui ne saurait-être qu’européen.
"Il y a dans toute chose l’indice d’une plénitude possible. Une âme ouverte et noble ressentira l’ambition de la perfectionner, de l’aider à atteindre cette plénitude. C’est cela l’amour — l’amour de la perfection de l’être aimé.
Il est fréquent, dans les tableaux de Rembrandt, qu’une simple toile blanche ou grise, ustensile ménager grossier, soit enveloppée d’une atmosphère lumineuse et rayonnante que d’autres peintres n’auraient employée que dans le but d’auréoler des têtes de saints. Et c’est comme s’il nous disait en délicate réprimande : « Que les choses soient sanctifiées ! Aimez-les, aimez-les ! Chaque chose est une fée qui revêt de misère et de vulgarité ses trésors intérieurs, et c’est une vierge qui doit être aimée pour devenir féconde. »
Le « salut » n’est pas synonyme d’éloge ou de dithyrambe ; il peut y avoir en lui de fortes censures. L’important est que le sujet soit mis en relation immédiate avec les courants élémentaires de l’esprit, avec les motifs classiques de la préoccupation humaine. Une fois entrelacé avec eux, il est transfiguré, transsubstantié, sauvé.
Il en résulte qu’une doctrine d’amour coule sous la terre spirituelle de ces essais, parfois risquée et âpre, avec un bruit sourd et doux, comme si elle craignait d’être entendue trop clairement. " — José Ortega y Gasset