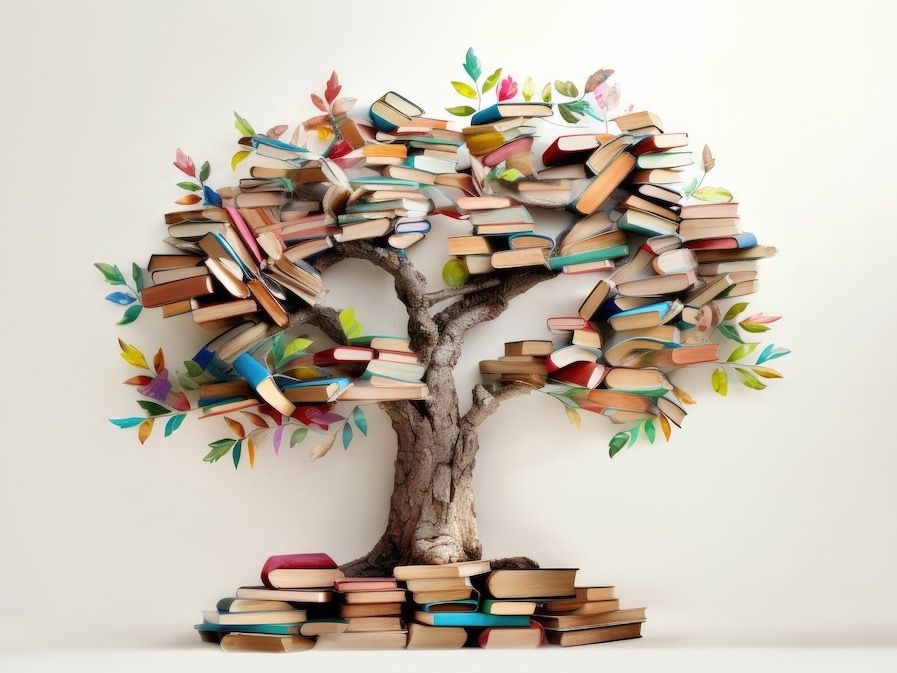
Journées d’étude UNIL – HEP Vaud
Le texte littéraire dans tous ses états : quels enjeux pour l’enseignement en L2 ?
Mardi 28 avril 2026 – HEP Vaud (Lausanne, salle C33-720)
Mercredi 29 avril 2026 – Université de Lausanne (Salle Amphipôle - 340.1)
La place de la littérature dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères et secondes (modernes et anciennes), dorénavant L2, demeure une question vive et souvent débattue. Tour à tour sacralisé par les approches traditionnelles, marginalisé par la méthode structuro-globale-audio-visuelle puis relégué au second plan dans les premières années de l’approche communicative (Albert & Souchon, 2000), le texte littéraire a été réhabilité par des approches plus récentes pour des raisons diverses.
La littérature peut être envisagée à la fois comme vecteur d’appropriation langagière, d’accès à d’autres cultures et de construction du sujet lecteur. Pour certain·es, la littérature reste un pilier incontournable de la Bildung, c’est-à-dire la formation scolaire visant à comprendre la culture (Pieper, 2007). Pour d’autres, il constitue un levier d’engagement et de motivation dans l’apprentissage d’une langue seconde/étrangère, par exemple en servant de tremplin vers l’écriture créative et l’expression de soi (Godard, 2015, Bemporad & Jeanneret 2018).
Le rôle de la littérature dans l’enseignement des langues secondes/étrangères fait l’objet de discussions à l’école secondaire comme dans l’enseignement supérieur. Quels textes faire lire ? Dans quel format ? Comment les lire ? Comment les exploiter en cours ? Dans quel but ?
Ces deux journées d’étude proposent d’ouvrir la réflexion sur ces enjeux en croisant les regards de la recherche et de la pratique enseignante. Elles réuniront des chercheur·euses en didactique des langues et de la littérature, des enseignant·es à l’école secondaire, ainsi que des étudiant·es des hautes écoles. Les échanges porteront sur l’enseignement de la littérature en L2 en contexte suisse (allemand, anglais, espagnol, français, grec ancien, italien, latin), tout en accueillant des contributions en L1 afin de nourrir la réflexion de manière comparative et intégrée. Nous proposons de structurer le questionnement en quatre axes :
Axe 1 – Corpus et choix de textes
Cet axe invite à réfléchir aux critères qui orientent le choix d’un texte littéraire dans l’enseignement des langues secondes et étrangères. On s’interrogera également sur le rôle de la littérature dans l’apprentissage d’une L2 et, de manière plus générale, à ce qui constitue un texte littéraire.
- Quels critères d’apprentissage justifient la sélection d’une œuvre ou d’un extrait ?
- Ces choix répondent-ils à des logiques institutionnelles, à des traditions disciplinaires, à des attentes sociales, ou bien à des projets pédagogiques plus situés ?
- Quels sont les critères pour choisir un corpus ? L’âge, le niveau de langue, le parcours scolaire des apprenant·es, etc. ?
- Faut-il privilégier les textes patrimoniaux, considérés comme des piliers incontournables de la culture cible, ou au contraire ouvrir davantage la place aux textes contemporains et à des genres habituellement moins valorisés (comme la science-fiction ou le roman policier)?
- Comment articuler la dimension esthétique des textes avec des objectifs langagiers ou culturels ?
Axe 2 – Traduction et adaptation
Outre les textes « originaux », des traductions ou des adaptations sont parfois introduites dans les cours de langue. La traduction, souvent dépréciée à la suite de l’abandon des méthodes dites traditionnelles, s’est vue revalorisée grâce à des approches plurielles, par le Volume complémentaire du Cadre européen des langues notamment, qui en ont fait un outil de médiation et un levier d’ouverture à la diversité linguistique (voir Volume complémentaire du CECR, Conseil de l’Europe 2018). Ce nouveau regard nous permet de considérer la traduction différemment et d’interroger sa pertinence dans le cadre de l’enseignement de la littérature L2. De même, les livres gradués semblent parfois représenter la seule option pour faire découvrir des textes littéraires à des apprenant·es de niveau élémentaire.
- Quelle place la traduction occupe-t-elle dans l’enseignement de la littérature L2 ?
- Quels en sont les bénéfices dans l’apprentissage d’une langue ?
- Les textes traduits sont-ils légitimes d’un point de vue scolaire ?
- Quelles sont les différentes adaptations interlinguistiques, intralinguistiques ou intermédiatique (théâtre, cinéma, musique) que l’on peut exploiter dans l’enseignement ?
- Les textes adaptés peuvent-ils être considérés comme des textes littéraires et quelle place peuvent occuper les textes adaptés dans l’enseignement des langues ?
- Quelle place accorder aux livres bilingues ? ou aux productions plurilingues ?
Axe 3 – Modalité de travail et objectifs d’apprentissage
Dans cet axe, il s’agit d’interroger les modalités de travail sur les textes littéraires dans différents contextes. En effet, si dans certains contextes l’analyse littéraire orientée vers la méthode de l’explication de texte constitue un objectif d’enseignement-apprentissage incontournable, d’autres contextes privilégient des approches de la lecture littéraire plus orientées vers la participation et la subjectivité du lecteur. Cet axe vise à entrer dans le cœur des démarches et dispositifs dans les classes, et vise à discuter les questions suivantes :
- Quelles sont les pratiques actuelles des enseignant·es de langue vis-à-vis des textes littéraires dans différents contextes et pour les différentes langues enseignées à l’école ?
- Quels sont les objectifs, les activités proposées et les types d’évaluations privilégiés par les enseignant·es de langue ?
- Quels liens entretiennent les pratiques d’enseignement du texte littéraire avec les nouvelles approches en didactique de la littérature privilégiant la subjectivité du lecteur et la lecture au premier degré ?
- Quels liens entretiennent les pratiques d’enseignement du texte littéraire avec les nouvelles approches en didactique des langues telles que la perspective actionnelle et les approches plurielles ?
- Quel lien fait-on entre les approches académiques des textes littéraires et les pratiques scolaires ?
Axe 4 – Multimodalité et intelligence artificielle générative
La diversification des supports numériques et l’essor de l’intelligence artificielle redéfinissent profondément les pratiques de lecture et l’enseignement de la littérature en L2. Lire ne signifie plus uniquement parcourir un texte imprimé : il s’agit aussi d’explorer des livres électroniques, d’écouter des récits audios ou d’interagir avec des formes narratives multimodales. Ces évolutions, en pleine expansion, invitent à interroger la transformation de notre rapport au texte littéraire ainsi que les modalités de sa transmission aux apprenant·es.
- En quoi ces nouveaux supports modifient-ils la manière de faire découvrir les textes littéraires aux apprenant·es ?
- Quels bénéfices mais aussi quels obstacles posent ces nouvelles modalités pour l’enseignement de la littérature en L2 ?
- Comment l’intelligence artificielle générative (IAg) peut-elle être mobilisée pour soutenir la lecture, l’annotation ou l’analyse des textes ?
- Dans quelles conditions l’IAg peut-elle constituer un outil pertinent de médiation ou de création en classe ?
- Quelles limites, quels risques ou quelles questions éthiques l’usage de l’IAg soulève-t-il pour l’enseignant·e comme pour l’apprenant·e ?
- Comment articuler ces innovations technologiques avec les objectifs culturels, formatifs et critiques propres à l’enseignement littéraire ?
Modalités de participation
Les interventions pourront prendre différentes formes :
- Exposés longs (20 minutes + 10 minutes de discussion)
- Exposés courts (10 minutes + 5 minutes de discussion)
- Tables rondes, podiums, ateliers (partage de pratiques, présentations d’activités, retours d’enseignement)
Les propositions doivent comporter :
- L’axe choisi,
- Le titre de l’intervention,
- Le type d’intervention (exposé long, court, atelier),
- Un résumé de 5 lignes au maximum.
Date limite de soumission : 22 décembre 2025
À envoyer à : lalpic@hepl.ch et efle@unil.ch
Notification des propositions retenues et programme provisoire : 15 janvier 2026
Informations pratiques
Participation gratuite mais inscription obligatoire.
Une attestation de participation et/ou de formation continue sera délivrée aux enseignant·es du Canton de Vaud qui le désirent
Public cible : chercheur·euses en langues et littérature, enseignant·es et formateurs du secondaire, étudiant·es universitaires et en formation à l’enseignement.
Organisation
Ces journées sont organisées conjointement par l’École de français langue étrangère de l'Université de Lausanne, l’Unité d’enseignement et de recherches des langues-cultures, et le laboratoire LPIC (Langues plurililinguisme, intéragration et culture) de la HEP Vaud, dans une volonté de dialogue entre recherche et pratique enseignante, et d’ouverture à la diversité linguistique et culturelle.
Comité d’organisation
Chiara Bemporad (HEP Vaud), Luc Fivaz (HEP Vaud), Cyrille François (UNIL-EFLE), Graziella Pesce (Présidente cantonale de chefs de files allemand, Secondaire II)
Comité scientifique
Alain Ausoni
Raphaël Baroni
Chiara Bemporad
Arnaud Buchs
Luc Fivaz
Cyrille François
Antje Kolde
Graziella Pesce
Paula Ristea
Ingo Thonhauser
Martina Zimmermann
Références citées
Albert, M.-C. & M. Souchon (2000). Les textes littéraires en classe de langue. Paris, Hachette.
Bemporad C. & T. Jeanneret (dir.) (2019). Lectures de la littérature et appropriation des langues et cultures. Recherches et applications, no 65.
Conseil de l’Europe (2022). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer : Volume complémentaire. Council of Europe.
Godard, A. (dir.) (2015). La littérature dans l’enseignement du FLE. Paris : Didier.
Pieper, I., et al. (dir) (2007). Texte, littérature et « Bildung ». Strasbourg : Conseil de l'Europe. Division des Politiques linguistiques.
Vignette d'illustration © Irinayeryomina