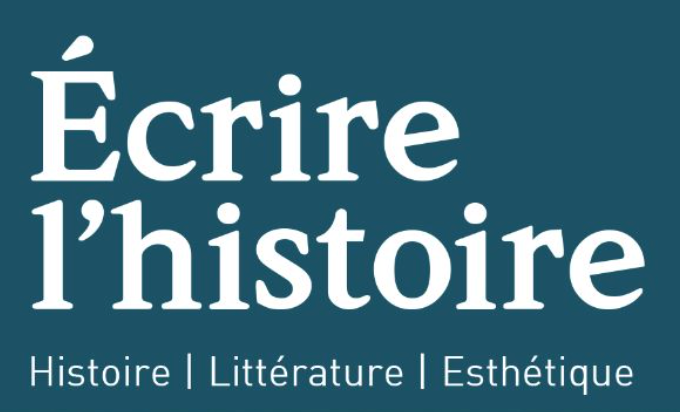
Appel à contributions pour la revue Écrire l’histoire
« Reconstitutions »
Numéro à paraître courant 2027
Dans les domaines cinématographique, télévisuel, scénique ou artistique, les contraintes de la reconstitution historique sont fréquemment associées à un idéal de résurrection du passé et à un impératif de respect des données événementielles, matérielles ou archéologiques susceptible de témoigner du professionnalisme de la production dans différents domaines : décors, costumes, accessoires, figuration, voire scénario et dialogue (déroulé chronologique, causalité historique, fonctionnement social). Pour ce faire, les œuvres peuvent mobiliser la collaboration de spécialistes extérieurs au domaine créatif, qui apportent une caution de conformité et de respectabilité à l’ensemble.
La reconstitution se heurte fréquemment, néanmoins, à ses propres limites : pressions budgétaires et temporelles associées au domaine de création, connaissances incomplètes ou discutées, difficultés à documenter l’intégralité concrète et le quotidien d’une époque révolue, nécessité d’adapter l’effort de restitution aux attentes des publics contemporains, etc. En outre, l’effort de restitution matérielle peut être appréhendé moins comme une ambition que comme une pesanteur, si ce n’est une servitude, la représentation visuelle du passé renvoyant dans cette optique à une dimension naïvement scolaire ou didactique, fatalement partiale ou illusoire, dont l’art aurait intérêt à s’émanciper.
De fait, l’attention académique accordée aux tentatives de reconstitution a d’abord résulté d’une vigilance disciplinaire d’origine historienne, évaluant les œuvres au prisme de leur degré de conformité aux connaissances disponibles, approche souvent peu préoccupée par les enjeux proprement créatifs et imaginaires, peu sensible voire hostile aux nécessités de l’anachronisme, du déplacement et de l’actualisation. Nombreux ont été les travaux, par ailleurs, attachés aux usages idéologiquement chargés de la reconstitution, le discours historique dont elle est le vecteur agissant à son tour, au moment de sa réception, sur un contexte socio-politique déterminé. Une autre approche semble spécifiquement liée, depuis quelques années, aux enjeux techniques et aux savoir-faire artisanaux présidant aux réalisations de grande envergure, aspects faisant l’objet d’une attention croissante de la recherche, par exemple dans le domaine du cinéma (dessins préparatoires, trucages, habillage-maquillage-coiffure [HMC], retombées environnementales, etc.). Les approches économiques et institutionnelles ont également pu croiser, ponctuellement, certaines productions historiques dont les dimensions et le faste ont semblé exemplaires en raison des ressources et des collaborations mobilisées.
Dans cette perspective, le présent numéro de la revue Écrire l’histoire souhaite repartir de la question de la reconstitution, malgré son caractère d’évidence et sa possible trivialité, pour interroger de façon problématisée l’entrecroisement constant des questions matérielles, historiques, culturelles, créatives et esthétiques. On souhaiterait en particulier donner à observer la manière dont l’écriture et la vision historiques déterminent les choix de reconstitution, tout en étant en retour déterminées et reconfigurées par ces derniers. On pourra mettre en lumière les marges d’invention et de stylisation laissées aux artistes par les sources à disposition, le jeu des références visuelles et des niveaux d’intertextualité propres à toute production d’image, le caractère imprévisible de processus créatifs qui se limitent rarement au simple décalque, les modalités d’implication des publics face à la diversité des échelles et des formats, ou encore les stratégies destinées à générer un sentiment d’authenticité. Ces orientations pourront être l’occasion de revenir sur le caractère collectif et partagé d’écritures essentiellement non verbales, visuelles et matérielles de l’Histoire, déterminées par des contraintes techniques et institutionnelles sans cesse renouvelées, mais aussi par les évolutions du champ historique proprement dit. En sens inverse, l’emprise et l’influence de ces reconstitutions visuelles sur la recherche académique pourront faire l’objet d’une réflexion spécifique. Conjointement, on pourra interroger le foisonnement des reconstitutions costumées à caractère festif ou commémoratif, en lien avec certaines tendances culturelles contemporaines (essor de la patrimonialisation nationale ou régionale, du médiévalisme, de l’histoire militaire, etc.) et avec la diversité des réappropriations. La reconstitution pouvant être tout autant une tentative résurrectionnelle qu’une opération idéologique, les implications politiques de la reconstitution dans ses déclinaisons actuelles pourront faire l’objet de propositions spécifiques.
Les objets abordés pourront relever de l’ensemble des arts de l’image animée (cinéma, télévision, jeu vidéo) et de la scène, sans limitation à une période temporelle. Des travaux portant sur des aires non-occidentales seront particulièrement appréciés. Les enjeux sonores de la reconstitution pourront être pris en considération, de même que les dispositifs muséaux.
Les propositions de contribution, en français ou en anglais, d’une longueur de 2000 à 3000 signes, accompagnées d’un état bibliographique provisoire, sont attendues pour le 15 avril 2026. Les propositions retenues donneront lieu à une remise d’article d’ici au 15 novembre 2026.
—
Direction du numéro et contacts
Gaspard Delon – gaspard.delon@u-paris.fr
Marie Frappat – marie.frappat@u-paris.fr
Université Paris Cité – Laboratoire CERILAC – UFR LAC
—
La revue
https://www.cnrseditions.fr/revue/ecrire-lhistoire/
NB : La revue ne garantissant pas le financement de traductions, les auteurs et autrices retenus devront veiller à proposer une traduction en français de leur article.
English version : https://u-paris.fr/cerilac/aac-ecrire-lhistoire-reconstitutions-15-avril-2026/