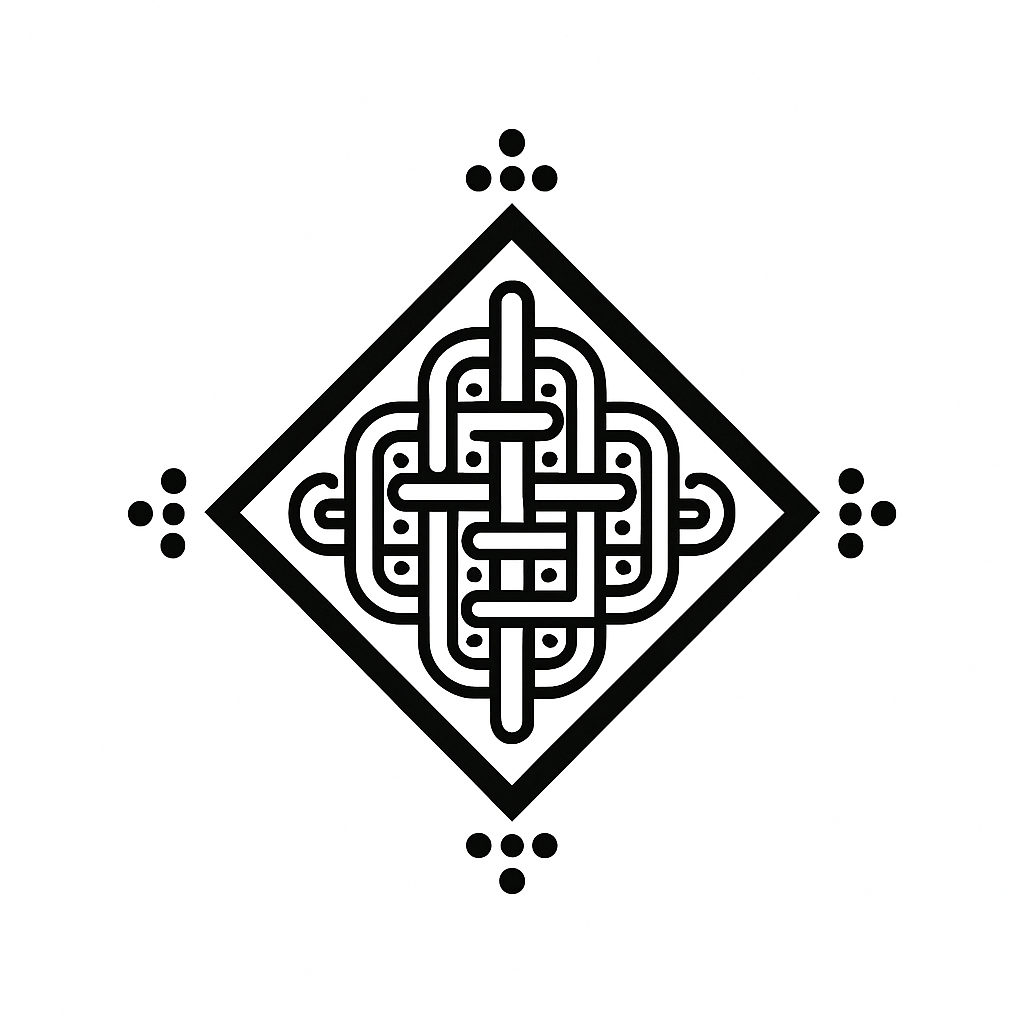
Le Comité de rédaction des Cahiers de Tunisie (série Lettres et Langue) lance un appel à contributions pour le numéro 238 de la revue dont le dossier thématique porte sur Les discours de la domination : textes, arts et médias.
Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension de nos sociétés, de leurs mécanismes et de leurs évolutions, le comité de rédaction souhaite rattacher ce numéro des Cahiers de Tunisie aux Objectifs du Développement Durable (ODD) tels que définis par l’ONU. À travers cette réflexion sur les discours de la domination, nous espérons ainsi participer à la réalisation de l’ODD 5, lutte pour l’égalité entre les sexes, de l’ODD 10, réduction des inégalités, et de l’ODD 16, paix, justice et institutions efficaces.
« Le discours des idées se construit à travers le discours du pouvoir, le premier relevant d’une problématique de la vérité, le second d’une problématique de vraisemblance »[1], écrit Patrick Charaudeau dans son essai sur Le Discours politique. Or, à « l’ère de la post-vérité »[2], les discours sont plus que jamais soumis au pouvoir et aux appareils idéologiques. La polémique soulevée par l’ouvrage d’Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine, rendu indisponible à la vente en 2023 par la maison d’édition Fayard, prouve à quel point les voix dissidentes sont marginalisées par les voix dominantes qui visent à monopoliser la vérité quitte à passer par la censure. Portés par des discours que le philosophe italien Antonio Gramsci[3] qualifie d’hégémoniques, ces logiques façonnent la perception des événements. La chose est d’autant plus vraie dans un monde où l’hyperconnexion et les intelligences artificielles redéfinissent les modalités de circulation des narrations établies ainsi que les processus qui amènent les individus à y adhérer.
À la croisée des Lettres, des arts et des sciences du langage, ce numéro entend interroger la manière dont les narrations hégémoniques impactent nos représentations collectives, s’imposant comme des paradigmes susceptibles de miner nos modes de pensée. Les chercheurs souhaitant y contribuer pourront également s’intéresser aux contre-discours subversifs, tout discours étant à même de créer des espaces de contestation face aux pensées dominantes[4]. Les contributeurs interrogeront aussi sans doute les « subalternités », telles que les définit Gayatri Chakravorty Spivak[5], car les Subaltern Studies permettent de mieux appréhender l’invisibilisation à laquelle sont vouées les voix des dominés. Les « subalternes » sont condamnés à produire leur contre-discours dans la marge c’est-à-dire dans des espaces médiatiques, littéraires ou artistiques alternatifs, espaces qui pourront certainement intéresser nos contributeurs. Les travaux de ces derniers s’inscriront dans les axes suivants sans toutefois s’y limiter :
1. Représentations littéraires et artistiques
En littérature comme en art, les œuvres peuvent tant reconduire que déjouer les schémas hégémoniques des discours dominants. De la littérature coloniale à la littérature postcoloniale, des arts plastiques aux arts numériques, l’œuvre créée met en scène le dominé tel qu’il est vu par le dominant, et inversement. Étudier les discours de la domination revient à étudier les récits des dominants, la manière dont ils sont agencés et transmis ; de même, les récits des dominés reposent sur des stratégies narratives et esthétiques qui peuvent aller dans le sens d’une résistance ou d’une allégeance aux discours normatifs, stratégies qu’il convient d’étudier.
2. Médias et propagande
Longtemps associée aux régimes autoritaires et à leur appareil de manipulation des masses, la propagande s’exerce plus que jamais dans les médias où les débats partisans sont légion. L’initiative « FIGNEWS Shared Task », un projet de recherche sur l’analyse des discours médiatiques et des biais de propagande pendant la guerre à Gaza, suffit à démontrer à quel point les médias numériques et les réseaux sociaux qui leur servent de relais peuvent influencer l’opinion publique. Les politiques de modération des contenus sur Facebook ou sur X peuvent ainsi invisibiliser certains discours, tout en en favorisant d’autres en valorisant des contenus via des algorithmes prédateurs.
3. Identités et narrations collectives
Les discours de la domination façonnent les identités des peuples et structurent les mémoires collectives. Les mythes officiels peuvent déterminer des politiques nationales et amener des peuples à renier des réalités historiques au détriment de groupes minoritaires par exemple. Les manuels scolaires, les hymnes nationaux, les commémorations officielles et les institutions peuvent contribuer à l’instauration d’une mémoire collective sélective et, par là même, exclusive, les imaginaires sociaux étant souvent des imaginaires de la ségrégation.
4. Genre et domination masculine
Du point de vue des études de genre, on pourrait s’intéresser au discours masculiniste en tant que discours de la domination par excellence. Là où les mouvements féministes tentent de recentrer les questions des inégalités en dénaturalisant les rapports sociaux, le discours masculiniste, au contraire, les essentialise afin de pérenniser la domination masculine. Les contributeurs pourraient étudier le masculinisme du point de vue linguistique en termes de dominance, mais également dans sa logique androcentrée et exclusive. L’approche socio-psychologique offre de son côté la possibilité de se pencher sur les violences verbales, psychologiques ou physiques inhérentes à la montée de ce mouvement réactionnaire.
5. Intelligences artificielles
L’analyse des discours développés par les IA peut s’avérer du plus grand intérêt. Lorsque les algorithmes de machine learning sont biaisés, les modèles de langage sont susceptibles de verser dans les extrêmes (ainsi que l’a révélé le cas récent de l’IA Grok). À l’heure où certains géants de la tech exercent un monopole écrasant sur ces technologies, il peut être intéressant de s’interroger sur les biais politiques et/ou culturels présents dans les corpus et dans les données servant à entraîner les IA.
Modalités de soumission
- Les chercheurs, enseignants et doctorants (en Lettres, langue et études artistiques et médiatiques, notamment) sont invités à soumettre des articles originaux en arabe, en français ou en anglais.
- Les contributions peuvent prendre la forme (non exclusive) d’articles scientifiques, d’analyses critiques ou d’études de cas.
- Les propositions doivent comporter environ 500 mots, incluant le titre, l’axe choisi, une présentation de la problématique et de la méthodologie et une bibliographie sélective.
- Les contributeurs sont également priés de fournir une notice bibliographique dans laquelle sont mentionnées leurs publications les plus récentes ainsi que leur institution de rattachement.
- Les propositions sont à envoyer aux adresses suivantes : anis.nouairi@fshst.rnu.tn et cahiers.tunisie@fshst.rnu.tn
Calendrier
- Date limite pour l’envoi des propositions : 07 décembre 2025
- Réponse du comité de lecture : avant le 14 décembre 2025
- Envoi des articles complets, conformes aux normes de la revue (charte fournie aux auteurs retenus) : 28 février 2026
- Publication du numéro : juin 2026
Sélection des articles
Chaque proposition sera évaluée par le comité de rédaction des Cahiers de Tunisie (série Lettres et Langue) selon des critères de rigueur scientifique, d’originalité et de pertinence par rapport à la thématique du numéro. Nous espérons concevoir ce numéro 238 comme un espace de dialogue scientifique faisant intervenir des perspectives théoriques et des contextes géographiques divers.
[1] Patrick Charaudeau, Le Discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert, 2005, p. 35.
[2] Voir Ran Halévi, « L'ère de la post-vérité : la montée de l'individualisme et la communauté des vérités subjectives », in Charles Mercier, Jean-Philippe Warren et Régis Malet (dir.), Post-vérité : la crédibilité du discours scientifique à l'heure des réseaux sociaux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2025.
[3] Voir Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Turin, Einaudi, 1975.
[4] Voir Judith Butler, The Force of Nonviolence, Londres, Verso, 2020.
[5] Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, in Cary Nelson et Lawrence Grossberg (dir.), Marxism and the Interpretation of Culture, Londres, Macmillan, 1988.
Special Issue of Cahiers de Tunisie (No. 238)
Discourses of Domination: Texts, Arts, and Media.
The editorial board of Cahiers de Tunisie (Literature and Language Series) invites contributions for issue No. 238 of the journal, which will be dedicated to the theme Discourses of Domination: Texts, Arts, and Media.
To foster a deeper understanding of our societies, their inner workings, and their transformations, the editorial board seeks to align this issue of Cahiers de Tunisie with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Through this exploration of discourses of domination, we hope to contribute particularly to the advancement of SDG 5 (Gender Equality), SDG 10 (Reduced Inequalities), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).
“The discourse of ideas is constructed through the discourse of power, with the former addressing the problem of truth and the latter the problem of plausibility,”[6] writes Patrick Charaudeau in his essay Le Discours politique. In today’s so-called “post-truth”[7], discourses are more than ever subjected to power structures and ideological apparatuses. The controversy surrounding Ilan Pappé’s book The Ethnic Cleansing of Palestine, which was withdrawn from sale in 2023 by the publishing house Fayard, illustrates the extent to which dissenting voices are marginalized by dominant ones that seek to monopolize truth—even at the cost of censorship. These dynamics are shaped by what the Italian philosopher Antonio Gramsci[8] refers to as hegemonic discourses, which actively shape the perception of events. This phenomenon is particularly salient in a hyperconnected world where artificial intelligence technologies redefine both the circulation of established narratives and the mechanisms through which individuals come to adopt them.
At the intersection of literature, the arts, and language sciences, this issue aims to examine how hegemonic narratives influence our collective representations, establishing themselves as paradigms capable of undermining our ways of thinking. Contributors may also explore subversive counter-discourses, since any discourse has the potential to create spaces of resistance against dominant ideologies[9]. They will likely also engage with the concept of “subalternity,” as defined by Gayatri Chakravorty Spivak[10], since Subaltern Studies offer valuable insight into the processes of silencing to which the voices of the oppressed are subjected. “Subalterns” are often compelled to construct their counter-discourses from the margins—that is, within alternative media, literary, or artistic spaces— which are of relevance to this issue. The contributors’ work will fall under (but not be limited to) the following themes:
1. Literary and Artistic Representations
In both literature and the arts, creative works can either reproduce or subvert the hegemonic frameworks of dominant discourses. From colonial to postcolonial literature, from the visual arts to digital arts, creative expression stages the figure of the dominated as seen by the dominant—and vice versa. To study discourses of domination is to analyze the narratives of the powerful: how they are constructed, disseminated, and maintained. Similarly, the narratives of the oppressed draw on specific narrative and aesthetic strategies that may signal either resistance to or compliance with normative discourses—strategies that merit close examination.
2. Media and Propaganda
Long associated with authoritarian regimes and their machinery for mass manipulation, propaganda is more active than ever in the media, where partisan debates are rampant. The FIGNEWS Shared Task initiative—a research project on media discourse analysis and propaganda bias during the war in Gaza—demonstrates just how much digital media and the social networks that amplify them can shape public opinion. Content moderation policies on platforms like Facebook and X can suppress certain narratives while promoting others, often through predatory algorithmic systems.
3. Identities and Collective Narratives
Discourses of domination shape collective identities and structure shared memory. Official myths can drive national policies and lead populations to deny historical realities, often to the detriment of minority groups. School textbooks, national anthems, official commemorations, and institutions can all contribute to the construction of a selective—and therefore exclusive—collective memory, as social imaginaries are frequently founded on forms of segregation.
4. Gender and Male Domination
From a gender studies perspective, the masculinist discourse can be examined as a paradigmatic discourse of domination. While feminist movements aim to reframe inequality by deconstructing socially constructed roles, masculinist discourse seeks to essentialize them to perpetuate male dominance. Contributors might explore masculinism from a linguistic standpoint—analyzing patterns of dominance—as well as its androcentric and exclusionary logic. A socio-psychological approach could also shed light on the verbal, psychological, and physical violence tied to the rise of this reactionary movement.
5. Artificial Intelligence
Analyzing the discourses produced by artificial intelligence is also of significant interest. When machine learning algorithms are biased, language models can veer toward extreme positions—as highlighted in the recent case of the AI model Grok. At a time when major tech companies hold overwhelming monopolies over these technologies, it is worth interrogating the political and/or cultural biases embedded in the datasets used to train AI systems.
Submission Guidelines
- Researchers, instructors, and doctoral candidates (especially in literature, language, and media/art studies) are invited to submit original articles in Arabic, French, or English.
- Submissions may take the form of (but are not limited to) scholarly articles, critical analyses, or case studies.
- Proposals should be approximately 500 words in length and include: a title, the chosen thematic axis, a brief outline of the research question and methodology, and a selective bibliography.
- Contributors should also include a short biographical note listing their most recent publications and institutional affiliation.
- Proposals should be sent to both of the following addresses: anis.nouairi@fshst.rnu.tn and cahiers.tunisie@fshst.rnu.tn
Timeline
- Deadline for submission of proposals: December 7, 2025
- Notification of acceptance: By December 14, 2025
- Deadline for submission of full articles (in compliance with journal guidelines): February 28, 2026
- Publication of the issue: June 2026
Selection Process
Each submission will undergo peer review by the editorial board of Cahiers de Tunisie (Literature and Language Series), based on criteria of scholarly rigor, originality, and relevance to the thematic focus of the issue. With this 238th edition, the journal seeks to cultivate a space for intellectual exchange that embraces diverse theoretical frameworks and geographical perspectives.
[6] Patrick Charaudeau, Political Discourse: The Masks of Power, Paris, Vuibert, 2005, p. 3
[7] See Ran Halévi, “The Post-Truth Era: The Rise of Individualism and the Community of Subjective Truths,” in Charles Mercier, Jean-Philippe Warren, and Régis Malet (eds.), Post-Truth: The Credibility of Scientific Discourse in the Age of Social Media, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2025.
[8] See Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Turin, Einaudi, 1975.
[9] See Judith Butler, The Force of Nonviolence, London, Verso, 2020.
[10] Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, in Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, London, Macmillan, 1988.