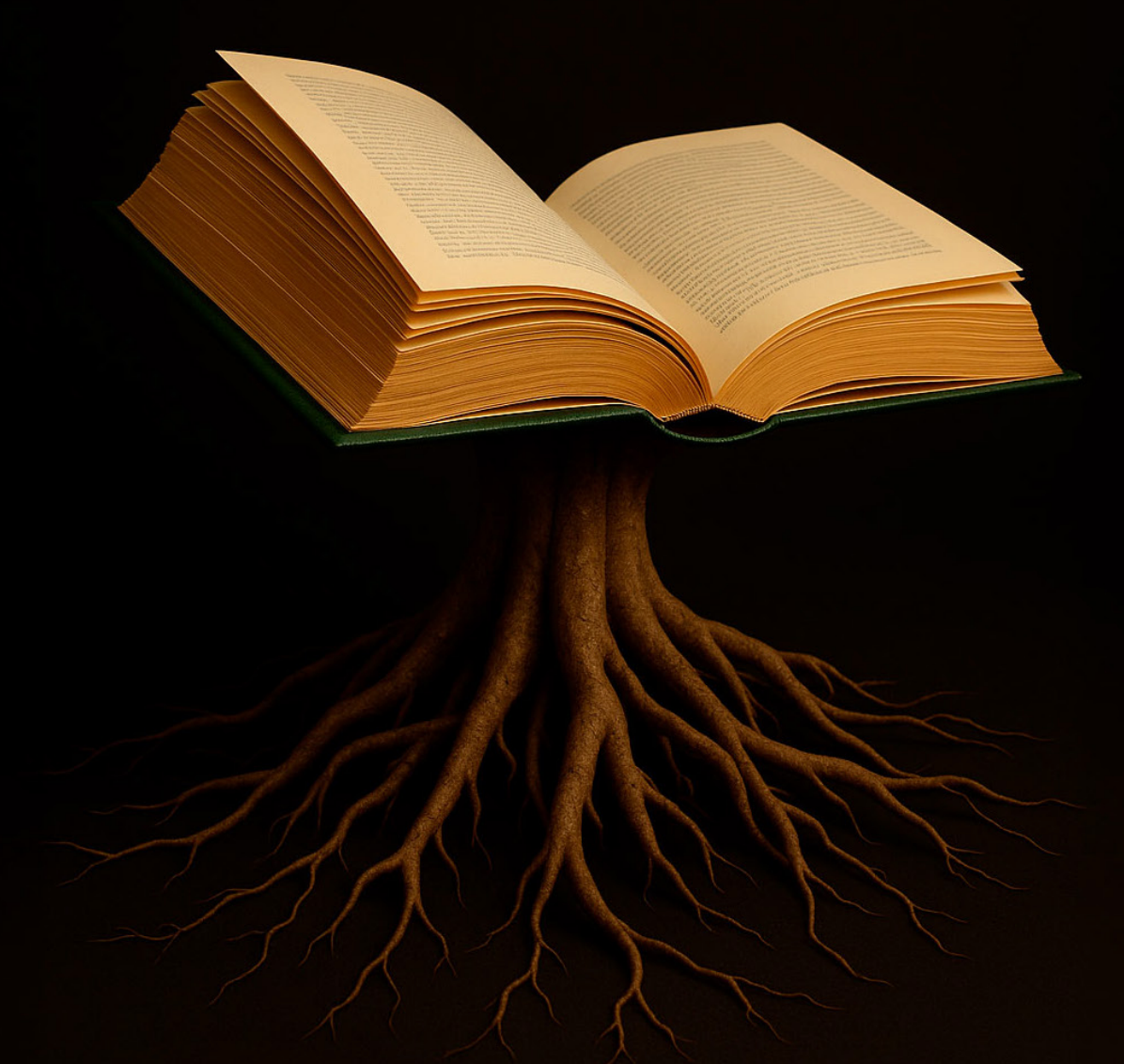
Le souci de la littérature : une pratique comparatiste
9e Congrès de l’APLC 2026
Faculté des Lettres de l’Université de Porto
15,16 et 17 juillet 2026
ILC – Université de Porto/Université des Açores
En 2003, Gayatri Chakravorty Spivak annonçait, dans un essai qui fit date (Death of a Discipline), la mort de la Littérature Comparée en tant que discipline littéraire telle que nous l’avions connue et pratiquée. Le titre semblait sans appel. Or, plusieurs chercheurs en littérature y ont plutôt lu un manifeste en faveur d’un renouvellement de la méthode comparée appliquée au fait littéraire.
En effet, Spivak y énonçait les contradictions du comparatisme traditionnel et occidental que la perspective mondialisée (Damrosch, 2003), privilégiée depuis quelque temps par la recherche en littérature, se proposait de résoudre et de dépasser par le biais d’un nouvel outillage critique axé sur l’importance renouvelée de la traduction, de la circulation et cartographie du texte lu (Moretti, 2005), du polycentrisme (Chakrabarty, 2000), et de la tension symbolique et historique entre le centre et la périphérie par une attention à l’hybridité, à la créolisation (Glissant, 1990), et à la décolonisation du canon (Bhabha, 1994 ; Spivak, 1999).
Vingt ans plus tard, force est de reconnaître que, non seulement les Études Comparatistes résistent, mais s’avèrent bel et bien une arme disciplinaire de résistance face aux apories de la littérature-monde et aux projets culturels fondés sur la prémisse globale.
Il convient de souligner que l’engagement premier du comparatisme est bien le souci de la Littérature en soi, en tant qu’épreuve de la complexité du monde. En effet, il est en soi une pratique de souci de la Littérature, toujours consciente du besoin d’ouverture à de nouveaux enjeux et aiguillages critiques.
Entretemps, le concept de care s’est imposé dans la pensée contemporaine (Tronto, 1993 ; Latour, 2006 ; Laugier, 2020 ; Fleury, 2019) comme approche du monde dont on dégage l’expression polysémique dans la recherche appliquée, notamment en littérature (soin, guérison, cure). Partant d’une perspective élargie du concept et de la pratique du care qui interroge le littéraire en tant que tournant éthique, épistémologique et social, ce colloque entend mettre l’accent sur le potentiel du littéraire en tant que savoir heuristique autre du monde dans la sphère publique, sa forte propension aujourd’hui à renouer avec l’engagement social sous forme d’agentivité, ainsi que sa capacité à imaginer, voire à enfanter des mondes à venir et en devenir.
En effet, le soin et la pratique du comparatisme ont partie liée dans le renouveau des attentions portées par la recherche en Littérature en tant qu’affirmation de la résistance de cette discipline qui se veut souci dans ses deux acceptions : attention et exigence. Comme l’affirme Frédérique Toudoire-Surlapierre (2022), « L’enjeu est moins de chercher à définir pour une n-ième fois la littérature comparée que de se demander pourquoi il est si important de savoir ce que l’on fait quand on compare ».
Raison pour laquelle la Littérature Comparée s’assure une nouvelle légitimité théorique et heuristique : elle ne vise pas seulement le potentiel différentiel de l’autre, mais pointe le sens inhérent à la pratique comparatiste, essentielle à la stabilité identitaire, et confère à cette discipline une vocation épistémique et un impact politique qu’on a pu vouloir lui nier. D’où ses accointances avec les ressorts du care.
Aussi, l’Association Portugaise de Littérature Comparée (APLC), par la coorganisation de l’ILC à l’Université de Porto et de l’Université des Açores, est-elle heureuse d’annoncer ce congrès international qui se tiendra à la Faculté des Lettres de l’Université de Porto, les 15,16 et 17 juillet 2026, et en raison duquel elle lance cet appel à communications aux chercheurs comparatistes que le souci de la Littérature en tant que pratique comparatiste interpelle, interroge, mobilise ou inspire.
Axes thématiques
1. Littérature Comparée dans le renouveau de la recherche en littérature ;
2. Littérature Comparée et éthique du care ;
3. Littérature Comparée et modalités et expressions de l’agentivité ;
4. Littérature Comparée dans la conception de mondes à venir et en devenir ;
5. Le canon, la traduction et la lecture littéraire comme résistance dans la pratique comparatiste ;
6. Littérature Comparée et Humanités Médicales ;
7. Littérature Comparée et fondamentaux anthropologiques (naître, grandir, transmettre, mourir) ;
8. Littérature Comparée et écosystèmes (Écocritique, Géocritique, Géopoétique, Humanités Environnementales).
—
Envoi de propositions
Les propositions de communication devront inclure les données suivantes : nom, institution de rattachement, notice biobibliographique (200 mots), titre, axe thématique retenu et résumé (250 mots, maximum).
Elles devront être envoyées à l’adresse électronique suivante : congressoaplc2026@gmail.com
Les communications admises ne dépasseront pas les 20 minutes.
—
Calendrier
28/02/2026 : date butoir pour l’envoi des propositions de communication
27/03/2026 : date limite pour la réponse du comité scientifique
01/05/2026 : date limite pour les inscriptions
22/05/2026 : diffusion du programme provisoire
—
Inscription
• Enseignants et chercheurs : (tarif préférentiel – du 28 mars au 17 avril 2026) 120,00 € | (tarif normal – du 18 avril au 1er mai 2026) 150,00 €
• Étudiants : (tarif préférentiel – du 28 mars au 17 avril 2026) 85,00 € | (tarif normal – du 18 avril au 1er mai 2026) 95,00 €
• Membres de l'APLC (du 28 mars au 1er mai 2026) : 60,00 €
Pour bénéficier du tarif membre de l'APLC, il est obligatoire d'envoyer, avant le 31 janvier 2026, la preuve du paiement des cotisations).
Modalités de paiement :
L'inscription et le paiement s'effectuent via ce lien: https://www.letras.up.pt/si/subscriptions?event=126
—
Comité d’Organisation
Maria Luísa Malato (Bureau APLC, U. Porto/ILC)
Fátima Outeirinho (U. Porto/ILC)
José Domingues de Almeida (U. Porto/ILC)
Dominique Faria (U. Açores/CHAM-NOVA-UAc).