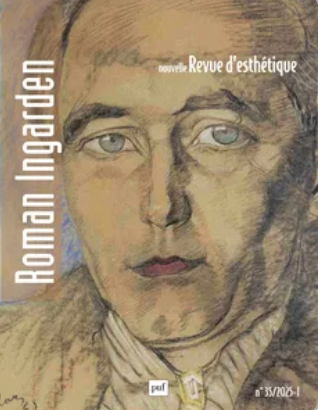
L’esthétique de Roman Ingarden constitue l’une des dernières grandes esthétiques phénoménologiques du 20esiècle. Elle se distingue par son ambition de penser la possibilité d’une théorie unifiée des arts. Sa démarche s’est inaugurée sur le terrain littéraire avec la publication de L’Œuvre d’art littéraire en 1921. Ce projet, fondamentalement ontologique, a trouvé son prolongement phénoménologique en 1937 avec La Connaissance de l’œuvre d’art littéraire qui, pour la première fois, donne une place centrale au lecteur et au spectateur, autrement dit, inaugure ce que l’on appelle désormais l’esthétique de la réception.
Anne Coignard, Connaître une œuvre littéraire : un idéal inaccessible ?
Michał Mrugalski, Ingarden incarné : l'inférence prédictive de la lecture chez Ingarden et dans les approches énactivistes de la cognition
Maxime Decout, Repenser la mauvaise lecture.
Bernard Gendrel, Entre œuvre d’art et objet esthétique : la théorie littéraire à la lumière d’Ingarden.
Adnen Jdey, Le problème du style dans l’esthétique phénoménologique d’Ingarden. Esquisse d’une reconstitution.
Justine Janvier, Lire et faire l’œuvre. Le rôle de la lecture chez Roman Ingarden et Luigi Pareyson
Pierre Fasula, Ingarden et l’Ut pictura poesis (ou le système des arts)
Olivier Malherbe, L’artiste et ses œuvres : anatomie de la rencontre créatrice selon Ingarden.
Jean-Marie Schaeffer, L’adaptation cinématographique des œuvres littéraires
Anastasiia Cherepanova, L'utilisation des théories de Roman Ingarden dans l'adaptation cinématographique du roman de Romain Gary « La promesse de l’aube ».
Edward Swiderski, Ontologie et/ou esthétique de la musique ? La quête de Roman Ingarden.
Maud Pouradier, L’impensé de l’opéra chez Roman Ingarden.
Isabelle Barbéris, Faut-il condamner l’infidélité du metteur en scène ?