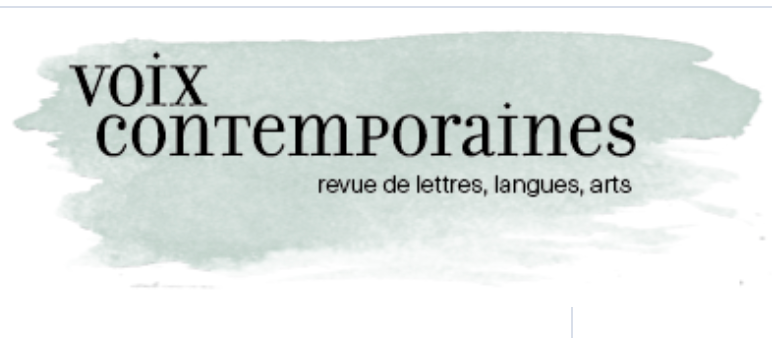
“À quatre mains”. Co-création et modulations du geste artistique dans la création contemporaine (revue Voix Contemporaines)
“À quatre mains”.
Co-création et modulations du geste artistique dans la création contemporaine
Voix Contemporaines n° 7, 2026, dir. Morgane Kieffer et Frédéric Martin-Achard
Toute une veine de la théorie et de la critique est tournée, depuis le début du siècle, vers les pratiques intermédiales et l’importance accrue des échanges entre disciplines et pratiques artistiques au sein de la création contemporaine, en lien avec divers héritages issus du vingtième siècle comme de traditions plus anciennes. Ce 7e numéro de Voix contemporaines s’inscrit dans ce sillage critique et théorique, mais voudrait s’en distinguer en mobilisant ces outils pour penser plus spécifiquement les pratiques de co-création, entendue comme “toute activité conduisant à la création d’une œuvre commune” (Goudinoux 2018: 11). Les créations à quatre mains (artistique, littéraire ou en recherche-création, intermédiales, transdisciplinaires ou non), qu’elles résultent d’un compagnonnage au long court ou de collaborations ponctuelles au sein d’une œuvre unique ou d’un projet, et les collectifs, pérennes comme éphémères, constituent autant d’objets que l’on pourra étudier ici. L’horizon privilégié pour ce numéro relève ainsi de la “transdisciplinarité[1]”, par opposition avec d’autres pratiques caractérisées elles soit par la multidisciplinarité, la pluridisciplinarité ou l’interdisciplinarité, selon un degré croissant d’interpénétration des pratiques.
La réflexion pourra se déployer dans au moins trois perspectives, non exhaustives: socioéconomique, esthétique, et sociale. On pense à différents formats et types de réalisation: des productions issues de commandes et résidences, dont il s’agira d’interroger aussi bien les conditions matérielles de création, les intentions et la visée, et le résultat en lui-même selon une perspective esthétique. La collaboration inter-artistique, voire intermédiale, peut-elle être étudiée comme une injonction caractéristique de l’époque actuelle? On pourra s’intéresser aux productions co-créées par des collectifs institutionnalisés ou occasionnels : par exemple, Une chic fille (2008), roman écrit à 26 mains au sein du collectif Inculte, le Studio Venezia (2017) de Xavier Veilhan avec de nombreux musiciens pour la Biennale de Venise, Light Turbulences (2025), EP de poésie sonore unissant les poètes Jérôme Game et Jean-Michel Espitallier à DJ Chloé, ou Dojo Sisters (2024), qui rassemble les musiciennes Isabelle Duthoit, Fanny Meteier, la chorégraphe Anna Chirescu et la plasticienne-performeuse Violaine Lochu pour une création multiforme (vidéo-performance, installation sonore et lumineuse, série de capes-partitions), qui croise l’univers des arts martiaux, l’écriture musicale et l’histoire des suffragettes, pour interroger le sport comme pratique d’empowerment et de collectivité.
On pourra également étudier l’héritage de l’activisme (à la suite des collectifs engagés dans la lutte contre le sida dans les années 1980-1990, tels que General Idea ou Gran Fury), questionner l’actualité du collectif dans un espace mondialisé (Honf en Indonésie ou Aldeia Gentil au Brésil par exemple), ou son imaginaire (les références au Bauhaus et au Black Mountain College chez Veilhan, ou le projet The Atlas Group, centre de recherche inventé par Walid Raad). Les créations issues de duo pourront être envisagées puisque, contrairement à l’effet souvent produit par les collectifs, les noms des artistes ou auteur·rices y figurent explicitement et les oeuvres ont un statut co-signé (par distinction avec le précédent exemple, au sein du collectif Inculte, Maylis de Kerangal et Joy Sorman signent bien de leurs deux noms le roman Seyvoz, 2022). Les collaborations entre artistes issu·es d’une même discipline (Fischli et Weiss, Pierre et Gilles, Bernd et Hilla Becher, Gilbert et George, Garcin et Viel dans Travelling en 2019, ou Garcin en collaboration avec Faye; celle entre Joël Pommerat et Marion Boudier, issus chacun du théâtre quoique leurs affinités se distribuent respectivement du côté de la pratique et de celui de la théorie), ou les duos transdisciplinaires (Sophie Calle et Paul Auster; les nombreuses collaborations de Christophe Fiat avec des artistes plasticiens, dont Thomas Hirschhorn et Massimo Furlan ; Cerith Wyn Evans et Throbbing Gristles en 2008 ; Mathieu Pernot et Philippe Artières, Annie Ernaux et Marc Marie, ou le compagnonnage entre Valère Novarina et Céline Schaeffer d’un côté, Olivier Cadiot et Rodolphe Burger de l’autre).
Les travaux réalisés en partenariat entre artistes et artisans pourront aussi attirer notre attention, que ceux-ci s’inscrivent dans une logique d’accompagnement commercial sur l’initiative de marques (par exemple la commande adressée par Nike aux designer et artiste Loris Gréaud and Mathieu Lehanneur pour célébrer la nouvelle technologie “Flywire” de la marque, en 2009), dans une logique de valorisation du patrimoine et/ou de commande institutionnelle (par exemple les vitraux réalisés pour l’Abbatiale de Conques par Soulages et Fleury, ou la chapelle San Pere à Palma de Majorque réalisée par Miquel Barceló en 2007 toujours avec la collaboration de Fleury pour les vitraux), dans un élan personnel ou pour répondre à des besoins spécifiques liés à la confection d’artefacts ou à la maîtrise d’outils numériques, robotiques ou d’intelligence artificielle.
La collaboration artistique pourra aussi s’entendre dans un sens plus large, in absentia, où la collaboration intervient moins explicitement lorsque paraît l'œuvre, mais est partie prenante de son élaboration. C’est le cas par exemple de Sur le fil (Verticales, 2025), dernier texte d’Olivia Rosenthal écrit à partir d’entretiens avec différents funambules, dont Chloé Moglia avec qui par ailleurs Rosenthal a créé plusieurs performances par le passé. La collecte de voix ici prend un relief particulier puisqu’elle prend en charge un autre langage artistique, issu des pratiques circassiennes, et engage d’autres enjeux que les précédents livres de Rosenthal bâtis à partir du même principe. Le cas d’Olivia Rosenthal est riche par ailleurs de nombreuses formes de collaborations trans- et intra-disciplinaires, puisque de multiples rencontres artistiques ont nourri au fil du temps son activité créatrice: cinéastes (Olivier Ducastel, Laurent Larivière), écrivains (Denis Lachaud, Michaël Batalla, Patrick Chatelier), chorégraphes (Chloé Moglia) ou encore musicien (Eryck Abecassis). On pourra penser aussi à l’une des dernières pièces de Hakim Bah (Sortir par la porte. Une tentative d’évasion, 2023, écrit pour et avec l’artiste circassien Juan Ignacio Tula, avec qui Bah avait déjà proposé un «Sujet à Vif» à Avignon (Pourvu que la mastication ne soit pas longue, 2021), ou Misandra, 2025, écrit en lien avec un judoka professionnel). La rencontre, alors, se situe moins dans le processus de création lui-même qui n’est collectif que durant sa genèse que dans l’intégration par l’écriture d’une autre pratique artistique et du langage propre d’un autre artiste.
Ce sont ainsi les modulations du geste artistique dans sa plasticité et sa dimension collective que se propose de mesurer ce numéro de la revue, selon plusieurs approches possibles :
● Étude des protocoles d’écriture inter-artistique: d’un point de vue génétique, comment de telles collaborations se mettent-elles en place? un intérêt particulier sera porté à la question de la temporalité du travail collectif, que celui-ci soit simultané ou en différé, portant alors l’intérêt sur le degré de fusion et d’interconnexion du geste.
● Étude des conditions matérielles de la création collective: le champ de la commande est-il particulièrement propice à ce type de partenariat? Existe-t-il, dans les arts comme dans tant d’autres domaines (conception culturelle, projets scientifiques ou académiques) une tendance à favoriser la création collective, voire l’interdisciplinarité pour elle-même?
● Analyse esthétique des croisements et éventuels déplacements induits par de telles pratiques (inflexions stylistiques ou génériques; changements matériels du support de création: typographie, objet final, composition, etc; inflexion esthétique et influence de plus long terme sur la pratique de l’un ou l’autre des partenaires).
● Comment l’écriture prend-elle en charge le corps et la corporéité du geste artistique qu’elle cherche à retranscrire ? Comment, le cas échéant, cette altérité artistique est-elle thématisée ?
● Comment ces pratiques nous invitent-elles à déplacer la notion d’auctorialité, d’une part, et toute une axiologie moderne de la pratique artistique fondée sur la notion de singularité, d’autre part?
● Dans une perspective sociologique, on réfléchira au fonctionnement de l’institution littéraire et aux processus de canonisation ou de patrimonialisation de l’art que ces pratiques infléchissent éventuellement. Quel accueil ces pratiques et objets hybridés rencontrent-ils auprès du public large, d’une part, mais aussi au sein des instances de valorisation de l’institution?
Un intérêt particulier sera porté aux propositions de contributions collectives, voire pluridisciplinaires également, pour ce numéro qui permettrait ainsi d’associer un geste critique à l’objet d’étude retenu.
—
Les propositions d’articles d’un maximum de 500 mots, assorties d’une brève bio-bibliographie sont à envoyer avant le 1er décembre 2025 inclus à morgane.kieffer@univ-st-etienne.fr et frederic.martin.achard@univ-st-etienne.fr. Les réponses seront notifiées mi-décembre.
En cas d’acceptation, les articles seront à rendre pour le 1er avril 2026. Les articles feront l’objet d’une évaluation par les pairs en double aveugle, selon les statuts de la revue.
Le numéro paraîtra mi-novembre 2026.
—
Bibliographie indicative
Alavoine Bernard, Benhamou Noëlle, Lemonnier-Delpy Marie-Françoise (dir.), Écrire à quatre mains (XIX-XXIe siècles), Amiens, Artois Presses Université, coll. «Littérature et arts», 2025.
Audet René et Lahouste Corentin (dir.), “Arts littéraires et reterritorialisations textuelles”, Études littéraires, vol. 53, n° 3, 2024.
Audi Paul, Terreur de la peinture, peinture de la Terreur. Sur Les Onze de Pierre Michon, Bordeaux, William Blake and Co, 2015.
Autant-Mathieu Marie-Christine (dir.), Créer ensemble. Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe-XXe siècles), Lavérune, L’Entretemps, 2013.
Baetens Jan et Lits Marc (dir.), La Novellisation/Novelization. Du livre au film/From Film to Novel, Leuven (Belgique), Leuven University Press, 2004.
Baetens Jan, « La novellisation, un genre contaminé », Poétique, n° 138, 2004, p. 135-151.
Baud Jean-Marc, Inculte. Collectif littéraire, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. “perspectives”, 2023.
Bessière Jérôme et Payen Emmanuèle, Exposer la littérature, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2015.
Blanckeman Bruno et Brun Catherine (dir.), “Romans et chansons”, Revue des Sciences Humaines, n° 348, 2022.
Blay Philippe, Branger Jean-Christophe, Fraisse Luc, Marcel Proust et Reynaldo Hahn - Une création à quatre mains, Paris, Clasiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n°21, 2022.
Caffari Marie et Mohs Johanne, « Écritures contemporaines et processus dialogiques », A contrario, 27 (2), 2018, 3-20. En ligne : https://doi.org/10.3917/aco.182.0003.
Chiarelli Cosimo et Noirot Julie (dir.), “Photographie et arts de la scène”, Focales, n° 3, 2019. En ligne: http://journals.openedition.org/focales/552.
Cléder Jean, Entre littérature et cinéma. Les affinités électives, Paris, Armand Colin, 2012.
Clerc Jeanne-Marie, Écrivains et cinéma. Des mots aux images, des images aux mots, Klincksieck, 1985.
Demoulin Esther, Beauvoir et Sartre. Écrire côte à côte, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2024.
Demoulin Esther et Baud Jean-Marc, Séminaire "Co-écrire et collaborer en littérature (XXeXXIe siècles)", université Paris Cité, 2024-2025.
Desclaux Jessica, Gervais Bertrand, Lahouste Corentin, Reverseau Anne, Scibiorska Marcela (dir.), Iconothèques. Collecte, stockage et transmission d’images chez les écrivains et les artistes (XIXe-XXIe siècle), Rennes, PUR, 2025.
Donin Nicolas et Ferrer Daniel (dir.), « Créer à plusieurs mains », Genesis, n°41, Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 2015.
Dozo Björn-Olav et Ellena Laurence (dir.) « De l’émergence à la canonisation », COnTEXTES 17, 2016. En ligne : http://journals.openedition.org/contextes/6209.
Dubois, Jacques, L’institution de la littérature, introduction à une sociologie, Bruxelles, Bernand Natnan/Éditions Labor « Dossiers media », 1978.
Dumont Fabienne, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970, Rennes, PUR, coll. « Archives du féminisme », 2014
Farron Ivan et Kürtös Karl (éd.), Pierre Michon entre pinacothèque et bibliothèque, Berne, Peter Lang, coll. “Variations”, volume 4, 2003.
Gaité Florian, « Collaborations et co-créations pluridisciplinaires », dans Goudinoux Véronique (dir.), Collaboration et co-création entre artistes des années 1960 à nos jours, Paris, Canopé, 2018, p. 45-57.
Gaité Florian, Tout à danser s’épuise : essais critiques, Aurillac, Sombres Torrents, 2021.
Glinoer Anthony et Lacroix Michel (dir.), La Littérature contemporaine au collectif, Fabula/Les colloques, 2020. En ligne : https://doi.org/10.58282/colloques.6671.
Glinoer Anthony, Les classiques littéraires. Introduction à une sociologie, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, coll. “Espace littéraire”, 2025.
Goudinoux Véronique (dir.), Collaboration et co-création entre artistes des années 1960 à nos jours, Paris, Canopé, 2018.
Goudinoux Véronique, Oeuvrer à plusieurs. Regroupements et collaborations entre artistes, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015.
Green Charles, The Third Hand. Collaboration in Art from Conceptualism to Postmodernism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2011.
Gris Fabien, Images et imaginaires cinématographiques dans le récit français (de la fin des années 1970 à nos jours), thèse de doctorat, université Jean Monnet, 2012.
Hirschi Stéphane (dir.), Les Frontières improbables de la chanson, Valenciennes, CAMELIA, 2001.
Lafon Michel et Peeters Benoît, Nous est un autre : enquête sur les duos d’écrivains, Paris, Flammarion, 2006.
Mara De Wachter Ellen (dir.), Co-Art: Artists on Creative Collaboration, Londres, Phaidon, 2017.
Margras Fanny et Ferrero Corinne (dir.), “Écrire (et penser) ensemble, (Nouveaux) enjeux théoriques, génétiques, éthiques et politiques de l’écriture en collaboration”, Continents manuscrits. Génétique des textes littéraires - Afrique, Caraïbe, Diaspora, n° 25, 2025. https://doi.org/10.4000/14kt3
Marguin Séverine, Collectifs d'individualités au travail: les artistes plasticiens dans les champs de l’art contemporain à Paris et à Berlin, Rennes, PUR, coll. “Arts contemporains”, 2019.
Menger Pierre-Michel, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, coll. “La République des idées”, 2002.
Mougin Pascal, La Tentation littéraire de l’art contemporain (dir.), Dijon, Les presses du réel, coll. « Figures », 2017.
Nachtergael Magali et Reverseau Anne, Un monde en cartes postales : cultures en circulation, Marseille, Le Mot et le Reste, 2002.
Passeron René (dir.), La Création collective, Paris, Clancier-Guénaud, 1981.
Pluvinet Charline, « Écritures en partage dans la littérature contemporaine : un geste de confiance », Fabula/Les colloques, « Fiducia (II). Matter of Trust/Question de confiance », 2024. En ligne : https://www.fabula.org/colloques/document12721.php.
Sauvageot Anne, Le Partage de l’œuvre. Essai sur le concept de collaboration artistique, Paris, L’Harmattan, 2020.
Vouilloux Bernard, La Peinture dans le texte. XVIIIe-XXe siècles, Paris, CNRS éditions, 1995
— L'Art des Goncourt. Une esthétique du style, L’Harmattan, 1997.
— Langages de l’art et relations transesthétiques, Paris, Ed. de l’éclat, 1997.
[1] Florian Gaité distingue quatre régimes : la multidisciplinarité “réunit des productions d’artistes qui évoluent dans un même champ disciplinaire global mais dont les techniques diffèrent localement”, la pluridisciplinarité “regroupe des coopérations fondées sur un partage clair entre les disciplines et le respect de leurs spécificités respectives”, l’interdisciplinarité qui suppose la mise en place d’une méthodologie commune et, enfin, la transdisciplinarité qui “la confusion des disciplines dans une coopération qui se place au-delà des différences entre disciplines, inaugurant des œuvres transitives et protéiformes”. (Gaité 2018: 45-46).