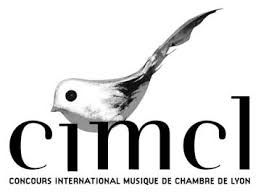
Journée d’étude dans le cadre du Concours International de Musique de Chambre de Lyon
Le mercredi 15 avril 2026 à Lyon,
Université Lumière Lyon 2, site des Berges du Rhône
Quand les arts s’emparent de la musique de chambre / Quand la musique de chambre s’empare des arts
Le département de Musique et musicologie de l’Université Lumière Lyon 2 a établi un partenariat privilégié avec le Concours International de Musique de Chambre de Lyon. Il organise, depuis sa création en 2004, une journée d’étude annuelle qui se tient pendant le Concours, ainsi que d’autres actions de médiation pédagogique en marge des épreuves. Jusqu’en 2018, les manifestations scientifiques se sont intéressées à l’effectif mis chaque année à l’honneur par la compétition et ont permis la publication de plusieurs volumes sur les genres et les répertoires de la musique de chambre tels que le quatuor à cordes, le trio avec piano, le quintette à vent, le duo violon et piano, le duo violoncelle et piano, le duo voix et piano, etc. (éditions Symétrie, Université de Lyon et Microsillon). Les éditions des années 2020 ont été organisées autour d’une thématique transversale sur l’histoire de la musique de chambre, en insistant sur les questions d’institutions et d’interprétation (édité en 2024 chez Symétrie), ou bien sur les notions d’homogénéité et d’hétérogénéité dans l’écriture propre au genre (volume à paraître). En 2025, la journée était de nouveau consacrée à l’effectif à l’honneur (voix-piano) avec cette thématique : « Le répertoire pour piano et voix : féminin et masculin ».
Pour l’édition 2026 du CIMCL, consacrée au quintette à vent, le comité d’organisation de la journée d’étude souhaite mener une réflexion plus transversale et interartistique, sur la manière dont les arts (littérature, poésie et théâtre, cinéma, arts plastiques…) incluent une représentation de la musique de chambre, et réciproquement sur les possibles emprunts que celle-ci fait de références et de gestes artistiques.
Devant la quasi absence d’études sur le sujet, les champs de prospection restent largement ouverts, mais devront se limiter au répertoire de musique de chambre sans texte chanté, dans la sphère de la musique occidentale savante (pas d’instrument seul, pas d’ensemble supérieur à une dizaine d’instruments). La musique pour un seul instrument mais plusieurs instrumentistes (par exemple le piano à quatre mains) pourra être étudiée. On veillera également à exclure toute attitude créatrice de type biographique/biopic ou documentaire.
Les propositions pourront s’intéresser aux questionnements qui suivent, sans limitation, soit de manière diachronique, soit en ciblant un répertoire précis. L’éventuelle réciprocité (plus ou moins équilibrée) des rapports entre la musique de chambre et les différents arts pourra être étudiée au sein d’une même communication.
Les deux orientations du sujet (notamment la première) permettent des propositions provenant de champs autres que la musicologie : l’Histoire de l’art, les études littéraires, les études cinématographiques. Pour la deuxième orientation, plus directement musicale, les soumissions d’interventions par des compositeurs seront les bienvenues, en plus de celles des musicologues.
1. Quand les arts s’emparent de la musique de chambre
Le propos devra traiter d’oeuvres où, soit la représentation (plastique, littéraire, cinématographique, scénique) évoque l’exercice des musiciens (qu’il s’agisse du thème principal de l’œuvre ou pas), soit la musique de chambre est intégrée sans représentation, mais avec un rôle si important qu’elle peut se substituer à un réel personnage (notamment
dans les productions audio-visuelles). Il faudra ainsi veiller à ne pas choisir des oeuvres cinématographiques dont la bande musicale emprunte au répertoire de musique de chambre, si celle-ci n’est pas représentée de manière diégétique ou bien ne joue pas un rôle crucial pour la narration.
Dans le domaine des arts plastiques, il faudra également écarter les oeuvres dans lesquelles l’instrument de musique est seulement porteur d’un symbole (dans l’art mythologique, dans les vanités, par exemple), qui n’a alors aucun lien avec le genre de la musique de chambre, comme dans de nombreuses peintures antérieures au XVIIe siècle.
Les propositions pourront ainsi, par exemple, répondre aux sujets suivants :
- quelles sont les raisons poïétiques de l’emprunt à la musique de chambre (biographiques ?
anecdotiques ?) ?
- ces emprunts sont-ils le reflet, par le type de représentation des musiciens et musiciennes, de configurations sociétales ? (musiques de cour, de salon…)
- le goût de la référence particulière à un genre intimiste qu’incarne la musique de chambre trahit-il des esthétiques particulières – avec par exemple l’apparition de l’expression « cinéma de chambre » ? Pourquoi choisir d’emprunter précisément à la musique de chambre et pas à
un autre genre musical ?
- l’emprunt à la musique de chambre influe-t-il le langage utilisé ?
- quelles sont les configurations instrumentales de musique de chambre les plus souvent
utilisées ? Les ensembles de vents, par exemple, ne sont-ils pas beaucoup moins représentés que les ensembles de cordes ?
Exemples d’oeuvres (liste non exhaustive) :
Littérature : Proust, James Joyce (Musique de chambre), Tolstoï (Sonate à Kreutzer), Thomas Mann, Romain Rolland, André Gide…
Arts plastiques : Véronèse (Les Noces de Cana, 1563), Brueghel l’Ancien (L’Ouïe, 1618), Vermeer (Concert à trois, 1664), Turner (Soirée intime de musique à Petworth, 1835), Auguste Renoir (Petites filles à la leçon de musique, 1892), Kandinsky, (Impression III, Concert, 1911), Henri Haydn (Les Trois musiciens, 1920), Picasso (Trois musiciens, 1921), Raoul Dufy (Le Concert orange, 1948), Nicolas de Staël, Joan Mitchell (Quatuor II pour Betsy Jolas, 1976), Luciano Ori (Fantasia Cromatica, 1986), Aldo Mondino (série des Quatuors à cordes), Marie-Gabrielle Thierry (Le Parc, sur le Quatuor à cordes de Bruckner, 2010)
Cinéma : Chaplin-Keaton (Les feux de la rampe, 1952), Rohmer (Ma nuit chez Maud, 1969), Blier (Buffet froid, 1979), Godard (Prénom Carmen, 1983), Tony Scott (The Hunger, 1983), Sautet (Un coeur en hiver, 1992), Raoul Ruiz (Le Temps retrouvé, 1999), Bergman (Sarabande,
2003), Desplechin (Rois et Reines - 2004), Yaron Zilberman (Le Quatuor, 2012), Julia Kowalski (Musique de chambre, 2012), Grégory Magne (Les musiciens, 2024).
Pistes bibliographiques :
Bosseur, Jean-Yves, Musique, passion d’artiste, Genève, Skira, 1991.
Bosseur, Jean-Yves, Musique et arts plastiques, Interactions au XXe siècle, Paris, Minerve, 1998.
Gétreau, Florence, Voir la musique, Paris, Citadelles & Mazenod, 2017. Regarder en particulier les chapitres suivants : « Musiciens de profession et musiciens de cour », « portraits de dilettantes, « ensembles domestiques », « Salons et ateliers »
Junod, Philippe, La musique vue par les peintres, Lausanne, Vilo, 1988.
Junod, Philippe, Contrepoints, Dialogues entre musique et peinture, Genève, Contrechamps, 2006.
Parrat, Jacques, Des relations entre la peinture et la musique dans l’art contemporain, Nice, Z’éditions, [s.d.].
Thierry, Marie-Gabrielle, « La musicalité du paysage en peinture : Le Parc, sur le quatuor à cordes de Bruckner, in Florence Collin (dir.), Musique et arts plastiques : hommage offert à Michèle Barbe, Université de Paris-Sorbonne, Série Musique et Arts Plastiques, 2011, p.117-121.
Vivès, Vincent, La musique, anthologie littéraire et philosophique, Paris, Buchet Chastel, 2011.
Törnqvist, Egil, “Le rôle de la musique dans l’oeuvre cinématographique d’Ingmar Bergman”, Bulletin de liaison des adhérents de l’AFAS n° 31, été-automne 2007, p. 2-16.
2. Quand la musique de chambre s’empare des arts
Cette perspective est plus délicate, pour plusieurs raisons. Une recherche rapide sur la toile internet montre qu’on parle plus aisément des arts qui empruntent à la musique – parce que son mode d’expression est précisément et sémiotiquement non représentatif et très suggestif – que de la musique qui s’empare des arts. D’autre part, en musique, l’emprunt aux autres arts n’est pas réservé à la musique de chambre. Néanmoins, afin que la journée soit également marquée par une démarche musicologique et aussi parce que le répertoire existant possède un intérêt encore peu étudié, le comité d’organisation souhaite solliciter des communications sur cette réciprocité. De plus, l’emprunt à la peinture, au cinéma, à la littérature …, dans un art détaché du signifié précis (la musique), incite le compositeur à réfléchir sur le langage. Ainsi, en plus des questions d’ordres biographiques ou sociétales posées en première partie (sur le choix de telle ou telle référence), il sera possible de réfléchir sur la manière dont le langage et l’écriture manifestent (de manière latente ou ostensible) la référence artistique précise, à l’intérieur même d’un contexte de musique de chambre. Sont-ce les formes, les couleurs, la singularité poétique, le sujet de l’histoire ou du scénario, les particularités du montage… de l’oeuvre de référence qui ont intéressé le compositeur ? Où est-ce aussi la tentation de la spatialisation ? de la narration, dans un genre de musique « pure » ?
Exemples d’emprunts dans la musique de chambre :
- aux arts plastiques : Antoine Tisné (Etudes d’après Maurice Denis), Pierre Boulez (Le Livre),
Nono (Fragmente-Stille, an Diotima), Hugues Dufourt, Roger Tessier, Saariaho (Nymphea, quatuor à cordes), Salvatore Sciarrino, Francis Miroglio, Frédéric Durieux (Here, not There - A Tribute to Barnett Newman (2004-2007)), Graziane Finzi, Philippe Schoeller.
- à la littérature : Janacek (1er Quatuor Sonate à Kreutzer), Joseph Holbrooke, Herbert Howell, Schoenberg (La Nuit Transfigurée)
- au cinéma : ?
Pistes bibliographiques :
Bosseur, Jean-Yves, Musique et arts plastiques, Interactions au XXe siècle, Paris, Minerve, 1998.
Cobbett, Walter Wilson, Dictionnaire encyclopédique de la musique de chambre, Paris, Robert Laffont, 1999.
Delannoy, Sylvine, « Influence d'un modèle littéraire dans la musique de chambre de Schumann : le Märchen » Trajectoires - Travaux des jeunes chercheurs du CIERA, 2007, 1, pp.111-122. https://shs.hal.science/halshs-00250325v1
Grivel, Delphine, Maurice Denis et la musique, Lyon, Symétrie, 2011.
Tranchefort, François-René (dir.), Guide de la musique de chambre, Paris, Fayard, 1989.
Von der Weid, Jean-Noël, Le flux et le fixe, peinture et musique, Paris, Fayard, 2012.
—
Les propositions (environ 500 mots), accompagnées d’un CV, devront être envoyées avant le 10 décembre 2025 à
Céline Carenco (celine.carenco@univ-lyon2.fr)
Muriel Joubert (muriel.joubert@univ-lyon2.fr).
Les laboratoires Passages XX-XXI Lettres et Arts, IHRIM et le Département Musique et Musicologie de Lyon 2, ainsi que le CIMCL (https://www.cimcl.fr/) sont partenaires de cet événement scientifique.