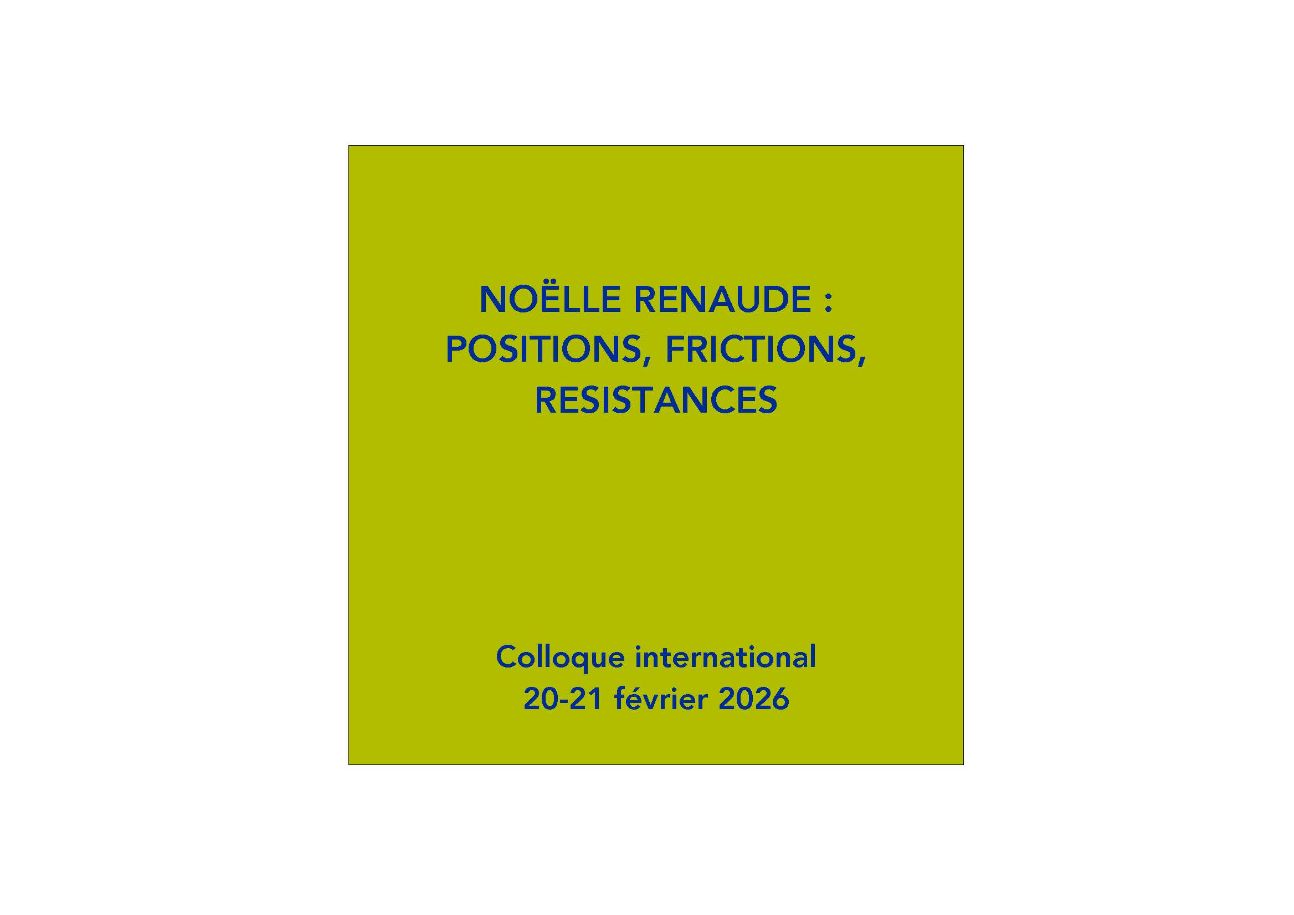
Noëlle Renaude : positions, frictions, résistances
Colloque international, 20-21 février 2026
Lieux : Théâtre Ouvert / Université Sorbonne Nouvelle (Paris)
Propos
Profondément réfractaire aux formules définitives, l'oeuvre protéiforme de Noëlle Renaude déjoue les codes, bouscule les frontières, renverse les points de vue, met à mal les hiérarchies, sans se soucier du raisonnable ni des convenances – et ce, à toutes les échelles et dans toutes les composantes de l’écriture : la phrase, le personnage, la fable, le livre, la scène. Cette échappée hors des normes, cette propension à se soustraire aux attentes et aux repères établis, font à la fois la singularité de cette oeuvre et sa nécessité.
Se caractérisant, en premier lieu, par un mouvement de renouvellement continu, par un désir insatiable d’interroger les moyens, les modes et les enjeux de l’art en général et du théâtre en particulier, cette oeuvre se distingue, simultanément, par quelques tendances prégnantes. De texte en texte, c’est un monde sans message ni grands discours qui se déploie, peuplé de figures à la fois étranges et familières dont Noëlle Renaude met en scène – avec une forme de crudité, d’humour et de tendresse mêlés – les lâchetés, les arrangements, les mesquineries ordinaires, mais aussi, les étonnements, les angoisses, les peines et les joies. Dans cette oeuvre tout entière tournée vers le travail des sons et de la syntaxe, les puissances de la parole et la fabrique de l’oralité, il se trouve que les êtres et les histoires auxquels l’auteure donne forme ne constituent jamais un enjeu ni un moteur de l’écriture. Ils n’en sont pas moins l’une des sources du plaisir – ou de la méfiance – que son oeuvre peut susciter.
Parfois à ses dépens, au risque des méprises ou des contresens, Noëlle Renaude a le goût du paradoxe : son écriture cultive l'inconciliable, elle joue du contradictoire, procède avec une forme d’insolence, sans fards et sans ménagements, et continue d’évoluer par impasses, crises, impossibilités successives.
S’aventurant à la lisière de ce qui est acceptable pour le livre, la scène, le roman ou le poème, ne jouant du reconnaissable que pour mieux l’inquiéter, Noëlle Renaude place ses lecteurs et lectrices à l’endroit où les savoir-faire vacillent, où les outils de travail éprouvés perdent de leur efficience, et où il faut, partant, les interroger, adapter, renouveler.
Poussées scénaristiques et topographiques, champs d’expérimentation qui dérangent les routines dramaturgiques en interrogeant la frontière entre les genres, leur mixité, assemblage des contraires, éclipses du personnages, marathons verbaux, jeu sur les calibres, réécritures, mise en question de l’oralité, situations déjouées, enquêtes sans mobiles, paysages évanescents, jeux typographiques… : cette grande entreprise de démantèlement des normes et des canons, où s’agrègent une multiplicité de gestes, fait de l’écriture de Noëlle Renaude un chantier poétique et esthétique dont il importe d’interroger les singularités et les obsessions, les endroits de clivage ou de résistance, les puissances de transformation.
Étrangeté de l’histoire, l’oeuvre de Noëlle Renaude, malgré son envergure et son inventivité n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune monographie : exception faite de l’ouvrage collectif dirigé par Michel Corvin, Noëlle Renaude, atlas alphabétique d'un nouveau monde (Théâtrales, 2010), elle n’a été examinée qu’à la faveur de chapitres ou de contributions épars. Ce vide relatif est insolite au regard d’une production foisonnante – 38 pièces (dont des créations radiophoniques), une centaine de romans alimentaires pour la revue Bonne soirée, une traduction (La Source des saints, de J. M. Synge, 2018), un livret pour un spectacle de lanterne magique (Faust magicien, 2018), un roman biographique (P. M. Ziegler, peintre, 2022), deux romans noirs dont l’un primé (Les Abattus, Rivages, coll. « Noir », 2021 prix « Transfuges » du meilleur polar francophone ; Une petite société, Rivages, coll. « Noir », 2022) ; des incursions dans le poème (Se délier la langue, Avignon 2023) – et il contraste avec la reconnaissance dont Noëlle Renaude peut par ailleurs jouir dans les milieux artistiques et académiques. Régulièrement jouée, invitée pour intervenir dans des écoles d’art ou à l’université (École nationale supérieure d’arts de Cergy, Haute École des Arts de la Scène de Lausanne, Sorbonne Nouvelle…), elle a été faite, en 2021, Commandeure de l’ordre des Arts et des Lettres – consécration institutionnelle qu’est venue renforcer l’inscription, en 2025, de Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux, au programme de spécialité “études théâtrales” de l’ENS.
Si ces derniers événements assoient l’importance de cette oeuvre, l’écart demeure toutefois saisissant entre, d’un côté, la richesse et l’exigence du geste artistique de Noëlle Renaude, de l’autre, la rareté des études qui lui ont été consacrées. En se saisissant de son oeuvre complète (où se croisent écriture dramatique, romanesque et poétique, mais aussi, théorique et critique), ces deux journées de colloque auront donc pour enjeu et ambition : de préciser les processus au travail dans l’écriture de Noëlle Renaude, en se demandant notamment comment ils opèrent au fil de l’oeuvre, mais aussi, d’un genre ou d’un médium à un autre ; d’examiner les dyspraxies que cette oeuvre provoque chez toutes celles et ceux qui entrent en relation avec elle : quels savoirs pratiques et théoriques vient-elle perturber, quelles manières de faire requiert-elle d’inventer ? ; d’interroger les discours que cette oeuvre peut susciter dans le milieu théâtral (qu’il s’agisse de textes signés par des compagnons de route, d’articles parus dans la presse, ou encore, de notes d’intention de spectacles montés en milieu amateur) ; de situer la singularité des points de vue sur l’art et sur le monde que Noëlle Renaude façonne dans ses propres textes ou lorsqu’elle écrit sur d’autres oeuvres.
Dans cette perspective, pourront être abordées, de manière non exclusive, les thématiques suivantes :
- La prolifération des histoires (feuilletons, aventures, enquêtes…) et/ou le rapport à l’Histoire ;
- Les phénomènes d’emprunt, de détournement et de mélange des références (les plus populaires comme les plus savantes), des registres (comique, tragique, lyrique…) ou des codes génériques (roman, cinéma, peinture…) ;
- La mise à mal des normes et des standards (qu’ils soient esthétiques, éditoriaux ou sociétaux….) ;
- La mise en tension du concret et de l’abstrait, de l’ordinaire et de l’extraordinaire, de la transparence et de l’opacité ;
- La pensée et la critique de l’art (intégrées aux oeuvres littéraires ou se déployant dans des espaces de publication dédiés)
Bibliographie indicative
- Corvin, Michel, Le Motif dans le tapis : suspension et ambiguïté du sens dans le théâtre contemporain, Théâtrales, 2016.
- Corvin, Michel, La Lecture innombrable des textes du théâtre contemporain, Théâtrales, 2015.
- Corvin, Michel, Noëlle Renaude, atlas alphabétique d’un nouveau monde, Théâtrales, 2010.
- Hersant, Céline, « Formuler la privation et l’excès : euphémismes et tautologies (Noëlle Renaude / Valère Novarina) », in Manger et être mangé : l’alimentation et ses récits, sous la dir. de Florence Fix, Orizons, 2016.
- Hersant, Céline, « Une projection paysagée : Par les routes de Noëlle Renaude », in Un Théâtre en quête d’espaces ? Expériences scéniques de la limite, sous la dir. de Florence Fix et Frédérique Toudoire-Lapierre, Éditions Universitaires de Dijon, 2014.
- Hersant, Céline, Recyclage et fabrique continue du texte : Valère Novarina, Noëlle Renaude, Daniel Lemahieu, thèse de doctorat en Études théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle, 2006.
- Renaude, Noëlle ; Cristina de Simone, « Je suis un auteur qui pense, de sa table, la scène », revue Théâtre / Public, « Écrire pour le théâtre », n° 254, janvier-mars 2025, p. 41-46
- Renaude, Noëlle ; Métais-Chastanier, Barbara, Accidents, essai épistolaire, ENS éditions, 2016.
- Renaude, Noëlle ; Julie Sermon, « Théâtre et discontinu », Agôn : Revue des arts de la scène, [En ligne], 1 | 2008. URL : http://journals.openedition.org/agon/864
- Renaude, Noëlle ; Julie Sermon, « Écrire, non pas pour des acteurs, mais pour des personnes. Entretien avec Noëlle Renaude », Agôn : Revue des arts de la scène, [En ligne], 7 | 2015. URL : http://journals.openedition.org/agon/3354
- Ryngaert, Jean-Pierre ; Sermon, Julie, Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Théâtrales, 2006.
- Sermon, Julie, L'Effet-figure : états troublés du personnage contemporain (Jean-Luc Lagarce, Philippe Minyana, Valère Novarina, Noëlle Renaude), thèse de doctorat en Études théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle, 2004.
- Sermon, Julie, "Le feuilleton et la passion des fictions : le cas de Noëlle Renaude", Registres : Revue d'études théâtrales, Hors Série (n°4), "Écrire pour le théâtre aujourd'hui. Modèles de représentation et modèles de l'art" (dir. Joseph Danan et Catherine Naugrette), 2015.
- Sermon, Julie, « Écrire (avec) le paysage, Le théâtre à ciel ouvert de Noëlle Renaude », Revue d'Histoire du Théâtre, n° 296, 2023.
- Théâtre / Public, « Renaude, Minyana, Novarina, Koltès, dramaturgie contemporaine », n° 183, avril 2006.
- Frictions, théâtre | écritures, n° 39, février 2025.
- Par les routes / Des écritures dans l’espace : Hervé Blutsch, Robert Cantarella, Damien Chaîne, Rodolphe Congé, Céline Hersant, Frédéric Maragnani, François Raffinot, Noëlle Renaude, Théâtre Ouvert, 2006.
*
Les propositions de communication (résumé de 2500 signes espaces compris + bio-bibliographie succincte) sont à adresser avant le 20 octobre 2025 à :
colloque.renaude@gmail.com
Les réponses seront données aux contributeurs et contributrices le 15 novembre 2025.
Comité d’organisation :
Céline Hersant (IRET – Université Sorbonne Nouvelle)
Julie Sermon (HAR – Université Paris-Nanterre)
Pierre Longuenesse (IRET - Université Sorbonne Nouvelle)
Comité scientifique :
Céline Hersant (IRET – Université Sorbonne Nouvelle)
Julie Sermon (HAR – Université Paris-Nanterre)
Olivier Neveux (Ihrim – ENS de Lyon)
Pierre Longuenesse (IRET - Université Sorbonne Nouvelle)