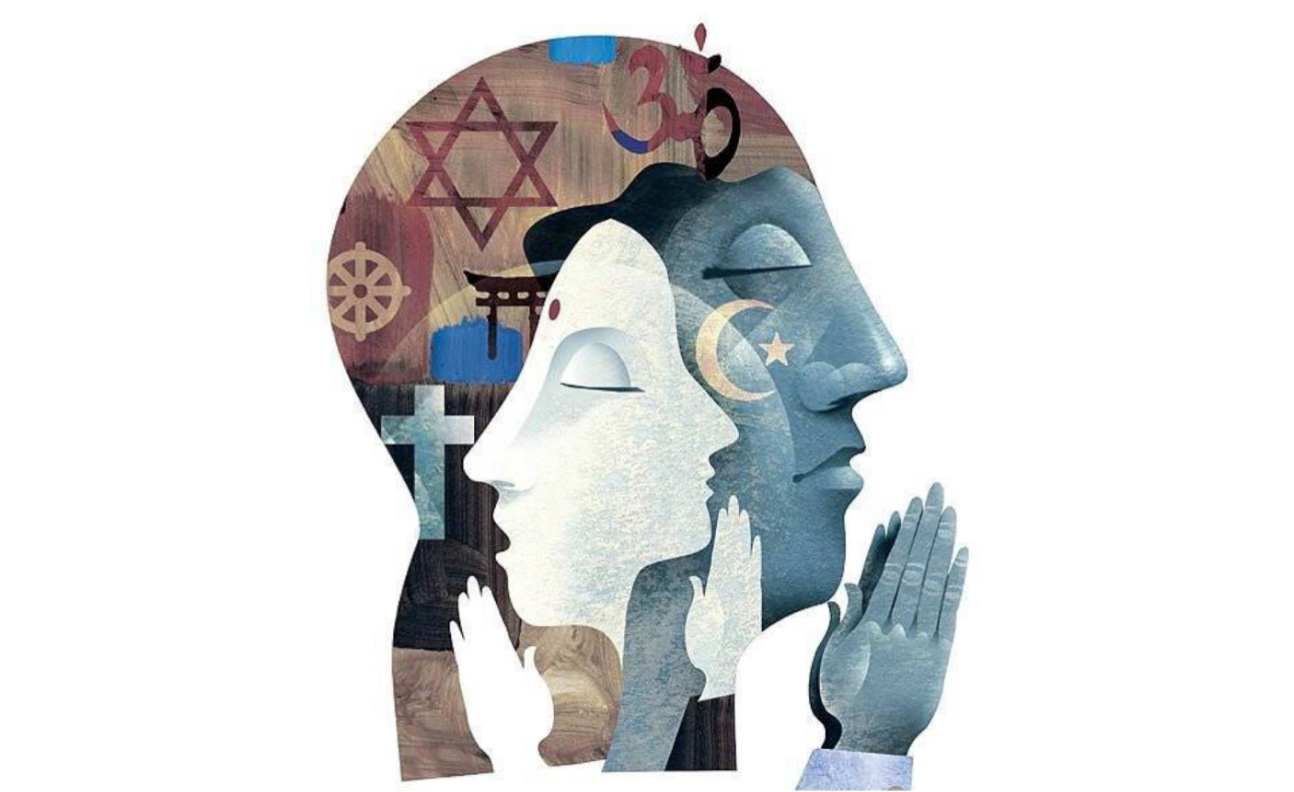
COLLOQUE INTERNATIONAL
L’IMAGE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
L’image. Un mot aussi familier que complexe. L’image est depuis toujours porteuse d’ambivalence : force de révélation ou de mystification, de transmission ou de manipulation. C’est une forme qui, tout en étant visible, interroge sans cesse l’invisible, l’absence, le mystère, le divin, ou encore le mensonge. L’image n’est jamais neutre : elle crée, reflète, dissimule, suggère et impose. Dès lors, penser l’image, c’est engager une réflexion qui traverse les disciplines, les époques et les cultures.
Dans l’Antiquité grecque, l’image a d’abord servi une fonction poétique et religieuse. Homère, en anthropomorphisant les dieux, initie une tradition où l’homme devient mesure du divin, comme le souligne Alain Besançon (L’image interdite, 1994). L’art devient alors un vecteur de beauté, mais aussi un support idéologique. Pour la Grèce antique, l’idéal esthétique, l’idéal de beauté qui devait concevoir et parer les dieux n’était pas hors du monde « les artistes grecs et les poètes comprirent à quelle splendeur pouvait atteindre l’homme et ils trouvèrent en lui l’accomplissement de leur recherche de beauté» (Edith Hamilton, La mythologie, ses dieux, ses héros, ses légendes). Dans ce prolongement, la philosophie platonicienne introduit une rupture fondatrice : l’image y est suspecte, illusion trompeuse, simple reflet de l’idée. Platon place la mimesis dans le registre du simulacre, ce qui ouvrira un long débat sur la légitimité de la représentation, poursuivi par les penseurs médiévaux, modernes et contemporains.
Dans les religions monothéistes, l’image occupe une place centrale mais conflictuelle. Le judaïsme et l’islam posent une interdiction claire de représenter Dieu, au nom de sa transcendance absolue. Le christianisme, quant à lui, oscille entre deux pôles : l’icône qui rend visible l’incarnation, et l’aniconisme biblique. La crise iconoclaste byzantine (726-843) incarne ce tiraillement : peut-on représenter l’invisible sans trahir le sacré ? L’Islam, en particulier, a élaboré une esthétique du texte et du signe – notamment à travers la calligraphie et l’architecture – pour dire Dieu sans figurer son image. Comme le rappelle Art-Albert Keller (Approche de la mystique, 1996), cette stratégie du détournement de l’image a nourri une symbolique visuelle d’une grande richesse.
Sur le plan politique, l’image devient très tôt un instrument de pouvoir. L’empereur romain est représenté comme image terrestre du divin, et cette sacralisation du pouvoir visuel perdure sous d’autres formes jusqu’aux régimes contemporains. Des propagandes totalitaires aux démocraties médiatiques, l’image agit : elle construit des mythes, façonne des identités collectives, instrumentalise l’émotion. La philosophie contemporaine – de Debord à Baudrillard, en passant par Didi-Huberman – a mis en lumière cette puissance politique des images et leurs capacités à produire du réel simulé. Dans le domaine de l’art, l’image s’est lentement affranchie des dogmes religieux. L’avènement de la perspective à la Renaissance, l’émergence du sujet moderne, l’abstraction du XXe siècle et aujourd’hui l’imagerie numérique, marquent une évolution radicale : de l’icône sacrée à l’image fabriquée par algorithmes. À l’ère des intelligences artificielles, l’image devient générative, performative, automatisée. Elle ne copie plus : elle invente. Elle soulève alors des interrogations éthiques, esthétiques, et ontologiques fondamentales. L'image d’aujourd’hui n’est plus nécessairement un objet à contempler, mais un flux à décrypter, un dispositif à interroger, un enjeu civilisationnel à problématiser. Enfin, les enjeux contemporains de l’image dans la publicité, le cinéma, les réseaux sociaux, les médias et les univers immersifs brouillent les frontières entre fiction et réalité. Nous vivons dans une « société de l’image » qui exige de renouveler nos outils de lecture critique, et d’interroger la notion même de vérité visuelle.
Partant de toutes ces considérations, nous trouvons légitimes les interrogations qui suivent : Comment la question de la représentation de l’invisible a-t-elle été pensée et argumentée par le monothéisme ? De quelle façon le Christianisme a-t-il su allier entre les deux inconciliables bibliques, à savoir l’interdit des images et l’existence des images de Dieu ? Est-ce qu’on a réfléchi sur la représentation de Dieu en Islam ? Comment l’Islam, considéré comme monothéisme abstrait (Hegel, La raison dans l’histoire. Introduction à la Philosophie de l’Histoire), a-t-il réagi face à sa propre réserve émise sur l’image? Au plan de l’exploitation politique des images, quelles sont les carences que les intelligences artificielles risquent, faussement, d’induire au détriment de la vérité et de l’éthique universelle? En ayant à sa disposition l’infiniment possible, quel avenir l’art numérique peut-il s’octroyer afin de garantir et préserver le beau et le vrai ensemble? Quel rôle peut jouer, encore, l’art aujourd’hui ? Comment préserver le sens, le beau, l’humain dans un monde d’images proliférantes et souvent déconnectées du réel ?
Objectifs du colloque
Ce colloque international se propose d’ouvrir un espace de dialogue interdisciplinaire entre chercheurs en philosophie, art, esthétique, théologie, sciences religieuses, sciences politiques, histoire de l’art, littérature, sociologie, et technologies numériques, afin de réfléchir à la place et aux mutations de l’image dans notre monde contemporain.
Axes de recherche proposés (non limitatifs)
· La critique philosophique de l’image : de Platon à Deleuze, en passant par Kant, Hegel, Sartre, Debord ou Baudrillard
· Image et religion : représentations du divin dans le judaïsme, le christianisme, l’islam et autres traditions spirituelles
· Art et théologie : tensions entre foi et figuration, icônes, aniconisme, esthétiques du sacré
· Image et politique : propagande, image du pouvoir, iconoclasmes politiques, soft power visuel
· L’esthétique islamique : calligraphie, ornementation, spiritualisation de l’abstraction
· Art et mythologie : fonctions symboliques et narratives des images dans les cultures anciennes
· Image et rhétorique : pouvoir persuasif de l’image, figures visuelles, dispositifs médiatiques
· L’art moderne et contemporain : rupture avec la représentation, montée de l’abstraction, postmodernité visuelle
· Image et publicité / image et consommation : fabrique du désir, économie de l’attention, marketing visuel
· Art numérique et IA : génération d’images, deepfakes, métavers, éthique de la création algorithmique
· Les images photographiques et cinématographiques : captation du réel, mise en scène, mémoire visuelle
· Image, vérité et manipulation : crise du visible, post-vérité, esthétique de la simulation
· Transdisciplinarité de l’image : passages entre arts, sciences humaines et technologies
Références Bibliographiques
• BARTHES, Roland, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957.
• BAUDRILLARD, Jean, Simulacres et simulation, Éditions Galilée, Paris, 1981.
• BELTING, Hans, Pour une anthropologie des images, Gallimard, Paris, 2001.
• BESANÇON, Alain, L’image interdite : une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, Gallimard, coll. Folio-Essais, Paris, 1994.
• BREDEKAMP, Horst, Les images politiques : une archéologie, CNRS Éditions, Paris, 2007.
• BUCAILLE, Maurice, La Bible, le Coran et la science, Éditions Seghers, Paris, 2005.
• BURCKHARDT, Titus, L’art de l’Islam, langage et signification, Bourges, Éditions Sindbad, Paris, 1985.
• CHEBEL, Malek, Dictionnaire des symboles musulmans : rites, mystique et civilisations, Albin Michel, coll. Spiritualité vivante, Paris, 2001.
• CHEBEL, Malek, L’imaginaire arabo-musulman, PUF, Paris, 1993.
• COLLECTIF, Images, regards, pouvoirs, sous la dir. de M.-A. Guégan, Publications de la Sorbonne, Paris, 2018.
• COLLECTIF, L’image entre savoir et pouvoir, Actes du colloque du Collège de France, Paris, 2012.
• COLLECTIF, Penser l’image : regards croisés, sous la dir. de F. Frontisi-Ducroux & L. Perrot, CNRS Éditions, Paris, 2005.
• CORBIN, Henry, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, coll. Folio Essais, Paris, 1986.
• CORBIN, Henry, L’imaginal et l’imaginaire dans la gnose iranienne, Paris, Éditions Verdier, 1981.
• DANIEL, Norman, Islam et Occident, Éditions du Cerf, coll. Patrimoines, Paris, 1993.
• DEBORD, Guy, La société du spectacle, Buchet-Chastel, Paris, 1967.
• DELEUZE, Gilles, Cinéma 1 : L’image-mouvement, Éditions de Minuit, Paris, 1983 ; Cinéma 2 : L’image-temps, Éditions de Minuit, Paris, 1985.
• DERRIDA, Jacques, La vérité en peinture, Flammarion, Paris, 1978.
• DIDI-HUBERMAN, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Éditions de Minuit, Paris, 1992 ; Images malgré tout, Éditions de Minuit, Paris, 2003 ; Quand les images prennent position, Éditions de Minuit, Paris, 2009.
• FLICHY Patrice, L’imaginaire d’Internet, Éditions La Découverte, Paris, 2001.
• FRANCASTEL, Pierre, Art et technique, Éditions Gallimard, Paris, 1988.
• GARNIER François, Le langage de l’image au Moyen-Âge, signification et symbolique, Éditions du Léopard d'or, Paris, 1982.
• GERVAIS, Thierry & MOREL, Gaëlle, La Fabrique de l’information visuelle Photographies et magazines d’actualité, Larousse, Paris, 2008.
• GRABAR, Oleg, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1973.
• GRESH Alain et RAMADAN Tarik, L’Islam en questions, Actes Sud, France, 2002.
• HAMILTON, Edith, La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes, Belgique, Éditions Marabout, Paris, 1997.
• HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Introduction à l’esthétique, le beau, trad. Samuel Jankélévitch, Éditions Flammarion, Paris, 1979.
• HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire, trad. Kostas Papaioannou, Éditions 10/18, Paris, 1965.
• IBN ARABI, Le livre des contemplations divines et des aurores des secrets sanctissimes, Présentation et traduction de Stéphane Ruspoli, Sindbad, Paris, 1999.
• JIMINEZ, Marc, Qu’est-ce que l’esthétique ? Gallimard, coll. Folio Essais, Paris, 1997.
• KELLER, Art-Albert, Approche de la mystique, Éditions Albin Michel, Paris, 1996.
• LAROUSSI Moulim, Esthétique et art islamique, Afrique Orient, Casablanca, 1991.
• MARÇAIS, Georges, L’art musulman, Quadrige / PUF, 2ᵉ éd., Paris, 1991.
• MARIN, Louis, Des pouvoirs de l’image, Éditions du Seuil, Paris, 1993.
• MITCHELL, W.J.T., Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, University of Chicago Press, Paris, 1986.
• MONDZAIN, Marie-José, Image, icône, économie, Éditions du Seuil, 1996 ; L’image peut-elle tuer ?, Paris, Éditions Bayard, 2002.
• NEF, Frédéric (dir.), Penser l’aniconisme. Philosophie et iconoclasme religieux, Éditions Vrin, Paris, 2020.
• PANOFSKY, Erwin, La perspective comme forme symbolique, Éditions de Minuit, Paris, 1975.
• PLATON, La République, Livre X.
• RANCIÈRE, Jacques, Le destin des images, Éditions La Fabrique, Paris, 2003.
• RÉAUX, Louis, Iconographie de l’art chrétien, Presses Universitaires de France, Paris, 1955.
• SARTRE, Jean-Paul, L’Imaginaire, Gallimard, Paris, 1940.
• SONTAG, Suzan, Devant la douleur des autres, Traduit de l’anglais (États- Unis) par Fabienne Durand-Bogaert, Éditions Christian Bourgois, Paris, 2022.
• THÉLY, Nicolas, Corps, art vidéo et numérique, Éditeur Scérén-CNDP, Paris, 2006.
• THOMINE Janine Sourdel, De l’art de l’Islam, Geuthner, Paris, 1984.
___________________________________________________________________________
Modalités de soumission
Les propositions de communication (titre + résumé de 300 à 500 mots), accompagnées d'une brève notice bio-bibliographique (150 mots max), sont à envoyer avant le 30 janvier 2026 à l’adresse suivante : t.azzelarab@uiz.ac.ma
Les langues du colloque sont : français, arabe, anglais et espagnol
Les propositions doivent préciser :
Le titre de la communication
Le nom et prénom de l’intervenant(e)
L’établissement ou affiliation
L’axe principal concerné (voir liste ci-dessous)
Une brève bibliographie
—
Dates à retenir
- Date limite de soumission des propositions des contributions 30 / 01 / 2026
- Retour aux auteurs : 31 / 03 / 2026
- Date limite de soumission des textes définitifs : 30 / 06 / 2026
- Le colloque aura lieu à la FLSH- Agadir- Maroc, les 19, 20 et 21 novembre 2026
Les communications retenues par le comité scientifique seront publiées dans le numéro 34 de la revue Dirrassat, éditée par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir.
—
Coordinateurs du colloque
- MAKACH Zohra, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- TOUDA Azzelarab, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ZIZAOUI Abdelmottaleb, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
Comité d’organisation
- ABOUELKACEM Hafid, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ABRIGHACH Mohamed, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- AFAKIR Mohamed, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ALAHYANE Ayad, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ANDAM Lhassane, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- BELAAYACHI Abderrahmane, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- CHIBLI Fatima, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- EL BOUWAB Soumaya, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- El KACIMI Badreddine, (Université Ibn Zohr, FFG- Guelmim- Maroc)
- FAIZ Fatima, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- IMZILEN Abdelwahed, (Directeur de l'Institut National des Beaux-Arts- Annexe d’Agadir, Maroc)
- MAAROUFI Rabia, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- MAKACH Zohra, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- OUMERZOUG Abdelaziz, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- TALMENSSOUR Abdelâali, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- TOUDA Azzelarab, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ZIZAOUI Abdelmottaleb, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
Comité scientifique
- AFAKIR Mohamed, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ALAHYANE Ayad, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- AZZOUZI Abdelmounim, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FLSH Saïs- Fès- Maroc)
- BENELAZMIA Nadia, (Université Moulay Ismaïl, FST, Meknès- Maroc)
- BENKIRANE Thami, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FLSH- Dhar El Mehraz- Fès- Maroc)
- BENNOUDI Hanane, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- CHAFIK Hassan, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FLSH Saïs- Fès- Maroc)
- CHIGUER Abdelkrim, (Université Moulay Ismaïl, FLSH- Meknès- Maroc)
- DIANE Elhoucine, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ELHIMANI Abdelghani, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FLSH Saïs- Fès- Maroc)
- ELIDRISSI Nacer, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ELMANIRA Rochdi, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ELMOUAHAL Mokhtar, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ENNACIRI Hassan, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ERRADI Amina, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ERRHOUNI Leila, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- FERTAT Omar, (Université Bordeaux – Montaigne- France)
- GHARIOUA Abderrahmane, (Université EL Quaraouiyine, Rabat, Maroc)
- GHOUATI Sanae, (Université Ibn Tofail, FLSH, Kénitra- Maroc)
- HADJI Khalid, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FLSH Dhar El Mehraz- Fès- Maroc)
- ID IBRAHIM Hassan, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FSDM- Dhar El Mehraz- Fès- Maroc)
- JAYED Abdelkhaleq, (Université Ibn Zohr, Faculté des Langues, des Arts et des Sciences Humaines- Ait Melloul- Maroc)
- KAMAL Abderrahim, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FLSH- Dhar El Mehraz- Fès- Maroc)
- KATUSZEWSKI Pierre, (Université Bordeaux- Montaigne- France)
- KSIKES Driss, Dramaturge, essayiste et romancier, (Directeur du CESEM, Rabat- Maroc)
- MAAROUFI Rabia, (Université Ibn Zohr FLSH- Agadir- Maroc)
- MABROUR Abdelouahed, (Université Chouaïb Doukkali, FLSH, El Jadida- Maroc)
- MAKACH Zohra, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- NAJI Mohammed, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- NAJIH Aziz, (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, E.N.S- Fès- Maroc)
- OUBELLA Abdelkrim, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- RUOCCO Monica, (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"), Naples, Italie
- TALMENSSOUR Abdelâali, (Université Ibn Zohr FLSH- Agadir- Maroc)
- TOUDA Azzelarab, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- TRABELSI Mustapha, (Université de Sfax –Tunisie)
- ZIZAOUI Abdelmottaleb, (Université Ibn Zohr, FLSH- Agadir- Maroc)
- ZOUAK Mehdi, Archéologue, Directeur de l'Institut National des Beaux-Arts- Tétouan et de ses Annexes- Maroc)
__________________________________________________________________________
Formulaire de participation
À envoyer, en pièce jointe, à l’adresse suivante :
Nom et Prénom :
Université/Institution :
Adresse postale :
Téléphone :
E-mail :
Directeur de thèse (si vous êtes doctorant) :
Titre de la contribution :
Résumé (Français /Arabe/Anglais/ Espagnol) :
400 - 500 mots / Mots clés (05)/ axe :
Références bibliographiques :
Notice biobibliographique :
Responsable:
Laboratoire d’Études et Recherches en Langue, Littérature, Culture et Identité FLSH - Université Ibn Zohr – Agadir–Maroc
Url de référence :
http://www.flsh-agadir.ac.ma
Adresse :
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Agadir, Maroc
BP 29/S, Rue Hassan Bounaâmani, Agadir 80000
Tél. : 0528220878 / 0528220558