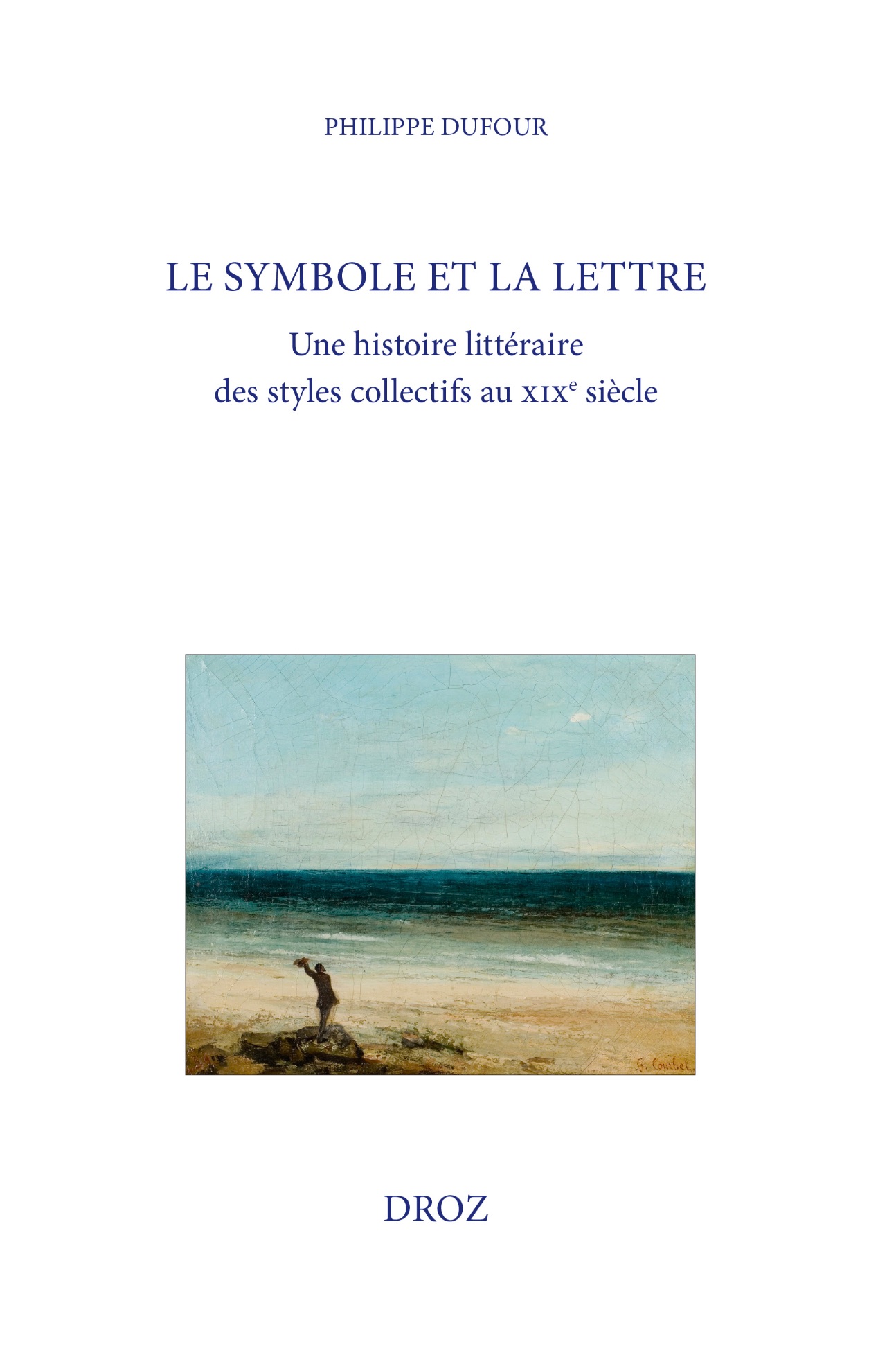
Philippe Dufour, Le Symbole et la lettre. Une histoire littéraire des styles collectifs au XIXe siècle
Quelle place pour l’idéal au sein d’une société impuissante à fonder des valeurs communes après la Révolution française ? Quelle place pour la littérature dans un monde du relatif ? Deux tendances se dégagent : d’un côté, les littéralistes, raillant le monde social ou jouissant du monde sensible ; de l’autre, les symbolistes, opposant un désir d’idéal religieux ou politique au réel détesté. Philippe Dufour parcourt ici ce champ littéraire à travers quelques grands noms (Chateaubriand, Hugo, Baudelaire, Flaubert), sur fond des trois grandes mouvances du temps : le romantisme, le réalisme et le symbolisme. Ainsi se dessine une histoire des écritures, au sens de Roland Barthes : des styles d’époque qui sont des manières de se situer dans l’Histoire.
En contrepoint à ces styles collectifs, l’ouvrage examine le discours savant sur le symbole, de la mythologie comparée et de l’histoire des religions. Dans ce transfert culturel, de l’Allemagne à la France, on entend tantôt la nostalgie d’un âge symbolique originel, tantôt des doutes sur la profondeur des symboles ou sur la vérité historique des récits bibliques.
Table des matières
Prologue – Pour une histoire des écritures
Symbole rhétorique et symbole métaphysique
Symboliques du sublime et allégories de la déréliction
Symboles réfléchis, symboles irréfléchis
Histoire des idées et littérature mêlées
Première partie. Pensées du symbole au XIXe siècle
Chapitre premier. Archéologie romantique : le symbole sous le mythe
Le sens fuyant : le mystère originel du symbole
Le sens perdu : la critique des mythes
Le sens retrouvé : l’allégorisation rétrospective
Le retour de la lettre : la poésie des mythes
Chapitre II. Archéologie positiviste : la métaphore sous le symbole
Une génétique du mythe
Un laconisme désenchanté
L’histoire des mythes
L’ethnologue contre le philologue
Deuxième partie. Le temps de la désymbolisation
Chapitre III. La lettre perdue de la Bible
La lecture mythographique
La lecture historique
La lecture archéologique
Chapitre IV. Du christianisme au panthéisme historique
Histoire d’un silence
Le Christ prométhéen
Troisième partie. Le symbole face à l’histoire moderne
Chapitre V. Hugo ou les symboles du panthéisme historique
L’histoire symbolique ou historiographies mêlées
Écrire la légende dorée de Waterloo
Construire une « pensée en images »
Prométhée déchaîné
Le symbole et le littéral
Style symbolique : histoire philosophique
Waterloo, en réalité
Chapitre VI. Baudelaire ou les bruits de la modernité
Un lyrisme dialogique
Les voix extérieures
Langages en observation
Le langage des muets
Les voix de la nature se sont tues
À la recherche d’une petite musique
Quatrième partie. Le temps des littéralistes
Chapitre VII. Flaubert : du style symbolique au style phénoménologique
Vers là-bas
Le monde sans âme
Le regard touche, l’oreille voit
Une confusion des styles
Chapitre VIII. Chateaubriand ou la prose poétique du monde sensible
Petits nuages blancs
Ciel gris perle
Plumes couleur de rose
Couleur fleur de pêcher
Chapitre IX. La lettre désenchantée ou le style satirique de la belle âme réaliste
L’esprit satirique
Le lecteur indigné
Les voix du roman
La frêle voix de l’idéal
La voix cynique
Voix narratives
Impertinence de Stendhal
Balzac épilogue
L’ironie impersonnelle de Flaubert
Épilogue. L’art sans dieux
Littéralistes et symbolistes, même combat
L’écriture symboliste : le mystère du monde
L’écriture symboliste : le mystère des mots
L’écriture symboliste : le mystère du moi
Bibliographie
Index