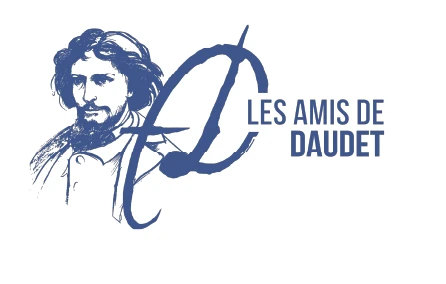
« Naturalisme pas mort » : l’Enquête sur l’Évolution littéraire de Jules Huret en 1891 met en évidence un changement de génération, un clivage littéraire auquel n’ont pas échappé les grands écrivains réalistes. La bibliothèque de la Pléiade a récemment publié un volume consacré au « troisième » Zola, l’auteur des Trois Villes.
Les derniers romans d'Alphonse Daudet ont, eux, sombré dans un relatif oubli : Roger Ripoll a seulement sauvé dans la bibliothèque de la Pléiade Port-Tarascon, La Fédor et Le Trésor d’Arlatan : trois romans de la décennie 1890 n’ont pu être retenus par Gallimard. L’ensemble constitue pourtant un corpus qui mérite d’être étudié en s’interrogeant sur les ruptures et les continuités par rapport au reste de l’œuvre : les thèmes daudétiens trouvent une reformulation dans un contexte nouveau. On pourra ainsi interroger plusieurs entrées :
- Le contexte biographique, la maladie de plus en plus douloureuse et handicapante, la question du divorce qui s’impose avec les soucis familiaux de Léon trouvent des échos dans ces derniers romans.
- L’Imaginaire fin-de-siècle étudié sous le terme de décadence a marqué l’écrivain. Dans quelle mesure reprend-il les topoï de cet imaginaire ?
- La perméabilité au contexte idéologique, historique et politique favorise l’émergence de nouveaux personnages : l’anarchiste, le parlementaire, etc.
- L’intérêt pour le roman psychologique et la « psychologie des profondeurs » peuvent donner une nouvelle dimension aux personnages d’un écrivain souvent catalogué comme un romancier de mœurs.
- Daudet et les idées nouvelles : Quelles valeurs sont-elles mises en avant par le « marchand de bonheur » qui découvre le pessimisme fin-de-siècle avec les souffrances de la maladie et se fait de plus en plus sensible aux manifestations de la pitié, prônées par le roman russe.
- Daudet et la modernité. Une nouvelle modernité s’impose. Les romans rendent compte d’un monde urbain qui évolue. Le romancier s’intéresse aux avancées scientifiques et techniques et aux métiers nouveaux qu’elles génèrent.
- Daudet et les réseaux fin-de-siècle : Les liens avec Jean Lorrain, Montesquiou, Mallarmé, Barrès, Bourget, Geoffroy, Loti et dans une certaine mesure avec les jeunes greniéristes qui vont chez Edmond de Goncourt. Daudet s’intéresse aux nouveaux mouvements, même s’il exprime des jugements critiques sur le Symbolisme et sur le langage hermétique selon lui, trop souvent adopté.
- Une poétique romanesque renouvelée. Dans quelle mesure Daudet pratique-t-il désormais une forme de roman à thèse et de « roman d’idées » à la façon de Bourget, à rebours de son scepticisme et de sa vision jusque-là dominée par une fragmentation impressionniste.
A noter : Les communications devront porter exclusivement sur le corpus daudétien des années 1890, à savoir : Port-Tarascon (1890), L’Obstacle (1980), Rose et Ninette (1892), La Petite Paroisse (1894), La Fédor (1897), Le Trésor d’Arlatan (1895), Ultima (1896), Soutien de famille (1897). La mise en relation de Daudet et des auteurs fin de siècle est vivement encouragée.
—
Le colloque aura lieu les vendredi 5 et samedi 6 juin 2026 à la bergerie du château de Montauban, à Fontvieille (Bouches-du-Rhône).
Les communications dureront 20 minutes. Elles seront ensuite publiées dans la revue Le Petit Chose, à la fois en volume et en ligne sur Persée où se trouvent tous les numéros depuis 2006 (https://www.persee.fr/collection/lepec).
Les propositions sont à envoyer avant le 15 janvier 2026 avec un court CV et une présentation en quelques lignes à :
· Anne-Simone Dufief : pierre-anne-simone-dufief@wanadoo.fr
· Romain Enriquez : romain.enriquez@sorbonne-universite.fr
· Bernard Urbani : b.urbani@wanadoo.fr