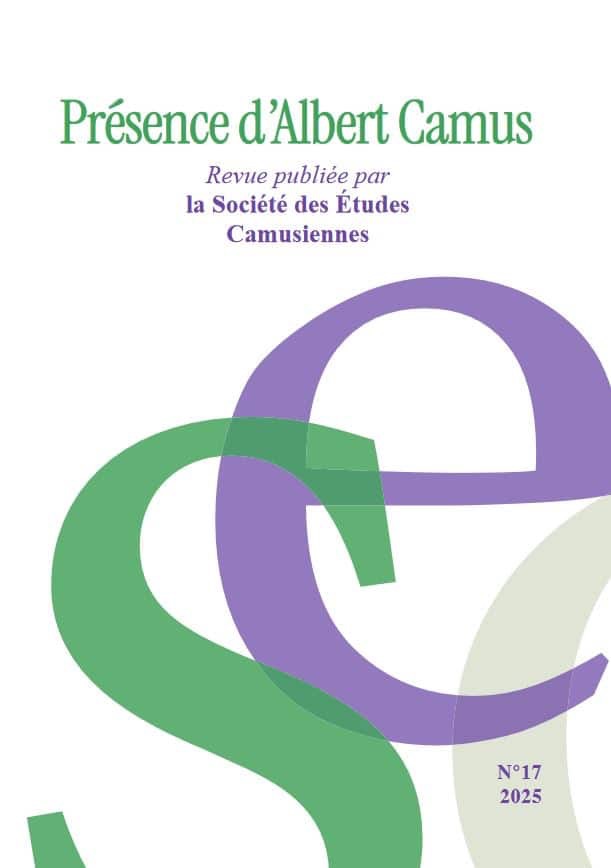
Sommaire
Texte :
Albert Camus, « Une interview peu connue ? », présentée par David H. Walker.
Contributions :
Matthieu Donnarumma et Rémi Baudouï, « Camus et Nietzsche. À propos des Actuelles (1944-1948) ».
Samara Fernanda A. O. de Lócio e Silva Geske, « L'écrivain corrige la création divine : la genèse de la section "Révolte et art" de L'Homme révolté ».
Cécile Beslé, « Lire Camus avec Ricœur : Les trois stades de la symbolique du mal de La Mort heureuse à La Chute ».
Arezou Davdar, « (Omni)Présence d’Albert Camus en Iran ».
Jean-Pierre Barou, « Es-tu camusien ou sartrien ? ».
Travaux universitaires :
Messaoud Mzara, « Roman et être : la fiction d’Albert Camus à la lumière de la philosophie de Heidegger ».
Document :
« En attendant Requiem pour une nonne », Le Figaro littéraire, samedi 22 septembre 1956. Propos recueillis par Dominique Arban.
Comptes-rendus :
Anne Prouteau, Camus chez les Justes (Agnès Spiquel) ; RLM, La postérité de Camus (Pierre-Louis Rey) ; Albert Camus, Actuelles IV (Agnès Spiquel) ; Faris Lounis et Christian Phéline, Retrouver Camus (Christian Chevandier), Rémi Larue, Albert Camus et la violence. À l’épreuve du « siècle de la peur » (Denis Salas) ; Alessandro Bresolin, Camus et Job (Anne-Marie Tournebize) ; Vivien Matisson, La Monstruosité du langage dans les récits après 1945. Une génération tardive (Io Wanatabe) ; Alexis Lager et Rémi Larue, Albert Camus et la nature contre l’histoire (Michel Laplace).
Bibliographie
Vie de la Société des Études Camusiennes
Hommage à Fernande Bartfeld
In memoriam (Denis Charbit)
Bibliographie (Guy Basset)
Abstracts
***
Résumés des contributions
Matthieu Donnarumma et Rémi Baudouï : « Camus et Nietzsche. À propos des Actuelles (1944-1948) »
Les analyses de la philosophie grecque sur la pensée d’Albert Camus ont décelé au fil du temps l’importance du Nietzsche de La Naissance de la tragédie du point de vue de la pensée d’un monde nihiliste et de l’absurde libéré de Dieu. Dans la double perspective de l’analyse de la réception de Nietzsche en France chez les intellectuels et de l’analyse de l’œuvre, l’écrivain est à la fois profondément marqué par le philosophe tout en s’en affranchissement au fil du temps. La Seconde Guerre mondiale et son cortège de désolations marquent une rupture dans sa passion nietzschéenne. Elle le conduit dans L’Homme révolté à dépasser les contradictions du rapport entre pessimisme et messianisme pour proposer comme seule alternative au renoncement, l’engagement dans les affaires du siècle quel qu’en soit le prix de la victoire et surtout de l’échec. Les Actuelles, 1944-1948, qui précèdent la publication de L’Homme révolté, interrogent dans ses chroniques, pourtant placées sous les mânes de Nietzsche, les modalités de sa distanciation critique des points de vue de l’histoire, de la justice et de la politique.
Samara Fernanda A. O. de Lócio e Silva Geske, “L'écrivain corrige la création divine : la genèse de la section « Révolte et art » de L'Homme révolté »
Dans une note sur La Peste, Camus écrit « le médecin, ennemi de Dieu, il lutte contre la mort », or à partir de la lecture de L'Homme Révolté nous pouvons bien étendre cette épithète à l'écrivain, car nous y découvrons que la création artistique est l'une des expressions de la révolte humaine contre sa condition. En ce sens, il est intéressant de remarquer que dans la section « Révolte métaphysique », il est question surtout des écrivains dont la révolte s'avère comme un geste blasphémateur contre le Dieu créateur. Mais l'effort des écrivains cités est plutôt de détruire ou d'anéantir la création divine. Dans « Révolte et art », Camus approfondit la question et propose une solution en apparence positive : la correction de la création à travers l'art. Comme dans toute son oeuvre, il rejette la réponse chrétienne, celle de la grâce, et se met du côté des « damnés". Ces quelques références montrent qu'en rédigeant « Révolte et art », Camus s'insère dans une problématique qui émerge tout particulièrement à cette époque en France, à savoir, les relations de la création artistique et de la métaphysique pensée à partir de la perspective chrétienne, à travers tout un ensemble de critiques et philosophes catholiques. Nous constatons que Camus n'ignore pas cette question lorsque nous nous penchons sur les oeuvres qu'il consulte et les références que nous pouvons retrouver dans cette section de son essai. Notre objectif sera donc d'élucider brièvement la rédaction de "Révolte et Art" à partir du manuscrit Agnely et lire sa genèse à la lumière des discussions sur les rapports entre l'art et la métaphysique connues et/ou citées par Camus et ses retentissements sur la rédaction de « Révolte et Art ».
Cécile Beslé, « Lire Camus avec Ricœur : Les trois stades de la symbolique du mal de La Mort heureuse à La Chute
Partant de l’analyse proposée par le philosophe Paul Ricœur des trois stades de la symbolique du mal – archaïque, éthique et supraéthique, Cécile Beslé étudie la présence des symboles primaires du mal que sont la souillure, le péché et la culpabilité dans l’écriture narrative camusienne et plus particulièrement dans La Mort heureuse et dans La Chute. Ces deux œuvres ont valeur de pôles illustrant le chemin parcouru par l’auteur dans son approche littéraire du mal. Le mal, perçu initialement comme extérieur, tend à s’intérioriser et à se complexifier. Cette évolution va de pair avec la disparition claire des frontières entre le bien et le mal, la difficulté de la relation à autrui et la question cruciale de la liberté individuelle face au mal.
Arezou Davdar (Omni)Présence d’Albert Camus en Iran
Albert Camus, figure emblématique de la littérature du XXe siècle, a profondément influencé l’Iran par ses réflexions sur l’absurde, la révolte et la condition humaine. Ses œuvres, largement traduites, ont captivé écrivains, traducteurs et penseurs iraniens, trouvant un écho dans les bouleversements socio-politiques du pays. Des romans comme L’Étranger et La Peste, ainsi que des pièces telles que Caligula, ont été adaptés pour refléter les réalités locales, devenant des références dans la littérature et le théâtre iraniens. Des auteurs comme Jalâl Âl-e Ahmad et des poètes comme Ahmad Châmlou s’inspirent de Camus, intégrant ses thèmes dans leurs créations. Les incessantes retraductions de ses textes, leurs ventes rapides et les fréquentes mises en scène témoignent de son impact dans la politique, la société, l’art et la philosophie en Iran. Cet article analyse la réception de Camus, de la sphère littéraire à la presse, en passant par les milieux universitaires et le grand public. Ses idées sur la tyrannie et la justice reflètent les luttes iraniennes, suggérant une exploration future de son influence sur des arts modernes comme le cinéma.
Jean-Pierre Barou, « Es-tu camusien ou sartrien ? »
Cette question, qui me fut posée par Daniel Cohn-Bendit, continue de s’élever comme un mur infranchissable. En choisir un, c’est éliminer l’autre. Certes, un affrontement a bel et bien existé entre les deux écrivains, Sartre assénant à Camus ce jugement à propos de L’Homme révolté paru en 1951 et qui suscita l’admiration de Hannah Arendt : « Et si votre livre témoignait de votre incompétence philosophique ? » Camus produisit une réponse officielle dans laquelle il se refusait d’être, contrairement à Sartre, « au service de l’histoire » – déjà, en 1948, il avait opposé « l’esprit historique », conduisant à ses yeux à un nihilisme immoral, à « l’artiste », que la beauté protège de cette démesure. Et une réponse officieuse : une pièce, L'Impromptu des philosophes, restée quasiment secrète jusqu’en 2006 – Sartre y est caricaturé sous les traits de « M. Néant ». Fallait-il en rester là ? C’était figer Camus et Sartre dans des rôles périmés, oublier que Sartre devait à partir des années 70 plonger dans la question morale jusqu’à interroger le « phénomène religieux. » Oublier l'intérêt que Camus ne cessa de porter lui-même à cette question, à la responsabilité : « Je me révolte, donc nous sommes. » Ne pas tenir compte de la convergence qui les unit au-delà de cette dispute, c’est les figer dans une posture mortifère.