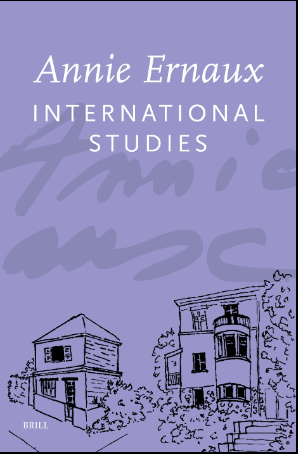
Annie Ernaux au-delà des œuvres consacrées : premiers romans, textes courts, entretiens (Annie Ernaux International Studies, n° 2 )
Appel à contributions
Annie Ernaux International Studies (éd. Michèle Bacholle et Jacqueline Dougherty)
n° 2 : « Annie Ernaux au-delà des œuvres consacrées : premiers romans, textes courts, entretiens »
Dir. Fanny Cardin, Maryline Heck, Adèle Plassier Angoujard
Si l’œuvre d’Annie Ernaux a donné lieu depuis les années 1990 à une production critique très dense [1], celle-ci a privilégié certains livres de l’auteure, qu’il s’agisse des récits auto-socio-biographiques (La Place, Une femme), des entreprises d’écritures mémorielles comme La Honte, L’Évènement, Les Années ou Mémoire de fille), des journaux extimes (Journal du dehors, La Vie extérieure, Regarde les lumières mon amour), ou des récits intimes comme Passion simple ou L’Usage de la photo. Au-delà de ces textes, une quantité importante d’écrits reste encore peu étudiée, à commencer par les trois premiers romans (Les Armoires vides, Ce qu’ils disent ou rien, La Femme gelée). Mais ce sont aussi les entretiens, les extraits de journaux (journaux intimes ou journaux d’écriture) ainsi que l’ensemble conséquent de textes courts publiés par l’auteure (récits, essais, articles, tribunes...) [2] qui demandent à être commentés. Ces derniers sont particulièrement éclectiques dans leurs formats comme dans leurs modes de publication (recueils et anthologies, presse, ouvrages collectifs ou numéros de revue). Ce numéro se propose de renouveler les approches de l’œuvre d’Annie Ernaux, en invitant à se pencher sur ces textes peu investis par la critique.
Les propositions de chapitres pourront porter sur un texte précis ou sur un corpus spécifique. Malgré la grande hétérogénéité de ces écrits, il s’agira d’interroger les échos qui peuvent se tisser entre eux, comme entre certains de ces textes et le reste de l’œuvre d’Annie Ernaux [3]. Nous invitons les contributrices et contributeurs à étudier les dynamiques de confirmation ou d’inflexion qui lient ces textes aux livres les plus connus, mais aussi les lignes de forces potentiellement nouvelles ou les nuances qu’ils permettent de dégager, pour interroger leur place dans la poétique ernausienne. Voici quelques éléments de problématisation – non limitatifs – que nous proposons de creuser.
1. Continuités, circulations et dialogues critiques.
Des enjeux et thèmes transversaux sont communs aux premiers romans, aux textes courts et au reste de l’œuvre, tels que le deuil, le changement de classe sociale, les voyages, la maladie ou encore la sexualité. Les rapprochements entre les textes moins étudiés et d’autres plus connus seront ainsi les bienvenus, comme cela a pu être déjà fait entre Les Armoires vides et L’Évènement. On pourra s’interroger sur la façon dont la forme romanesque ou les formes brèves influent sur la manière dont Ernaux écrit ces thématiques spécifiques, ou souligner au contraire les lignes de force qui perdurent au-delà des époques et des genres.
Les nouvelles et courts textes narratifs, rassemblés pour certains dans Écrire la vie, le récent Cahier de l’Herne ou le recueil Hôtel Casanova et autres textes brefs, constituent un corpus riche et encore peu exploité, à mettre en regard des récits longs. Des analyses précises sur l’un ou l’autre de ces textes peuvent être proposées, ainsi que des études sur les rapports intertextuels avec les livres plus connus – à l’instar des échos qui rapprochent par exemple le texte « Hôtel Casanova » de Une femme et de « Je ne suis pas sortie de ma nuit ».
On pourra aussi poursuivre l’analyse, déjà initiée par plusieurs chercheurs et chercheuses, du dialogue que les livres d’Annie Ernaux entretiennent avec ses textes critiques sur l’écriture et sur la littérature, en mettant l’accent sur ces derniers. Une étude diachronique de ces textes pourrait interroger les évolutions des positions de l’auteure à travers le temps. On pourra également se pencher sur les textes dans lesquels Ernaux revient sur ses influences littéraires, de Proust à Simone de Beauvoir en passant par Pavese et Bourdieu, entre autres [4]. Il conviendra aussi de prendre en compte les différentes formes empruntées par l’auteure pour développer ses positions critiques, tels que les entretiens [5], les discours ou les textes indépendants. Par exemple, le rapport d’Ernaux à la question du genre et du féminisme pourrait être envisagé, du « je » « à peine sexué » de l’article « Vers un je transpersonnel » à l’inscription de l’écriture dans « une aire à la fois sociale et féministe » (discours de réception du Prix Nobel).
2. Inflexions poétiques et politiques.
Par ailleurs, l’analyse de certains de ces textes peut aussi amener à identifier des inflexions au sein de l’œuvre ernausienne. La chronologie de ces publications par rapport au reste de la production gagnera à être étudiée, ainsi que la pertinence (ou non) d’effets de corpus génériques : Comment penser l’abandon du roman ? À partir de quand sont publiés les textes courts ? Des périodes de publications spécifiques sont-elles identifiables ? Les différentes formes textuelles explorées par l’auteure (courts textes narratifs, entretiens, journaux, articles variés, etc.) forment-elles des corpus cohérents ?
Les trois romans d’Annie Ernaux constituent ici un ensemble à part. Si Les Armoires vides a été beaucoup commenté, une petite poignée d’articles – anglophones seulement –, concernent Ce qu’ils disent ou rien. La Femme gelée est pour sa part rarement étudié en lui-même, mais seulement dans des études globales sur l’œuvre. Nous proposons d’interroger la spécificité de ces textes, mais aussi les résonances entre eux ou les échos avec les textes à suivre (notamment à l’aune du refus du roman amorcé par Ernaux en 1984). Le style enlevé et cru de ces récits d’enfance et d’adolescence, racontés par un « je » fictif mais proche de la trajectoire personnelle d’Ernaux, contraste avec l’écriture plate qui sera recherchée par la suite – mais manifeste déjà un mouvement contradictoire de refus et de désir de littérature.
Autre exemple de corpus bien distinct : les articles et tribunes d’Ernaux publiés de plus en plus fréquemment dans la presse à partir des années 2000. En prise directe avec l’actualité, qu’elle soit littéraire (comme la réponse à Richard Millet), ou politique (par exemple lors du mouvement des Gilets jaunes), ces textes témoignent de l’évolution du discours politique de l’auteure, mais aussi de sa posture littéraire. Les travaux de Jérôme Meizoz ou d’autres approches socio-poétiques de la littérature pourraient permettre de poursuivre l’analyse de la construction de la figure médiatique de l’auteure au regard de ces textes et de ses prises de positions politiques – son statut d’auteure reconnue ayant rendu légitime, par exemple, le fait d’adresser une « Lettre au Président » [6]. Un autre sous-corpus pourrait être composé des discours de réception de prix littéraires [7], qui contribuent également à forger la posture de l’auteure. Il serait intéressant de se pencher en particulier sur les enjeux et les attendus institutionnels de ce type de discours.
3. Enjeux de production, d’édition et de réception.
Les réflexions sur le contexte de publication des textes et les processus de production, d’édition et de réception sont également encouragées. Les textes courts, qui sont bien souvent le fruit de commandes, engagent différents enjeux d’écriture et de publication, selon qu’ils sont publiés dans la presse ou dans des volumes : que font la commande et le format à l’écriture d’Ernaux, en termes de style mais aussi de rapport à cette nécessité « vitale » d’écrire [8] qui conditionne l’élaboration de nombre de ses livres ? Il paraît crucial d’interroger les dispositifs de commande à l’aune de l’écriture. Une approche génétique, grâce au fonds Annie Ernaux de la BNF, pourrait aussi enrichir cette approche – les archives concernant L’Autre fille montrent, par exemple, que la rédaction aurait commencé avant la commande de NiL Éditions. On pourrait se pencher, à l’occasion de ce numéro, sur les journaux publiés par extraits, par exemple dans le photojournal qui ouvre Écrire la vie ou dans les Cahiers de l’Herne. On peut interroger ici les stratégies de publication des inédits, leur dissémination à travers différents volumes et le travail éditorial impliqué. Les études sur le journal d’écriture de L’Atelier noir et ses deux versions différentes sont également les bienvenues. On pourra également analyser la remédiatisation des textes courts dans l’anthologie Quarto, le recueil Folio ou le Cahier de l’Herne : Dans quelle mesure ces volumes nous invitent-ils à tisser des liens entre ces productions variées ? Quels effets de corpus créent-ils ?
On invitera enfin à interroger la place des différents corpus dans le contexte de la reconnaissance critique de l’auteure. La présence de textes d’Ernaux en ouverture d’un livre [9] ou dans des numéros de revue [10] traduit l’autorité liée depuis plusieurs années maintenant à sa signature. Ces questionnements rejoignent ceux évoqués plus haut sur la posture d’auteure et sur la manière dont les modes de publication des textes y participent. À titre d’exemple, les entretiens [11] dessinent un corpus spécifique (en particulier les trois dialogues qui ont donné lieu à une publication séparée, L’Écriture comme un couteau, Le Vrai lieu et Une conversation) qui pose de manière singulière la question d’une auctorialité partagée ou non, et du choix éditorial de proposer la publication au nom d’Annie Ernaux.
Le travail initié par ce numéro engage enfin à interroger la réception de ces différents corpus dans des cadres institutionnels variés, qu’il s’agisse de l’enseignement secondaire ou de la critique universitaire. On pourrait ainsi réfléchir à la manière dont ils éclairent les processus d’institutionnalisation de l’œuvre de l’auteure, les éventuelles dynamiques de majoration et de minoration de certaines productions spécifiques – vis-à-vis des hiérarchies [12] qui structurent le champ littéraire, les textes étudiés ici sont-ils des textes mineurs ? –, et leurs évolutions.
—
Notes
[1] Pour un état de l’art problématisé de la critique ernausienne, on se reportera à l’article d’Élise Hugueny-Léger, « État présent. Annie Ernaux », French Studies, vol. 72, n°2, 2018, p. 256-269. Une bibliographie rigoureuse et actualisée est disponible sur le site annie-ernaux.org, créé par Élise Hugueny-Léger et Lyn Thomas.
[2] On trouve une liste précise de ces textes sur le site annie-ernaux.org, à l’adresse suivante : https://www.annie-ernaux.org/fr/publications-2/.
[3] Si cela semble pertinent, des comparaisons avec l’œuvre d’autres écrivains et écrivaines peuvent être envisagées.
[4] Pensons à « Cesare Pavese », « Bourdieu, le chagrin », tous deux reproduits dans Écrire la vie, ou encore à « L’art d’écrire : Wolf, Breton, Perec ou les années de formation », texte inédit publié sur annie-ernaux.org.
[5] On songe bien sûr aux trois entretiens publiés, L’Écriture comme un couteau (Avec Frédéric-Yves Jeannet, Stock, 2003), Le Vrai lieu (avec Michelle Porte, Gallimard, 2014) et Une conversation (avec Rose-Marie Lagrave, EHESS 2023) mais aussi à tous les entretiens donnés régulièrement par Ernaux à la presse, ou encore à ses dialogues avec des chercheurs et chercheuses.
[6] « Sachez, Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie... », lettre d’Annie Ernaux, France Inter, 30 mars 2020.
[7] Voir notamment le Discours prononcé à l’Université de Cergy-Pontoise en 2014, le texte « Un Prix. Que signifie ‘recevoir un prix?’ » écrit pour la réception du prix Marguerite Yourcenar en 2017 et publié dans Écrire la vie, le discours de réception du Prix Formentor en 2019 publié dans le Cahier de l’Herne et enfin celui de réception du Prix Nobel en 2022.
[8] Annie Ernaux écrit dans Mémoire de fille (Paris, Gallimard, 2016, p. 18) : « Aucun autre projet d’écriture ne me paraît, non pas lumineux, ni nouveau, encore moins heureux, mais vital, capable de me faire vivre au-dessus du temps. Juste 'profiter de la vie' est une perspective intenable, puisque chaque instant sans projet d’écriture ressemble au dernier. »
[9] Annie Ernaux rédige par exemple la préface de Vanité plurielle d’Olivier Tomasini, Grenoble, Critères édition, 2012.
[10] Les références sont très nombreuses mais l’on peut citer « Parmi les rares photos de famille... », Acteurs du siècle, Bernard Thibault (dir.), Paris, Le Cercle d’Art, 2000, « "Le fil conducteur" qui me lie à Beauvoir », Simone de Beauvoir studies, n°17, 2000-2001, ou encore « La honte, manière d’exister, enjeu d’écriture », Lire, écrire la honte, Bruno Chaouat (dir.), Presses universitaires de Lyon, 2007.
[11] Voir à ce sujet le travail d’Odile Cornuz sur le livre d’entretien dans D’une pratique médiatique à un geste littéraire : le livre d’entretien au XXe siècle, Genève, Librairie Droz, 2016.
[12] Luc Fraisse (dir.), « Les hiérarchies littéraires » [dossier], Revue d’Histoire Littéraire de la France, PUF, Mars- Avril 1999.
—
Modalités de contribution
Les propositions de communication (250-300 mots, anglais ou français), accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à adresser à Maryline Heck (heckmaryline@yahoo.fr), Fanny Cardin (fanny.cardin@gmail.com) et Adèle Plassier Angoujard (pa.adele@gmail.com) d’ici le 15 décembre 2025.
Le numéro fera partie de la nouvelle collection Annie Ernaux International Studies, dirigée par Michèle Bacholle et Jacqueline Dougherty et bientôt publiée chez Brill. Il sera intégralement en français : les articles devront être rédigés dans cette langue.
—
Calendrier prévisionnel :
Décembre 2025 : envoi des propositions
Janvier 2026 : retour sur les propositions
Mai 2026 : soumission des articles complets
2026-2027 : relectures en double aveugle et préparation de la publication, à paraître en septembre 2027
—
Bibliographie indicative :
ADLER, Aurélie, Éclats des vies muettes : Figures du minuscule et du marginal dans les récits de vie d’Annie Ernaux, Pierre Michon, Pierre Bergounioux et François Bon, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012.
––, avec Julien PIAT, Julien et Valérie MONTÉMONT (dir.), « Annie Ernaux, les écritures à l’œuvre » [dossier], Fabula / Les colloques [en ligne], disponible sur : https://www.fabula.org/colloques/sommaire6613.php.
BACHOLLE, Michèle, Annie Ernaux : De la perte au corps glorieux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
BEST, Francine, BLANCKEMAN, Bruno et DUGAST-PORTES, Francine, (dir.), Annie Ernaux : Le Temps et la Mémoire. Colloque de Cerisy, Paris, Colloque de Cerisy/Stock, 2014.
CHALONGE, Florence de, et DUSSART, François (dir.), « Annie Ernaux, une écriture romanesque » [dossier], Littérature, n°206, 2022, disponible sur : https://shs.cairn.info/revue-litterature-2022-2.
CHARPENTIER, Isabelle, « “Quelque part entre la littérature, la sociologie et l’histoire...”: L’œuvre auto-sociobiographique d’Annie Ernaux ou les incertitudes d’une posture improbable », COnTEXTES [en ligne], n°1, 2006, disponible sur : https://journals.openedition.org/contextes/74.
CORNUZ, Odile, D’une pratique médiatique à un geste littéraire : le livre d’entretien au XXe siècle, Genève, Librairie Droz, 2016.
DUGAST-PORTE, Francine, Annie Ernaux : Étude de l’œuvre, Paris, Bordas, 2008.
FRAISSE, Luc (dir.), « Les hiérarchies littéraires » [dossier], Revue d’Histoire Littéraire de la France, Année 99, n°2, Mars-Avril 1999, PUF.
FORT, Pierre-Louis (dir.), L’Herne : Annie Ernaux, Paris, L’Herne, coll. « Cahiers de L’Herne », 2022.
FORT, Pierre-Louis, et Violaine HOUDART-MEROT (dir.), Annie Ernaux : Un engagement d’écriture, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Fiction/Non-Fiction 21 », 2015.
HECK, Maryline, Écriture et expérience de la vie ordinaire. Perec, Ernaux, Vasset, Quintane, Bruxelles, La Lettre Volée, coll. « Essais », 2023.
HUGUENY-LÉGER, Élise, Annie Ernaux, Une poétique de la transgression, Oxford/New York, Peter Lang, coll. « Modern French Identities », 2009.
––, « État présent. Annie Ernaux », French Studies, vol. 72, n°2, 2018, p. 256-269.
HUNKELER, Thomas, avec Marc-Henry SOULET (dir.), Annie Ernaux, Se mettre en gage pour dire le monde, Genève, Métis Presse, coll. « Voltiges », 2012.
KAHN, Robert, MACÉ, Laurence et SIMONET-TENANT, Françoise (dir.), Annie Ernaux : l’intertextualité, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015.
MEIZOZ, Jérôme, Postures littéraires : Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine, 2007.
MAINGUENEAU, Dominique, Le Discours littéraire, Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, coll. « U. Lettres », 2004.
THOMAS, Lyn, Annie Ernaux, à la première personne [1999], trad. de l’anglais par Dolly Marquet, Paris, Stock, 2005.
THUMEREL, Fabrice (dir.), Annie Ernaux, une œuvre de l’entre-deux, Arras, Artois Presse Université, coll. « Études littéraires », 2004.
VILLANI, Sergio (dir.), Annie Ernaux : Perspectives critiques, Toronto, Legas, 2009.
ZENETTI, Marie-Jeanne, « Une filiation en forme de phrases. Mémoire en exergue et mise en question du canon dans l’œuvre d’Annie Ernaux », dans Robert KAHN, Laurence MACÉ et Françoise SIMONET-TENANT (dir.), Annie Ernaux: l’intertextualité, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p. 193-203.