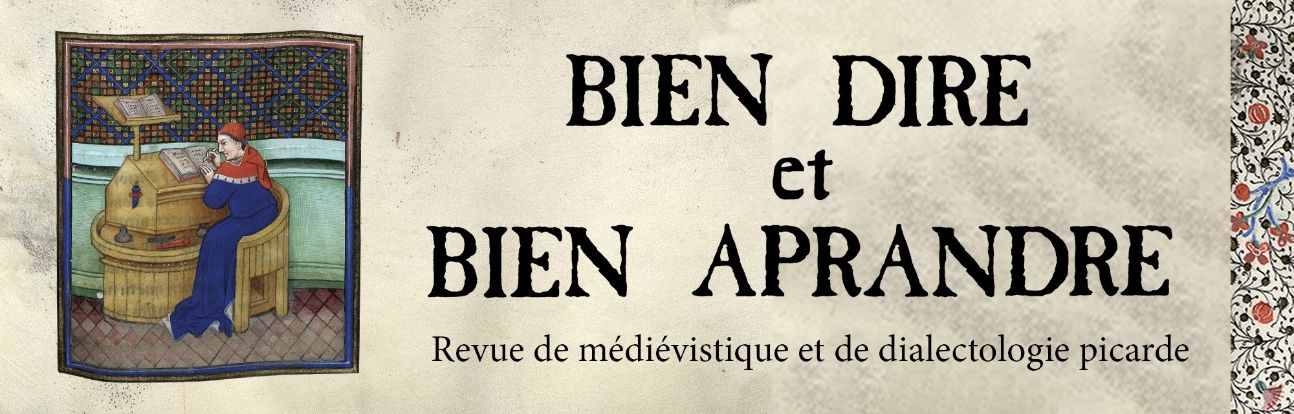
Le Moyen Âge à l’opéra
Revue Bien Dire et Bien Aprandre, n°41, 2026
Numéro dirigé par Marie-Madeleine Castellani et Matthieu Marchal
C’est peu dire que le Moyen Âge a des liens avec l’opéra ; depuis l’origine du genre, il l’irrigue et le nourrit, lui offrant des sujets exploités aussi bien dans le grand opéra du XIXe siècle que dans les formes baroques ou contemporaines.
S’il s’inspire de l’Antiquité dans ce que l’on considère comme les premiers opéras, Monteverdi met en scène, lors du Carnaval de 1624, dans un de ses madrigaux guerriers, Il combattimento di Tancredi e Clorinda, sujet venu directement de la Première croisade, certes à travers le filtre de la Gerusalemme liberata du grand Tasse (1581), deux chevaliers en armure qui s’affrontent dans un palais vénitien. Cet ouvrage, « au carrefour du madrigal et de l’opéra », a pu être qualifié d’« opéra miniature d’avant-garde » lors de sa reprise en 2020 au théâtre des Champs Élysées. Tancrède sera encore le héros de deux œuvres plus tardives, l’une d’André Campra (1702) l’autre de Rossini (1813), opera seria ou melodramma eroico, ici à travers le Tancrède de Voltaire, sur lequel s’appuie le livret, Rossini ayant également composé un Guillaume Tell.
Les siècles classiques et la musique baroque ont donné naissance à plusieurs opéras inspirés de la Jérusalem délivrée ou des figures épiques de Roland et Renaut de Montauban (Rinaldo de Haendel, 1711 ou Orlando furioso de Vivaldi, 1727), tandis qu’André Grétry compose en 1784 un Richard cœur de lion dont le grand air de Blondel, « Ô Richard, ô mon roi », a été perçu comme un hymne à la royauté.
Le XIXe siècle est particulièrement représentatif de la présence du Moyen Âge à l’opéra avec Euryanthe de Carl Maria von Weber (1823), d’après l’histoire de Gérard de Nevers, et surtout Verdi qui a puisé dans le passé médiéval le sujet de plusieurs de ses œuvres, qu’il s’agisse des croisades, avec I Lombardi à la prima cruciata (1843) et Jerusalem (1847), de Giovanna d’Arco (1845, sur un livret de Schiller), de Macbeth (1847, inspiré par Shakespeare), ou encore des Vêpres Siciliennes (1855), ou du célèbre Trovatore (1857). On pourra citer aussi le grand opéra français avec Margherita d’Anjou (1820) et surtout Robert le diable (1831) de Meyerbeer. Le décor du Faust de Gounod (1859) est bien médiéval, comme le montrent aussi bien le film de Murnau que sa représentation à l’opéra dans San Francisco (1936). Le domaine arthurien est également présent avec Le Roi Arthur, le semi-opéra de Purcell et surtout Le Roi Arthus d’Ernest Chausson (1903), dont le livret, rédigé par le compositeur, puise directement aux œuvres d’origine. Rappelons que le sujet de Pelléas et Mélisande (1902) a pu lui aussi être rapproché de légendes médiévales.
Si ces œuvres sont généralement parvenues aux compositeurs par des intermédiaires postérieurs au Moyen Âge, en revanche tous les opéras de Wagner, à une exception près, mettent en œuvre des héros médiévaux, le livret s’appuyant sur des textes anciens que le compositeur possédait dans sa bibliothèque, comme le Parsifal de Wolfram d’Eschenbach ou le Tristan de Gottfried de Strasbourg.
La période contemporaine s’intéresse aussi à ce passé médiéval : L’Amour de loin de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho reprend la légende du troubadour Jaufré Rudel, sur un livret de l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf. Plus récemment encore, Wim Henderickx a composé, d’après le roman à sujet médiéval Le Cœur converti de Stefan Hertmans (2018), The convert, créé à l’opéra des Flandres (Anvers-Gand) et à l’opéra de Rouen durant la saison 2022-2023, signe que la source n’est toujours pas tarie.
L’opéra étant aussi un spectacle vivant, il pose la question de la mise en scène et de la représentation de la période médiévale : on ne peut qu’évoquer ici les multiples mises en scène de Wagner allant de la « reconstitution » (celles de Bayreuth au XIXe siècle) à des versions épurées (Wieland Wagner, 1951, Patrice Chéreau, Olivier Py…) ou transposées dans des périodes contemporaines (Simon Stone, Aix-en-Provence, 2021) ou encore utilisant la vidéo (Peter Sellars, Paris Bastille, 2005). Mais toutes les œuvres à sujet médiéval sont concernées par cette problématique de la représentation.
Les liens entre opéra et Moyen Âge semblent être un domaine de recherches actuel : ce sera l’une des thématiques du prochain congrès Rencesvals (à Neuchâtel) et un colloque comparatiste sur « Les Grandes Figures historiques à l’opéra » se tiendra à Lille en décembre 2025, avec des interventions portant sur des héros médiévaux, notamment Jeanne d’Arc.
Dans le cadre du présent numéro, une approche résolument pluridisciplinaire est privilégiée. L’ambition des recherches est de dépasser les cloisonnements traditionnels pour proposer des interprétations novatrices des œuvres étudiées. Nous encourageons vivement les propositions qui explorent les interactions fécondes entre différentes disciplines telles que la littérature, la musicologie, l’histoire, les études théâtrales et l’iconographie. Les propositions d’articles sont ouvertes à diverses thématiques, incluant en particulier l’analyse des livrets d’opéra et de leurs sources médiévales. Concernant cet axe, les contributions pourraient s’intéresser aux processus d’adaptation et de transformation des récits, aux évolutions des thèmes et des personnages, à la persistance ou à la réinvention des structures narratives, ainsi qu’aux dialogues intertextuels entre les époques. L’étude de la musique peut être également envisagée dans une perspective historique élargie, du baroque à l’époque contemporaine. Les propositions pourraient ainsi explorer les évolutions des formes musicales, les interactions entre musique et société, le rôle des institutions et des mécènes, ainsi que les influences réciproques entre les compositeurs, les metteurs en scène et les interprètes. Enfin, il serait intéressant d’examiner en profondeur les motivations et les circonstances – qu’elles soient politiques, sociales, économiques ou culturelles – qui ont conduit à la création de ces œuvres durant des périodes historiques spécifiques.
Les projets d’article (entre 3000 et 5000 caractères, avec bibliographie primaire et secondaire indicative, 5-10 mots-clés, et un bref curriculum-vitae de 5-10 lignes) sont à adresser avant le 7 septembre 2025 à : contact-revue-bdba@univ-lille.fr
Procédure d’évaluation : évaluation par double expertise.
Calendrier :
- 7 septembre 2025 : réception des projets d’article.
- 15 octobre 2025 : notification des décisions d’acceptation ou de refus aux auteurs.
- 1er mars 2026 : réception de la première version des articles, puis début de la double évaluation.
- 15 juin 2026 : livraison des textes définitifs par les auteurs dont les articles ont été acceptés, après les éventuelles corrections d’ordre scientifique ou de forme.
- Octobre 2026 : publication du numéro de la revue.