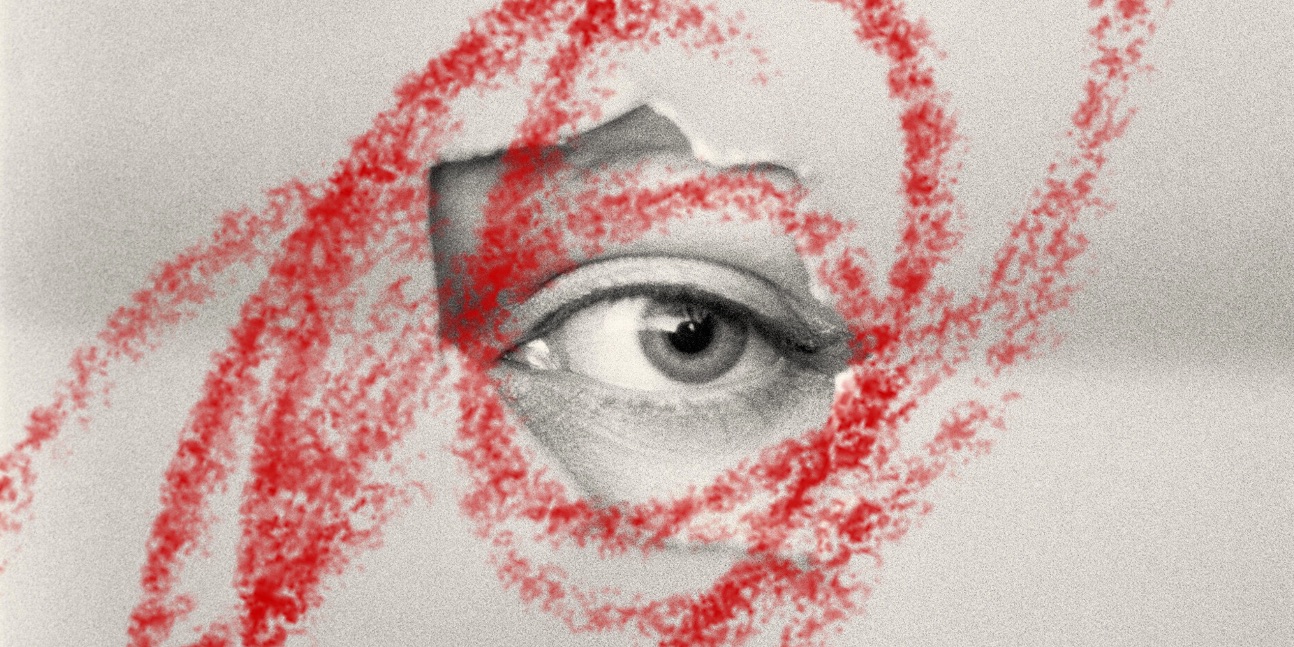
PORNOGRAPHIE À BABEL
Traduction, sexualité, obscénité
Conférence internationale bilingue
23–24 octobre 2025, Université d’Anvers, Belgique
À de maintes reprises, la littérature « pornographique » – du grec ancien πορνη (prostituée) et γραφω (écriture/peinture) – a été vilipendée pour sa nature brutale, transgressive et obscène. Alternant des passages érotiques et philosophiques, elle se prête une double lecture : l’une littéraire, l’autre aphrodisiaque. Cette ambivalence, à la fois thématique et suggestive, lui vaut d’être souvent la cible de vives critiques dans des débats sociétaux, où elle devient le terrain d’affrontements idéologiques, sinon un objet caché et relégué au non-dit. Véhiculant des représentations sexuelles aux formes diverses, elle a néanmoins commencé à s’imposer progressivement dans le champ académique, où des chercheureuses tentent d’examiner les modalités de ces représentations et les ressorts qui les sous-tendent. Ce faisant, la « pornologie » remet en question la complexité du pornographique sans chercher à le défendre ou à le condamner sur le plan moral (Hubier, 2021).
C’est dans cette optique qu’il convient de s’interroger sur ce qui constitue véritablement l’essence de la littérature pornographique, une fois mise entre parenthèses sa réception sociocritique. Certes, cette littérature brave le champ du dicible en jouant souvent la carte du vulgaire et de l’obscène, mais son réalisme stylistique marqué sert nettement à rendre le récit plus palpable et évocateur, qu’il s’agisse de susciter l’excitation, le choc ou la violence. Les textes pornographiques et les pensées hétérodoxes qu’ils renferment nous invitent à réfléchir aux stratégies qu’ils déploient pour détourner la censure et défier les idéologies dominantes. N'est-ce pas précisément parce qu’elle est aux prises avec le pouvoir que la littérature pornographique se voit censurée, voire interdite, et qu’elle est contrainte de passer sous le manteau ? Ou qu’elle est requalifiée en « littérature érotique » dans les paratextes afin de ne pas trop blesser la pudeur ? Par ces détours euphémiques et ces appellations édulcorées l’on démontre combien cette littérature reste sous l’emprise des normes sociales et du regard que porte sur lui son lectorat. Sa définition, en constante évolution, reflète les mutations des tabous sexuels à travers le temps – pensons par exemple à la pathologisation psychanalytique des fétiches ou encore à la tension que Foucault identifie entre ars erotica et scientia sexualis(1976).
Porteuse de sexualité et de volupté, la littérature pornographique s’est répandue aux quatre coins du monde, même jusqu’à Babel, symbole de la traduction. En franchissant – et bien souvent transgressant – de multiples frontières culturelles, elle a été traduite et adaptée. Or ce voyage transculturel soulève une question délicate : comment « traduire pour faire jouir » (Boulanger, 2013) ? Comment traduire la poétique transgressive de la littérature pornographique ? Traduire le pornographique, c’est inévitablement s’inscrire dans un rapport avec le discours dominant et les représentations mouvantes des sexes (et du sexe), genres, sexualités, corps et identités. De là, évidemment, que la traduction du pornographique exige une attention particulière à la langue cible et à la culture d’arrivée. Si la traduction est censée refléter une imagination sexuelle « équivalente », elle nous incite à nous questionner sur les manières dont les cultures façonnent ce qui est ressenti comme érotique, voire pornographique. Les choix lexicaux et le champ sémantique mis en œuvre dans la traduction jouent, par conséquent, un rôle primordial dans la reconstruction de la charge érotique du texte. Se pose également la question de la relation entre traduction et double lecture de la littérature pornographique : selon les stratégies de traduction mis en œuvre et l’appareil péritextuel accompagnant la traduction, celle-ci peut privilégier une lecture littéraire ou, au contraire, aphrodisiaque. Dans la lignée des réflexions de Toury (1995), comment l’acceptabilité de la traduction pornographique s’ajuste-t-elle à ce que la culture d’arrivée considère comme recevable ?
Aussi pourrait-on, à l’instar de Kaminski (2018), se demander si cet entremêlement culturel et idéologique ne ferait pas glisser la traduction pornographique vers l’adaptation pornographique. En effet, adapter, faire circuler et éditer en traduction des textes pornographiques, et donc des textes à forte charge transgressive, requiert parfois la mise en place de stratégies novatrices pour recontextualiser l’œuvre dans la culture cible : dans quelle mesure les paratextes dévoilent-ils des prises de position au sein des débats sociétaux et idéologiques dont fait l’objet la littérature pornographique ? L’intérêt porté à la réception de ces textes traduits est susceptible de révéler pourquoi l’on traduit des textes que l’on tend, par ailleurs, à dissimuler. Si cette littérature est, par essence, transgressive, ne peut-on argumenter dès lors que le fait de la traduire constitue en soi un acte transgressif ?
Dans le prolongement de ces réflexions, les contributeurices sont encouragé.e.s à repenser les traductions de littérature pornographique en fonction de sa double lecture, à envisager ces textes traduits sous un angle philosophique, à interroger les manières dont la traduction reformule ou reconfigure les notions du pornographique, de l’obscène et de la sexualité au-delà des frontières culturelles, et à reconsidérer l’impact de la sexualisation de la culture sur la production littéraire et traductive. Bien que le colloque soit bilingue français-anglais, nous accueillerons des communications sur des études de cas portant sur toutes combinaisons linguistiques, de n’importe quelle période historique, ainsi que des propositions de communication théoriques ou méthodologiques.
Nous accueillerons avec intérêt des propositions portant sur les thèmes suivants (liste indicative et non exhaustive) :
- Théorie et méthodologie de la traduction du pornographique
- Circulation/sociologie/marginalisation de la littérature pornographique en traduction
- Histoire/émergence de la littérature pornographique en traduction
- Traductions et adaptations érotiques/pornographiques
- Pratiques de la traduction d’œuvres/de passages pornographiques
- Traduire la langue érotique : stylistique, discours, sémiose, imaginaire, désir
- Littérature pornographique en traduction et censure, discours, pouvoir, idéologie
- Rôles des traducteurices de littérature pornographique, paratextes, édition
- Manipulation de sexe(s), sexualités, genres, corps, identités en traduction
- Obscénité, transgression, perversion, vulgarité, grivoiserie, obsession, tabou en traduction
- Traduction féministe/activiste et littérature pornographique
- Littérature pornographique en traduction et chair, lecture corporelle, lecture érotique, performativité
- Philosophie de la traduction du pornographique : ontologie, épistémologie, herméneutique, phénoménologie, praxéologie, éthique
Keynotes
Frédéric Lagrange (Sorbonne Université, CEREJ)
Pauline Henry-Tierney (Newcastle University)
Petra Van Brabandt (Sint Lucas Anvers)
Will McMorran (Queen Mary University of London)
Comité scientifique
Philippe Vanhoof, Katrien Lievois, Kris Peeters (Université d’Anvers, unité de recherche TricS).
—
Modalités de l’envoi des communications
Les propositions de communications en français ou en anglais de 500 mots au maximum (références incluses) accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique seront téléversées via ce formulaire au plus tard le 30 juin 2025 : https://forms.gle/yRCAC6gQcfmWRrRh7.
La durée prévue des communications est de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Le comité scientifique notifiera sa décision aux intervenant.e.s avant le 15 juillet 2025. En cas de questions et pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à Philippe Vanhoof : (philippe.vanhoof@uantwerpen.be).
—
Bibliographie sélective
Boulanger, P.-P. (2013). « Traduire pour faire jouir ». In P.-P. Boulanger (dir.), Traduire le texte érotique, Presses de l’Université du Québec, coll. « Figura », 41–56.
Coleman, L., & Held, J. (eds). (2014). The Philosophy of Pornography: Contemporary Perspectives. Rowman & Littlefield.
Colligan, C. (2024). Translating Pornography: The Case of Henriette Doucé. In B. J. Baer & S. Bassi, The Routledge Handbook of Translation and Sexuality, Routledge, 210–229.
Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Gallimard.
Henry-Tierney, P. (2023). Translating Transgressive Texts: Gender, Sexuality and the Body in Contemporary Women’s Writing in French. Routledge.
Hibbs, S., Şerban, A., & Vincent-Arnaud, N. (dirs.). (2018). Corps et traduction, corps en traduction. Lambert-Lucas.
Hubier, S. (2021). Pornologie. Le murmure.
Kaminski, J. (ed.). (2018). Erotic Literature in Translation and Adaptation. Legenda.
Lagrange, F., & Savina, C. (dirs). (2020). Les Mots du désir : La langue de l’érotisme arabe et sa traduction. Diacritiques Éditions.
Maingueneau, D. (2007). La littérature pornographique. Armand Collin.
McMorran, W. (2017). The Marquis de Sade in English, 1800-1850. Modern Language Review, 112(3), 549–566.
Santaemilia, J. (ed.). (2005). Gender, Sex and Translation: The Manipulation of Identities. St. Jerome Publishing.
Sontag, S. (1967). The Pornographic Imagination. In S. Sontag, Styles of Radical Will, Farrar, Strauss and Garrax, 1969, 205–233.
Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. John Benjamins.
Van Brabandt, P., & Maes, H. (2021). Kunst of pornografie? Een filosofische verkenning. ASP Editions.