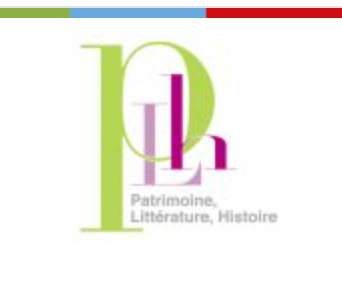
Hétérolinguisme et traduction comme acte et sources de création littéraire (Toulouse & en ligne)
Appel à communications pour une journée d’étude
Hétérolinguisme et traduction comme acte et sources de création littéraire
L’hétérolinguisme se définit dans les termes de Rainier Grutman comme la présence dans le texte « d’idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit, aussi bien que de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principale » (Grutman, 2019 : 60). Dans d’autres termes, la notion d’hétérolinguisme désigne et renvoie à ce phénomène de mise en scène de la pluralité linguistique, d’écriture avec les langues, d’hétérogénéité ainsi que les rapports de force et d’interaction dans un texte, car il vise principalement l’aspect littéraire de ce fait.
De nos jours, l’écriture hétérolingue est une caractéristique incontournable des productions littéraires et culturelles contemporaines en raison des mouvements d’échanges et de transferts qui se multiplient entre les sociétés contemporaines, ainsi que de l’ampleur prise par les phénomènes d’exil et de migration à travers le monde (Bianco et Cermakian, 2025). Cette écriture créative s’appuie sur la traduction interlinguistique comme acte de création (Zouini, 2021) notamment dans les textes littéraires arabophones, francophones ou anglophones produits par des écrivain.e.s, bilingues au moins, qui se situent à la croisée des langues (Gauvin, 2006 : 14) qui engagent un jeu de langues dans leur langue d’écriture. Cette production inclut également les travaux issus de contextes multilingues, notamment dans des pays où coexistent plusieurs langues, tels les pays arabes ou les pays membres de l’ex-Union soviétique.
Dans ce processus, l’auteur ou l’autrice effectue une première traduction de sa langue maternelle vers sa langue d’écriture, inscrivant ainsi des réalités linguistiques et son propre imaginaire. Cette pratique, qualifiée d’écriture hétérolingue, se nourrit souvent de la traduction, non seulement comme un outil, mais comme une source ou une expérience d’altérité qui génère une nouvelle écriture et place la traduction au centre de la création littéraire.
D’une part, l’on peut trouver des auteurs et des autrices qui traduisent leurs propres textes dans une expérience d’auto-traduction, modifiant le sens et la structure du passage et créant ainsi des œuvres doubles, mouvantes (comme l’écrivain algérien arabophone Waciny Laredj et sa participation à la traduction de son roman Le livre de l’émir, l’écrivain saoudien francophone qui a traduit son propre roman La Ceinture en arabe, ou encore l’écrivain nord-américain d’origine irakienne Sinan Antoon, qui a traduire de l’arabe à l’anglais le roman The Corpse Washer). D’autre part, d’autres intègrent directement plusieurs langues dans leurs écrits, jouant avec la tension entre compréhensibilité et opacité (à l’instar des écrivain.e.s antillais.e.s, des écrivain.e.s de la diaspora, des écrivain.e.s arabes francophones ou anglophones, etc.). La traduction peut également mener à l’invention des formes de réécritures, où le texte traduit devient un palimpseste (Genette,1982), un dialogue avec d’autres langues et d’autres cultures.
Au cours de cette journée, on s’intéressera à cette poétique hétérolingue dans les textes, au rôle de la traduction comme source première de l’écriture de l’œuvre et aux modalités de son insertion pour assurer un seuil minimum de lisibilité au lecteur (Suchet, 2015 : 78).
Par ailleurs, l’une des questions que soulève la traduction d’un texte hétérolingue concerne, cette fois-ci, sa transposition d’une langue source à une langue cible en raison de la question de l’hétérogénéité linguistique. Il est bien entendu admis que toute traduction doit privilégier une version proche de l’original plutôt qu’une création nouvelle qui succombe à la tentation de se laisser inspirer par son propre talent d’écrivain, autrement dit à un dépassement du texte source (Berman, 1999 : 40). Toutefois, la présence d’hétérolinguisme peut conduire le sujet traduisant à faire appel à une démarche créative au moment de ce passage d’une langue à une autre qui n’est pas sans embûches. On peut penser aux réalia, à l’onomastique ou encore aux proverbes, ou, en d’autres termes, à tous ces éléments qui ancrent le texte source dans sa propre culture et que beaucoup de théoriciens (Maria Tymoczko, David Bellos, Paul Bendia, Myriam Suchet) ont évoqué en cherchant à élaborer des propositions aptes à prendre en compte le texte hétérolingue. Comment procéder donc face à la co-présence des langues au moment d’engager l’acte de traduire ? L’hétérolinguisme serait-il inconciliable avec la traduction ou bien son effacement en traduction pourrait-il donner lieu à d’autres stratégies créatives pour échapper au nivellement de la superposition des langues (Berman 1985 : 79) ? Et qu’elle est la place de la création et la créativité dans la traduction en situation hétérolingue ?
Sans se restreindre à une seule aire linguistique, cette journée explorera les axes suivants sans pour autant s’y limiter :
- Identité, hétérolinguisme, monolinguisme ;
- L’altérité comme expérience d’écriture hétérolingue ;
- L’hybridité comme processus d’écriture et de création ;
- Les dimensions créatrices de la traduction ;
- L’auto-traduction comme écriture double ;
- Écriture de soi et auto-traduction ;
- La visibilité et l’invisibilité du sujet traduisant ;
- Traduction, langue perdue, langue sauvée.
—
Les langues de la journée d’étude sont l’arabe, le français et l’anglais et les communications pourront être d’ordre théorique ou proposer une analyse de texte.
Modalités :
Les propositions de communication de 300 mots environ, accompagnées d’une courte biographie (Nom, prénom, statut, spécialité), d’un titre et d’une bibliographie non exhaustive, sont à envoyer au plus tard le 28 avril 2025 aux adresses ci-dessous.
Les réponses seront envoyées vers le 2 mai 2025.
Imane-Sara Zouini : imane.zouini@univ-tlse2.fr
Annamaria Bianco : annamaria.bianco@univ-tlse2.fr
—
La journée d’étude aura lieu les 16 & 17 septembre 2025 à la Maison de la recherche de l’Université Toulouse Jean Jaurès (5, allées Antonio-Machado 31058 TOULOUSE Cedex 9) en mode hybride (présentiel & distanciel) sous la forme d’une présentation de 20 minutes, qui sera suivie d’un échange d’environ 10 minutes.
Les contributions retenues mèneront à une publication sous la forme d’actes.
Le logement et le repas seront financés par l’organisation, les frais de transport seront laissés à la charge des équipes de recherche des participant.e.s.
Comité d’organisation :
Imane-Sara Zouini (ELH-PLH, Université Toulouse Jean Jaurès)
Annamaria Bianco (IREMAM, Université Aix-Marseille/Ifpo)
Bibliographie
Bellos, David, Is That Fish in Your Ear? The Amazing Adventure of Translation, Londres, Peingui, 2012.
Berman, Antoine, « La traduction et la langue française. », Meta, volume 30, numéro 4, décembre 1985, p. 341–342. https://doi.org/10.7202/002063ar
Bianco, Annamaria et Cermakian, Stéphane (dir.), Exil et Traduction. Regards sur un croisement fécond, Paris, Classiques Garnier, 2025.
Derrida, Jacques, « Des Tours de Babel », Psyché. L’invention de l’autre, Paris, Galilée, 1987.
El Qasem, Fayza, « Écriture de soi et autotraduction. Quelle marge de manœuvre pour l’auteur ? », L’erreur culturelle en traduction, édité par Stéphanie Schwerter et al., Presses universitaires du Septentrion, 2019.
Gauvin, Lise, L'écrivain francophone à la croisée des langues, Paris, Karthala, Lettres du Sud, 2009.
Grutman, Rainier, « Les motivations de l’hétérolinguisme : réalisme, composition, esthétique », dans Brugnolo et Orioles. Eteroglossia e plurilinguismo letterario II. Plurilinguismo e letteratura. Atti del XXVIII Convegno interuniversitario di Bressanone (6-9 luglio 2000), Il Calamo, Rome, 2002.
Grutman, Rainier, Des langues qui résonnent. L’hétérolinguisme au XIXe siècle québécois, Montréal, Fides-CÉTUQ, 1997.
Schwerter, Stéphanie, et al., éditeurs. L’erreur culturelle en traduction, Presses universitaires du Septentrion, 2019.
Suchet, Myriam, L’Imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Paris, éditions Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, série Littérature et mondialisation, 2014.
Tymoczko Maria, Translation, resistance, activism, Amherst, University of Massachusetts Press, 2010.
Zouini, Imane-Sara, « Traduire la littérature marocaine d’expression française : cas du roman Les Temps noirs d’Abdelhak Serhane », Accueillir l’Autre dans sa langue. La traduction comme dispositif de médiation, Pitannâ lìteraturoznavstva (Questions de critique littéraire), n° 103, Tchernivtsi, 2021, p. 72-84.