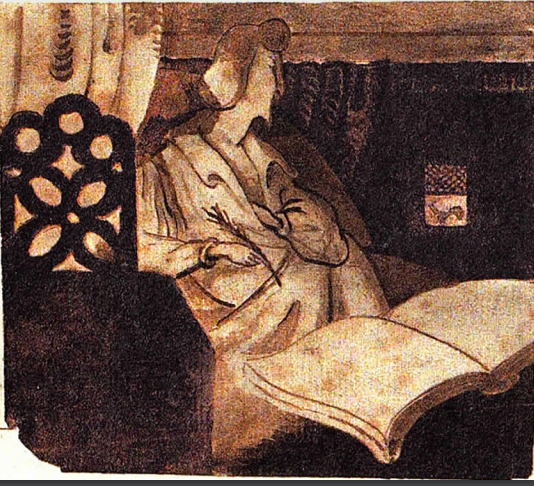
Séance 4, 3 avril 2025, 16h-19h
Alexandra Saemmer, « Éditer la poésie numérique »
Depuis plus d’un demi-siècle, des poètes expérimentent avec la matérialité du texte numérique. Les outils-logiciels jouent dans ce processus un rôle fondamental de « dispositif » au sens foucaldien : ils mettent à disposition des savoirs encodés dans des fonctionnalités, qui agissent comme des contraintes fructueuses ; mais ces savoirs également cadrent et orientent les possibilités expressives. C’est au plus tard lorsqu’un outil-logiciel devient obsolète, et que l’œuvre créée en appui sur lui se trouve à son tour condamnée à la disparition, que le dispositif s’impose avec violence comme une structure de pouvoir.
La poésie numérique est ainsi, depuis ses débuts, empreinte d’un paradoxe : elle a voulu se libérer des règles et contraintes de l’édition littéraire traditionnelle ; or, les technologies numériques la font littéralement marcher au pas.
Je montrerai dans une première partie quelques conséquences de cette dépendance vis-à-vis du dispositif technologique sur la poétique de l’œuvre numérique. Jean-Pierre Balpe, auteur fondateur de la poésie numérique en France, sera ensuite placé au centre de mon intervention. Depuis une quarantaine d’années et en appui sur une pléthore de dispositifs numériques (générateurs automatiques de texte, power point, blogs, plateformes sociales…), Jean-Pierre Balpe se saisit des contraintes et les fait jouer au sein des œuvres ; la disparition devient, dans certains cas, programme.
Je terminerai sur les défis que pose alors la réédition de ses œuvres que nous essayons d’engager actuellement, dans le cadre d’un projet de recherche porté avec Erika Fülöp et soutenu par la MSH Paris-Nord.
Alexandra Saemmer est professeure des universités en sciences de l’information et de la communication à Université Paris 8. Ses recherches portent sur la construction du sens par l’humain et par la machine-ordinateur. Elle est également autrice de littérature numérique.
Ouvrage monographique récent :
Saemmer Alexandra, Tréhondart Nolwenn, avec Coquelin Lucile, Sur quoi se fondent nos interprétations ? Introduction à la sémiotique sociale, Lyon, Presses de l’Enssib, 2022.
Œuvre de littérature numérique éditée récente :
Saemmer Alexandra, Appiotti Sébastien, Brunel Adrien et al., Nouvelles de la Colonie, dystopie polyphonique remédiatisée à partir de Facebook, Publie.net, 2022.
—
Julien Blaine, « La poésie à tout-va », entretien avec Anne-Christine Royère et Serge Linarès
Julien Blaine, né en 1942, est une des grandes figures de la poésie de performance et de la poésie action, qu’il a pratiquées depuis 1962 (Éléphant Reps 306) jusqu’à 2005 (Bye-bye la perf.). Il s’est aussi illustré dans l’univers de l’imprimé et de la graphie, en multipliant les expérimentations avant-gardistes sur tous les supports (du livre d’artiste au mail art) dans un esprit de révolte et de refondation. Sa très abondante bibliographie comporte aussi bien des recueils de poésie intersémiotique (dont les très signalés 13427 poèmes métaphysiques, 1986, Bimot, 1990 ; et la série des Albumanachs bisannuels, 6 volumes depuis 2014) que des catalogues d’exposition (dont les quatre tomes de Sortie de Quarantaine, 1992-1995), tant il a multiplié les modes d’expression et fait le choix risqué d’une créativité tous azimuts, privilégiant la mise en situation concrète. Très actif dans le domaine des périodiques, il a fondé ou co-fondé Les Carnets de l’Octéor, Géranonymo, L’Autre Journal et Doc(k)s. Tourné vers le collectif, il crée les Rencontres Internationales de Poésie de Tarascon en 1988, puis le Centre International de Poésie de Marseille (CIPM) en 1989. Sous son patronyme (Christian Poitevin), il fut adjoint à la culture à Marseille de 1989 à 1995. Son œuvre protéiforme a fait l’objet d’importantes expositions (notamment Un Tri au Musée d’Art contemporain de Marseille en 2009, et Le grand dépotoir = Bon débarras, à la Friche de la belle-de-Mai en 2020). Elle a donné lieu à un volumineux ouvrage critique sous la direction de Gilles Suzanne (La Poésie à outrance : à propos de la poésie élémentaire de Julien Blaine, Les Presses du réel, 2015).
Anne-Christine Royère est maîtresse de conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Ses travaux portent sur les poésies interartiales et intermédiales des XXe et XXIe siècles (poésie et arts visuels, poésie et arts sonores, poésie performance, poésie exposée) et sur l’histoire et les matérialités du livre du XIXe au XXIe siècle (pratiques et esthétiques du livre de création, pratiques bibliophiliques et livre d’artiste). Elle notamment édité l’ouvrage collectif Michèle Métail : la poésie en trois dimensions (Dijon, Les presses du réel, 2019) et codirigé avec Julien Schuh, la publication des Architectes du livre (Paris, Cabinet Chaptal Éditeur, 2021).
Serge Linarès est professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles à l’Université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches portent, pour l’essentiel, sur la poésie et les relations interartiales. Entre autres publications, il est l’auteur de Picasso et les écrivains (Citadelles & Mazenod, 2013) et de Poésie en partage. Sur Pierre Reverdy et André du Bouchet (L’Herne, 2018). Il a récemment co-édité trois ouvrages collectifs : La Critique d’art des poètes (avec Corinne Bayle et Philippe Kaenel, Kimé, 2022), Éditer en poète (avec Isabelle Diu, 2024), ainsi que le numéro d’avril 2024 de la revue Europe (avec Anne-Christine Royère) consacré à Anne-Marie Albiach.
Pour suivre la séance en ligne, écrire à cette adresse : serge.linares@sorbonne-nouvelle.fr