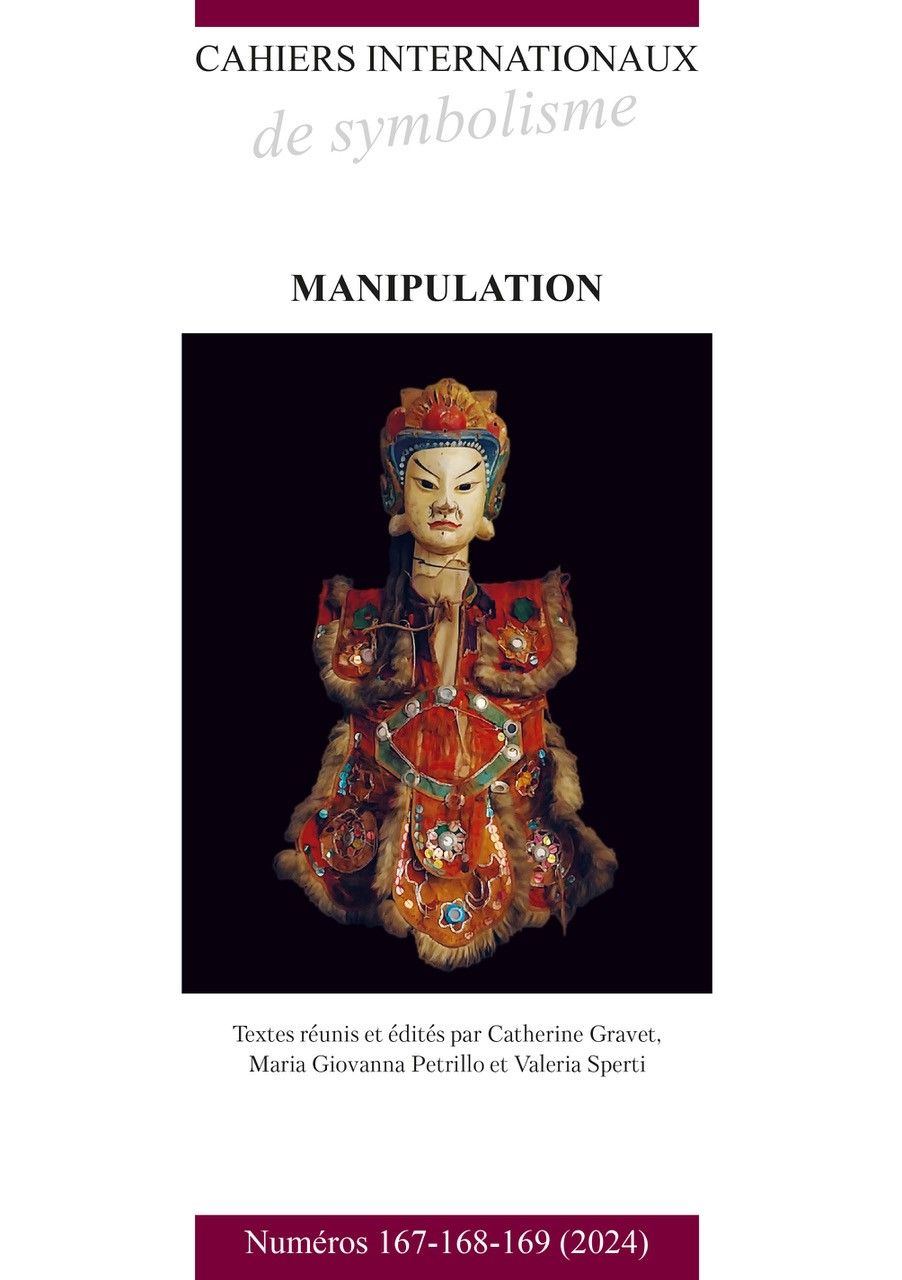
« L’imaginaire de l’archive »
Cahiers internationaux de symbolisme
Appel à contributions
L’imaginaire est ce dont nous héritons, singulièrement et collectivement, pour le transformer de l’intérieur et le perpétuer, tout à la fois. L’archive suit sensiblement le même processus : bien collectif et/ou privé, elle se transmet à destination des générations futures, qui vont s’en saisir – ou s’abstenir – pour lui donner du sens, afin d’éclairer passé, présent et avenir. Cette proximité légitime pleinement l’intérêt de traiter l’imaginaire de l’archive. L’archive appartient à tous les champs de la pensée ; l’étude de l’imaginaire qu’elle mobilise favorisera dès lors aisément le dialogues entre les disciplines qui font la spécificité des Cahiers internationaux de symbolisme.
Toutes les civilisations, depuis la plus haute Antiquité, ont eu recours à la conservation de documents officiels afin de porter témoignage, aux contemporains comme au futur, d’un avoir-lieu juridique, économique, administratif, politique, religieux, culturel, scientifique, etc. Le concept de centre d’archives se développe en Europe dès le XVIe siècle, ce qui entraîne, moins d’un siècle et demi plus tard, l’invention de l’archivistique comme véritable discipline, dans le sillage des études historiques modernes. Les archives sont en effet garantes de la mémoire historique, autant qu’elles révèlent avec acuité les manques et les oublis qui jalonnent cette Histoire (Schlanger).
Les pratiques archivistiques, à l’heure de la mondialisation, gagnent en standardisation à partir des années 1990. Parallèlement, la matérialité même de l’archive tend à se diversifier : depuis les papyrus en rouleaux et les codex, jusqu’aux documents nativement numériques, en passant par les traces de l’éphémère (manifestations militantes, arts de la scène, etc.), les archives prennent aujourd’hui toutes sortes de formes et de dimensions qui exigent une constante réinvention des pratiques de description, de conservation et de mise à disposition. Si notre époque a assurément le « goût de l’archive » (Farge), elle est aussi tombée dans une dépendance à cette « substance hallucinogène » (Melot). La tendance à l’accumulation et l’ambition totalisatrice émergent déjà au XIXe siècle (Foucault, 1967) et le développement des bibliothèques, des musées et des centres d’archives ouverts au grand public a transformé en profondeur l’imaginaire occidental qui y voit une possibilité d’échapper à l’écoulement implacable du temps.
Aujourd’hui, de nombreux centres d’archives ont augmenté leurs capacités d’accueil, en proposant également des services de reproduction numérique, voire de visites virtuelles. Cette question de l’accessibilité est d’autant plus essentielle lorsqu’elle peut sauver des vies, comme dans le cas des archives médicales, dont la conservation repose sur les épaules de professionnels de la santé déjà surchargés. L’évolution vers la circulation des données et le libre accès soulève autant de nouveaux défis que de questions pressantes, à plus forte raison que le numérique s’avère en définitive plus vulnérable (à l’obsolescence ou aux décisions politiques) que ne l’était le papier.
Or, les capacités (matérielles et financières) de classement et de conservation sont aujourd’hui débordées par la masse de documents entrants. De la même façon, la conservation des documents numériques entraîne un coût écologique que notre monde en plein changement climatique doit pouvoir reconsidérer. Des voix s’élèvent d’ailleurs, depuis le milieu des années 1980, pour repenser la dimension de pérennité de l’archive, cherchant à établir des distinctions entre « archives essentielles » et archives « intermédiaires » ou accessoires.
L’archive représente un symbole d’authenticité et de vérité dont il faut interroger la valeur autant que le sens, à plus forte raison au cœur d’une Europe qui se muséifie et sur une planète où le document authentique s’avère de plus en plus souvent monétisé. Ce rayonnement procède d’un processus de sacralisation du document authentique (Boudart et Meurée). Penser l’imaginaire de l’archive et veiller à le déconstruire implique une remise en question de son rôle au sein du récit historique de nos sociétés. Car l’archive n’est qu’illusoirement soustraite à l’écoulement du temps : si elle appartient à un passé révolu, elle est surtout « traite sur l’avenir » en fonction des usages qui seront les siens (Derrida, 1995).
Le document n’acquiert valeur d’archive qu’à partir du moment où il est conservé au sein d’une collection (potentiellement) informative et/ou testimoniale. Le prestige des archives tient donc à leur sélection : elles constituent ce qui est digne d’appartenir à la mémoire des hommes (raison pour laquelle Michel Foucault distingue l’archive au singulier des archives au pluriel, désignant par la première le processus « de la formation et de la transformation des énoncés » au sein d’une civilisation donnée [Foucault, 1969]). Les archives ne prennent sens qu’à être sélectionnées, identifiées et interprétées.
Plus elles sont anciennes, plus les gestes d’identification et d’interprétation sont délicats. De plus, chaque étape de la collection, de la conservation, du classement et de la communication suppose une « manipulation » du document qui contrevient à l’idéal d’intégrité et de pureté qu’on projette sur lui (Meurée). Le modèle de l’archiviste-historien, propagé par des institutions de grande réputation (l’École des Chartes à Paris, depuis deux siècles, par exemple), a pu être élevé au rang des héros de notre temps : son érudition spécifique lui permet en effet de jouer avec le destin des documents telle une Parque des temps modernes.
Le travail de sélection des archives procède d’un « devoir de mémoire » qui se trouve de plus en plus en butte au « droit à l’oubli » que réclament nos sociétés hypermédiatiques. L’archive constitue en effet un miroir : elle permet aux institutions, aux collectivités et aux individus de se réfléchir – à travers les âges et dans la contemporanéité. La dimension politique de l’archive réside dans son statut de levier destiné à produire du récit. De plus en plus de sphères juridiques (droit moral, droit privé, droit patrimonial, etc.) s’entrecroisent d’ailleurs à l’endroit des archives, complexifiant irrévocablement leur imaginaire : archives inédites, interdites, pirates, secrètes, éphémères…
L’archive peut également favoriser la porosité entre le réel et le fictif, à travers le geste interprétatif. L’anticipation horrifique de la manipulation de l’Histoire par l’archive s’avère par exemple source de nombreuses fictions, dont 1984 de George Orwell n’est pas la moindre. Cette capacité à produire du récit se mue en impérieuse nécessité lorsque les traditionnels usages administratifs, scientifiques et patrimoniaux de l’archive ne suffisent plus : les documents servent aujourd’hui de matériaux de création. L’on ne dénombre plus les productions documentaires, littéraires, cinématographiques et autres qui s’entent sur des archives, que celles-ci soient réelles ou inventées.
—
Les auteurs et autrices sont invité(e)s à soumettre par voie électronique des articles répondant au présent appel thématique de la revue. Les propositions, d’une longueur de 2500 caractères maximum (espaces comprises), devront être envoyées conjointement à Catherine Gravet (catherine.gravet@umons.ac.be) et à Christophe Meurée (christophe.meuree@aml-cfwb.be) avant le 26 mai 2025.
L’acceptation sera signifiée aux autrices et auteurs avant le 19 juin 2025.
Les articles définitifs (d’une longueur maximale de 40 000 caractères, espaces comprises), mis aux normes de la revue, devront être adressés aux mêmes adresses pour le 19 janvier 2026 au plus tard. Chaque article est soumis de manière anonyme, à au moins deux expert(e)s du domaine.
—
Bibliographie indicative
Giorgio Agamben, Auschwitz. L’archive et le témoin. Homo sacer III [paru initialement sous le titre Que reste-t-il d’Auschwitz, 1999], trad. Pierre Alferi, Paris, Rivages, « Petite bibliothèque », 2003.
Philippe Artières et Dominique Kalifa, dir., « Histoire et archives de soi », Sociétés et représentations, n° 13, 2002.
Philippe Artières et Annick Arnaud, dir., « Lieux d’archives. Une nouvelle cartographie, de la maison au musée », Sociétés et représentations, n° 19, 2005.
Jean-Pierre Babelon, Les Archives. Mémoire de la France, Paris, Gallimard, « Découvertes », 2008.
Jean-Pierre Babelon et François Terré, dir., Les Archives au fil du temps, Paris, Perrin – Fondation Singer-Polignac, 2002.
Jean-Christophe Bailly, L’Ineffacé. Brouillons, fragments, éclats, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC, « Le lieu de l’archive », 2016.
Christine Bard, Pauline Boivineau, Marion Charpenel et al., dir., Les Féministes et leurs archives, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Archives du féminisme », 2023.
Emmanuelle Bermès, De l’écran à l’émotion. Quand le numérique devient patrimoine, Paris, École nationale des Chartes – PSL, 2024.
Bénédicte Boisson, Marion Denizot, Sophie Lucet, dir., Fabriques, expériences et archives du spectacle vivant, Rennes, PUR, 2021.
Laurence Boudart et Christophe Meurée, « Objets authentiques, objets sacrés : de la construction de l’émotion patrimoniale », in Itinéraires, « Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui », dir. Aurélie Mouton-Rezzouk et Bérengère Voisin, 2022/1, en ligne : https://journals.openedition.org/itineraires/12162.
Sophie Cœuré et Vincent Duclert, Les Archives [2001], Paris, La Découverte, « Repères Histoire », 2019.
Sonia Combe, Archives interdites. Les peurs françaises face à l’histoire, Paris, Albin Michel, 1994.
Géraldine David et François Mairesse, dir., Collectionneurs & Psyché. Ce que collectionner veut dire, Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, 2020.
Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, 1995.
Jacques Derrida, Genèses, généalogies, genres et le génie. Les secrets de l’archive, Paris, Galilée, 2003.
Jacques Derrida, Trace et archive, image et art, Paris, INA, 2014.
Benoît Epron, Nathalie Pinède et Agnieszka Tona, dir., « Les objets nativement numériques : transformations et nouveaux enjeux documentaires ? », Balisages, n° 1, 2020, en ligne : https://journals.openedition.org/balisages/224.
Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, « Points Histoire », 1989.
Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, « Tel », 1969.
Michel Foucault, « Sur l’archéologie des sciences. Réponse au Cercle d’épistémologie » [1968], Dits et écrits, t. I : 1954-1975, éd. Daniel Defert et François Ewald, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001, pp. 724-759.
Michel Foucault, « Des espaces autres » [1967, 1984], Dits et écrits, t. II : 1976-1988, éd. Daniel Defert et François Ewald, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001, pp. 1571-1581.
Bruno Galland, Les Archives [2016], Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2020.
Hélène Gianecchini, Un désir démesuré d’amitié, Paris, Seuil, 2024.
Kenneth Goldsmith, Patrimoine pirate. Archives, circulations et polémiques artistiques à l’âge numérique, trad. Lionel Ruffel et Stéphane Vanderhaeghe, Paris, JBE Books, 2023.
Catherine Gravet, « Dépouiller des archives pour éditer des textes “résiduels” : le cas Alexis Curvers », Caietele Echinox, vol. 33, 2017, pp. 132-149.
Sylvie Lindeperg et Ania Szczepanska, À qui appartiennent les images ? Le paradoxe des archives, entre marchandisation, libre circulation et respect des œuvres, Paris, Fondation Maison des sciences de l’homme, « Interventions », 2017.
Hélène Ling et Inès Sol Salas, Le Fétiche et la plume. La littérature, nouveau produit du capitalisme, Paris, Rivages, 2022.
Sophie Lucet, Sophie Proust, dir., Mémoires, traces et archives en création dans les arts de la scène, Rennes, PUR, 2017.
Federica Martini et Julia Taramarcaz, dir. Feminist Exposure. Pratiques féministes de l’exposition et de l’archive, Genève – Martigny, art&fiction – Manoir de la Ville de Martigny, 2023.
Michel Melot, Des archives considérées comme une substance hallucinogène [1986], Paris, École nationale des chartes, « Propos », 2023.
Christophe Meurée, « Les épiphanies de la main : manipulations de l’archive », in Cahiers internationaux de symbolisme, « La manipulation », dir. Catherine Gravet, Maria Giovanna Petrillo et Valeria Sperti, n° 167-169, 2024, pp. 97-115.
Pierre Nora, dir., Les Lieux de mémoire [1984-1992], Paris, Gallimard, « Quarto », 2008, 3 t.
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, Paris, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2017.
Laurent Olivier et Jérôme Prieur, Où est passé le passé. Traces, archives, images, Paris, La Bibliothèque, 2022.
Anne Reverseau, Jessica Desclaux, Marcela Scibiorska et al., Murs d’images d’écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (XIXe-XXIe siècle), Louvain-la-Neuve, PUL, 2022.
Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’oubli [2000], Paris, Seuil, « Points essais », 2003.
Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues, Paris, Hermann, 2010.
Ann Laura Stoler, Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthode, trad. Christophe Jaquet et Joséphine Gross, Paris, EHESS, 2019.
Matteo Treleani, Qu’est-ce que le patrimoine numérique ? Une sémiologie de la circulation des archives, Lormont, Le Bord de l’eau, 2017.
Myriam Watthee-Delmotte, dir., « Archives : le futur du passé », Francophonie vivante, 2019/1.