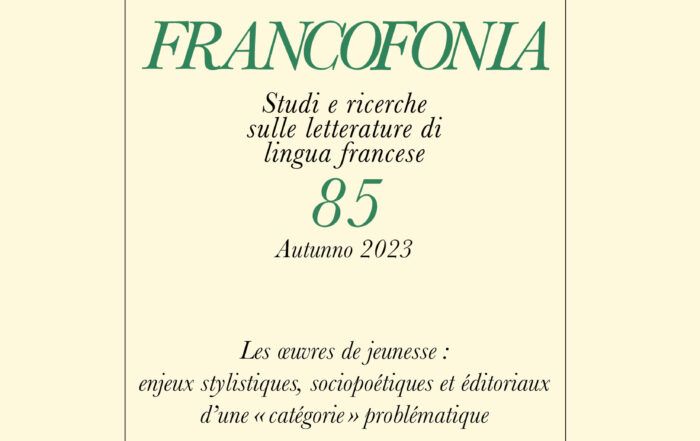
Francofonia, n° 85 : "Les œuvres de jeunesse: enjeux stylistiques, sociopoétiques éditoriaux d’une "catégorie" problématique" (dir. Ilaria Vidotto)
Francofonia, n° 85, Automne 2023
"Les œuvres de jeunesse :
enjeux stylistiques, sociopoétiques éditoriaux d’une «catégorie» problématique",
sous la direction d'Ilaria Vidotto
Lire sur Fabula l'introduction du volume…
—
Sommaire
Valeria Sperti, En souvenir de Jacques Chevrier
Ilaria Vidotto, Introduction : "Les œuvres de jeunesse : un impensé de la littérature ?"…
Clémence Aznavour, Les Œuvres de jeunesse de Marivaux: heurs et malheurs d’une catégorisation diachronique
Hélène De Jacquelot, Jean-Jacques Labia, Stendhal : Journaux et écritures de jeunesse (1801-1814)
Luciano Pellegrini, « Avant ma naissance ». Le style précoce de Victor Hugo (1814-1823)
Nicoletta Agresta, Zola avant « Zola » : les oeuvres de jeunesse du maître du naturalisme, un chantier méconnu
Emmanuelle Calvisi, Le style à travers les âges : les journaux intimes de jeunes écrivains au tournant du XXe siècle
Serena Codena, Écriture de jeunesse chez Yourcenar : le jardin des chimères et l’influence de D’Annunzio
Teresa Lussone, Irène Némirovsky, une « jeune débutante au rang des maîtres »
Gilles Philippe, Tuer le pair. Autour d’Une défaite de Jean-Paul Sartre
Lucas Kervegan, « Je peux ne pas renier mes textes de quand j’avais vingt ans » : Francis Ponge par-delà jeunesse et maturité
Christelle Reggiani, Qu’est-ce qu’une oeuvre de jeunesse ? Le cas de Perec.
—
Résumés des contributions
Clémence Aznavour, Les œuvres de jeunesse de Marivaux: heurs et malheurs d’une catégorisation diachronique
Ce que l’on nomme « oeuvres de jeunesse » de Marivaux désigne six textes écrits par Marivaux avant 1717 et édités pour la première fois par Frédéric Deloffre en 1972 dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade » de la maison Gallimard : Les Aventures de *** ou Les Effets surprenants de la sympathie, La Voiture embourbée, Pharsamon ou les Nouvelles folies romanesques, Le Bilboquet, Le Télémaque travesti, L’Homère travesti. Si ce volume a permis de donner accès à des oeuvres jusque-là peu ou pas connues, la catégorisation de ces textes comme « oeuvres de jeunesse » a imposé des biais de lecture que nous interrogeons afin de proposer une relecture en synchronie de ces oeuvres.
Hélène De Jacquelot, Jean-Jacques Labia, Stendhal: journaux et écritures de jeunesse (1801-1814)
D’après notre expérience en cours d’éditeurs des Journaux et Papiers de Stendhal, nous nous interrogeons sur la pertinence de la notion d’«oeuvre de jeunesse», au singulier ou au pluriel, d’un auteur qui commence assez tôt à noircir du papier. Le premier cahier de son journal date de 1801. Il n’a que 18 ans. Il entre pourtant assez tard en littérature. C’est seulement après la campagne de Russie, qu’il projette en 1814 la publication de ses deux premiers ouvrages, les Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase (1815), et l’Histoire de la peinture en Italie (1817). Nous inventorions ce qui pourrait tenir lieu d’ « écrits de jeunesse » dans cet intervalle de temps : Journaux, Pensées, ébauches de pièces de théâtre, études de caractères, projet d’un essai intitulé Filosofia Nova. Sans se montrer particulièrement précoce, notre auteur énonce cependant très tôt sa vocation et son ambition d’écrivain. Il dresse des listes d’oeuvres futures, tout en ne cessant d’emmagasiner de multiples expériences de lecture et de pensée. Il s’exerce obstinément à l’écriture. Mais c’est seulement quand il imprime enfin son nom de plume en tête de Rome, Naples et Florence, en 1817 qu’il s’inaugure comme Stendhal.
Luciano Pellegrini, «Avant ma naissance» le style précoce de Victor Hugo (1814-1823)
Cet article prend pour corpus la toute première production poétique (1814-1823) de Victor Hugo afin de proposer des catégories utiles à une théorie de l’oeuvre de jeunesse et du « style précoce ». Sa production juvénile est paradigmatique à divers titres : elle s’inscrit dans une période historique d’ « entre-deux » par excellence ; elle se situe à l’origine de l’une des carrières d’écrivain les plus longues et prolifiques ; elle a fait l’objet de lectures contrastées au fil du temps. Je distingue cinq aspects de cette production de jeunesse, cinq « ambiguïtés » qui me semblent caractéristiques des oeuvres de jeunesse. Ces cinq ambiguïtés concernent le positionnement de ces oeuvres dans l’Œuvre, tel que leur statut même semble indissociable d’une lecture téléologique, et les niveaux suivants : thématique, l’oeuvre paraissant tiraillée entre l’autobiographie et l’effort de dépasser un manque de matière ; stylistique, le poète affichant ses compétences artisanales, soit par une sorte d’hypercorrection classique, soit par une recherche cultivée de formes nouvelles ; socio-poétique, l’intention du poète de compenser son jeune âge par le travail et l’artifice l’amenant à brouiller les liens entre Génie et spontanéité ; chronologique, car l’histoire de la réception montre que la perception de la jeunesse et/ou de la maturité d’un écrit ne dépend pas nécessairement de l’âge de son auteur.
Nicoletta Agresta, Zola avant «Zola»: Les œuvres de Jeunesse du maître du naturalisme, un chantier presque méconnu
La critique s’est bien intéressée aux dernières oeuvres d’un Zola vieillissant, accablé par le drame de l’Affaire Dreyfus et par les conséquences de son engagement sur sa production littéraire et son image. Par contre, un certain silence critique accompagne la toute première période littéraire zolienne. Et pourtant, avant de devenir l’auteur des Rougon-Macquart, mais aussi avant d’être l’auteur de romans scandaleux, comme Thérèse Raquin ou Madeleine Férat, Émile Zola a été un poète timide et un conteur fantaisiste. La période allant des premiers débuts littéraires (1859) à la publication de son premier livre, un recueil de contes (1865), représente un moment capital dans la constitution de l’auctorialité zolienne et dans le positionnement de l’écrivain dans le champ littéraire et médiatique de l’époque. Ce travail, qui reparcourt les années qui accompagnent le jeune Zola dès les toutes premières ébauches inachevées jusqu’à son premier succès public, montre l’importance de ces oeuvres de jeunesse négligées et a le but d’examiner les stratégies que Zola met en oeuvre pour se placer dans le champ de son époque et pour donner une première image de soi.
Emmanuelle Calvisi, Le style à travers les âges: les journaux intimes de jeunes écrivains au tournant du XXe siècle
Nombreux sont les auteurs qui tiennent un journal intime pendant leur jeunesse : André Gide, Anaïs Nin, Guillaume Apollinaire, Renée Vivien, Simone de Beauvoir sont du nombre au tournant du xxe siècle. Le journal est souvent considéré comme un genre juvénile, sinon puéril. Ce serait même « la forme la plus enfantine qu’on puisse imaginer », à en croire Maurice Barrès. Nous commencerons par interroger cette affinité pour déterminer s’il s’agit d’un poncif, si les conventions propres au journal conviennent particulièrement aux plus jeunes, ou encore si cette prédilection est le résultat d’une histoire sociale des formes concédées à l’enfant, à qui les grands genres sont interdits. Nous proposerons ensuite une étude du style des jeunes diaristes à travers les âges, en tâchant de déceler leurs spécificités, lesquelles relèvent bien souvent d’une prise de position vis-à-vis de la tradition et de ses modèles. Ce sera l’occasion d’aborder la notion de « style juvénile », modelée sur le « style tardif » défini par Adorno et Saïd. Nous soulèverons enfin la question du statut de ces journaux privés, souvent détruits, reniés ou remaniés par les écrivains adultes : peuvent-ils être considérés comme des juvenilia s’ils restent inédits du vivant des auteurs ? Comment les néophytes consacrent-ils leurs carnets comme des « oeuvres » de jeunesse ?
Serena Codena, Écriture de jeunesse chez Yourcenar: le jardin des chimères et l’influence de D’Annunzio
Cet article se propose d’analyser l’influence de D’Annunzio sur une oeuvre juvénile de Yourcenar, Le Jardin des Chimères, poème dramatique qui reprend le mythe d’Icare. L’ouvrage a été mis au pilon par l’auteure et oublié, signe d’un préjugé à l’égard de ses prémices. La rhétorique est trop voyante et les grands modèles du passé sont imités jusqu’au plagiat. Parmi ceux-ci, nous reconnaissons D’Annunzio. Cette intransigeance à l’égard de ses juvenilia empêche de mettre en valeur les nombreuses qualités de cette oeuvre et nous cache l’influence que la poésie d’annunzienne semble avoir exercée sur la jeune Marguerite au niveau thématique aussi bien que stylistique. Les emprunts d’annunziens nous semblent alors fondamentaux dans ce laboratoire d’expérimentation qui est l’oeuvre de jeunesse et dans lequel Yourcenar a commencé à poser les bases pour construire son identité littéraire.
Teresa Manuela Lussone, Irène Némirovsky une «jeune débutante au rang des maîtres»
La réception d’Irène Némirovsky est exceptionnelle, car elle est passée par deux fois de l’anonymat à la célébrité : en 1929, la publication de David Golder chez Grasset lance cette jeune inconnue venant de l’est sous le feu des projecteurs ; en 2004, celle de Suite française chez Denoël fait redécouvrir au monde entier l’écrivaine oubliée après sa déportation à Auschwitz. À ces deux moments charnières de sa réception, son âge est perçu par la critique comme un aspect incontournable. L’article se propose d’en analyser les raisons, mises en regard de l’espace littéraire de ces deux époques.
Gilles Philippe, Tuer le pair. Autour d’une défaite de Jean-Paul Sartre
Les écrits de jeunesse revêtent un intérêt tout particulier dans le cas de Jean-Paul Sartre. La première raison en est simple : c’est que la question de savoir comment on devient écrivain a toujours été très présente dans l’oeuvre de ce dernier. La deuxième ne l’est guère moins : c’est que nous disposons non seulement d’un nombre important d’écrits de jeunesse de Sartre, mais aussi d’un ensemble considérable d’informations sur leur gestation. Parmi ces premiers travaux, les textes rédigés en 1927 permettent d’observer un évident chevauchement entre formation universitaire (et non plus simplement scolaire) et apprentissage proprement littéraire, mais aussi de voir comment se pose, pour un écrivain de vingt-deux ans, l’inévitable question des modèles.
Lucas Kervegan, «Je peux ne pas renier mes textes de quand j’avais vingt ans»: Francis Ponge par-delà jeunesse et maturité
L’intérêt du cas Ponge dans une réflexion autour de la notion d’oeuvre de jeunesse tient moins à ses juvenilia à proprement parler qu’à la façon dont il pense leur valeur et leur place dans son parcours d’écrivain. Son métadiscours témoigne d’un désir de dépasser, parfois au prix d’importantes distorsions, l’antagonisme entre jeunesse et maturité, et il a toujours voulu demeurer fidèle à certaines de ses premières intuitions. Le temps de l’écriture et celui de la publication sont, chez lui, souvent éloignés, ce qui lui permet de modeler certains de ses ouvrages de façon à tordre sa propre évolution littéraire : la forme de ses livres, qui joue avec la chronologie de ses textes, en fait un phénomène qui n’est pas seulement linéaire. Ce cas particulier permet finalement de penser la spécificité de la forme du recueil de poèmes lorsque l’on envisage de la notion d’oeuvre de jeunesse.
Christelle Reggiani, Qu’est-ce qu’une œuvre de jeunesse? Le cas de Perec
À partir d’un cas singulier, celui des écrits de jeunesse de Georges Perec, cet article voudrait éclairer la réflexion générale sur les oeuvres (littéraires) de jeunesse, dans la mesure où l’observation de la fabrique éditoriale de celles de Perec paraît rendre plus visible comme telle, à la manière d’une loupe, la construction que représente toujours, à des degrés et selon des modalités diverses, une oeuvre de jeunesse. De façon plus restreinte, la réflexion conduira aussi à une reconsidération stylistique, relevant elle-même d’une forme très particulière d’« anxiété de l’influence », de l’élaboration de la judéité littéraire de Georges Perec.