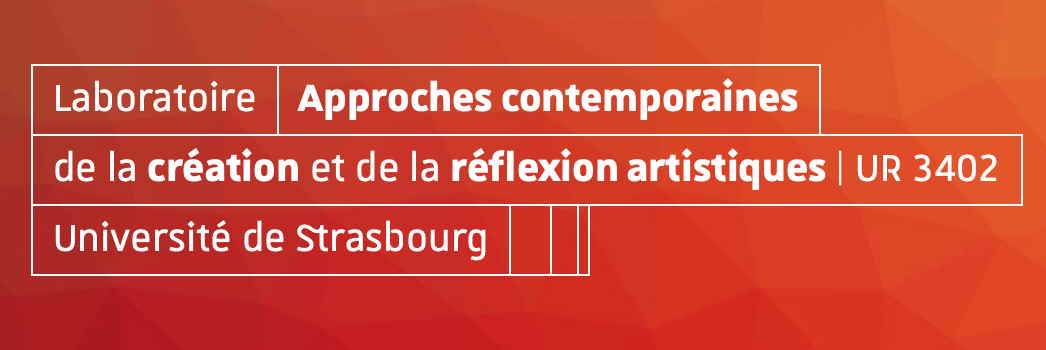
Appel à communications Colloque
Petite histoire, grande histoire
16-18 octobre 2024 UR 3402 ACCRA Université de Strasbourg
L’Université de Strasbourg accueille Fanny de Chaillé en résidence d'artiste de décembre 2023 à octobre 2024. Ce projet s’articule autour des enjeux de l’archive, du document, de la copie dans le spectacle vivant, comme autant d’outils de travail essentiels aux œuvres de la chorégraphe et metteuse en scène, notamment dans trois pièces récentes : Désordre du discours (2019), Le Chœur (2020) et Une autre histoire du théâtre (2022).
Cette résidence et le colloque qui la clôture sont l’occasion d’appréhender comment le travail artistique permet de porter un regard nouveau sur l’archive ou le document. Comment ce matériau permet-il la construction de récits, le tracé d’horizons critiques entre passé et présent, mais aussi d'interroger les liens entre histoire individuelle et histoire collective ?
Argumentaire
« S’emparer de textes philosophiques ardus, réactiver une leçon inaugurale ou rejouer une scène mythique de Pina Bausch… Revenir de l’absence de traces, ou au contraire copier des documents très scrupuleusement » c’est ce à quoi s’emploie Fanny de Chaillé dans ses dernières œuvres. Au cours de sa résidence à l’Université de Strasbourg, elle a souhaité plus précisément « interroger l’Archive dans la perspective d’un présent de l’expérimentation » au prisme de l’articulation entre histoire intime et histoire collective. Comment l'histoire individuelle peut-elle s'inscrire dans la « grande histoire » ?
Le présent colloque fait suite à un cycle de conférences et de rencontres qui se sont déroulés entre décembre 2023 et mars 2024 à l'Université de Strasbourg. Ces travaux furent l’occasion de questionner la manière dont l'histoire intime peut rencontrer l'histoire collective, depuis l’histoire de la correspondance conjugale pendant la Grande Guerre (Clémentine Vidal-Naquet), les archives inédites de Roland Barthes (Tiphaine Samoyault), le matériau autobiographique dans la création chorégraphique (Kaori Ito) ou encore l’histoire des sensibilités (Hervé Mazurel).
Dans les pas des Carnets d'hivers#7 qui ont interrogé cette année les « Théâtres intimes et mémoires communes » sous le prisme des arts de la marionnette, ce colloque « Petite histoire, grande histoire » – qui reprend le titre de la résidence de Fanny de Chaillé – invite à interroger la mise en scène de l’intime dans les arts du spectacle et de la performance, depuis l’archive et dans la perspective de son articulation avec l’histoire collective.
« Pour exister, l’intime a besoin d’un minimum de théâtralité, aussi confidentielle soit-elle. Il faut une scène, et d’abord une scène d’écriture, pour que ce qui précisément ne devrait pas se voir – cette intériorité superlative de l’intimus – se manifeste et se reconnaisse comme tel. L’intime sans miroir, sans écho, n’existe pas : il n’est que silence », ainsi que l’affirment Brigitte Diaz et José-Luis Diaz.
L’analyse littéraire, qui s’est penchée sur le « désir de l’intime » comme affirmation d’un genre à part entière au XIXe siècle, a mis en évidence les traces laissées dans les « archives de l’intime » et révélé comment elles participent à sa dramaturgie et sa scénographie. Ce faisant, cette mise en scène a permis « l’universalité de l’intime », « comme George Sand qui postule dans Histoire de ma vie que "l’humanité a son histoire intime dans chaque homme", ce qui rend à ses yeux la publicité de l’intime non seulement légitime, mais surtout désirable parce que féconde pour la communauté. » Ainsi, l’intime apparaît comme une « non-littérature qui est aussi une autre littérature, plus vraie, plus sensible que l’autre, l’institutionnelle ».
De fait, intimité et sensibilité sont liées. C’est ce que confirme, par exemple, Hervé Mazurel dans son Histoire des sensibilités en établissant une « généalogie de l’histoire des sensibilités », depuis les travaux de Lucien Febvre « qui invitait à une histoire de la vie affective et de ses manifestations » en passant par ceux d’Alain Corbin, Arlette Farge, Georges Vigarello ou encore Françoise Waquet, qui ont mis en évidence la nécessité de prendre en compte que « nos univers sensoriels varient selon le temps, les lieux et les milieux ». De même, François Laplantine, depuis le point de vue de l’anthropologie, rappelle que : « L’intime est une expérience de familiarité avec une personne, un animal, un lieu qui progressivement se transforme en lien. (…) Or elle peut se révéler déroutante, en venant brouiller les frontières de l’intérieur et de l’extérieur, du sujet et de l’objet, du visible et de l’invisible, du dicible et de l’inexprimable. »
Qu’en est-il sur scène ? Comment les arts du spectacle et la performance traitent-ils de l’intime, de son articulation avec le collectif, la communauté, la vérité, l’universalité ? Nous faisons l’hypothèse que l’archive et le document peuvent nous permettre de répondre, en partie, à ces interrogations.
Approches
Sans être exclusifs ni exhaustifs et sans limitation ni géographique ni temporelle, les propositions de communications pourront s’inscrire dans l’un ou l’autre des axes suivants :
> Axe 1 : Dramaturgies de l'intime in memoriam.
Cet axe interroge les superpositions de voix et d'identités entre petite et grande histoire, entre reconstruction du fait et éclatement du verbe.
> Axe 2 : L'objet, vers une « métonymie plastique ».
De l'objet construit en synthèse de l'histoire, à la scénographie (à la fois comme espace des fantômes et comme lieu de reconstruction), comment l'objet s’est-il positionné en médium « par lequel il est possible de se souvenir sans reproduire » ?
> Axe 3 : Le corps, comme passeur de l'intime.
Si le corps est « au centre des blessures matérielles et immatérielles », entre incarnation, hybridation et morcellement des représentations post-traumatiques, comment se fait-il dès lors territoire politique exposé sur la scène, représentation réaliste ou métaphorique d'histoires individuelles renversées par l'(les) histoire(s) collective(s) ?
Mots-clés : danse, théâtre, dramaturgie, objet, voix, histoire, intime, archive.
Bibliographie indicative
> Philippe Ariès et Georges Duby (dir.), Histoire de la vie privée, Paris, Seuil, 5 tomes, 1985-1987
> Hélène Beauchamp, « Trouble des corps dans la guerre d’Algérie : politique de l’opacité dans les tragédies de Kateb Yacine », in Muriel Plana et Frédéric Sounac (dir.), Corps troublés. Approches esthétiques et politiques de la littérature et des arts, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2018
> Hélène Beauchamp, « Des blessures de la guerre à la mémoire critique d’une patrie : les théâtres d’exil de Max Aub et Rafael Alberti », in Isabelle Ligier-Degauque et Anne Teulade (dir.), La Mémoire de la blessure au théâtre. Mise en fiction et interrogation du traumatisme de la Renaissance au XXIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018
> Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire des émotions, Paris, Seuil, 2017
> Alain Corbin et Hervé Mazurel (dir.), Histoire des sensibilités, Paris, PUF, 2022
> Brigitte Diaz et José-Luis Diaz, « Le Siècle de l’intime », Itinéraires, 2009-4, 2009, pp. 117-146
> Pénélope Dechaufour, « Béance, hybridation et morcellement du corps chez Kossi Efoui. Comment se souvenir sans reproduire ? », in Julie Postel et Marie Garré Nicoara (dir.), Corps béants, corps morcelés. Altération et constellation du corps dans les arts scéniques et visuels, Louvain-la-Neuve, EME, 2018, pp. 119-129
> Quentin Deluermoz, Emmanuel Fureix, Hervé Mazurel et M’hamedOualdi, « Écrire l’histoire des émotions : de l’objet à la catégorie d’analyse », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°47, 2013, pp. 155-189
> Lucien Febvre, « La Sensibilité et l’Histoire. Comment reconstituer la vie affective d’autrefois ? », Annales d’histoire sociale (1939-1941), tome 3, nos 1-2, janvier-juin 1941, pp. 5-20
> Cristina Grazioli et Didier Plassard (dir.), Puck. La marionnette et les autres arts, « Humain, non humain », n°20, Charleville-Mézières, Institut International de la Marionnette ; Lavérune (Hérault), L’Entretemps, juin 2014
> François Laplantine, Penser l’intime, Paris, CNRS Éditions, 2020
> François Laplantine, Penser le sensible, Paris, Pocket, 2018
> Daniel Madelénat, L’Intimisme, Paris, PUF, 1989
> Nicolas Truong, Les Penseurs de l’intime, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube ; Paris, Le Monde, 2021
> Marie Urban, Création théâtrale et expériences documentaires. L'exemple des arts de la scène germanophone d'aujourd'hui, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2023
> Georges Vigarello, Le Sentiment de soi. Histoire de la perception du corps, Paris, Seuil, 2014
Modalités de soumission
Les propositions de communications (300 mots, document au format .pdf) accompagnées d’une notice biographique sont à adresser pour le 27 juin 2024 aux deux adresses suivantes : omaubert@unistra.fr et gsintes@unistra.fr.
Une réponse sera apportée par le comité scientifique au plus tard le 8 juillet 2024.
À noter : une publication des actes du colloque étant envisagée courant 2025, les articles seront attendus pour le printemps 2025.
Comité scientifique
> Hélène Beauchamp, MCF HDR en littérature comparée, LLA CREATIS / Université Toulouse Jean Jaurès
> Fanny de Chaillé, directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
> Marco Consolini, PR en études théâtrales, IRET / Université Sorbonne Nouvelle
> Emmanuelle Delattre-Destemberg, MCF en histoire contemporaine, LARSH / UPHF
> Oriane Maubert, MCF en arts du spectacle, ACCRA / Université de Strasbourg
> Claudia Palazzolo, PR en danse, PASSAGES XX XXI / Université Lumière Lyon 2
> Guillaume Sintès, MCF en danse, ACCRA / Université de Strasbourg
> Marie Urban, MCF en études théâtrales, ÉCRITURES / Université de Lorraine
Organisation
> Oriane Maubert, MCF en arts du spectacle, ACCRA / Université de Strasbourg
> Guillaume Sintès, MCF en danse, ACCRA / Université de Strasbourg
https://residence-fannydechaille.unistra.fr
Avec le soutien de l’Université de Strasbourg (Faculté des Arts, UR 3402 ACCRA, IdEx « Université & Cité »), ainsi que de la Fondation d’entreprise Hermès, en partenariat avec Pôle-Sud CDCN, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, et le concours du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.