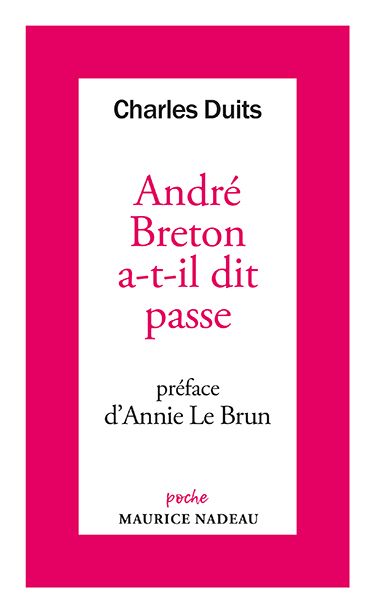
Publié pour la première fois en France en 1969, dans la collection des Lettres Nouvelles, Charles Duits nous offre un extraordinaire témoignage de sa rencontre avec André Breton, qui accueilli amicalement à New York, en 1942, ce tout jeune poète de 17 ans. Autour de lui, gravite une constellation surréaliste : la femme de Breton, Jacqueline Lamba, ainsi que Max Ernst, Duchamp, Masson, Tanguy, Man Ray, Matta.
Annie Le Brun en dessine magnifiquement les enjeux dans sa préface, Attention, « Danger lumineux » !
Né à Neuilly en 1925, d’un père Hollandais et d’une mère américaine, Charles Duits part pour l’Amérique en 1940. Après sa rencontre avec André Breton, ce dernier va demeurer pour lui, durant vingt ans, en dépit de brouilles passagères et de longs silences, un guide et un initiateur. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont Le Pays de l’éclairement. On découvre actuellement, longtemps après sa mort survenue en 1991, son œuvre de peintre demeurée méconnue.
—
Extrait de la Préface d'Annie Le Brun :
ATTENTION, « DANGER LUMINEUX » !
"Non, ce livre n’est pas un témoignage de plus sur André Breton. Non, Charles Duits ne parle pas de Breton pour parler de lui. Ou plutôt si, mais c’est le prétexte pour tenter de dire ce qui les a emportés l’un et l’autre, l’un vers l’autre ou loin de l’autre, à la suite de leur improbable rencontre à New York au cours de l’année 1942.
Charles Duits va avoir dix-sept ans, Breton en a quarante-cinq, tous deux sont en exil mais tous deux sont habités par ce qui aggrave et conjure l’exil. Du plus profond de sa solitude adolescente, Duits voit la solitude de Breton, qui, de son côté, voit dans celle du jeune homme la source vive de la poésie et la solitude imprescriptible qui l’entoure. En naît un étrange vertige. « On dirait qu’on bat des cartes de miroir dans l’ombre ». J’ai toujours pensé que cette phrase-clef du poème que Breton écrit lors de l’été 1943, au moment où il est le plus proche de Duits, évoque l’intensité de ce qui se joue alors entre le jour et la nuit. C’est à cela que Duits nous fait assister et qu’on n’a jamais vu. Bien sûr, les mots en sont partie prenante mais à la condition d’être à la hauteur, c’est-à-dire décisifs comme le vent qui, d’un instant à l’autre, redessine les rues de New York, comme le soleil de Long Island qui suspend tout dans son innocente violence, comme le soudain espace de l’éventuel qui renverse la ville…
Près de vingt-cinq ans plus tard, ainsi qu’il le ferait d’un courant, Charles Duits entreprend de remonter ce vertige qui ne l’a jamais quitté. Sûrement pas pour se souvenir, peut-être pour comprendre ce qu’il est mais surtout pour ne pas démériter de cet appel d’air primordial avec lequel se sera confondu tout ce qui lui importe. : « Un adolescent vient à ma rencontre, je le traverse. Un jeune homme vient, je le traverse. Et tous mes fantômes les uns après les autres. Je les pousse comme des portes. Ce sont des portes vitrées, sur chacune se dessine une image différente. »
Sa chance qui est aussi la nôtre est qu’il a un secret. Duits ne le livre qu’à la fin du texte, ne sachant peut-être pas qu’il lui doit la subtilité frémissante de son écriture : « J’ai toujours cru […] que l’on peut […] photographier l’ombre de l’instant ». Et il y réussit comme on n’aurait jamais imaginé que ce fût possible. J’y verrais volontiers un effet de la redistribution de ces « cartes de miroir », venant renforcer « l’ombre de l’instant », pour lui permettre de saisir ce qui est en train d’advenir, de sorte que tout vibre doublement à sa lumière paradoxale, qu’il s’agisse des êtres, des choses ou des paysages…"
Extrait d'André Breton a-t-il dit passe
"L’écrivain finalement s’adresse toujours à des « amis ». Aux hommes, aux femmes de la tribu, comme dit Mallarmé, au sein de laquelle il est né. Petite tribu, toujours ; morcelée, au surplus, par les haines. L’universalité de la parole est une fiction. Nous ne parlons que de nos soucis ; et n’en parlons qu’à ceux qui les partagent...
Rien ne lui était plus étranger que le souci de durer. Il se plaisait au contraire, comme il le dit quelque part, à « brûler la chandelle par les deux bouts ». Prenait, de propos longuement délibéré, le parti dont les chances paraissent les plus infimes.
Son œuvre est une barque qui fait eau de toutes parts. De la confiance qu’il place dans l’improbable, l’exemple je ne sais pourquoi le plus douloureusement touchant est resté pour moi la phrase qu’on peut lire dans Nadja : « Quelques jours plus tard, Benjamin Péret était là. »
Je vois des millions de visages crouler dans l’ombre, des millions de torses ruisselants de sueur, des millions de bouches attachées à des millions de seins, et toute l’Asie ensevelie avec ses étendards de fer sous une volute...
« Quelques jours plus tard, Benjamin Péret était là. » Phrase qui attend avec une sérénité monstrueuse que tout l’avenir la corrobore, justifie l’importance que Breton attache à la venue de Benjamin Péret. Phrase nue et menacée. Toute l’œuvre de Breton est ainsi faite, et faite à dessein sans doute, des éléments les plus périssables, éléments au nombre desquels il convient aussi de ranger, lorsque Breton écrit les Prolégomènes, la langue française elle-même... Nous sommes à l’heure la plus sombre de la guerre, la dissolution de la France semble définitive. Mais Breton s’exprime comme si RIEN n’avait eu lieu.
Une œuvre fragile, promise à la destruction et à l’oubli. Superbement fragile. Posée, comme la plume de l’aile de Satan, sur la lèvre du gouffre."