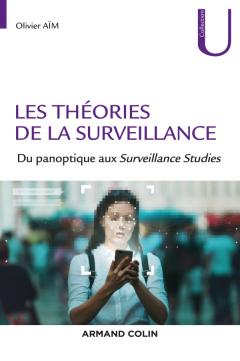
Si, d’un point de vue empirique, la surveillance est bien identifiée depuis plusieurs décennies comme un enjeu majeur - politique, social et économique – de nos sociétés contemporaines, donnant lieu à de nombreux dossiers et investigations journalistiques, le champ des écrits théoriques sur le sujet reste assez méconnu, souvent aimanté par la seule hypothèse "panoptique" formulée par Foucault dans Surveiller et punir (1975). Le fait est que les situations que nous vivons semblent accréditer l'idée d'une logique principalement "gouvernementale", portée par un arsenal de dispositifs de type avant tout "disciplinaire". Il n’est que d’évoquer la crise sanitaire actuelle… Dans Les théories de la surveillance. Du panoptique aux Surveillance Studies (A. Colin), Olivier Aïm ouvre l'œilleton sur une tradition de textes qui préexiste à la thèse foucaldienne (Taylor, Weber, James B. Rule), comme sur les relectures et les amendements théoriques qui lui succèdent, et l'horizon immense de recherche qui s’est ouvert depuis une vingtaine d’années : la société de contrôle (G. Deleuze), le paradigme sécuritaire (G. T. Marx ; G. Agamben), la capture (P. E. Agre), la dataveillance (R. Clarke), la vigilance (M. Foessel), la sousveillance (S. Mann), la gouvernementalité algorithmique (T. Berns et A. Rouvroy), le tri panoptique (O. Gandy ; D. Lyon), la société de la transparence (D. Brin ; B. C. Han ; E. Alloa ; etc.) ; la shareveillance (C. Birchall), le capitalisme de surveillance (S. Zuboff), la surveillance sociale (D. Boyd et A. Marwick), la société de l’exposition (B. E. Harcourt), le design de l’obscurité (W. Hartzog), l’obfuscation (F. Brunton et H. Nissenbaum)… L'Atelier de théorie littéraire de Fabula inaugure une nouvelle entrée "Surveillance" avec un extrait de l'ouvrage : "Le tournant "actuariel" de la littérature surveillancielle : Dostoïevki et Zamiatine".