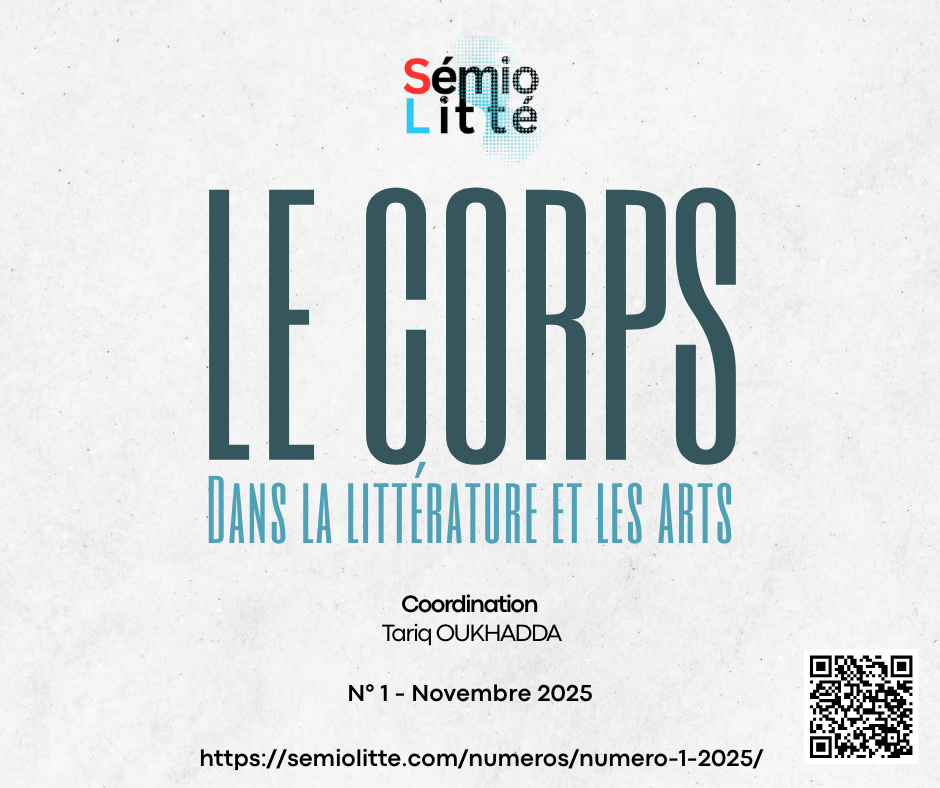
Sous la direction d’une équipe de jeunes chercheurs issus d’universités marocaines, la revue Sémiolitté publie son premier numéro. Ce projet collectif émane d’une volonté de créer un espace d’échange et de réflexion libre, rigoureux et ouvert sur le monde, tout en valorisant les approches et les voix émergentes de la recherche marocaine et internationale.
Le premier numéro, consacré au corps dans la littérature et les arts, marque le début d’une aventure éditoriale exigeante, pluraliste et engagée. Il ne constitue pas uniquement l’ouverture d’une série ; il est surtout la matérialisation d’un projet collectif et d’une vision fondés sur la curiosité intellectuelle. En effet, les articles réunis dans ce premier numéro offrent un panorama riche et pluriel de représentations du corps dans la littérature, les arts visuels et la pensée critique. Ils attestent de la vitalité des études sur la corporéité et de la diversité des perspectives offertes par des chercheurs d’ici et d’ailleurs.
Ces contributions, issues de divers horizons géographiques et disciplinaires, explorent la richesse d’une réflexion sur le corps comme expérience esthétique, sémiotique, littéraire et philosophique. Les auteurs explorent, chacun à sa manière, les limites du représentable, du dicible et du visible. Le corps se révèle, dans ces pages, comme un lieu de passage entre l’expérience de la souffrance, du traumatisme et de l’altération, et le désir de réappropriation. Il se situe aussi entre la norme sociale, les clivages genrés et le conditionnement du corps, et la quête de liberté. Enfin, il se donne comme une matérialité charnelle inscrite en mémoire et en archive du vécu.
Le corps, matière, symbole et mémoire à la fois, est un lieu privilégié où s’expriment les tensions entre domination et liberté, identité et altérité, souffrance et réinvention. Ce premier numéro de la revue Sémiolitté explore les multiples représentations du corps à travers trois ensembles d’articles : corps éprouvés, corps en mutation et corps imaginés.
La première section, « Corps éprouvés : souffrance, domination et résistance », aborde le corps comme lieu de douleur et de résistance. Agouchte El Mehdi analyse, à travers un roman, un long métrage et un jeu vidéo, la corporéité enfantine et met en lumière, avec justesse, les manifestations du corps traumatique au prisme de l’intermédialité. Mathilde Esperce explore la violence infligée au corps et examine le regard de l’endeuillé sur le cadavre du suicidé. Elle s’interroge sur le destin du corps, de la présence pesante et morbide du cadavre, de sa transformation en cendres jusqu’à sa mémoire. Maria Luna Aillaud lit dans Girl, Interrupted de Susanna Kaysen le corps à l’épreuve de l’aliénation et de l’enfermement : « un esprit enfermé dans un corps, lui-même enfermé dans une institution et figé par un diagnostic. » Tel est le point de départ de l’analyse de Maria Luna Aillaud qui montre, à travers le récit de Kaysen, les tentatives de réappropriation et de cheminement vers la guérison d’un corps chimiquement neutralisé et médicalement invisibilisé. Dans son article, Clarisse Couturier-Garcia explore la déchéance physique d’Hervé Guibert et de ses personnages, en se concentrant sur la transformation de leurs corps face au Sida. Jessica Ragazzini explore la relation entre l’art et l’identité en examinant le corps diminué et transformé, et en attribuant à la prothèse une signification sémiotique et poétique. Les œuvres de Sophie de Oliveira Barata et de Viktoria Modesta deviennent ainsi des espaces de reconfiguration du corps et de ses potentiels. Dans leur étude, Meryem Magdi et Samir Bouzrara explorent la représentation du corps malade, traumatisé et déchu dans l’œuvre de Jean Giono, notamment à travers le récit de la Grande Guerre. Imane Mouani s’intéresse au don d’organes et aux tensions entre valeurs biologiques et symboliques dans Réparer les vivants de Maylis de Kerangal. Mouani interroge ainsi la transplantation d’organes comme acte à la lisière du don salvateur et de la profanation. Michèle Villetard clôt la section par une lecture archéologique de la souffrance et du châtiment corporel dans la Mosaïque de Kimbros.
La deuxième section intitulée « Corps en mutation : hybridités, identités et transgressions », s’attache à penser les transformations du corps et les recompositions identitaires. Mustapha Nouari explore la marginalité symbolique du gaucher dans un monde de droitiers à travers le court métrage La Main gauche de Fadil Chouika. Nouari analyse les figures de la contrainte et de la normalisation corporelle dictées par la société, la religion et une tradition qui fait de l’usage de la main gauche l’expression d’une anomalie corporelle et sociale. Fida Hammoud explore également le langage de la main -souveraine et obsédante- dans le roman Le Manucure de Christos Chryssopoulos. Sara Elmouadden analyse les métaphores de la possession et de la conquête dans les représentations du corps féminin à l’époque coloniale. Entre paternalisme et domination, elle montre le corps féminin comme lieu de projection fantasmatique et en fait la métaphore de la conquête coloniale française au Maroc. Amine Hakim s’interroge sur la façon dont Carole Martinez, dans Le Cœur cousu et Du domaine des Murmures, remet en question les discours normatifs sur le corps féminin. Il explore comment ces œuvres repensent les dynamiques de soumission et de réappropriation, restituant ainsi au corps sa matérialité et son pouvoir de subjectivation. Bi Trah Alphonse Cheriff Kakou propose une lecture sémiotique de Garçon manqué de Nina Bouraoui et analyse la construction de l’identité de genre. Il met l’accent sur la dimension psychocorporelle et identitaire de l’être au-delà des critères sexués, souvent réducteurs. Urbain Ndoukou-Ndoukou, quant à lui, établit un dialogue entre Cent vies et des poussières de Gisèle Pineau et Les Femmes de Bidibidi de Charline Effah. Son analyse porte sur la poétique du corps féminin dans des contextes postcoloniaux marqués par la violence, la mémoire traumatique et les solidarités intergénérationnelles. Enfin, Cherif Oumayma Mayara relit Truismes de Marie Darrieussecq comme une exploration de la corporéité féminine en crise. Ce roman révèle une quête identitaire et existentielle où le corps, bestialisé, marginalisé et humilié, devient le lieu d’une résistance symbolique.
La troisième section, « Corps imaginés : symbolique, mémoire et esthétique », ouvre la réflexion sur le corps comme espace de mémoire et d’invention. El Mehdi El Maouloue examine le corps en crise à travers la corpographèse et l’empreinte somatique dans Dans le jardin de l’ogre de Leïla Slimani, tandis que Jaouad Mejli explore la géocritique du corps et ses corrélations spatiales. Grace Yan propose une sémiotique du corps populaire et de l’amour dans Germinie Lacerteux des frères Goncourt, et Zakia Rmida analyse la fictionnalisation du corps à travers la symbolique du miroir dans l’œuvre de Roger Martin du Gard. Samira Etouil et Sanae Ouardirhi s’intéressent à l’imaginaire et à l’esthétique du corps chez Hédi Bouraoui, tandis que Frédérique Lambert étudie les corps iconotraumatiques du néopéplum, entre palimpseste visuel et crise des normes. Soukaina Boushor analyse la représentation du corps féminin athlétique comme signe esthétique et performatif, et Alpha Moulopou conclut la section par une étude sémiotique du corps dans le dessin d’actualité de Pahé.
Enfin, la section Varia prolonge la réflexion en ouvrant le numéro à d’autres questionnements littéraires. Khouya Elomari El Alaoui étudie quelques images métamorphiques de la ville dans l’œuvre de J.-M.G. Le Clézio, Said Ouchari revisite Les Immémoriaux de Victor Segalen à travers la quête d’une parole perdue, et Mohammed Kheyi analyse les liens entre désir et marginalité dans Au bonheur des limbes de Mohamed Leftah.
—
I. Corps éprouvés : souffrance, domination et résistance
Agouchte El Mehdi — Fragments d’une chair fictionnelle : corporéité enfantine, trauma et mimésis dissociative dans la littérature, le cinéma et le jeu vidéo
Esperce Mathilde — Face à la violence du suicide, une dialectique du corps massacré
Aillaud Maria Luna — Écrire pour résister : Girl, Interrupted, de l’aliénation à la réappropriation
Couturier-Garcia Clarisse — Le corps à l’épreuve chez Hervé Guibert
Ragazzini Jessica — Prothèses en tension : sémiotique du corps altéré chez Sophie de Oliveira Barata et Viktoria Modesta
Magdi Meryem, Bouzrara Samir — La misère du corps humain chez Jean Giono : l’esclavagisme de l’homme moderne, le cas des Récits et essais
Mouani Imane — Le don d’organes : enjeux des valeurs symbolique et biologique du corps dans Réparer les vivants de Maylis De Kerangal
Villetard Michèle — Petit corps souffrant : accident, maladie et soins sur la mosaïque de Kimbros (Antioche, fin du IVᵉ siècle de notre ère)
II. Corps en mutation : hybridités, identités et transgressions
Nouari Mustapha — Un gaucher au pays des droitiers
Hammoud Fida — Le Manucure de Christos Chryssopoulos : quand la main exerce son empire
Elmouadden Sara — Corps féminins, territoires conquis : métaphores de la possession et ressorts d’un imaginaire colonial
Bi Trah Alphonse Cheriff Kakou — Analyse sémiotique du corps et de l’identité de genre : lecture de Garçon manqué
Ndoukou Urbain — Penser la chair au bord du désastre : poétique du corps féminin dans Cent vies et poussière de Gisèle Pineau et Les Femmes de Bidibidi de Charline Effah
Mayara Cherif Oumayma — Truismes de Marie Darrieussecq ou questionner la condition humaine
III. Corps imaginés : symbolique, mémoire et esthétique
El Maouloue El Mehdi — Corpographèse, empreinte et archive somatique dans Dans le jardin de l’ogre de Leila Slimani
Mejli Jaouad — La géocritique du corps chez Amin Maalouf et Mahi Binebine, de la séparation à la corrélation
Yan Grace — Une clinique de l’Amour : pour une sémiotique « populacière » du corps dans Germinie Lacerteux
Rmida Zakia — La fictionnalisation du corps par le biais du miroir
Etouil Samira, Ouardirhi Sanae — L’imaginaire et l’esthétique du corps dans les récits de Hédi Bouraoui
Lambert Frédérique — Corps iconotraumatiques : palimpsestes visuels et crise des normes dans un genre cinématographique issu de l’épopée antique, le néopéplum
Boushor Soukaina — Corps performants, corps signifiants : une lecture sémiotique et esthétique du corps féminin athlétique dans les récits visuels et littéraires contemporains
Moulopou-Moulopou Alpha-Eder — Sémiotique du corps dans le dessin d’actualité de Pahé
IV. Varia
Elomari El Alaoui Khouya — Images métamorphiques de la ville chez J-M.G. Le Clézio
Ouchari Said — Les Immémoriaux de Victor Segalen : l’exhumation de la parole perdue
Kheyi Mohammed — Quand l’écriture se fait marge. Ordre du désir et éthique marginale dans Au bonheur des limbes de Mohamed Leftah
Tariq Oukhadda