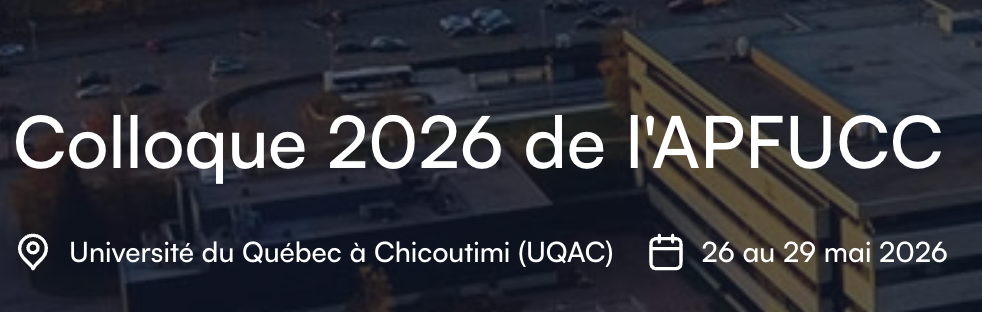
Les questions narratives et matérielles au croisement d'un pluralisme esthétique (APFUCC 2026, Univ. du Québec à Chicoutimi)
Appel à communications
Les questions narratives et matérielles au croisement d'un pluralisme esthétique (APFUCC, Univ. du Québec à Chicoutimi)
William Charest-Pépin, Université Laval (Laboratoire Ex situ), wichp@ulaval.ca
Laurence Richard, Université Laval (Laboratoire Ex situ), laurence.richard.6@ulaval.ca
Modalité: hybride
Depuis la deuxième moitié du siècle dernier, les pratiques expérimentales foisonnent dans la sphère littéraire québécoise. En marge des conventions éditoriales, ces initiatives, que nous associons au secteur des arts littéraires, ont pour dénominateur commun de réinventer le format livresque hégémonique, tantôt pour le subvertir, tantôt pour simplement s’en affranchir. Pensons ici au projet transmédia L’Île inventée (2016-) coproduit par les Productions Rhizome à Québec et Arkham sur Loire à Nantes, dont la configuration transmédiatique (Jenkins, 2006) se constitue de propositions expositionnelles, d’installations interactives, d’un balado, d’un recueil de contes et d’une novella. Deuxième exemple (plus radical en regard de sa forme hors du livre): le projet de l’organisme de médiation Les autres jours intitulé Le Chrysanthème (2023), un feuilleton littéraire postal livré en cinq épisodes et reprenant les codes du jeu d’évasion sur table et de l’enquête archivistique, est conçu pour s’écarter complètement des conventions livresques, et ce, pour proposer un récit ludique marqué par une diffraction médiatique.
Cet atelier souhaite mettre en lumière des initiatives semblables dont le dessein premier est d’exploiter un pluralisme esthétique (Message, 2013); l’une des visées de la journée serait d’approfondir la réflexion autour du rôle de la dimension matérielle dans la restitution d’une complexité du monde et des nombreux points de vue qui le composent. L’analyse de la matérialité de différents projets médiatico-littéraires pourrait permettre d’explorer ce phénomène plus en profondeur. Aussi, la poétique de la diffraction (Audet, 2019) semble-t-elle pouvoir faciliter la compréhension de mécanismes narratifs s’affranchissant non seulement d’une perspective téléologique, mais également de cette « synthèse de l’hétérogène » identifiée par Ricoeur pour au contraire favoriser le foisonnement discursif.
Les corpus à étudier valoriseraient l’intégration de plusieurs formes artistiques à leurs dispositifs et investiraient des canaux de diffusion pluriels (allant de la sphère numérique aux organismes de médiation culturelle, par exemple). Plusieurs pistes réflexives seraient donc à explorer : de quelles manières les stratégies (narratives, sémiotiques, matérielles, etc.) exploitent cette démultiplication des perspectives, stratégies que le livre ne pourrait investir de manière aussi pointue en raison des limites de sa forme ? Qu’en est-il de la possibilité, pour les récits de soi, de faire un récit identitaire en contexte de diffraction ?
Cet atelier se veut l’occasion d’analyser le bouleversement de notre conception de la littérarité et du marché éditorial francophone. Divers axes peuvent être explorés :
Axe 1 : les arts littéraires comme véhicules expressifs
Si les formes des arts littéraires affectent leurs propos, elles influent aussi sur la façon dont le public interagit avec elles : on peut penser aux Choses mortes, de Céline Huyghebaert, une exposition à la Fonderie Darling qui donne à voir l’enquête - réelle et fictive - menée par Huyghebaert autour de la figure de son père, des archives et des traces découvertes au fil des ans qui permettent la construction d’un récit dans un espace physique. Les arts littéraires, à la fois vecteurs de déstandardisations et d’un renouvellement des pratiques permettront, dans le cadre de cet atelier, d’explorer des corpus nouveaux et des artistes encore peu reconnus de la sphère critique.
Axe 2 : les secteurs éditoriaux
Les modalités éditoriales paraissent aussi différer grandement entre les arts littéraires et le livre traditionnel. Quelles tâches doivent assumer les éditeurs responsables des œuvres littéraires qui outrepassent le cadre du codex ? Comment jongler avec des formes artistiques comme la photographie ou la baladodiffusion, dont la diffusion se fait différemment de celle de la littérature ? Lors de cette journée, plusieurs cas de figure peuvent être présentés et problématisés autour de la question des stratégies éditoriales marginales.
Axe 3 : les stratégies narratives exploitées
Les pratiques littéraires sont bouleversées par la mise en place d’un pluralisme esthétique qui se reflète aussi bien dans le propos de l’œuvre que dans sa forme et sa transmission. Dans un tel contexte, quelles sont les stratégies narratives exploitées? Dans le cadre d’un projet transmédia complexe comme L’Île inventée, comment le « macro-récit » s’élabore-t-il? L’atelier sera l’espace d’une mise à l’épreuve des théories du récit en regard des arts littéraires.
—
Propositions à transmettre pour le 15 janvier 2026 : https://event.fourwaves.com/fr/394d20de-9415-4680-83ee-0f8661c73524/soumission
—
Corpus cité
ARKHAM SUR LOIRE, et PRODUCTIONS RHIZOME. L’Île inventée. Contes des Estuaires Nantes Québec, 2024, https://www.ile-inventee.net (Page consultée le 10 septembre 2024).
AUTRES JOURS (LES). Le Chrysanthème, Québec, Les autres jours, 2024.
BOITTE, Julie, et al. Contes des Estuaires, Québec, Productions Rhizome, 2022.
DUMAS, Simon (animateur). Cosmogonie de l’île inventée [baladodiffusion], Montréal, Productions Rhizome, Arkham sur Loire et la Quadrature, 2022, https://open.spotify.com/show/4onyu53UsoWo2nY73UGApn
HUYGHEBAERT, Céline. Les choses mortes [exposition], Montréal, Fonderie Darling, Plateforme de lecture, 2017.
VADNAIS, Christiane. L’Île inventée, Montréal, Éditions Rhizome, 2022, 140 p.
Sur la narrativité
BARONI, Raphaël. La tension narrative. Suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil, 2007, 448 p.
_____. « Pour une définition fonctionnelle de l’intrigue », dans Les rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Éditions Slatkine, 2017, p. 25-45.
_____. « Un feuilleton médiatique forme-t-il un récit ? », Belphégor. Littérature populaire et culture médiatique, no 14 (2016), http://journals.openedition.org/belphegor/660
BONACCORSI, Julia. « Sémiologie de la bande dessinée numérique », dans Pascal Robert [dir.], Bande dessinée et numérique, Paris, CNRS Éditions, 2016 https://books.openedition.org/editionscnrs/20622?lang=fr (Page consultée le 27 avril 2023).
BOURASSA, Renée. Les fictions hypermédiatiques. Mondes fictionnels et espaces ludiques, Montréal, Le Quartanier (coll. Erres essais), 2010, 340 p.
BRÉMOND, Claude. « La logique des principes narratifs », dans Communications, n° 8, 1966, p. 60-76 https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1115 (Page consultée le 2 octobre 2023).
MESSAGE, Vincent. Les romanciers pluralistes, Paris, Seuil (coll. Le don des langues), 489 p.
RICŒUR, Paul. Temps et récit 1, Paris, Seuil (coll. L’ordre philosophique), 1983, 404 p.
RICŒUR, Paul. Temps et récit 2, Paris, Seuil (coll. L’ordre philosophique), 1983, 320 p.
VILLENEUVE, Johanne. Le sens de l’intrigue ou La narrativité, le jeu et l’invention du diable, Québec, Presses de l’Université Laval (coll. Intercultures), 2004, 423 p.
Sur la lecture et le material turn
ARCHIBALD, Samuel. « Chapitre 3 : lecture/écran », dans Le texte et la technique. La lecture à l’heure des nouveaux médias [thèse de doctorat, sémiologie], Montréal, Université du Québec à Montréal, 2008, p. 115-154.
BARTHES, Roland. « La mort de l’auteur », Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984, p. 61-67.
_____. S/Z, Paris, Seuil, 1970.
BRILLENBURG WURTH, Kiene. « The Material Turn in Comparative Literature : An Introduction », Comparative Literature, vol. 3, no 70, 1er septembre 2018, p. 247-263, https://doi.org/10.1215/00104124-6991688 (Page consultée le 16 septembre 2024).
CITTON, Yves. « 1. Qu’est-ce qu’un geste ? », dans Yves Citton, dir., Gestes d’humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Armand Colin (coll. Le temps des idées), 2012 https://www-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/gestes-d-humanites--9782200279714-page-27.htm (Page consultée le 22 novembre 2023).
ECO, Umberto. Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset, 1985 [1979], 314 p.
_____. L’œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965, 313 p.
FISH, Stanley, et Yves CITTON. Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives, Paris, Les Prairies Ordinaires (coll. Penser / Croiser), 2007, 144 p.
INGARDEN, Roman Witold. L’Œuvre d’art littéraire, traduit par Philibert Secretan, Lausanne, L’Age d’Homme, 1983.
ISER, Wolfgang. L’acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, traduit par Evelyne Sznycer, Bruxelles, Mardaga, 1976.
LATA, Marion. Matières de lecture. Pour une théorie de l’exemplaire, de la littérature papier à la littérature numérique[thèse de doctorat, littérature française et comparée], Paris, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 2022, 667 p.
LESCOUET, Emmanuelle. « Gestes de lecture numérique et lecture immersive de science-fiction », dans ReS Futurae, vol. 20 (2022) https://doi.org/10.4000/resf.11364 (Page consultée le 20 novembre 2023).
_____, « Introduction aux gestes de lecture », Montréal, Université de Montréal, 2022, 14 p. https://hal.science/hal-03643898 (Page consultée le 27 août 2024).
MACÉ, Marielle. Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard (coll. Essais), 2011, 288 p.
Sur les études médiatiques
AUDET, René. « L’objectification (visuelle, numérique) des romans, ou la narrativité à l’épreuve de l’expérience matérielle des œuvres », textImage, n° 11 (2019), https://www.revue-textimage.com/17_blessures_du_livre/audet1.html (Page consultée le 27 août 2024).
_____. « Ne pas raconter que pour la forme : modalités de la diffraction dans les fictions narratives contemporaines », inédit, version augmentée du chapitre « Ne pas raconter que pour la forme : sur la diffraction dans les fictions narratives », dans Robert Dion et Andrée Mercier (dir.), La construction du contemporain. Discours et pratiques du narratif au Québec et en France depuis 1980, Montréal, Presses de l’Université de Montréal (« Espace littéraire »), 2019, p. 201-237, https://doi.org/10.5281/zenodo.3258361 (Page consultée le 27 août 2024).
_____. « Diffraction. Pour une poétique de la diffraction des textes narratifs », dans E. Bouju (dir.), Nouveaux fragments d’un discours théorique. Un lexique littéraire, Codicille, 2023, https://doi.org/10.47123/f51e9fed.ecdeba37 (Page consultée le 27 août 2024).
BARRANTES, Ximena Miranda. Façonner l’engagement du public par l’éditorialisation narrative : Design et évaluation d’un artefact de médiation numérique patrimoniale [thèse de doctorat, doctorat sur mesure], Québec et Valenciennes, Université Laval et Université Polytechnique Hauts-de-France, 2024, 492 p., https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1430747903
BOURDAA, Mélanie. « Le transmédia storytelling », Terminal, no 112 (2013) https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.4000/terminal.447 (Page consultée le 3 septembre 2024).
HAYLES, N. Katherine. Writing Machines, London, The MIT Press (coll. Mediawork), 2002, 144 p.
JENKINS, Henry. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New-York, New York University Press, 2006, 308 p.
MAIGRET, Éric. « Du “signifiant flottant” au “transmédia storytelling”, ou le retour aux stratégies », Terminal [En ligne], no 112 (2013) https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.4000/terminal.536 (Page consultée le 2 septembre 2024).
NACHTERGAEL, Magali. « Narrations muséales. Écritures de l’exposition, fictions et récits dans l’art contemporain », Captures, vol. 6, no 2 (2021), https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.7202/1088410ar (Page consultée le 2 septembre 2024).
RYAN, Marie-Laure. « Le transmédia storytelling comme pratique narrative », Revue française des sciences de l’information et de la communication, no 10 (2017), DOI : https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.4000/rfsic.2548(Page consultée le 2 septembre 2024).
Sur les arts littéraires
AUDET, René. « Les arts littéraires I - La littérature au diapason de ses incarnations contemporaines », dans Nuit blanche, no 159 (16 août 2020) https://nuitblanche.com/article/2020/08/la-litterature-audiapason-de-ses-incarnations-contemporaines-2/ (Page consultée le 2 novembre 2023).
______. « Nommer, et faire advenir, les arts littéraires : attestation des pratiques vivantes de la littérature », Itinéraires, no 2 (2023), https://journals.openedition.org/itineraires/12515 (Page consultée le 26 août 2024).
AUDET, René, et Corentin LAHOUSTE. « S’affranchir du rapport médusant de l’idée d’œuvre littéraire : balises critiques sur la performativité et la réception des arts littéraires », dans RELIEF - Revue électronique de littérature française, vol. 17, no 1 (2023), p. 183-194 https://doi.org/10.51777/relief17717 (Page consultée le 2 novembre 2023).
AUDET, René et al. « Nommer les arts littéraires », Laboratoire Ex situ, 2019 [En ligne] https://ex-situ.info/projets/nommer-les-arts-litteraires/ (Page consultée le 2 novembre 2023).
BISENIUS-PENIN, Carole, René AUDET et Bertrand GERVAIS, dir., « Les arts littéraires : transmédialité et dispositifs convergents », Recherches & Travaux, no 100 (2002), https://doi.org/10.4000/recherchestravaux.4655 (Page consultée le 2 septembre 2024).
LAMY, Jonathan. « Les arts littéraires II - Un écosystème hétéroclite et dynamique », dans Nuit blanche, no 159 (15 août 2020) https://nuitblanche.com/article/2020/08/les-arts-litteraires-ii-unecosysteme-heteroclite-et-dynamique/ (Page consultée le 22 octobre 2022).
NACHTERGAEL, Magali. « Écritures plastiques et performances du texte : une néolittérature ? », Le bal des arts, édité par Elisa Bricco, Quodlibet, 2015, https://books-openedition-org.acces.bibl.ulaval.ca/quodlibet/506 (Page consultée le 2 août 2024).
ROSENTHAL, Olivia, et Lionel RUFFEL, dir., dossier « La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre », Littérature, vol. 4, no 160 (2010).