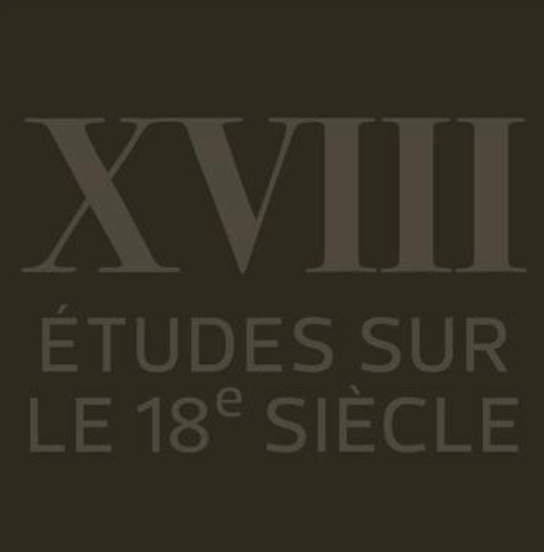
Regards croisés sur l’enfance, l’altérité et les pratiques éducatives dans les récits de voyage pendant le long XVIIIe s.
L’Éducation et l’Autre pendant le long XVIIIe siècle (1693–1811) :
Regards croisés sur l’enfance, l’altérité et les pratiques éducatives dans les récits de voyage
Les sociétés européennes sont marquées pendant le long XVIIIe siècle par des transformations profondes dans la manière dont elles conçoivent l’éducation. Nous proposons de faire commencer symboliquement cette période d’étude en 1693, – année de la publication de Some Thoughts Concerning Education de John Locke, et la diffusion de sa théorie de la tabula rasa – et de la refermer en 1811, l’année où Germaine de Staël écrit son essai De l’Éducation de l’âme par la vie, ouvrage dans lequel elle constate que « l’éducation a été la manie du siècle dernier » [1]. Cette période a vu le succès mondial des Aventures de Télémaque (1699) de Fénelon, roman pédagogique par excellence de la fin du XVIIe, ainsi que l’essor du théâtre d’éducation dans des milieux jésuites ainsi que dans les foyers familiaux. La promulgation du Code Napoléon de 1804 annonce les débuts d’une nouvelle ère : celle de l’éducation publique. Comment les écrivains et les enseignants de cette époque ont-ils commenté la façon dont on élevait les enfants à l’étranger ?
Les normes culturelles des différentes sociétés ont-elles influencé l’impact de théories didactiques venant de divers pays ? Les idées sur l’éducation venant de l’étranger ont-elles été adaptées pour mieux convenir à des mœurs ou à des coutumes religieuses différentes ? Comment déchiffre-t-on alors le regard porté sur l’enfant étranger ?
Dans un contexte de circulation intense des idées, des textes et des pratiques, l’éducation devient une question centrale du débat philosophique, politique et littéraire. De John Locke à Jean-Jacques Rousseau, de Félicité de Genlis à Germaine de Staël, les théoriciens et les écrivains ne cessent de remettre en question les modalités d’instruction, d’apprentissage, de socialisation et d’émancipation des jeunes. L’examen comparatif de ces œuvres révèle des transferts culturels complexes : l’Émile (1762) de Rousseau trouve un écho en Angleterre, tandis que Locke est traduit et commenté abondamment sur le continent. Ces échanges intellectuels témoignent d’un double mouvement d’appropriation et de résistance aux modèles éducatifs venus d’ailleurs. Le mot d’« altérité » étant plutôt associé aux discours scientifiques/de philosophie naturelle avant le XXe siècle, nous utiliserons ici ce concept dans une acception plus moderne pour interroger une époque où la subjectivité est en plein développement. Ainsi l’Autre, pour nous, désigne ici le « non-moi », l’Étranger, perçu tantôt comme menace, tantôt comme miroir critique de la société du pays dans lequel on est né.
Dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Jaucourt qualifie le voyage comme une forme d’éducation, en constatant que « les grands hommes de l'Antiquité ont jugé qu'il n'y avoit de meilleure école de la vie que celle des voyages ; école où l'on apprend la diversité de tant d'autres vies, où l'on trouve sans cesse quelque nouvelle leçon dans ce grand livre du monde ; & où le changement d'air avec l'exercice sont profitables au corps & à l'esprit » [2]. On sait en outre que pendant le long dix-huitième siècle, le genre du récit de voyage – réel ou fictif – connaît un essor remarquable. À une époque où la mobilité et l’alphabétisation sont en plein essor en Europe, le nombre de voyageurs qui s’engagent dans un « Grand Tour », ainsi que la publication de livres qui questionnent les mœurs de différentes sociétés, ne cesse de croître. Publié entre 1723 et 1737, les Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde de Jean-François Bernard et Bernard Picart est un « livre qui a changé l’Europe » [3] , pour reprendre le mot de Lynn Hunt ; cet ouvrage quasi-anthropologique pourrait être considéré est le symbole d’une ère où la curiosité envers l’Autre fait exploser le monde occidental. Pendant tout le siècle, des projets de commerce internationaux, tels les aventures des Compagnies des Indes (Orientales et Occidentales), mettent l’Ouest en contact avec des sociétés non-européennes. Avec ce tissage de liens et ce mouvement interculturel d’une ampleur sans précédent croît aussi le désir de comprendre ce qui se passe autre part. S’interroger et réfléchir sur la façon dont les enfants étrangers sont élevés suscitent vivement l’intérêt de ceux qui s’intéressent à l’altérité.
Le genre de récit de voyage devient donc l’un des vecteurs privilégiés pour observer, commenter, juger ou imaginer les pratiques éducatives en vigueur dans des cultures dites « autres ». Pensons au Voyage au Levant (1698) de Corneille Le Brun, aux Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse (1711), ou au Voyage autour du monde (1771) de Bougainville. À travers le regard du voyageur – indélébilement marqué par les présupposés de sa propre société – se dessinent les contours d’un discours sur la différence : comment les enfants sont-ils traités autre part – en Perse, en Chine, dans les colonies d’Amérique, en Afrique ou dans les régions nordiques de l’Europe ? Quelles valeurs leur sont inculquées ? À quels rythmes biologiques, sociaux ou moraux leur développement est-il associé ? À travers l’analyse de ces textes, se révèle une tension entre fascination et « exotisation » [4], entre relativisme culturel et affirmation universaliste.
Ce volume sera l’occasion d’étudier le point d’intersection entre le regard porté sur l’Autre – qu’il soit géographique, culturel, ou symbolique – et la critique (ou l’idéalisation) des pratiques éducatives durant l’époque des Lumières. Comment les écrivain.e.s, les pédagogues et les enseignant.e.s ont-ils décrit, évalué ou imaginé les modalités d’éducation dans des sociétés étrangères ? Les normes locales ont-elles su limiter l’influence de théories importées ? Et plus largement, comment se construit, dans ces textes, une figure de « l’enfant étranger » – à la fois objet de curiosité, de comparaison, de réprobation ou de rêve utopique ?
Nous invitions les auteurs à explorer la manière dont la différence culturelle est mobilisée dans des récits de voyage (fictionnels ou non) portant sur l’éducation, l’apprentissage ou la socialisation des enfants et des jeunes. Le corpus pourra inclure des voyages philosophiques, des lettres fictives, des traités pédagogiques mêlés à des considérations ethnographiques, des journaux de missionnaires ou encore des romans éducatifs à portée comparatiste.
Axes de réflexion potentiels (non exhaustifs) :
- Réception des traités didactiques dans différents pays ou différents contextes
- Présence des pratiques instructives de diverses cultures dans des récits de voyage qui font mention des pratiques éducatives étrangères
- Nationalisme (ou régionalisme) naissant dans des œuvres scolaires
- Commentaires et comptes rendus d’ouvrages portant sur la cultivation du savoir et de la moralité chez les jeunes
- Représentation de diverses religions et de leurs pratiques en ce qui concerne les meilleures façons d’élever et de faire s’épanouir l’enfant
- Discours concernant l’apprentissage des langues modernes
—
Les propositions devront porter sur des œuvres écrites entre 1693 et 1811. Même si le sujet disciplinaire du colloque s’ancre prioritairement dans le domaine de la littérature, les propositions pourront également s’appuyer sur les apports de l’histoire culturelle, de l’anthropologie, de la pédagogie, de l’iconographie, ou de l’histoire des idées. Une attention particulière sera portée aux approches pluridisciplinaires et comparatives, ainsi qu’aux travaux explorant des espaces extra-européens ou des périphéries intellectuelles.
Modalités de soumission :
Les propositions de chapitre (titre + résumé de 500 signes), accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer à nora.mary.baker@ulb.be avant le 15 décembre 2025. La date limite pour l’envoi des chapitres retenus (de 30 000 à 40 000 signes espaces compris) sera le 20 mars 2026. Ce projet de publication s’inscrit dans la collection Études sur le XVIIIe siècle. Cette série, publiée par les Éditions de l’Université de Bruxelles, vise à rassembler des contributions portant sur la philosophie, la culture, la littérature, et l’art du long XVIIIe siècle.
Direction du volume : Nora Baker (Université Libre de Bruxelles)
Rédacteur.ices en chef de la série : Valérie André, Christophe Loir (Université Libre de Bruxelles)
—
NOTES
[1] De Staël, Germaine, « De l’Éducation de l’âme par la vie », dans F. Lotterie (dir.), Œuvres complètes de Madame de Staël : Lettres sur Rousseau et autres essais moraux, Paris, Éditions Honoré Champion, 2008, p. 320.
[2] Jaucourt, Louis de, « Voyage (éducation) », L’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 17, p. 476, 1765.
[3] Hunt, Lynn; Jacob, Margaret C.; & Mijnhardt, Wijnand, The Book that Changed Europe: Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World, Cambridge, Harvard University Press, 2010.
[4] Le Bigot, Brenda, « Exotisation », dans Bouvet, M., Chossière, F., Duc, M., et Fisson, E. (dir.), Catégoriser : Lexique de la construction sociale des différences, Lyon, ENS Éditions, 2025, pp. 279–303.
Bibliographie indicative (sélection) :
Hunt, L., Jacob, M. C., & Mijnhardt, W., The Book that Changed Europe: Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World, Cambridge, Harvard University Press, 2010 [3].
Léonard, J., & Moreau, I. (dir.), Enfant, enfance et scandale à l’époque moderne, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2024.
Lotterie, F. (dir.), Œuvres complètes de Madame de Staël : Lettres sur Rousseau et autres essais moraux, Paris, Éditions Honoré Champion, 2008.
Martin, C., Éducations négatives : fictions d’expérimentation pédagogique au dix-huitième siècle, Paris, Classiques Garnier, 2010.
Moreau, I. (dir.), Les Lumières en mouvement. La circulation des idées au XVIIIe siècle, Lyon, ENS Éditions, 2009.
Plagnol-Diéval, M.-E. (dir.), L’enfant rêvé : Anthologie des théories et des pratiques d’éducation du XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Seth, C., & von Kulessa, R., « Lumières au pluriel », Arts et Savoirs 13, 2020, https://doi.org/10.4000/aes.2436
Stikić, B., « La réception et l’utilisation des Aventures de Télémaque dans l’enseignement du français langue étrangère », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde 31, 2003.
Von Kulessa, R. (dir.), Démocratisation et diversification. Les Lumières et l’éducation, Paris, Classiques Garnier, 2016.