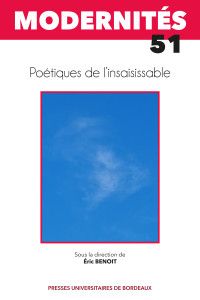
Ce livre collectif est le deuxième d’une série de cinq qui seront consacrés aux « Poétiques de la négativité ». Après Poétiques de l’incomplétude (volume 49, en 2024), le volume Poétiques de l’insaisissable résulte d’une collaboration entre le Centre Modernités et le Centre d’Études et de Recherches sur l’Europe Classique (CEREC) de l’Université Bordeaux Montaigne. Nous avons eu ainsi l’occasion d’ouvrir nos recherches aux siècles dits « classiques », et de confronter les esthétiques de la modernité à celles des siècles antérieurs.
Au cours de cette recherche sur l’insaisissable, comme notion et comme phénomène transformant les écritures littéraires, la coupure historiographique et conceptuelle entre les siècles dits classiques (xviie et xviiie) et les siècles dits modernes (depuis le xixe) a semblé devoir passer au second plan, laissant plutôt apparaître des continuités, des fils conducteurs trans-séculaires, parfois en lien avec la notion du « je ne sais quoi », parfois à la faveur de perspectives mythologiques, mystiques, oniriques, érotiques, rhétoriques, linguistiques, stylistiques, métaphysiques, intrapsychiques, phénoménologiques, épistémologiques, herméneutiques… D’où le choix d’écarter pour ce volume un plan chronologique, afin de faire résonner entre elles des études sur des œuvres appartenant aux quatre derniers siècles, et d’aborder successivement des problématiques insaisissables, des personnages insaisissables, des thématiques insaisissables, des formes insaisissables, sans oublier que la question de l’insaisissable se manifeste aussi dans d’autres arts comme la peinture et la musique.
Première partie - Essais
Éric Benoit
Onze approches de l’insaisissable
Lexicologique, épistémologique (Michaux, Ponge)
Mythologique (Tantale, Orphée)
Érotique, onirique (Nerval, Verlaine, Mallarmé, Desnos, Baudelaire, Proust…)
Mystique, apophatique (de la Patristique au XXe siècle)
Linguistique, stylistique (Balzac, Hugo)
Rhétorique (le sublime chez Boileau, le « je ne sais quoi » chez Bouhours)
Intrapsychique (de Proust à Bataille)
Phénoménologique (Jean-Pierre Richard, Reverdy, Michel Collot, Jaccottet)
Joëlle de Sermet
La provocation de l’insaisissable
La littérature et le « sans-mesure »
La force d’appel d’un adjectif substantivé
La matière noire au centre des récits
Les formes-chimères de la poésie
Perspectives : De l’insaisissable à la raison vivante
Florence Dumora
Insaisissable je ne sais quoi. Lettre apocryphe de Jean Ogier de Gombauld
—
Deuxième partie - Personnages insaisissables
Laurence Sieuzac
Marine Bastide De Sousa
Le dessein du corps élémentaire. Approche de la poétique acorporelle des récits à être élémentaire
La frustration du corps : un être sans organe
La frustration de l’esprit : la raison empêchée
Sans corps ni tête : la sublimation de la frustration
Marianne Lafforgue-Nichèle
Alexandre Dumas : le génie de l’insaisissable
La mobilité insaisissable du génie
Regard magnétique et don de vision
Une entreprise difficile pour le romancier
Comment dire l’insaisissable ?
Le paradoxe de l’indicible insaisissable
Jérémie Alliet
Intériorités insaisissables – le personnage balzacien
Le paraître insaisissable : Corentin
Le devenir insaisissable : Vautrin
Wafa Ghorbel
Madame Edwarda de Georges Bataille : l’insaisissable ruissellement
Christelle Defaye
Réécriture de la catabase d’Eurydice-Lol : une descente du fantôme au fantasme
L’in-fini du « désir demeuré désir » ou le regard qui tue
—
Troisième partie - Thématiques insaisissables
Zoé Perrier
Poursuivre l’insaisissable : éthique critique de Jean-Pierre Richard
Insaisissable méthode, insaisissables objets
L’insaisissable commentaire : une éthique critique ou une posture stratégique ?
Claire Leforestier
L’insaisissable ébriété de l’air. La chasse aux odeurs chez Jean Giono et Jean de Boschère
La description des senteurs chez Jean de Boschère
Éric Dazzan
Poétique du regard et évanescence du désir chez Gustave Roud et Sandro Penna
« Cela fut une chose tout à fait naturelle »
« Par la fenêtre du vent, je vois Aimé cueillir les premières pommes »
Mathieu Perrot
Le je-ne-sais-quoi de Cocteau : le jeu de l’insaisissable dans La Machine Infernale et Orphée
La mort, ses agents et ses revenants : une politique de l’absurde
Presque et peut-être : défier l’exactitude de la mort
Intuition, enquête et ironie tragique
Un langage insaisissable, la poésie
Marina Seretti
Saisissante, insaisissable : l’écriture des pierres selon Roger Caillois
Voussad Saïm
L’expérience poétique à l’épreuve de l’occulte dans L’infante maure de Mohamed Dib
Zheng Xiang
Un cas de réception insaisissable : Gérard de Nerval et He Qifang
—
Quatrième partie - Formes insaisissables
Eliza Liu
L’insaisissable infini : une relecture mathématique des stances de Rodrigue
Christiane Connan-Pintado
L’insaisissable du conte, de Perrault aux réécritures contemporaines
L’insaisissable définition du conte
Fortune de l’insaisissabilité des contes
Yasué Kato
« Insaisissable » et « saisir » : analyse lexicologique
La Petite Madeleine et le dialogue intérieur du narrateur
La phrase « insaisissable » de la petite sonate de Vinteuil
De « Contre l’obscurité » au projet de « Contre Sainte-Beuve »
À propos de l’impression musicale des aubépines en fleur
Les aubépines et le septuor de Vinteuil
L’élaboration stylistique et l’écriture « insaisissable » de Proust
Larisa Botnari
L’incompréhensible comme promesse de véracité : poétique du non-sens chez Émile Ajar
Le non-sens comme voie d’accès à l’impensable ?
Faute linguistique et « erreur humaine »
Saisir ou ne pas saisir, telle est la question
Jean-Michel Gouvard
« Comment dire/what is the word » de Samuel Beckett ou les mots pour ne pas le dire
Emmanuelle Tabet
Épiphanies de l’insaisissable dans le carnet poétique contemporain
Anna Levy
La littérature performée : une forme éphémère et insaisissable ?
La littérature performée : une forme éphémère et insaisissable
Temporalité fugace : l’inscription contextuelle
Insaisissable et illisible ? Le texte dans les performances littéraires
La Performance comme nouvelle médiation du texte littéraire
Performer le texte pour mieux le saisir
Médiation de la littérature : contre une littérature insaisissable ?
Les archives en performance : saisir l’insaisissable
—
Cinquième partie - Avec la peinture et la musique
Luca Rausch-Molnár
Saisir le changement à l’aide de la grâce insaisissable dans la réception littéraire de Watteau
La grâce saisissable : la grâce « locale »
L’époque de la raison : la grâce de Watteau dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
La grâce de Watteau qui transcende les siècles
Katalin Bartha-Kovács
La touche insaisissable de Chardin, à travers les écrits critiques de son temps
Réflexions liminaires au sujet de la notion d’insaisissable
Agréable tromperie : la touche vertigineuse
La touche insaisissable et le sentiment
Jocelyn Godiveau
L’essence poétique de l’impression ou « L’art mnémonique » de Charles Baudelaire
Le mouvement et la photographie
Jean Guillaumont
George Sand : sens physique, conception romantique
Guy de Maupassant, Fort comme la mort : poétique et métaphysique de l’insaisissable
Anna Opiela-Mrozik
Saisir le sonore avec le visuel : les musicalités romantiques
L’insaisissable de la musique dans l’optique philosophique et méthodologique
Le défi symboliste : la musique spiritualisée ou silencieuse
Entre la forme, le son et l’écriture : les musicalités modernes
—