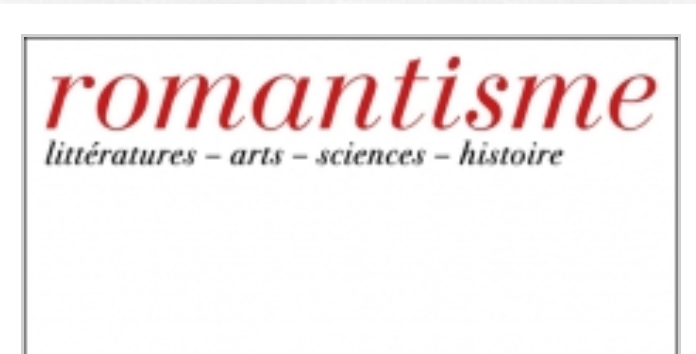
Appel à contributions
Les objets du quotidien. Entre privé et public
Romantisme 2027/1
dir. E. Fureix, C. Legoy
Le « tournant matériel » a puissamment renouvelé le regard des sciences sociales sur les objets (Borloz, Caraion, Lyon-Caen, 2025). Les objets ont parfois été saisis comme de simples instruments pour raconter l’histoire autrement, à l’origine d’un véritable genre éditorial et médiatique – « 100 objets racontent », etc. A travers des dispositifs de collecte, de valorisation et de monstration d’objets, les musées dits « de société » se sont aussi efforcés de rendre l’histoire à la fois plus intelligible et plus sensible, bousculant par là-même les manières de montrer le passé. Mais c’est, davantage encore, la boîte à outils mobilisée pour penser les objets qui s’est enrichie ces dernières décennies, dans un double contexte de surconsommation d’objets jetables et de cristallisation mémorielle autour des objets du passé. Les objets ne sont plus simplement saisis comme des traces archéologiques d’un monde disparu, ni comme des indices d’une « culture matérielle » (Julien et Rosselin, 2005), ni encore comme des signes au sein d’un « système des objets » (Baudrillard, 1968). Au même titre que les animaux, les objets mettent en tension les frontières voire le partage même entre humains et non humains (Latour, 1994). Une « agentivité » (agency) leur est reconnue, non pas en tant qu’acteurs du passé dotés d’une intentionnalité, mais en tant qu’agents interagissant avec des sujets et d’autres objets (Gell, 1998). Les objets ordinaires, tout comme les objets d’art, produisent ainsi de puissants effets dans le monde social (Appadurai, 1986 ; Blandin, 2002). Une approche des objets sur un mode biographique s’est également développée, intégrant leur agency(Bonnot, 2015). L’objet est alors saisi depuis son contexte de production jusqu’à sa circulation, exposition, consommation, puis ses usages sociaux et manipulations diverses, voire sa destruction, ou au contraire sa patrimonialisation. Ces biographies d’objet sont souvent « à trous », et autant que la biographie classique, sujettes au risque de « l’illusion » téléologique.
Tous ces questionnements prennent une singulière pertinence lorsqu’on les applique au XIXe siècle. « Siècle des choses » à certains égards (Diaz, 2012), il voit d’abord se multiplier à une échelle inédite les objets reproductibles, produits en série par la médiation de la machine. L’un et le multiple entretiennent dès lors de nouveaux rapports, incarnés dans des objets dont l’aura n’est pas pour autant nécessairement menacée. En tout cas, l’objet-marchandise entre dans de nouveaux circuits de consommation qui irriguent – diversement – l’ensemble des classes sociales. Il est exhibé et spectacularisé, des vitrines de grands magasins aux expositions universelles, mais aussi montré à distance dans des catalogues (Delapierre et alii, 2024). En tant que source de profit, l’objet sériel est simultanément source d’aliénation, dévoilée dans le « fétichisme de la marchandise ». L’objet-marchandise fait, dans un jeu de miroir, son entrée dans la « littérature industrielle » et le roman réaliste. C’est plus généralement le régime d’attention aux objets qui se modifie, se traduisant par leur migration massive sur la toile et dans l’espace de la fiction. Balzac aurait ainsi « conquis aux choses le droit d’être représentées » (Brunetière), pénétrant par effraction dans les intérieurs des protagonistes de ses romans. Le fantasme de la collection atteint aussi un de ses apogées, dans le monde réel comme dans la fiction : collections d’objets d’art, d’objets anciens, d’objets exotiques, d’objets coloniaux ou d’objets scientifiques (Pety, 2010). Enfin, les objets, en particulier les objets des classes subalternes, sont soumis à une évaluation morale et à des systèmes d’appréciation qui évoluent au fil du siècle.
Tous ces processus sont maintenant largement connus. Ce numéro de Romantisme voudrait déplacer un peu la focale, du côté des objets du quotidien au XIXe siècle, pour les saisir comme des objets-frontières. Objets domestiques, objets du travail, voire objets du décor urbain, tous façonnent la vie sociale ordinaire ; ils ordonnent mais défont aussi les frontières assignées du privé et du public. L’observation des pratiques sociales autour des objets du quotidien permet de mettre au jour les tensions entre leur repli sur l’espace privé et leur déploiement, exhibition ou dévoilement dans l’espace public (physique et symbolique). Trois terrains seront privilégiés dans ce numéro, sollicitant l’histoire, les études littéraires et l’histoire de l’art : les objets domestiques, entre intérieur et extérieur ; les objets intimes, entre secret et ostentation ; la politisation des objets du quotidien.
1. Objets domestiques, entre intérieur et extérieur
Les appartements bourgeois cristallisent, au XIXe siècle, une frontière de plus en plus étanche entre l'espace domestique et l'espace extérieur. L'intérieur bourgeois se définit en effet, et de plus en plus fermement, par sa clôture et sa césure d'avec la rue (Charpy, 2010). Cette césure s'opère et s'illustre par une série d'objets et de dispositifs matériels, inégalement étudiés, mais tous présents dans l'art et la littérature du XIXe siècle, qui en font souvent de puissants ressorts romanesques ou dramaturgiques. La loge du portier, ou du concierge, est le seuil matérialisant le passage de l'extérieur à l'intérieur, la sphère domestique commençant dès son franchissement. Timbres, sonnettes et boutons se répandent peu à peu qui confortent cette frontière – héler depuis la rue, crier par la fenêtre relevant des usages populaires. Ce seuil franchi, s'ouvre l'escalier dont l'espace est, déjà, un simulacre d'intérieur : décors de plus en plus soignés, moquettes, tapis, parfois chauffage ou meubles... tout cela signifie la rupture avec la rue et l'entrée, par le matériel, dans l'univers domestique. L'intérieur bourgeois, ensuite, redouble la rupture avec le monde : le paillasson marque son entrée, les sonnettes, les judas et les chaînes de sécurité se répandent et les bruits de la rue doivent être assourdis dans les logements, à grand renfort de tentures notamment. Les objets domestiques contribuent à l'étanchéité du chez-soi bourgeois. Dans ce processus de distinction matérielle des espaces, la fenêtre, objet-frontière par excellence, devient un enjeu : des dispositifs inédits (rideaux, garnitures ou persiennes notamment) se développent pour occulter la ville et soustraire l'intérieur domestique aux regards intrusifs. Elle cristallise significativement un abondant imaginaire littéraire (Del Lungo, 2014) et artistique — songeons à Caillebotte ou Baudelaire, pour ne citer que deux exemples.
Les intérieurs domestiques, ainsi cloisonnés de la rue, se muent, simultanément, en un théâtre des objets (Charpy, 2010) : argenterie, tableaux, bibelots, canapés, coussins brodés, machine à coudre, premiers téléphones s'y multiplient, en un décor de la réussite, d'une histoire familiale, des modes auxquelles cèdent leurs propriétaires ou des objets nouveaux diffusés par l'âge industriel. Car cet espace domestique est également voué à être vu. La frontière avec le monde extérieur est donc bien fragile : ces objets sont aussi des signes sociaux, mis en scène dans l'entre-soi bourgeois, soumis aux regards des proches ou des invités. L'attention neuve qui est portée à leur rangement, leur entretien et leur nettoyage, leur présentation, par le biais des premiers manuels d'économie domestique pour les maîtresses de maison, témoigne de cette incertaine frontière entre l'usage pour soi et le rôle de distinction sociale de ces objets. De cette frontière incertaine avec le monde extérieur témoigne tout autant, quoique différemment, le fantasme d'une importation du monde chez soi – par les objets exotiques et coloniaux notamment (Charpy, 2015 ; Singaravelou, Venayre, 2020).
Si farouche que soit la volonté bourgeoise de cloisonnement, le monde extérieur rôde toujours sur ces objets domestiques. Il aiguise ainsi la hantise de l'intrusion chez soi, de l'effraction et du vol des biens que recèle l'intérieur domestique (Chauvaud, Houte, 2014). Le XIXe siècle est donc, aussi, celui de la surenchère des techniques de leur protection au moyen de coffres-forts, de serrures ou de portes blindées.
Abondamment peints et décrits, les intérieurs bourgeois ne sont cependant pas les seuls soumis aux regards extérieurs, les intérieurs populaires le sont également. Les logements ouvriers, tout particulièrement, sont ainsi scrutés et détaillés par les écrivains, les peintres ou les enquêteurs sociaux (Geerkens et alii, 2019) : on y lit longtemps la rareté des meubles et leur caractère essentiellement fonctionnel (tables, chaises, buffets ou armoires ; horloges et pendules plus que miroirs... (Daumas, 2018)), l'exiguïté, et souvent la plurifonctionnalité, des pièces, l'état des fenêtres, absentes parfois ou brisées, la rusticité du linge... Par la description du cadre matériel, c'est la tentative de déchiffrement d'un nouveau groupe social qui se joue. Chez beaucoup, sur ce cadre matériel se projette la hantise, traversant le siècle, des classes laborieuses. L'intérieur domestique est, aussi, une question publique et morale.
Enfin, l'œil de l'État s'invite également sur ces objets de l'espace domestique : le recensement des portes et fenêtres (et les résistances qu'il suscite - ainsi lors de l'« été rouge » (Caron, 2002)) ; les inventaires après décès et leur pesée d’objets trahissent eux aussi l'impossible soustraction du domestique aux regards extérieurs.
Les contributions s'insérant dans cet axe pourront aborder tous les objets, dispositifs matériels et décors du quotidien, sous l'angle de la frontière – affirmée ou incertaine – entre l'intérieur et l'extérieur :
- Par leur participation à la césure, renforcée sur le siècle, entre l'intérieur et l'extérieur
- En tant que signes sociaux, mis en scène et voués à être vus
- En tant qu'ils opèrent une importation du monde dans l'intérieur domestique
- En tant qu'ils constituent des enjeux publics et moraux, sous l'œil des enquêteurs sociaux, des artistes ou de l'État.
2. Objets de l’intime, entre secret et ostentation
La construction, par sa clôture, de l'espace domestique au XIXe siècle s'accompagne, indissociablement, d'un processus accéléré d'individualisation – ou d'affirmation d'un moi singulier – et d'émergence d'une sphère qui le permet et l'exprime : celle de l'intime (Ariès et alii, 1999 ; Diaz, 2009 ; Artières, 2022). Historiens et spécialistes de littérature ont largement étudié ses voies et ses signes, lisibles, notamment, dans de nouvelles pratiques d'expression et de déchiffrement du moi. Au-delà, cette intimité nouvelle est alors incarnée, traduite et défendue par toute une série d'objets et de dispositifs matériels. Les choses, ainsi, racontent aussi l'histoire de l'intime.
L'apparition, inégale selon les milieux sociaux, d'une chambre conjugale ou d'une chambre à soi en est l'un des signes forts (M. Perrot, 2009). S'y logent les objets qui témoignent de pratiques de plus en plus dévolues au secret : tenues de nuit, pour le sommeil ; bibles ou chapelets pour la prière ; livres pour la lecture ; papier, plume et encre, avant le stylo-plume, pour l'écriture... Elle n'est pourtant pas le seul espace que le XIXe siècle s'attache à assigner au monde de l'intime : cabinets d'aisance ou cabinets de toilette deviennent progressivement deux lieux inviolables, soustraits aux regards. L'intimité du corps s'encadre de dispositifs techniques qui visent à l'isoler. (P. Perrot, 1984). Au sein de l'espace domestique, nombre d'objets dessinent ainsi ce territoire de l'intime à protéger : les verrous entre les pièces à l'intérieur des logements se répandent dans les appartements bourgeois quand, dans les milieux plus populaires, où cette aspiration à l'intimité se répand également, rideaux, paravents ou cloisons permettent de différencier les usages de l'espace domestique (Daumas, 2018). La porte fermée, ce qui se joue derrière, ce qui s'échappe de bruits ou de bribes de conversations, devient un topos fertile en intrigues. Les meubles à clés se répandent également, ainsi des secrétaires, voués à cacher les correspondances ou les journaux intimes, dont la pratique se diffuse alors (Lejeune, 1993) ; ainsi des coffres recélant des objets-souvenirs. Dans l'espace bourgeois, la mise à distance des domestiques, notamment par les systèmes d'appels qui orchestrent leurs allers et venues sans crier (sonnettes, cordons acoustiques, téléphones intérieurs), ou par les escaliers de service, vise également à délimiter espace domestique et espace de l'intime. Ces dispositifs nourrissent, eux aussi, l'imagination des romanciers et des dramaturges.
Ces choses de l'intime ne sont pourtant que partiellement cantonnées au secret ; elles deviennent en effet, indissociablement, des objets scrutés, montrés, exhibés, n'échappant ni aux regards ni au spectacle. À l'heure où s'impose la mise à l'écart des gestes de l'intimité corporelle, se multiplient dans l'art, et de façon frappante, les scènes de toilette avec brocs, cuvettes, éponges et bassines (ou tubs) – ainsi chez Degas ou Toulouse-Lautrec pour ne citer qu'eux – ou, plus rarement, baignoires (Alfred Stevens, Femme au bain (1867) ou Caillebotte L'homme au bain (1884), par exemple). De la même façon, à l'heure où se répand la présence des miroirs dans l'espace domestique, se multiplient, en peinture autant qu'en photographie, les portraits au miroir qui livrent aux regards cet objet, par excellence de l'intimité, qui permet de se regarder soi-même.
Les objets de l'intime sont donc aussi des objets-frontières, entre le secret et le dévoilement, voire la mise en scène et l'instrumentalisation commerciale. Ainsi du lit, qui, à la fin du siècle, sert de cadre à nombre de spectacles de striptease mimant le coucher d'une jeune fille – se déshabillant donc pour rejoindre son lit – ou son lever (Charpy, 2023). Plus largement, c'est toute l'industrie de l'obscénité, qui se développe alors (Rodemacq, 2015), qui repose sur ce dévoilement des parures de l'intime, corsets ou bas. Leur dévoilement n'est cependant pas toujours accompagné de leur sexualisation, la peinture offrant nombre d'exemples de scènes de femmes mettant leur bas en une représentation de l'intimité ordinaire. Ce statut d'objets-frontières est aussi celui, différemment, des bijoux sentimentaux – sur lesquels il reste beaucoup à écrire. Voués au culte de l'intime, exprimant le secret d'un cœur ou d'un lien, ils servent aussi au partage sensible, objets tantôt dissimulés tantôt exhibés.
Les objets liés à la sexualité n'échappent pas non plus à ce statut ambivalent, entre tabou, usage et publicité. Le XIXe siècle est aussi bien celui des premières pratiques clandestines de contraception que de diffusion des premières publicités pour les objets anticonceptionnels, masculins et féminins (Mortas, 2023). L'essor du commerce des instruments anti-onanisme trahit, lui aussi, ce territoire de l'intime exposé. Le XIXe siècle règlementariste voit aussi se diffuser les visites médicales des prostituées (Corbin, 1978) au cours desquelles se répand l'usage du speculum, instrument de pénétration dans l’intimité du corps féminin.
Objets-frontières, encore, objets de l'intime exposés, sont ceux qui se diffusent dans l'espace de la ville à la fin du XIXe siècle : bancs publics, où viennent flirter les amoureux ; vespasiennes ou colonnes-urinoirs, lieux de rencontre homosexuels (Révenin, 2006).
Les contributions s'insérant dans cet axe pourront aborder tous les objets et décors de l'intime, à la charnière du secret et de l'ostentation :
- Sous l'angle des modalités et dispositifs du secret qui les entourent de plus en plus, dessinant un territoire de l'intime à protéger et isoler
- Sous l'angle de leur dévoilement
- Sous l'angle de leur exhibition spectaculaire, publicitaire ou commerciale
- Sous l'angle de leur présence publique
3. Les objets du quotidien, entre ordinaire et politique.
Une autre frontière traverse les objets du quotidien : celle qui sépare l'ordinaire et le politique, déclinaison de la frontière mouvante entre privé et public1. La Révolution française s’est ainsi accompagnée d’une production massive d’objets chargés d’incarner la « régénération » en cours, les idées nouvelles et leur espace-temps (Auslander, 2010). Des jeux de cartes « révolutionnés » aux éventails imprimés, des « reliques patriotiques » de la Bastille aux boutons historiés : la politique s’est nichée sur des objets sans qualités, et ces derniers ont incorporé les signes des temps nouveaux, au risque de l’éphémère en raison des incessants bouleversements politiques (Taws, 2013). Les croyances politiques se sont aussi données à voir à travers des cocardes, bonnets, sacrés cœurs tissés et autres accessoires nichés sur le corps des citoyens et des citoyennes, suscitant conflits et doutes sur la transparence des opinions (Wrigley, 2002).
Ces mécanismes d’incorporation du politique sur les objets du quotidien se sont prolongés au XIXe siècle, révolution et contre-révolution continuant de s’affronter à travers ce prisme (Fureix, 2019). Les progrès techniques, les mutations du goût et les nouvelles pratiques de consommation populaire rendent alors possible la migration massive d’images politiques sur des objets quotidiens et des accessoires corporels : foulards et mouchoirs illustrés, tabatières imprimées, têtes de pipe, assiettes « parlantes », éventails historiés, jouets illustrés, etc. Ces objets à images – « iconophores » – intègrent ainsi des scènes d’actualité, transfigurant l’artefact en media puis en trace commémorative, ou encore des figures d’hommes ou de femmes « illustres », contemporaines d’une « politique de la célébrité » (celebrity politics). La prolifération de ces objets à référents politiques a partie liée avec les processus de politisation populaire et de démocratisation informelle. Avant même que le suffrage ne devienne « universel » en 1848, l’exhibition d’objets et d’accessoires identitaires permettait à des individus – hommes ou femmes – ordinaires ou subalternes de s’affirmer dans l’espace politique et d’exprimer une opinion. Cet usage public des objets explique l’extrême attention des autorités, en particulier sous la Restauration, face à la circulation d’objets réputés « séditieux », à leur exhibition et à leurs effets sur l’ordre public. L’hybridité des objets à décor politique – entre le privé et le public, l’intérêt et la croyance, le conformisme et la dissidence – rend leur étude passionnante, à la condition de pouvoir documenter leurs usages sociaux.
Ces objets domestiques circulent à une échelle transnationale à « l’âge des révolutions » et ne se cantonnent pas à des cultures partisanes ou patriotiques (Francia et Sorba, 2021). Des « causes » beaucoup plus larges incorporent aussi les objets domestiques. Il en est ainsi des objets dits « abolitionnistes », relativement rares dans l’espace français, mais très massifs au contraire dans l’espace britannique et états-unien où ils ont donné à voir un puissant mouvement d’opinion contre l’institution esclavagiste : des faïences ou indiennes à décors hostiles à l’esclavage et à la traite, mais aussi des objets de consommation « éthique » produits hors du système esclavagiste (tapis en laine et non en coton ; sucre de betterave et non de canne, etc.). De la même manière, des militantes féministes, à la fin du XIXe siècle, ont su utiliser des objets ordinaires pour exprimer sur la scène publique leur volonté de défaire l’ordre des genres, dans le domaine juridique et politique : des petits ballons violets lancés lors de la commémoration du centenaire du Code civil à la Sorbonne, des éventails suffragistes à la Belle-Epoque, etc. (Larrère, 2022).
D’autres objets ordinaires sont politisés non par les images et signes qu’ils recèlent, mais par les pratiques sociales qui les entourent. La pratique, croissante au fil du siècle, de l’offrande politique, version démocratisée du cadeau diplomatique, est à cet égard significative, avec sa logique de don /contre-don. Divers objets, modestement bricolés, ont ainsi été adressés par de simples citoyens aux souverains successifs et à des représentants politiques, de manière plus ou moins désintéressée selon les cas. Cette pratique matérielle du politique par le bas reste largement une terra icognitahistoriographique pour le XIXe siècle. Sur un autre mode, la matérialité même de l’objet peut en soi être chargé d’émotions politiques. Des fragments issus de destructions iconoclastes peuvent ainsi se métamorphoser en reliques politiques, conservées chez soi ou patrimonialisées : des pierres ou des clés de la forteresse de la Bastille, des micro-fragments de la colonne Vendôme détruite par la Commune de 1871 ou des morceaux de velours arrachés au trône de Louis-Philippe en 1848. La conservation de cheveux, d’ossements ou autres reliques corporelles de grands hommes, héros ou martyrs politiques, relève aussi d’une politisation de l’espace domestique, avant de gagner l’espace public des musées. Pour ne pas parler des reliquaires du siège de Paris en 1870-1871, composés de morceaux de pain et d’ossements animaux et conservés chez soi comme traces d’un événement collectif traumatique.
Les objets les plus ordinaires ont aussi été, par des « arts de faire » et des bricolages symboliques, mobilisés dans des luttes collectives, devenant ainsi des objets de résistance ou « disobedient objects » (Flood, 2020). Des objets sonores– casseroles, chaudrons, sifflets – ont ainsi été agités dans le cadre de cortèges charivariques, surtout dans les années 1830, contre des députés ou des préfets honnis, et plus tard dans le siècle à l’occasion de certaines grèves (Fureix, 2023). Le chaudron et la casserole sont devenus les vivants symboles d’une nouvelle éloquence démocratique, opposée aux « bavardages parlementaires » et légitimée par la vox populi. Des objets liés au monde du travail, ont également occupé l’espace public, dans le cadre de protestations collectives et de défense des droits : les machines elles-mêmes, contestées en tant que « tueuses de bras » et destructrices de savoir-faire techniques, publiquement détruites dans le cadre de mouvements luddites durant la première moitié du XIXe siècle ; mais aussi des objets moins attendus, comme des artefacts « perruqués » et détournés du processus de production. Enfin, des objets de détention, fabriqués dans le cadre d’internements politiques (prison, déportation et bagne politiques) oscillent également entre le bricolage ordinaire et le geste de résistance : ainsi des bibelots de pacotille façonnés en noix de coco ou en écaille par des déportés communards en Nouvelle-Calédonie.
[1] Pour une série d’exemples, voir le site Objetspol, Objets politiques au siècle des révolutions (1768-1880) : https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/page/accueil
Les contributions s'insérant dans cet axe pourront aborder les multiples manières de politiser des objets ordinaires au XIXe siècle :
- à travers l’usage privé et/ou public d’objets domestiques à décor politique
- à travers la défense de « causes » incorporées dans des objets
- à travers l’usage d’objets ordinaires pour interpeller ou dialoguer avec les pouvoirs
- à travers le détournement d’objets du quotidien à des fins protestataires
—
Les propositions d'article, avec notice bio-bibliographique, (d'une page maximum) sont attendues pour le 15 décembre 2025.
Elles sont à envoyer à Emmanuel Fureix (fureix@u-pec.fr) et à Corinne Legoy (corinne.legoy@univ-orleans.fr).
Les articles acceptés (30 000 signes maximum) seront à rendre pour le 30 juin 2026.
—
Indications bibliographiques
Anaïs Albert, La Vie à crédit. La consommation des classes populaires à Paris (années 1880-1920), Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux xixe et xxe siècles », 2021
Arjun Appadurai (dir.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Londres-New York, Cambridge University Press, 1986.
Philippe Ariès, Georges Duby, Michelle Perrot (dir.), Histoire de la vie privée, T4. De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Point, 1999.
Philippe Artières, Histoire de l'intime, Paris, CNRS Editions, 2022.
Leora Auslander, Des révolutions culturelles : la politique du quotidien en Grande-Bretagne, en Amérique et en France, XVIIe-XIXe siècle, trad. Camille Hamidi, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010.
Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard 1968.
Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Livre des passages, Paris, Le Cerf, 1989
Laurence Bertrand-Dorléac, Les choses. Une histoire de la nature morte, Paris, Lienart, 2022.
Bernard Blandin, La construction du social par les objets, Paris, PUF, 2002.
Thierry Bonnot, « La biographie d’objets : Une proposition de synthèse », Cultures et musées, 2015, n°25, https://journals.openedition.org/culturemusees/543
Sophie-Valentine Borloz, Marta Caraion, Judith Lyon-Caen (dir.), Écrire les choses. Littérature et culture matérielle 1830-2020, Seyssel, Champ Vallon, 2025.
Catherine Brice et Emmanuel Fureix, dir., Objets politiques, Parlement(s), 2023/3.
Marta Caraion, Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle, Seyssel, Champ Vallon, 2020.
Jean-Claude Caron, L'été rouge. Chronique de la révolte populaire en France (1841), Paris, Aubier, 2002.
Manuel Charpy, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise. 1830-1914, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Luc Pinol, Université François-Rabelais de Tours, 2010.
Manuel Charpy, « Les intérieurs en natures mortes », Arts et Sociétés. Lettre du séminaire, Sciences Po Paris, n°101/2015.
Manuel Charpy, « Se coucher et se lever en scène. Déshabillages et résistances (1890-1914) », Modes Pratiques. Revue d'histoire du vêtement et de la mode, 2023/5, « Des nuits ».
Frédéric Chauvaud, Arnaud-Dominique Houte, Au voleur ! Images et représentations du vol dans la France contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe et XXe siècle, Paris, Aubier, 1978.
Anne Coudreuse, Françoise Simonet-Tenant (dir.), « Pour une histoire de l'intime et de ses variations », revue Itinéraires. Littérature, textes, cultures, 2010/4.
Emmanuelle Delapierre et alii (dir.), Le spectacle de la marchandise. Ville, art et commerce, 1860-1914, Paris, In Fine, 2024.
Jean-Claude Daumas, La révolution matérielle. Une histoire de la consommation. France XIXe-XXIe siècle, Paris, Flammarion, 2018.
Andrea Del Lungo, La fenêtre. Sémiologie et histoire de la représentation littéraire, Paris, Seuil, 2014.
Brigitte Diaz et José-Luis Diaz, « Le siècle de l'intime », Itinéraires, 2009-4, « Pour une histoire de l'intime et de ses variations ».
José-Luis Diaz, dir., Les choses, Le Magasin du XIXe siècle, Champ Vallon, 2012
Christopher Fletcher (dir.), Everyday Political Objects. From the Middle Ages to the Contemporary World, Londres, Routledge, 2021
Catherine Flood, “Disobedient Objects. Une exposition indisciplinée”, Techniques et culture, 2020/2, n°74, p. 88-107.
Enrico Francia, Oggetti Risorgimentali. Una storia materiale della politica nel primo Ottocento, Rome, Carocci, 2021.
Enrico Francia et Carlotta Sorba (dir.), Political objects in the Age of Revolutions, Rome, Viella, 2021.
Alfred Gell, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998.
Eric Geerkens, Nicolas Hatzfeld, Isabelle Lespinet-Moret, Xavier Vigna, Les enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine, Paris, La Découverte, 2019.
Emmanuel Fureix, L’œil blessé : politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019.
Philippe Hamon et Bertrand Tillier, Natures mortes, objets orphelins et choses particulières, Romantisme, 2022/4
Marie-Pierre Julien et Céline Rosselin, dir., La culture matérielle, Paris, La Découverte, 2005
Mathilde Larrère, Guns and Roses. Les objets des luttes féministes, Paris, Le Détour, 2022.
Bruno Latour, « Une sociologie sans objet ? Note théorique sur l’interobjectivité », Sociologie du travail, 1994, p. 587-607.
Philippe Lejeune, Le moi des demoiselles. Enquête sur le journal de jeune fille, Paris, Seuil, 1993.
Christine Macel, dir., L'intime. De la chambre aux réseaux sociaux, Paris, Gallimard/Musée des Arts décoratifs, 2024.
Pauline Mortas, Articles intimes pour dames et messieurs. Une histoire du marché lié à la sexualité (France, années 1880-1930), thèse de doctorat sous la direction de Dominique Kalifa (puis Anne Rasmussen) et Sylvie Chaperon, université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 2023.
Paris 1793-1794. Une année révolutionnaire. Catalogue de l'exposition au musée Carnavalet-Histoire de Paris du 16 octobre 2024 au 16 février 2025, Paris, Paris-Musées, 2024.
Michelle Perrot, Histoire de chambres, Paris, Seuil, 2009.
Philippe Perrot, Le corps féminin. Le travail des apparences XVIIIe-XIXe siècle, Paris, Seuil, 1984.
Dominique Pety, Poétique de la collection au XIXe siècle. Du document de l'historien au bibelot de l'esthète, Nanterre, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2010.
Régis Révenin, « L'émergence d'un monde homosexuel moderne dans le Paris de la Belle-Epoque », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2006/4.
Maxence Rodemacq, « L'industrie de l'obscénité à Paris. 1855-1930 », Romantisme, 2015/1, n°167, p.13-20.
Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.), Le magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Fayard, 2020.
Carlotta Sorba, « Faire de l’histoire politique avec des objets », « Faire de l’histoire du politique avec les objets. Trajectoires et enjeux actuels », Revue d’histoire culturelle, XVIIIe-XXIe siècles, 2022/4, https://journals.openedition.org/rhc/1253
Richard Taws, The Politics of the Provisional : Art and Ephemera in Revolutionary France, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2013.
Richard Wrigley, The politics of Appearances. Representations of Dress in Revolutionary France, Oxford-New York, Berg, 2002.