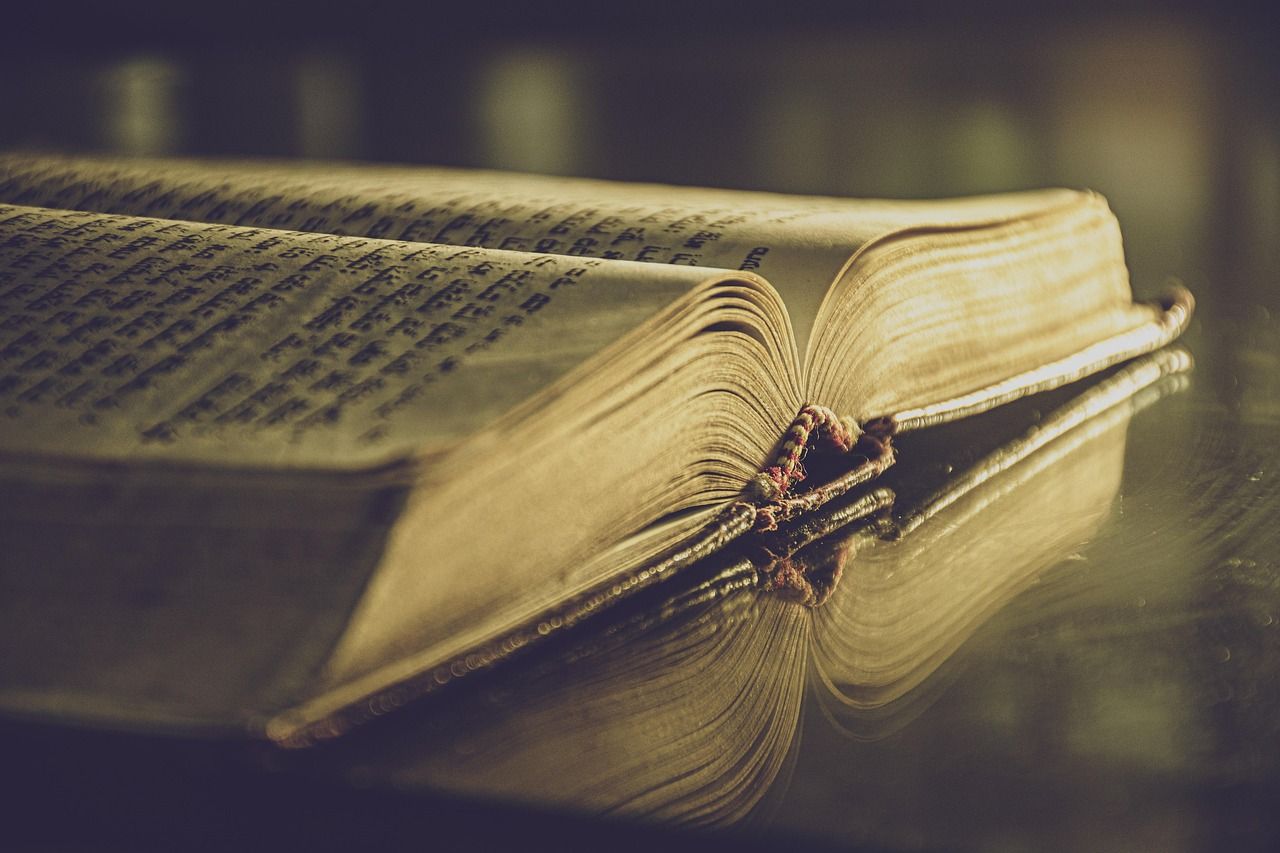
Comment on écrit l’histoire fictive. Historiographies en fictions / How to write fictional history. Historiographies in imaginative fiction (INHA, Paris)
Appel à communication
INHA, vendredi 20 et samedi 21 février 2026
(English version below)
L’histoire est une source d’inspiration pour la littérature de l’imaginaire : les périodes historiques, particulièrement antique et médiévale, constituent un creuset de références où puisent les auteurs de science-fiction et de fantasy, d’Asimov à Tolkien, comme l’ont montré de récents travaux sur la réception classique (Bost-Fiévet et Provini 2014) et le médiévalisme (Ferré 2010). Plus récemment encore, les actes d’un récent colloque (Besson 2019) ont montré la part d’imitation de l’histoire, lorsque documents, sources et légendes fictives peuplent l’œuvre et son passé imaginaire.
La rencontre organisée par l’association les Têtes Imaginaires (revue Fantasy Art & Studies), qui se déroulera les 20 et 21 février 2026 à Paris, vise à poursuivre cette réflexion sur les liens entre histoire et littérature de l’imaginaire, en repartant de l’histoire en tant que pratique d’élaboration d’un récit historique. Une dimension caractéristique de ces mondes imaginaires est que leur passé est structuré, par exemple en chronologies millénaires, et c’est sur la forme de ces Histoires, plutôt que sur leur contenu, que portera la rencontre. Trois gestes historiens en particulier attirent l’attention : l’enquête des sources historiques, le découpage chronologique du passé et le sens historique donné à sa progression. Le croisement de ces caractéristiques permettra d’étudier « comment on écrit l’histoire », pour reprendre la formule de Paul Veyne (1971), mais dans la littérature de l’imaginaire.
La démarche vise à faire dialoguer étroitement histoire et littérature en invitant particulièrement à identifier les représentations et modèles à l’origine des historiographies littéraires. Il s’agit donc d’associer ces « historiographies internes », littéraires et fictives, à la culture de l’écriture historique qu’ont ces auteurs, laquelle est parfois transmise par d’autres auteurs de l’imaginaire. On s’intéressera donc aux perceptions de l’histoire en tant que pratique, sans chercher à statuer sur une éventuelle fidélité à l’égard de méthodologies historiques plurielles par nature. La fantasy et la science-fiction se présentent comme un terrain privilégié ; l’uchronie, qui présente un passé identique au nôtre jusqu’au point de divergence, peut aussi faire l’objet de nouvelles enquêtes (Henriet 2004).
Le premier geste historien concerne l’enquête historique, les documents, récits, archives, mentionnés dans l’œuvre en tant que sources fictives de l’histoire. Bon nombre de travaux dus à des littéraires et à des historiens ont mis en lumière le thème de ces documents fictifs, essentiel dans le travail de l’historien (voir par exemple, à propos de Dune, Rossignol 2005). Les rôles de cette documentation sont pluriels, entre marqueur de rationalité (Besson 2002), mise en abyme du récit dans le cas du Livre Rouge du Seigneur des Anneaux (Pantin 2009, Ferré 2014), voire réflexion sur l’histoire (Budin 2019). Les variations de ces rôles peuvent être étudiés dans une démarche comparatiste. Il s’agit aussi de replacer les représentations de l’enquête historique dans le contexte de l’auteur et de sa culture (Pantin 2019).
Le deuxième geste met en cohérence le passé sous la forme de chronologies, de périodes, de dates charnières : il lui donne une forme cohérente. Cette périodisation du temps fictif reprend parfois les grandes périodes traditionnelles, par le nom ou le principe (Antiquité, Moyen Âge, etc.). Tolkien utilise ainsi l’idée d’Antiquité à plusieurs reprises dans son continuum historique, en tant qu’idée d’une époque idéale et révolue : la période met en profondeur le passé (Maillard 2024). Les modèles et formes de ces découpages restent cependant largement à explorer. Les travaux récents d’historiens, qu’il s’agisse de Jacques Le Goff, de Dominique Kalifa sur les noms des périodes (Kalifa 2020) ou de Maria Teresa Schettino et de Sylvie Pittia (2024) sur la notion de date-clef, fournissent des éléments de relecture des œuvres de l’imaginaire.
Le troisième geste est celui du sens de cette histoire. Quelle logique profonde anime la causalité historique de cet ensemble documentaire et chronologique ? Quelles « lois de l’histoire », comme elles sont appelées par Veyne (1971, p. 221), entre déterminisme et grands hommes, trouve-t-on à l’œuvre comme moteurs de l’histoire et de la causalité ? Quelle forme, linéaire ou cyclique (Bergue 2019), se trouve donnée au temps ? À nouveau, on pourra se demander si la source de ces conceptions est liée à un contexte historique ou à un courant philosophique : un homme comme Asimov aurait ainsi été influencé par le contexte de la « crise » avant de reporter ce motif dans son œuvre (Käkelä 2014). On se rappellera que l’œuvre, futuriste ou non, porte les « peurs et espoirs du temps présent » (Besson 2021).
La rencontre se déroulera en format hybride, les vendredi 20 et samedi 21 février 2026, dans les locaux de l’Institut National d’Histoire de l’Art, 2, rue Vivienne, 75002 Paris. Il sera possible de participer à l’événement à distance. Les contributions portant exclusivement sur la Fantasy seront publiées dans le volume 20 de la revue Fantasy Art and Studies. Les contributions portant sur la science-fiction feront l’objet d’une publication séparée.
Les propositions de communication sont attendues dans un format .doc ou .docx de 2000 signes, en français ou en anglais. Elles présenteront clairement une question de recherche, un cadre théorique et méthodologique ainsi que les principaux axes d’analyse envisagés. Elles seront accompagnées d’une courte présentation biobibliographique. Les propositions de jeunes chercheurs et chercheuses sont les bienvenues.
Les propositions sont à adresser conjointement à fantasyartandstudies@outlook.com et dimitri.maillard@gmail.com pour le 21 octobre 2025 au plus tard.
Elles pourront s’inscrire dans les axes décrits ci-dessous : les propositions multipliant les liens entre les axes sont valorisées, tout comme celles qui adopteront une démarche comparatiste, et articulant histoire et littérature.
1. Les sources et leur transmission : l’enquête
- La matérialité des sources et des archives, conservation, transmission, consultation
- Les témoins, l’oralité et l’écriture
- Les historiens et leur enquête
2. Rationaliser ou ne pas rationaliser
- Les formes du récit historique
- Rythme du passage du temps, calendrier, chronologie, datation
- Périodes et noms de périodes
3. Le sens de l’histoire
- Conception du temps cyclique, linéaire
- Philosophies de l’histoire
4. Des historiographies datées
- Culture historique et historiographique des auteurs
- Évolution de cette représentation dans l’œuvre des auteurs
History is a source of inspiration for imaginative literature: historical periods, particularly ancient and medieval times, are a melting pot of references drawn upon by science fiction and fantasy authors, from Asimov to Tolkien, as recent studies on classical reception (Bost-Fiévet and Provini 2014) and medievalism (Ferré 2010) have demonstrated. More recently, the proceedings of a recent symposium (Besson 2019) have shown the extent to which history is imitated when documents, sources and fictional legends populate a work and its imaginary past.
The conference organised by the association les Têtes Imaginaires (Fantasy Art & Studies journal), which will take place on 20 and 21 February 2026 in Paris, aims to continue this exploration of the links between history and fantasy literature, starting from history as the practice of constructing a historical narrative. A characteristic feature of these imaginary worlds is that their past is structured, for example in millennial chronologies, and it is the form of these histories, rather than their content, that will be the focus of the meeting. Three historical approaches in particular attract attention: the investigation of historical sources, the chronological division of the past, and the historical meaning given to its progression. The intersection of these characteristics will allow us to study “how history is written”, to borrow Paul Veyne’s (1971) phrase, but in the realm of imaginative literature.
The approach aims to establish a close dialogue between history and literature, with a particular focus on identifying the representations and models that underpin literary historiographies. The aim is therefore to link these “internal historiographies”, both literary and fictional, to the authors’ culture of historical writing, which is sometimes transmitted by other authors of imaginative fiction. We will therefore focus on perceptions of history as a practice, without seeking to judge any fidelity to historical methodologies that are pluralistic in nature. Fantasy and science fiction are ideal fields for this; uchronia, which presents a past identical to our own until the point of divergence, may also be the subject of further investigation (Henriet 2004).
The first historical gesture concerns historical research, documents, accounts and archives mentioned in the work as fictional sources of history. Many works by literary scholars and historians have highlighted the theme of these fictional documents, which are essential to the work of the historian (see, for example, Rossignol 2005 on Dune). These documents play multiple roles, ranging from markers of rationality (Besson 2002) to mise en abyme of the narrative in the case of The Red Book of the Lord of the Rings (Pantin 2009, Ferré 2014), and even reflections on history (Budin 2019). The variations in these roles can be studied using a comparative approach. It is also a question of placing representations of historical inquiry in the context of the author and their culture (Pantin 2019).
The second gesture brings coherence to the past in the form of chronologies, periods and key dates: it gives it a coherent form. This periodisation of fictional time sometimes echoes the major traditional periods, either in name or in principle (Antiquity, Middle Ages, etc.). Tolkien thus uses the idea of Antiquity several times in his historical continuum, as the idea of an ideal and bygone era: the period gives depth to the past (Maillard 2024). However, the models and forms of these divisions remain largely unexplored. Recent work by historians, such as Jacques Le Goff and Dominique Kalifa on the names of periods (Kalifa 2020) or Maria Teresa Schettino and Sylvie Pittia (2024) on the notion of key dates, provides elements for reinterpreting works of fiction.
The third gesture concerns the meaning of this history. What profound logic drives the historical causality of this documentary and chronological collection? What ‘laws of history’, as Veyne (1971, p. 221) calls them, between determinism and great men, are at work as drivers of history and causality? What form, linear or cyclical (Bergue 2019), is given to time? Once again, we may wonder whether the source of these conceptions is linked to a historical context or a philosophical current: a man like Asimov would thus have been influenced by the context of the “crisis” before transferring this motif into his work (Käkelä 2014). It should be remembered that the work, whether futuristic or not, reflects the “fears and hopes of the present time” (Besson 2021).
The meeting will take place in a hybrid format on Friday 20 and Saturday 21 February 2026 at the Institut National d’Histoire de l'Art, 2, rue Vivienne, 75002 Paris. It will be possible to take part in the event remotely. Contributions focusing exclusively on Fantasy will be published in volume 20 of the journal Fantasy Art and Studies. Contributions focusing on science fiction will be published separately.
Proposals for papers should be submitted in .doc or .docx format, with a maximum length of 2,000 characters, in French or English. They should clearly present a research question, a theoretical and methodological framework, and the main lines of analysis envisaged. They should be accompanied by a short bio-bibliographical presentation. Proposals from young researchers are welcome.
Proposals should be sent jointly to fantasyartandstudies@outlook.com and dimitri.maillard@gmail.com by 21 October 2025 at the latest.
They may fall within the areas described below: proposals that combine several areas will be valued, as will those that adopt a comparative approach and link history and literature.
1. Sources and their transmission: research
- The materiality of sources and archives, conservation, transmission, consultation
- Witnesses, oral tradition and writing
- Historians and their research
2. To rationalise or not to rationalise
- Forms of historical narrative
- The passage of time, calendar, chronology, datation
- Periods and names of periods
3. The meaning of history
- Cyclical and linear conceptions of time
- Philosophies of history
4. Dated historiographies
- The historical and historiographical culture of authors
- The evolution of this representation in the works of authors
Comité scientifique / Scientific board
- Anne Besson, Professeur en littérature comparée, Université d’Artois
- Viviane Bergue, docteure en littérature comparée (Université de Toulouse 2)
- Maxime Émion, Maître de conférences en histoire ancienne à l’Université Savoie Mont Blanc
- Dimitri Maillard, docteur en histoire ancienne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Laura Martin-Gomez, Maître de conférences en anglais à l’Université de Toulouse
- Isabelle Pantin, Professeur émérite en littérature de la Renaissance, École Normale Supérieure, Paris
- Sandra Provini, Professeur de littérature française du XVIe siècle, Université de Rouen-Normandie
Bibliographie / Bibliography
M. Attali, « Du mythe à la Fantasy. Enjeux historiographiques de la réécriture contemporaine de l’Énéide dans Lavinia d’Ursula L. Leguin (2008) », A. Besson (dir.), 2019, p. 75-100.
V. Bergue « Primhistoire, temporalité cyclique et chronologie linéaire : le temps de la Fantasy », A. Besson (dir.), 2019, p. 53-74.
A. Besson, D’Asimov à Tolkien, Cycles et Séries dans la littérature de genre, Paris, CNRS Éditions, 2004.
A. Besson, « La Terre du Milieu et les royaumes voisins : de l’influence de Tolkien sur les cycles de Fantasy contemporains », V. Ferré (dir.), Tolkien, trente ans après (1973-2003), Paris, Christian Bourgois, 2004, p. 357-379.
A. Besson (dir.), Fantasy et Histoire(s), Colloque des Imaginales, Chambéry, ActuSF, 2019.
A. Besson, Les Pouvoirs de l’Enchantement, Paris, Vendémiaire, 2022.
Fl. Besson, « Sortir des Moyen Âge imaginaires : le rythme historique de la Fantasy médiévaliste », A. Besson (dir)., 2019, p. 171-193.
M. Bost-Fiévet, S. Provini (dir.), L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain, Paris, Classiques Garnier, 2014.
N. Budin, « Les fées historiques, entre histoire et fiction », A. Besson (dir.), 2019, p. 121-140.
Hugues Chabot, « L’Image du chercheur et de la recherche scientifique dans la science-fiction de l’Âge d’Or. Une Histoire des sciences en trois temps : rupture, contraction, évolution », Cycnos, 2006-10-13.
V. Ferré (dir.), Médiévalisme. Modernité du Moyen Âge, Paris, L’Harmattan, 2010.
V. Ferré, Lire J. R. R. Tolkien, Paris, Pocket, 2014.
Fr. Hartog, Régimes d’historicité, présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil, 2003.
E. B. Henriet, L’Histoire revisitée. Panorama de l’uchronie sous toutes ses formes, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 65-70.
J. M. J. Käkelä, « Asimov’s Foundation Trilogy: From the Fall of Rome to the Rise of Cowboy Heroes ». Extrapolation, 49(3), (2008), p. 432-449
J. M. J. Käkelä, « Managing and Manipulating History : Perpetual Urgency in Asimov and Heinlein », Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 1, 2, 2014, p. 7-22.
D. Kalifa (dir.), Les Noms d'époque. De « Restauration » à « années de plomb », Paris, Gallimard, 2020.
D. Maillard (dir.), Tolkien et l’Antiquité, Passé et Antiquités en Terre du Milieu, Paris, Classiques Garnier, 2024.
I. Pantin, Tolkien et ses légendes. Une expérience en fiction, Paris, CNRS Éditions, 2009.
I. Pantin « L’histoire au miroir de la légende dans l’œuvre de Tolkien », A. Besson (dir.), 2019, p. 101-120
I. Pantin, S. Provini, Tolkien et la mémoire de l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2025.
B. Rossignol, « Figures de l’historien dans le cycle de Dune de Frank Herbert », Cycnos, 2005, 22, 2, p. 67-83.
M. T. Schettino, S. Pittia (org.), Dates-clés des Grecs, dates-clés des Romains : une périodisation commune ?, colloque organisé à Strasbourg les 25, 26, 27 septembre 2024.
P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971.
Jean-Louis Trudel, « La science-fiction et l’appropriation des révolutions scientifiques », Sciences & fictions, 2008-05.
H. Williams (dir.), Tolkien and the Classical World, Walking Tree Publishers, 2021.