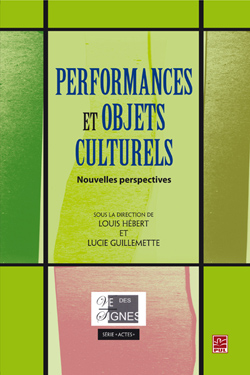
Performances et objets culturels. Repères théoriques
Sous la direction de Louis Hébert (Université du Québec à Rimouski) et Lucie Guillemette (Université du Québec à Trois-Rivières)
Québec : Presses universitaires de Laval, 2012.
EAN 9782763790558
Prix 59,95CAND
538 p.
Présentation de l'éditeur :
En guise d’introduction à ce livre, posons quelques balises pour l’étude des performances culturelles et des objets qu’elles produisent à leur terme.
1. Nature et culture
La culture est traditionnellement interdéfinie avec la nature. L’homme est tantôt tiré du côté de la nature – par exemple, en tant qu’animal raisonnable –, tantôt du côté de la culture – par exemple en tant que maître adamique de la nature –, tantôt placé comme médiateur entre les deux – n’a-t-il pas et un corps et un esprit, n’est-il pas la nature produisant la culture à travers ses objets (matériels ou idéels) ? Cette prééminence de l’humain est contestée, et l’on parle maintenant de cultures animales : alors « l’innovation et sa transmission ne suffisent pas à définir la spécificité des cultures humaines ; c’est la diversification et l’autoréflexion des pratiques techniques et sémiotiques qui les distingue » (Rastier, 2002 : 5). La nature de la culture, de l’objet et de la performance culturels, déjà problématique, s’en trouve modifiée.
2. Nature polyculturelle des objets
Performances et objets appartiennent à une série circoncentrique de zones culturelles d’étendues croissantes. C’est que les cultures connaissent des paliers descriptifs, de la zone culturelle minimale à la zone culturelle maximale. Si l’on peut sans doute à bon escient parler de culture ethnique, sociétale, nationale, où s’arrête la culture transnationale : peut-on parler, par exemple, d’une culture européenne, d’une culture occidentale et, pourquoi pas, planétaire ? Où commence la culture : une profession, une entreprise (on parle couramment de « culture d’entreprise »), une institution, une ville sont-elles coextensives d’une culture particulière ? Chose certaine, des relations hiérarchiques s’établissent entre différents paliers culturels si bien que l’on peut parler d’usages, normé ou non, d’une culture. Proposons d’appliquer à la culture le traitement qu’Humboldt (Rastier, 2002 : 244) a fait des langues : les cultures doivent non seulement être envisagées dans leur diversité mais dans leur diversité interne et jusque dans les usages individuels qui en sont faits.
Une même performance, un même objet peut appartenir à des zones culturelles distinctes d’un même palier descriptif. Deux cultures peuvent se fondre partiellement ou complètement ou une nouvelle culture peut émerger plus ou moins complètement d’une autre culture. Se posent alors la question de la pondération des deux éléments constitutifs (l’un prédomine-t-il ?) et celle de l’intensité du mélange/tri (à quel point leur mélange ou leur séparation est-il achevé ?). Les quatre grands degrés – ou d’un point de vue dynamique, les quatre grandes étapes – de mélange/tri sont la séparation, la contiguïté, le mélange (ou brassage) et la fusion (Zilberberg, 2000 : 11). Ainsi, le métissage culturel, qui rapproche des zones culturelles différentes, relève du mélange, « pratique sémiotique figurale indépendante des contenus circonstanciels investis » (Zilberberg, 2000 : 8).
2. Nature différencielle de la culture
La coexistence des cultures peut être sémiotiquement représentée grâce à un modèle systémique et différentiel. Ainsi, selon ce modèle, chaque culture obtient sa valeur relativement aux cultures qui partagent avec elle le même ensemble définitoire et également par la différence qui s’instaure entre les différents ensembles définitoires. Dans une perspective tant productive qu’interprétative, des opérations d’assimilation (régies par des forces centripètes (Klinkenberg, 1996 : 260)) et de dissimilation (régies par des forces centrifuges) sont susceptibles de diminuer ou d’augmenter les contrastes entre cultures. La nature différentielle alors prêtée à la culture suppose une approche différentielle et comparée. La fonction et l’objectif principal des sciences de la culture est la caractérisation : « le programme de caractérisation semble définitoire des sciences de la culture. Il vise la singularité des objets, qui culmine dans l’oeuvre d’art non reproductible. » (Rastier, 2002 : 4) L’objectif de caractérisation impose une méthode différentielle et comparée : « car une culture ne peut être comprise que d’un point de vue cosmopolite ou interculturel : pour chacune, c’est l’ensemble des autres cultures contemporaines et passées qui joue le rôle de corpus. En effet, une culture n’est pas une totalité : elle se forme, évolue et disparaît dans les échanges et les conflits avec les autres. » (Rastier, 2002 : 5) Cette relation différentielle peut être envisagée sous un angle irénique – les cultures coexistent ou peuvent coexister pacifiquement, elles opèrent des échanges – ou polémique – les cultures sont de facto ou structurellement en perpétuelle lutte pour « occuper le terrain ». Le modèle de la « guerre des langues » en sociolinguistique permet de poser quelques balises pour décrire la dynamique conflictuelle ou à tout le moins le rapport de force. Comme pour une langue, la force d’une culture se mesure par une série de critères : nombre de personnes impliquées, force militaire, force politique, force économique, étendue et dispersion géographique, prestige proprement culturel, etc. Ces facteurs ont des effets rétroactifs et une grande force culturelle peut amener une plus grande force économique, par exemple.
3. Variation culturelle
Qui dit culture dit variation culturelle, par opposition à la nature considérée comme stable et universelle. Klinkenberg (1996 : 255) distingue, dans les facteurs externes de la variation sémiotique, l’espace, le temps et la société, le groupe social. Nous dirons que ces trois éléments sont non seulement des locatifs, des repères, mais des facteurs modifiant la culture. Diverses relations sont susceptibles de s’instaurer entre ces facteurs (Klinkenberg, 1996 : 256) : (1) la variation dans l’espace peut dépendre de la variation temporelle et (2) vice versa ; (3) la variation dans l’espace peut être corrélée avec la variation dans la société et (4) vice versa ; (5) la variation dans le temps peut dépendre de la variation dans la société et (6) vice versa. Par exemple (cas 5), la cuisine et la structure des repas aujourd’hui (variation dans le temps) dominants en Europe sont la continuation de la cuisine bourgeoise (variation dans la société). La culture peut ainsi être envisagée en synchronie/diachronie, syntopie/diatopie, synstratie/diastratie. Selon la métaphore organique, que l’on peut par ailleurs contester, les cultures et les formes culturelles (par exemple, un mouvement artistique, un genre) naissent, se développent, atteignent leur apogée, déclinent et disparaissent. De nouvelles cultures (et formes culturelles) naissent sur les débris des anciennes, mais ces débris ne sont pas inertes et ils informent la nouvelle culture.
4. Culture et systèmes sémiotiques
Pour Rastier, la culture fait intervenir trois sphères, même si la sphère la plus caractéristique est sans doute la seconde, où elle trouve à se réfléchir. Pour pallier les insuffisances des bipartitions ontologiques (par exemple, monde physique/monde cognitif), Rastier propose la tripartition sphère physique, sphère sémiotique et sphère des processus mentaux ou sphère cognitive. Voici en résumé cette hypothèse : « une culture peut très bien être définie comme un système hiérarchisé de pratiques sociales. » (Rastier 1994 : 211) Toute pratique sociale est une activité codifiée, qui met en jeu des rapports spécifiques entre trois sphères (Rastier 1994 : 224) : 1. Une sphère physique constituée par les interactions matérielles qui s'y déroulent. 2. Une sphère sémiotique constituée des signes (symboles, icônes et signaux, etc.) qui y sont échangés ou mis en jeu. 3. Une sphère des processus mentaux propres aux agents et en général fortement socialisés (Rastier 1994 : 4 et 1991 : 237-243). Dans cette tripartition la sphère sémiotique est médiatrice entre le monde physique et le monde des processus mentaux, le plan de l'expression ayant des corrélats privilégiés dans la sphère physique et le plan du contenu, dans la sphère mentale (Rastier 1994 : 5). Les corrélats physiques attachés aux signifiants sont les stimuli (Klinkenberg) et les corrélats cognitifs des signifiés sont les images mentales ou simulacres multimodaux (Rastier). La spécificité des sciences de la culture réside dans la description de la sphère sémiotique. En effet, les sciences de la culture, par opposition aux sciences de la nature, doivent leur richesse à deux diversités :
« celle des cultures, qui les fait se mouvoir dans des temps et des espaces différenciés ; puis, pour chaque objet culturel, celle des paramètres non reproductibles, qui empêchent toute expérimentation au sens strict et écartent ainsi le modèle des sciences physiques. Même promus au rang d’observables, les faits humains et sociaux restent le produit de constructions interprétatives. Aussi, les sciences de la culture sont les seules à pouvoir rendre compte du caractère sémiotique de l’univers humain. » (Rastier, 2002 : 3-4)
Fontanille présente ainsi la sémiosphère de Lotman (1998) : « La sémiosphère est le domaine dans lequel les sujets d’une culture font l’expérience de la signification. L’expérience sémiotique dans la sémiosphère précède, selon Lotman, la production des discours, car elle en est une de ces conditions. La sémiosphère est avant tout le domaine qui permet à une culture de se définir et de se situer, pour pouvoir dialoguer avec les autres cultures » (Fontanille, 2003 : 296). La sémiosphère est donc le lieu réflexif d’une culture, qui s’y lit indiciairement. La notion de sémiosphère constitue, semble-t-il, un élargissement par rapport à celle de discours social (Angenot), qui s’applique à tout ce qui se dit ou s’écrit dans une société. Le discours social sert également d’« objectivateur » : étudier un discours social, c’est prendre en compte des « pratiques par lesquelles la société s’objective dans des textes et des langages » (Angenot : 1989 : 35) L’un et l’autre concept découlent de l’axiome qui veut que le producteur se reflète indiciairement dans sa production, se connaît, ne peut se connaître que dans sa production. Ce postulat repose sur la triple nature de tout signe selon Bühler : symbole relativement au référent, signal relativement au récepteur et indice (ou symptôme) relativement à l’émetteur. Lotman reconnaît des « traductions » d’éléments extérieurs à une culture qui intègrent un processus à quatre phases : « l’objet extérieur est admiré et envié, apparaissant comme une menace ; puis il est assimilé et perd son lustre car on oblitère son origine ; enfin, on l’universalise, en se proposant comme source de son universalité. Mais nulle part il n’est prévu que l’altérité puisse être appréciée comme telle, ni que dans la « traduction » une distance puisse être maintenue, car son but est précisément d’annihiler l’altérité. » (Rastier, 2002 : 6).
La « traduction » d’une culture ou d’une production culturelle en une production sémiotique, par exemple un texte anthropologique, adaptée à une autre culture est affectée par diverses « mises en forme » : choix de la sémiotique (la langue écrite ou oral accompagnée ou non de documents visuels, etc.) ; choix du support (un texte en livre ou en revue, une communication, etc.) ; choix du public (ouvrage de vulgarisation ou savant, public occidental, etc.) ; choix du discours (discours anthropologique, etc.) ; choix du genre (article en revue savante, dans un quotidien, etc.) ; choix de mise en discours (tournures personnelles ou impersonnelles, etc.). Calame accorde un caractère déterminant à la mise en discours, qui semble également englober d’autres mises en forme que celles que nous venons de présenter : « C’est donc dans la mise en discours, dont le résultat matériel est la monographie, que pratiques et représentations indigènes acquièrent l’aspect holiste qui les constitue en culture. » (Calame, 2002 : 62) On rejoint par là un autre postulat répandu : celui de l’interdépendance du fond et de la forme, du support et du « supporté », du média et du médiatisé, etc.
* * *
Le présent ouvrage se compose d’une trentaine de contributions qui reprennent à divers degrés des problématiques liées à la constitution des objets culturels dans les discours et à leur signification dans les sociétés. La teneur variée des études regroupées fait en sorte que l’on y aborde les objets culturels dans toute leur complexité, à la fois sous un angle théorique, analytique et critique. Il en résulte une oeuvre à multiples voix rendant compte de sujets riches et inépuisables et perçant maints horizons disciplinaires. Les collaborateurs et collaboratrices orientent leurs recherches tantôt vers l’investigation d’objets culturels mis en forme par des discours de toute provenance et de productions sémiotiques qui en émergent, tantôt vers l’illustration de modèles mis à l’épreuve pour comprendre et expliquer une panoplie de productions discursives et culturelles.
Dans un premier temps, François Rastier projette d’interroger les sciences de la culture afin de rendre compte de la spécificité sémiotique complexe des objets culturels qui, partant, ne peuvent être réduits à des marchandises triviales dans un contexte de mondialisation. Relevant d’une praxéologie, ces objets peuvent acquérir un statut d’objets de connaissances scientifiques dans la mesure où ils s’inscrivent dans des processus de production et d’interprétation de la culture. Dans le cadre d’une anthropologie sémiotique, Rastier procède à une typologie des objets culturels que la professionnalisation et le court terme économique ont ramifiés et trop bien compartimentés. Il importe, pour l’auteur, de « restituer la complexité du concept de culture pour réunifier le monde humain ». C’est sous un angle analogue que Jean-Guy Meunier tente de définir l’objet culturel. L’auteur aborde la question de la culture s’articulant autour de métaphores issues d’approches distinctes (naturaliste et herméneutique) et qui, en dépit de leur apparente opposition, reposent sur une même conception sémiotique. Toujours en interrogeant la relation qui prévaut entre le monde naturel et le monde de la culture, Magoulas Charalampos s’attarde plus particulièrement au facteur de la perception dans le contexte d’une culture mondialisée et des conflits politiques qu’elle engendre. Dans le prolongement des travaux d’une sémiotique tensive, Luisa Ruiz Moreno s’intéresse, pour sa part, à la construction sémiotique de l’objet culturel émanant des discours eux-mêmes et d’une dialectique du sujet et de l’objet, construction liée de ce fait au concept de performance. Selon une perspective théorique qui vise à reproduire la genèse de produits culturels distincts – le carré sémiotique et le tétralemme –, Louis Hébert examine les relations de contrariété et de contradiction qui se déploient au sein de deux modèles intellectuels de mise en forme de la culture. L’auteur cherche alors à mettre en relief les questionnements épistémologiques inhérents à des systèmes de modélisation de la pensée qui se situent à chacune des extrémités de sphères culturelles déterminantes.
Nombreux sont les objets culturels dont les performances atteignent leur paroxysme dans le jeu lui-même. Alejandro Zamora examine la notion de jeu comme pratique culturelle dans le roman City de l’écrivain italien Alessandro Baricco. L’auteur décrit cette pratique du roman moderne comme un objet théorique de premier plan dans le discours des sciences humaines. La dimension sémiotique des performances culturelles est au coeur de la réflexion de Nicolas Couégnas et Delphine Marc qui se penchent à leur tour sur la pratique ludique. Mis en rapport avec les propositions sémiotiques de Rastier, le sujet sémiotique qui survient dans le jeu apparaît alors comme un sujet modal hybride. Si le jeu et le jouet modélisent les performances culturelles d’un sujet, les animaux en peluche constituent des objets transculturels par excellence dans le texte de Walter Putnam. Simulacres de la nature, ces objets témoignent des grandes étapes de l’histoire industrielle moderne tout en se prêtant, dans la sphère du privé, aux fantaisies de jeunes sujets.
À l’aulne des structures oppositionnelles qui façonnent certains modèles dominants au coeur de l’édification des sciences de la culture, les liens qui se tissent entre le sujet et l’objet font partie intégrante de certains systèmes d’interprétation des sociétés et des productions culturelles qui les définissent. C’est d’ailleurs la dichotomie sujet/objet qu’interroge Nanta Novello Paglianti dans une étude qui se propose d’intégrer l’humain à des modèles d’interprétation propres aux sciences sociales. À l’image de tels modèles, le signe s’inscrit dans un processus de signification, ce qui permet à l’auteure de rendre compte de l’art brut brésilien sans y apposer des schèmes d’interprétation limitatifs et conditionnés par les poncifs de l’art classique. Ce sont également des processus d’interaction (ou d’opposition) culturelle qui guident l’étude de Catalina Sagarra examinant les récits de témoignages de survivantes au génocide ayant eu lieu au Rwanda en 1994. S’appuyant sur des critères morphologiques et raciaux, le texte fait état des appropriations et des déformations du culturel dans le contexte de la colonisation belge et des luttes antagonistes qui s’en suivirent. Toujours selon une perspective où le soi et l’autre contribuent à la construction de l’identitaire, Olga Galatanu analyse des valeurs et des images de la francophonie. Les mécanismes sémantico-discursifs retiennent l’attention dans la mesure où ils rendent compte de processus de construction et d’interprétation du sens discursif assigné aux divers espaces culturels francophones. C’est à la querelle qui a animé l’édition canadienne-française face à des intellectuels français, au terme de la Seconde guerre mondiale, que s’attarde François Provenzano. L’article pose d’abord La France et nous de Robert Charbonneau comme un objet discursif ayant donné lieu à une performance métaculturelle et, par la suite, dégage de cette illustration une réflexion sociosémiotique de la culture. Marcelino Chauque se penche également sur la dynamique du Je et de l’Autre alors qu’il scrute les postures identitaires de locuteurs français et mozambicains. Retenant les catégories sémiotiques du proche et du lointain, l’auteur tente de « dégager une structuration spatiale de l’imaginaire linguistique des sujets en interaction. » La notion du « bon sauvage » dans le contexte de la découverte de l’Amérique alimente la réflexion de Nour Elsobky qui s’attarde aux récits de voyageurs ayant déconstruit le mythe propre à la création du Nouveau Monde et ce, au profit de l’éloge du modernisme et du progrès. Marie-Eve Samuel jauge à son tour les interactions culturelles du civilisé et du sauvage qui constellent le célèbre roman de Michel Tournier. Si elle signale des figures et des thèmes dont les significations sont parfois contradictoires, l’auteure effectue une nouvelle lecture de l’oeuvre et met à contribution la notion du tiers inclus dans le but de cerner l’entre-deux littéraire du texte romanesque. C’est pour ainsi dire un entre-deux cinématographique que cherche à débusquer Lucie Roy au fil d’une étude montrant la contamination réciproque des motifs du documentaire et de la fiction au sein d’oeuvres de documentaire et de fiction du cinéma américain.
L’espace et les objets introduits au sein des figurations spatiales constituent des éléments déterminants des productions sémiotiques qui ne peuvent se limiter à une structure linéaire temporelle. La sémiotique des objets fonde l’étude de Marc Monjou dont la réflexion s’engage vers de nouvelles problématiques tributaires de la prise en compte de la dimension fonctionnelle des objets, négligée par une tradition linguistique les réduisant à de simples référents ou supports de signes. Quant à Magariños de Morentin, il explore certains principes développés au sein de la théorie pragmatique de Charles Pierce dans le but d’élaborer une sémiotique indicielle dont l’objet de connaissance s’incarnerait dans l’université de la rue. De son côté, Roberto Flores s’intéresse aux événements composant un récit et à l’effet de continuité que celui-ci peut instaurer au fil de la trame narrative. Au-delà d’une conception sémiotique qui pose le récit comme une transformation entre un état initial et un état final, l’auteur se propose de décrire et d’analyser l’intégration des événements et leur culmination dans un récit dont la progression narrative est tributaire d’un espace de signification. S’inspirant des sciences cognitives qui associent le temps des processus à un fond temporel en continu, l’auteur examine les suites itératives d’événements et assigne un rôle privilégié à la place du continu et de l’espace dans le narratif. Dans le sillage des sémiotiques de l’architecture développées au cours des années 1960, Ufuk Dogrusoz décrit le programme de recherche d’Alain Rénier et en identifie les principaux jalons théoriques et méthodologiques. L’auteur suppose que la complexité spatiale du programme n’a pu être prise en compte en raison du modèle structuraliste d’application dont il a émergé. Toujours dans l’optique d’une sémiotique de l’architecture, Ruggero Lancia se penche sur le signe architectural mis en rapport avec les espaces culturels réels au sein d’une oeuvre graphique de Bernard Tschumi.
Les rapports que le signe linguistique entretient avec des univers de référence exposent des mécanismes de modélisation de sens permettant de rendre compte des performances des objets culturels. Yves Bordet dévoile l’armature linguistique des grandes oeuvres de la littérature française avec les 1 700 mots composant la liste du Français Fondamental littéraire (FFL), qui en constituent les lexèmes de prédilection. L’encyclopédie linguistique répertoriée pénètre 95% des textes français ayant marqué les années 1950 et 1960, ce qui rend ce grand discours davantage accessible aux apprenants du français, langue étrangère. Yolanda G. López Franco se livre à une étude lexicologique comparative alors qu’elle isole le signifiant qu’est le prénom et en fait un phénomène révélateur, pour deux périodes données, de biens symboliques et de projets parentaux inhérents à des communautés linguistiques à la fois similaires et différentes (France et Mexique). Sébastien Ruffo jette un éclairage sémiotique sur le phénomène de la turlutte, qu’il associe à un signe linguistique aux contours flous, à une pratique qu’il situe entre la nature et la culture, bref, entre le cru et le cuit, pour reprendre les notions propres à l’anthropologie structurale.
Axées sur la dynamique des représentations et des objets d’un imaginaire, les pratiques littéraires et artistiques évoquent des lieux de performance culturelle permettant de reconstituer la trajectoire des êtres et des choses. André Gervais présente le premier roman de Louise Desjardins comme un lieu où la culture savante et la culture populaire se font écho, mélange de genres qui ponctue en quelque sorte le parcours d’une jeune femme au sein de son Québec natal et dans l’ailleurs. Ce sont les espaces de signification sous-jacents à des processus d’interaction culturelle alambiqués qui retiennent l’attention de Lucie Guillemette dans une étude consacrée à une suite romanesque pour la jeunesse dont l’auteure est Claudine Vézina. Une jeune Québécoise est en effet projetée dans les méandres d’une enquête qui l’amène à se familiariser avec des espaces culturels autres, dont celui du Japon. L’art public et les 42 sculptures qui sillonnent le territoire montréalais sont l’objet de l’investigation de Romain Gaudreault. Ce dernier pose les objets culturels associés respectivement à la présence britannique et à la présence française comme des figures de tension nationale entre les deux peuples, reproduites en terre montréalaise.
Selon une perspective d’analyse faisant de l’hyperlien un objet de saisie culturelle, Florentina Vasilescu Armaselu commente les caractéristiques du texte électronique dont la densité informationnelle, rendue possible par des techniques photographiques diverses, permet un retour au contexte de production sociohistorique. Les objets peuplant le cyberespace sont soumis également à l’attention d’Éric Trudel dans une étude portant sur les sites web de la restauration. L’auteur s’appuie sur la théorie morphosémantique développée à l’intérieur de la sémantique interprétative de Rastier pour analyser les thèmes sémantiques qui composent les sites sélectionnés.
Ouvrages cités
ANGENOT, M. (1989), « Le discours social : problématique d’ensemble », 1889 : Un état du discours social, Longueuil (Québec), Préambule, p. 13-39.
CALAME, C. (2002), « Interprétation et traduction des cultures », L’homme, Paris, p. 51-78.
FONTANILLE, J. (2003), « La sémiosphère », Sémiotique du discours, Limoges, Presses de l’U. de Limoges, p. 296-299.
KLINKENBERG, J.-M. (1996), « La variation sémiotique », Précis de sémiotique générale, Paris, Seuil, p. 239-309.
LOTMAN, I. (1998), La sémiosphère, Limoges, Presses de l’Université de Limoges.
RASTIER, F. (2002), « Avant-propos. Pluridisciplinarité et sciences de la culture », Une introduction aux sciences de la culture, Paris, Presses universitaires de France, p. 1-10.
RASTIER, F. (1991), Sémantique et recherches cognitives, Paris, Presses universitaires de France.
RASTIER, F., M. CAVAZZA et A. ABEILLÉ (1994), Sémantique pour l'analyse, Paris, Masson.
ZILBERBERG, C. (2000), « Les contraintes sémiotiques du métissage », Esthétiques du métissage, Tangence, Rimouski/Trois-Rivières, 64, automne, p. 8-24. (URL : http ://www.erudit.org/revue/tce/2000/v/n64/008188ar.pdf)