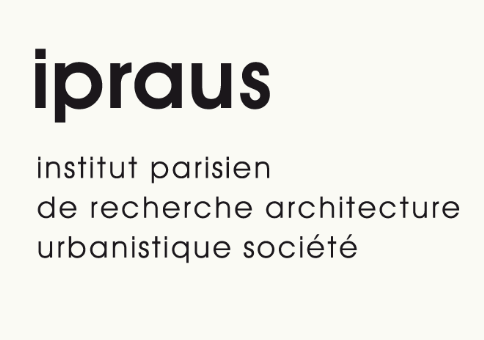
Pour une histoire féministe des discours sur l’environnement construit et paysager du long XIXe s. en France (Paris)
Argumentaire
Depuis les années 1970, des architectes, historien·ne·s féministes écrivent une histoire des villes, de l’architecture et de l’habitat à travers le prisme du genre, pour reconstruire une histoire des femmes qui pensent l’espace. Ces recherches se sont révélées fondamentales non seulement pour écrire l’histoire des femmes, mais surtout pour écrire une nouvelle histoire (Thébaud 1998). Par ces recherches, le genre devient une « catégorie utile d’analyse historique » (Scott 1988) à part entière qui engage la décomposition des effets d’une société patriarcale sur la construction de récits architecturaux.
Cette journée d’étude s’inscrit dans une histoire transnationale qui a déjà été menée notamment aux États-Unis sur les « féministes matérielles » (Hayden 1981/2023) mais aussi en prenant en compte le travail des femmes architectes en général et non pas en se concentrant sur les exceptions connues (Torre 1977). C’est dans le souci de déplier les différents dispositifs spatiaux, les dynamiques genrées au sein de la profession et la reconfiguration critique de l’histoire de l’architecture prenant en compte les voix des femmes et les questionnements portés par les mouvements féministes qu’une large littérature s’est développée. Si cette dernière est à prédominance anglo-américaine, de nombreux mouvements, projets et figures ont été étudiés à l’international, on pense en particulier à l’Allemagne (Uhlig 1981 ; Terlinden, von Oertzen 2006), au Danemark (Vestbro 1982), aux Pays-Bas (Novas Ferradas 2023, 2024), et à la Belgique (Vranken 2018).
En France, l’histoire de l’architecture au féminin a été précédée par une vague de travaux de sociologues sur les enjeux liés à la féminisation de la formation et de la profession d’architecte en France (Chadoin 1998 et 2002 ; Lapeyre 2003). Elle s’est d’abord concentrée sur les pionnières, dans une logique de rattrapage après des décennies d'historiographie ayant globalement invisibilisé les femmes architectes. Deux grands axes se détachent : celui la féminisation des études d’architecture et de la profession depuis la fin du XIXe siècle (Diener 2013 ; Giaquinto 2016 ; Girard et Ringon 2019 ; Bouysse-Mesnage 2022 et 2023a), porté par le programme de recherche sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture en France au XXe siècle (HENSA20), et celui de leur apport à la production théorique et construite française, principalement moderniste (Koering 2016, 2018 et 2023 ; Bouysse-Mesnage et al., 2023b ; Mittmann 2023a et 2023b). Cette dynamique s’est élargie parallèlement à l’histoire de la critique d’architecture au féminin, à laquelle sont consacrés depuis quelques années programmes (Barbut et Kramer-Mallordy) et travaux de recherche (Knockaert, en cours), événements scientifiques (Châtelet, Jannière, Scrivano 2023) et expositions (Szacka 2025). Cette dynamique s’est néanmoins concentrée sur le XXe siècle et sur quelques figures majeures de la critique d’architecture et d’urbanisme au féminin, françaises (Marie Dormoy, Françoise Choay) ou nord-américaines (Ada Louise Huxtable, Phyllis Lambert, et la critique féministe américaine).
Aussi important soit-il, ce rattrapage en cours n’a pas encore permis de répondre à une question pourtant cruciale : « Comment écrire [...] des histoires féministes de l'architecture sans femmes architectes ? » (Hultzsch 2022). La traduction en français et la publication récentes de textes charnières, principalement issus de la scène anglo-américaine, ayant abordé entre les années 1970 et 1990 une histoire de l’architecture prenant en compte plus largement l’apport des femmes et des mouvements féministes (Dadour 2022 ; Hayden 1981/2023), ont réactivé l'héritage de l'ouvrage pionnier sur l’histoire et l’actualité des utopies féministes (Denèfle 2009). Une thèse en cours autour de projets architecturaux féministes qui pensent la socialisation du travail domestique (Jonville, en cours) confirme ce regain d'intérêt pour une histoire féministe de l'architecture, complémentaire d’une histoire des femmes architectes (Bastoen 2024 ; Thibault 2014).
Un programme de recherche en cours, intitulé Women Writing Architecture: Female Experiences of the Built 1700-1900 et piloté par Anne Hultzsch depuis l’ETH Zurich, cherche à explorer la production discursive féminine sur l’architecture en évitant l’écueil de la survalorisation de l’individu concepteur (Willis 1998) : « L'écriture et la publication ont historiquement offert (et offrent encore souvent aujourd'hui) un espace aux femmes, et à d'autres groupes marginalisés, pour parler d'une voix publique, pour être entendus, pour pratiquer. Elles ont créé des réseaux intellectuels et des discours qui ont façonné la manière dont les bâtiments sont perçus, produits, compris et utilisés » (Hultzsch 2022). La France occupe néanmoins une position marginale parmi les terrains d’étude de la cinquantaine de chercheurs et chercheuses impliqués dans ce programme.
Notre ambition est donc de cartographier les recherches en cours sur les discours féminins et féministes sur l’environnement construit et paysager dans les presses généraliste, féminine et féministe et l’édition en France, dans le long XIXe siècle (1789-1914). Les contributions pourront attacher une attention particulière aux formes, supports, thématiques et dimension intertextuelle des discours ; aux trajectoires, stratégies auctoriales et réseaux des autrices ; à la réception de leurs discours, tout en replaçant la France dans un cadre de réflexion transnational.
Mots clés
femmes ; féminisme ; architecture ; urbanisme ; aménagement ; paysage ; presse ; édition ; discours ; réseaux ; auctorialité ; France ; XIXe siècle
Modalités de contribution
La participation prendra la forme d’une communication de 20 min pour les chercheur.se.s et les doctorant.e.s et une session sera dédiée aux étudiant.e.s de master sous un format Pecha Kucha (20 diapositives toutes les 20 secondes pour une présentation totale de 6 min 40).
Les propositions (titre + résumé de 300 mots maximum) sont à envoyer jusqu’au 5 janvier 2026 au plus tard à julien.bastoen@paris-belleville.archi.fr et juliettejonville@gmail.com.
Calendrier
Lancement appel à communication : mi-novembre 2025
Date butoir pour l’envoi des propositions : 5 janvier 2026
Réponse aux intervenant·e·s retenu·e·s : fin janvier 2026
Journée d’étude : jeudi 12 mars 2026
Comité d’organisation
Julien Bastoen, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville, chercheur IPRAUS
Juliette Jonville, doctorante en architecture, Université Gustave Eiffel, IPRAUS
Comité scientifique
- Lucie Barette, autrice, chercheuse en langue et littérature françaises, Laslar UR4256/Normandie Université
- Julien Bastoen, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville, chercheur IPRAUS
- Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Malaquais, chercheuse ACS
- Hélène Jannière, professeure HDR en histoire de l’architecture contemporaine, université Rennes 2, directrice de l'unité de recherche Histoire et critique des arts
- Juliette Jonville, doctorante en architecture, université Gustave Eiffel, IPRAUS
- Laetitia Overney, professeure HDR en sociologie, université Le Havre-Normandie, chercheuse Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des Sociétés (UMR CNRS 6266)
- Estelle Thibault, professeure HDR en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville, chercheuse IPRAUS
Références
BARETTE Lucie, Corset de papier. Une histoire de la presse féminine, Quimperlé, Divergences, 2022.
BASTOEN Julien, « Sabine Méa : femme-artiste, critique polygraphe et féministe », dans Julie Anselmini et Lucie Barette (coord.), Critiquer au féminin au XIXe siècle [actes en ligne], Fabula.org, coll. « Colloques Fabula », février 2024, https://www.fabula.org/colloques/document11438.php.
BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Féminisation » dans Anne-Marie Châtelet, Amandine Diener, Marie-Jeanne Dumont et Daniel Le Couédic (dir.), L’architecture en ses écoles, une encyclopédie de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle, Châteaulin, Locus Solus, 2022, p. 358‑360.
BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, Les pionnières : architectes en France au XXe siècle. Les femmes, élèves du troisième atelier d'Auguste Perret à l'Ecole des beaux-arts (1942-1954), thèse de doctorat en histoire, sous la direction d’Anne-Marie Châtelet, Université de Strasbourg, 2023a.
BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, Dadour Stéphanie, Grudet Isabelle, Labroille Anne et Macaire Elise (dir.), Dynamiques de genre. La place des femmes en architecture, Marseille, Parenthèses, 2023b.
CHADOIN Olivier, « Féminisation : la fin d’un modèle ? », Urbanisme, « Dossier : féminin », n°302, septembre-octobre 1998.
CHADOIN Olivier, « La féminisation de la profession d’architecte : entre dépréciation statutaire et reconfiguration identitaire », Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme, 29 juillet 2002.
CHÂTELET Anne-Marie, JANNIÈRE Hélène et SCRIVANO Paolo (coord.), journée d’étude « Femmes de presse, critiques d’urbanisme et d’architecture », journée d’étude, ENSA Strasbourg, 17 mai 2023.
CIGLIANO HARTMAN Jan (dir.), The Women Who Changed Architecture, Princeton, Princeton Architectural Press, 2022.
DADOUR Stéphanie (dir.), Des voix s’élèvent. Féminismes et architecture, Paris, Éditions de La Villette (Théorie critique), 2022.
DENÈFLE Sylvette (dir.), Utopies féministes et expérimentations urbaines, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
DIENER Amandine, « Les pionnières, élèves dans l’entre-deux-guerres », dans Châtelet Anne-Marie et Storne Franck (dir.), Des Beaux-Arts à l’Université. Enseigner l’architecture à Strasbourg, Strasbourg, ENSA Strasbourg/Recherches, vol. 1, 2013, p. 106-113
ELEB Monique et DEBARRE Anne, Architectures de la vie privée XVIIe-XIXe siècles, Paris, Fernand Hazan, 1999.
FAYOLLE Caroline, « Libérer le temps des femmes. Division sexuelle du travail et agir féministe en 1848 », Participations, vol. 31, no3, 2021, p. 53‑57.
FRIEDMAN Alice, Women and the Making of the Modern House: A Social and Architectural History, New Haven, Yale University Press, 2006.
GIAQUINTO Violette, Présence des femmes dans la section architecture de l’École des beaux-arts (1898-1968), mémoire de master en histoire de l’architecture, sous la direction d’Eléonore Marantz, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2016.
GIRARD Laura, RINGON Constance, « Des femmes à la conquête d’une formation. L’enseignement de l’architecture à Toulouse (1794-1968) », Politiques de la culture, 4 novembre 2019, https://chmcc.hypotheses.org/9510.
HAYDEN Dolores, The Grand Domestic Revolution. A History of Feminist Designs For American Homes, Neighborhoods, and Cities, Boston, MIT Press, 1981 (1ère édition). Traduction française : La grande révolution domestique : une histoire de l’architecture féministe, Paris, B42, 2023.
HAYDEN Dolores, « What would a non-sexist city be like ? Speculations on housing, urban design, and human work », Signs, vol. 5, n°3, 1980, p. 170-187.
HEYNEN Hilde et BAYDAR Gülsüm, Negotiating domesticity, spatial productions of gender in modern architecture, Londres, Routledge, 2005.
HULTSZCH Anne, « Other Practices: Gendering Histories of Architecture / Otras Prácticas: Historias de la arquitectura con perspectiva de género », ZARCH, n°18, juin 2022, p. 30-41, https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.2022186968.
JONVILLE Juliette, La matérialisation des revendications du mouvement des femmes dans l'architecture : les utopies féministes en France de 1830 à 1914, thèse de doctorat en cours sous la direction d’Estelle Thibault, université Gustave Eiffel.
KNOCKAERT Manon, Les rôles des femmes dans la critique d'architecture des années 1930 aux années 1990 en France, thèse de doctorat en cours sous la direction d’Hélène Jannière, université de Rennes 2.
KOERING Elise, Eileen Gray et Charlotte Perriand dans les années 1920 et la question de l’intérieur corbuséen. Essai d’analyse et de mise en perspective, thèse de doctorat en histoire de l’architecture, sous la direction de François Loyer, université de Versailles-Saint-Quentin, 2010.
KOERING Elise, « Architecte ménagère : une nouvelle experte de l’habitat des années 1920 », Source(s) – Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, n°8-9, 2016, p. 103-117.
KOERING Elise, « Décoratrice-ensemblière : une étape vers la profession d’architecte dans les années 20 ? », Livraisons d’Histoire de l’Architecture, 2018, n°35, p. 111-123.
KOERING Elise, « Pour une historiographie des femmes architectes en France : entre silence et reconnaissance », dans Gauthier Bolle, Amandine Diener, Shahram Abadie (dir.), Pour une histoire culturelle de l'architecture. Essais offerts à Anne-Marie Châtelet, Genève, MétisPresses, p. 149-156, 2023.
LAPEYRE Nathalie, La féminisation des professions libérales : analyse sociologique d’un processus. Le cas des femmes médecins, avocates et architectes, thèse de doctorat de sociologie, université de Toulouse-Le Mirail, décembre 2003.
MARTIN Brenda, SPARKE Penny (dir.), Women’s places: Architecture and Design 1860-1960, Londres/New York, Routledge, 2003.
MITTMANN Elke (coord.), « Les femmes architectes, l'impact sur les débuts du modernisme. Autour du “Monde Nouveau de Charlotte Perriand (1903-1999)” », exposition à la Galerie Chabrier, Saint-Pierre-des-Corps, 19 janvier-8 mars 2023a.
MITTMANN Elke (coord.), « Les femmes architectes, l'impact sur les débuts du modernisme et au-delà, en France et en Europe », journée d’étude, Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire, 8 mars 2023b.
NOVAS FERRADAS María, « The VAC Rotterdam’s Work on Model Home Exhibitions (1951-1956): Women’s Voices in Housing Must be Heard », Architectural Histories, vol. 12, n°1, 2024.
NOVAS FERRADAS María, « A flat of one’s own: the Elisabeth Brugsmaflat in The Hague (1945–1958) », The Journal of Architecture, vol. 28, n°3, 2023, p. 402‑433.
PLANTÉ Christine, THÉRENTY Marie-Ève et MATAMOROS Isabelle (dir.), Féminin/Masculin dans la presse du XIXe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Des deux sexes et autres », 2022.
SCOTT Joan, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, vol. 37, n°1, 1988, p. 125‑153.
SZACKA Léa-Catherine (coord.), « Histoires croisées. Gae Aulenti, Ada Louise Huxtable, Phyllis Lambert, sur l’architecture et la ville », exposition au Centre culturel canadien, Paris, 2025.
TERLINDEN Ulla, VON OERTZEN Susanna, Die Wohnungsfrage ist Frauensache ! : Frauenbewegung und Wohnreform 1870 bis 1933, Berlin, Reimer, Dietrich, 2006.
THĖBAUD Françoise, Écrire l’histoire des femmes, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions, 1998.
THĖRENTY Marie-Ève, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Paris, CNRS Editions, 2023.
THIBAULT Estelle, « Du compte rendu de Paestum au béton armé : l’école rationaliste vue par Laure Labrouste », dans Michèle Lambert-Bresson, Annie Térade (dir.), Architectures urbaines, formes et temps. Mélanges en l’honneur de Pierre Pinon, Paris, Picard, 2014, p. 180-185.
TORRE Susanna (dir.), Women in American Architecture: a Historic and Contemporary Perspective, New York, Architectural League of New York, 1977.
UHLIG Günther, Kollektivmodell „Einküchenhaus“. Wohnreform und Architekturdebatte zwischen Frauenbewegung und Funktionalismus 1900-1933, Gießen, Anabas Verlag, 1981.
VESTBRO Dick Urban, HORELLIi Liisa, « Design for Gender Equality: The History of Co-Housing Ideas and Realities », Built Environment, vol. 38, n°3, 2012, p. 315‑335.
VRANKEN Apolline, Des béguinages à l'architecture féministe : Comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l'habitat ?, Bruxelles, Université des Femmes, 2018.
WILLIS Julie, « Invisible Contributions: The Problem of History and Women Architects », Architectural Theory Review, vol. 3, nº2, novembre 1998, p. 57-68, https://doi.org/10.1080/13264829809478345.