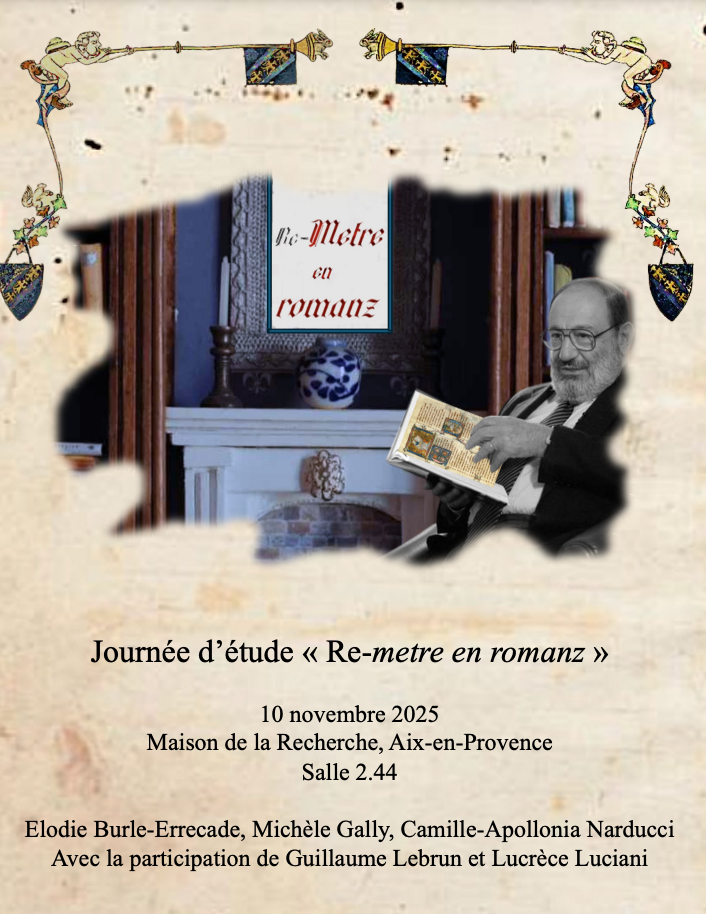
Journée d’étude « Re-metre en romanz »
10 novembre 2025
Maison de la Recherche, Aix-en-Provence, salle 2.44
Elodie Burle-Errecade, Michèle Gally, Camille-Apollonia Narducci
Avec la participation de Guillaume Lebrun et Lucrèce Luciani
Tous les médiévistes connaissent cette expression : « metre en romanz ». Il s’agissait pour les auteurs médiévaux de traduire vers la langue vernaculaire les textes fondateurs hérités de l’Antiquité. Portés par les noms des Anciens, les thèmes et les traducteurs acquéraient une légitimité en passant par la traductio et l’imitatio. On pense à Marie de France hésitant sur la matière de ses lais : « Pur ceo començai a penser / d’alkune bone estoire faire / e de Latin en Romanz traire ».
Ce processus de légitimation de son œuvre – et de soi-même en tant que démiurge – par l’éloge de celle d’autrui est une clef du processus créatif médiéval et il peut sembler curieux pour notre époque, dans laquelle le droit d’auteur est codifié, d’observer une telle posture, généralement dans l’incipit d’une œuvre, alors même que le processus d’édition actuel incite à canaliser toute l’originalité d’un texte dans ses premières lignes.
Le médiévalisme, qui se rêve reproduction du médiéval, a-t-il conservé ce motif-clef ? Dans le passage du roman (au sens de langue poétique et vernaculaire) au roman (au sens de genre littéraire) a-t-on abandonné ce processus de mise en abyme si particulier ?
Le médiévalisme réside dans la « trace médiévale », « une dialectique de la présence et de l’absence à laquelle s’ajoute la notion d’effet à retardement » selon Michèle Gally. Mais qu’en est-il quand cette trace est exhibée et mise en scène ?
Si une œuvre médiévaliste convoque des extraits médiévistes, comme Les Hussites de Andrezj Sapkowski, citant Dante et ses hendécasyllabes ou encore des octosyllabes de Chrétien de Troyes, est-ce pour stigmatiser le contexte historique de l’histoire ?
La citation médiéviste dans une œuvre médiévaliste est-elle d’ailleurs toujours fiable ? Comment ne pas en douter quand Giono, dans son Bestiaire, recrée le concept des marginalia en donnant à lire une supposée citation de La Queste du Graal : « Il rencontra un paysan qui radoubait son fond de culotte avec du fil écru ». Un tel marginalium semble jeter le doute dans l’esprit d’un lecteur sur ses propres souvenirs médiévistes et littéraires, sur la valeur de l’œuvre présentée comme source d’une telle référence. Le pacte de lecture d’une œuvre médiévaliste exhibant ponctuellement des « traces » médiévistes est nécessairement double et ludique : l’histoire des personnages s’efface au profit de l’enquête du lecteur cherchant à repérer les citations qu’il identifie, guettant celles qu’il ne connaît pas et identifiant parfois de fausses citations apocryphes.
L’effeuillage d’une trilogie plus récente, Le Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski, suggère que celle-ci est un texte double : un roman médiévaliste tissé en contre-point avec un pseudo-poème médiéval en octosyllabes, « le roman du Bel Églantier ». La disposition des vers, ou encore les lettrines, imitent le texte médiéval et le pseudo-médiévisme se veut le signifié là où le texte-roman se veut le signifiant. Cette poétique à deux voix / voies du médiéval semble une coquetterie, mais ce jeu littéraire permet de donner ses lettres de noblesse à un genre en plein essor, reliant des genres de l’imaginaire comme celui de la fantasy à la « littérature blanche » dont s’est nourri l’auteur.
Les stratégies auctoriales et éditoriales, pour mettre en place ce pseudo-médiévisme, jouent tout autant avec les codes graphiques que génériques. Ainsi, les « Archives monastiques d’Hibernia » ou encore « la Chronique de Skelig » dans Monastère de Serge Filippini intègrent et amplifient la matière des annales irlandaises médiévales en se distinguant par une police de caractère différente de celle du texte-cadre.
Plus que la mise en abyme du médiévisme dans le médiévalisme, de l’Ancien chez le moderne, l’apparition d’une poïèsis pseudo-médiévale dans un texte médiévaliste permettrait-elle de faire des personnages des hypostases des lecteurs de médiévisme ? Les Hobbits de Tolkien, en entendant Aragorn déclamer les vers du conte de Beren et Lúthien, savourent une poésie « composée dans le mode qu’on nomme ann-thennath », qui rappelle les codes de la poésie iambique anglaise. Et parce que les vers sur Beren et Lúthien sont illustrés tout autant qu’ils illustrent l’histoire d’amour entre Aragorn et Arwen, on peut se demander si la mise en abyme du médiévaliste intégrant ses lettres médiévistes dans son œuvre permet seulement une autre version / versification de son histoire ou s’il s’agit du point de départ d’une histoire autre, pleinement autonome de son récit-cadre, bâtie supposément ex nihilo comme un nouveau to biblion.
Accueil : 9h
9h30-10h30 : « Le médiévalisme : ça a débuté comme ça ? », présidé par Nina Sophia Assas
9h30 - 10h : Michèle Gally « Résurgences. Ecrire dans les pas des Médiévaux (Pierre Michon, Álvaro Pombo, Lorette Nobécourt) »
10h - 10h30 : Adeline Richard-Duperray « [Se] rétablir en poésie avec le roi Krogold et le roi René »
10h45-12h15 : « Le Moyen Âge : un motif dans le tapis ? », présidé par Théo Blauwart
10h45 - 11h15 : Sandra Gorgievski « Les récits enchâssés de Myrddhin dans la bande dessinée Arthur, une épopée celtique de Chauvel et Lereculey »
11h15 - 11h45 : Élodie Burle-Errecade « Citer le Moyen Âge par le mot et l’image dans le jeu contemporain »
14h-15h : « La citation médiévale : lector in lingua ? », présidé par Lu Pan
14h - 14h30 : Diogo Costa Moreira Maia « Le Gué-savoir, un continuum de poésie en langues romanes »
14h30 - 15h : Francesca Manzari « Médiévalisme et poésie romantique anglaise »
Table-ronde 16h-16h45 : « Composer le Moyen Âge en bonne et due forme ! »
Guillaume Lebrun (Fantaisies guérillères)
Lucrèce Luciani (La Femme changée en Bibliothèque)
Animée par Camille-Apollonia Narducci