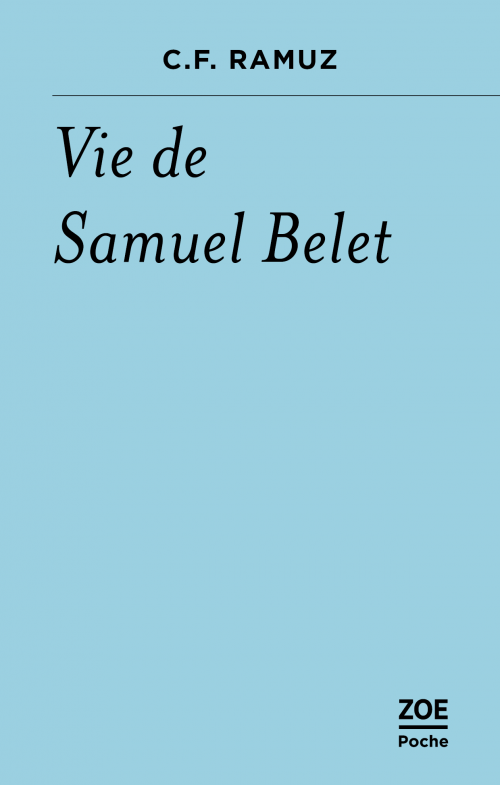
Vie de Samuel Belet s’inscrit dans la pure tradition des romans d’apprentissage. Un paysan cherche les mots pour restituer son existence: la mort de sa mère, son premier chagrin d’amour, le départ pour Paris, l’effervescence des luttes ouvrières, le retour au pays natal, la perte de ses proches.
Déployée dans la langue de Ramuz, l’expérience singulière d’un individu devient un miroir qui nous invite à mieux voir, mieux sentir, mieux accepter.
—
Extrait :
Je m’appelle Jean-Louis-Samuel Belet, né à Praz-Dessus, le 24 juillet 1840, d’Urbain Belet, agriculteur, et de Jenny Gottret, sa femme, comme on peut voir sur mes papiers.
Je n’avais que dix ans quand mon père mourut. Cinq ans après ce fut ma mère.
J’allais entrer dans ma quinzième année. Un matin que j’étais à l’école, on heurte. Le régent va ouvrir; il me dit:
– Samuel, il te faut rentrer chez toi.
Il avait un air tout drôle. Je lui dis:
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Je ne sais pas. C’est Mme Blanc qui vient te chercher.
Mme Blanc était une de nos voisines. Elle m’attendait dans le corridor. Et, elle aussi, je la regarde, et à elle aussi je lui trouve un air tout drôle ; je me mets à avoir peur ; je demande de nouveau :
– Madame Blanc, qu’est-ce qu’il y a ?
Mais elle avait déjà pris les devants, et marchait à grands pas sans se retourner. N’est-ce pas? je n’étais déjà plus un tout petit garçon, et puis la peine que nous avions à vivre, ma mère et moi, m’avait rendu raisonnable avant l’âge: je me mets à courir, je la rattrape, je lui dis: «Je suis sûr que c’est un malheur.» Et comme elle continuait à ne pas répondre, tout à coup je comprends, je pense: «C’est maman!» Et sans plus m’inquiéter d’elle, je prends mes jambes à mon cou.
Notre maison était à l’autre bout du village. La première chose que je vois devant la maison, c’est la voiture du médecin. Une petite voiture à deux roues, peinte en jaune; et le maréchal, avec son tablier de cuir et ses manches de chemise retroussées jusqu’à l’épaule, tenait le cheval par la bride, parce que le cheval était un peu nerveux. En m’apercevant il baissa la tête; il y avait bien là cinq ou six personnes, outre lui: tout le monde se tait brusquement. Et ceux qui se tenaient devant la porte s’écartent. Moi, je courais toujours. Personne n’a l’idée de m’arrêter au passage. J’entre comme un fou: je trouve maman couchée sur son lit.
Elle n’était pas déshabillée: mais son corsage était tout dégrafé. À côté d’elle se tenaient le médecin et deux femmes qui, tous trois, se penchaient sur elle, et le médecin avait à la main une serviette mouillée avec laquelle il lui frottait les tempes, puis il se mit à lui frapper la figure avec le coin de la serviette: maman alors ouvrit les yeux et poussa un grand soupir, sur quoi de nouveau elle se raidit. Elle avait le bout du nez tout blanc et les lèvres bleues; je me souviens aussi de ses cheveux, parce qu’ils étaient bien lissés d’ordinaire, et à présent ils traînaient en désordre sur le traversin. Elle avait donc ouvert les yeux, mais déjà elle les avait refermés; elle n’avait pas même eu l’air de me reconnaître; et moi je restais là, debout au pied du lit.
Et moi non plus je n’avais rien dit; il m’avait fallu un moment pour mettre en ordre mes idées. Mais voilà tout à coup que maman se renverse en arrière, saisit des deux mains le coin du coussin, s’y cramponne; en même temps son corps se soulève sous le drap; en même temps il se fait un bruit dans sa gorge comme quand un bassin de fontaine se vide, alors je me mets à pleurer.
Le médecin se retourne et dit: «Qu’est-ce qu’il fait là, ce gamin?» Il m’empoigne par un bras, une des femmes par l’autre; ils m’ont fait sortir, je n’ai plus rien su.
Sauf que dans l’après-midi maman était morte et deux jours après on l’enterrait.