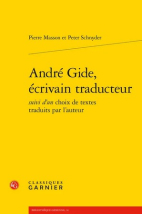
« On ne s’improvise pas traducteur » : Gide et l’art de traduire
1En 1905, Gide note dans son Journal : « Quand je n’écris plus, c’est quand j’aurais le plus à écrire1. » Il s’agit de l’une des nombreuses entrées où l’on le voit jongler entre ses différentes occupations et se plaindre d’un manque de répit qui l’empêche d’écrire. Des épreuves à corriger, des articles critiques à terminer, des lettres qui attendent une réponse le détournent de l’écriture, non seulement de ses œuvres en cours, mais aussi de son Journal lui-même. À cela s’ajoutent les nombreuses visites qu’il reçoit, notamment lorsqu’il est à Paris. « Ce n’est point tant l’exigence des occupations que leur nombre, leur diversité ; j’en ai l’esprit tout disloqué. Le meilleur temps de Paris est celui où l’on est censé ne pas y être2 », se plaint-il.
2Pourtant, son immense activité épistolaire et sa foisonnante production critique ont été déterminantes pour le développement de sa pensée et de son œuvre, comme l’ont montré des publications récentes sur le sujet3. Ressenties par Gide parfois comme un pensum, ces activités façonnent sa figure intellectuelle et sa morale d’artiste. Elles lui permettent également de mettre à l’épreuve son écriture et de se penser en tant qu’écrivain. Tout comme l’écriture diaristique, ces activités journalières font, à part entière, partie de son œuvre. Mais il y a une autre tâche à laquelle Gide s’est consacré dès sa jeunesse et qui est indispensable pour comprendre ce que Klaus Mann a appelé la « prismatique diversité4 » de sa production : la traduction.
3Le volume de Pierre Masson et Peter Schnyder, André Gide, écrivain traducteur, suivi d’un Choix de textes traduits par l’auteur, poursuit ce travail de relecture et de revalorisation d’aspects moins connus ou encore peu étudiés de l’œuvre du prix Nobel de 1947. Bien que des études ponctuelles aient été consacrées à Gide et à ses traductions5, il manquait encore un travail critique et éditorial de cette ampleur, abordant la question de manière systématique et offrant au lecteur une vue d’ensemble de son activité de traducteur. Après un avant-propos (« Un traducteur passionné et patient ») et deux chapitres détaillant son parcours de traducteur et son approche de cette tâche parfois ingrate mais passionnante (« Une vie de traductions » et « Splendeurs et misères de la traduction »), le livre propose un recueil de textes traduits par Gide (p. 107-264), témoignant de l’ampleur, de la diversité et de la qualité de son travail de traducteur.
4Le volume se propose ainsi de reconstruire chronologiquement la place que la traduction, « en tant que pratique et en tant que réflexion », occupe dans son parcours et de faire un « bilan des faits et dits » du traducteur, de ses « choix, mais aussi [d]es contradictions dans lesquelles Gide manœuvre » et donc « [d]es limites que l’écrivain a imposées au traducteur » (p. 12). Oui, car comme l’indique bien le titre du volume, c’est toujours en tant qu’écrivain qu’il traduit et s’intéresse à la traduction. À la différence d’un « pur traducteur », tel que l’appelle Berman, c’est-à-dire de celui qui écrit « à partir d’une œuvre, d’une langue et d’un auteur étrangers6 », Gide fait de la traduction un espace de dialogue entre son écriture et celle de l’auteur traduit, dialogue qui se transforme tantôt en glose, tantôt en discours théorique sur l’art de traduire, mais où, presque systématiquement, « l’écrivain finit par l’emporter sur le traducteur » (p. 13).
5D’ailleurs, comme le suggèrent bien les premières occurrences du verbe « traduire » que l’on rencontre dans son Journal, pour Gide la traduction est avant tout une forme d’expression et de recherche de soi. « Ô lâche ! S’il est vrai que tu penses, s’il est vrai que tu sens, tu dois te traduire7 ! », écrit-il en mai 1888. Et encore, quelques mois plus tard, il note : « Comme j’ai pensé que pour se traduire, il fallait se connaître, je me suis cherché. Je me suis trouvé si pâle et si indécis que j’ai voulu accentuer les contours de ma personnalité que je soigne8. » Et, comme le montre bien le volume de Masson et Schnyder, dans ce parcours de définition de soi, la traduction occupe une place centrale.
De l’importance des langues et des littératures étrangères
6Le chemin reconstruit par les deux spécialistes, qui mène Gide vers la traduction, s’ouvre sous l’égide d’une figure tutélaire l’ayant profondément marqué, bien qu’on puisse difficilement mesurer à quel point elle a pu véritablement l’« influencer » (p. 15) : Anna Shackleton. Ancienne gouvernante et amie anglo-écossaise de sa mère, elle dédiait son temps libre à la botanique, à la peinture et à la traduction et il lui arrivait de lire au jeune André des extraits des livres qu’elle traduisait. « Elle écrivait, note-t-il dans ses Mémoires, dans de gros cahiers d’écolier emplis jusqu’à la dernière ligne d’une sage et fine écriture », des cahiers dont il n’arrive pas à se débarrasser, reconnaissant en eux « tant de patience, d’amour et de probité9. »
7Pourtant, ni elle ni ses parents (qui utilisaient l’anglais pour ne pas être compris) ne l’ont véritablement initié aux langues étrangères. Gide apprendra l’allemand à l’École alsacienne, tandis que l’apprentissage de l’anglais se fera plus tard, à partir de 1910. Ainsi, le fait de « n’avoir pu précocement maîtriser aucune langue vivante » devient un « inconscient regret » (p. 16) que, comme le soulignent avec subtilité les deux auteurs du volume, Gide exprime dans ses œuvres, notamment à travers la jeunesse très cultivée des Cahiers d’André Walter et de La Porte étroite. Ce « fantasme » (p. 16) peut aussi expliquer pourquoi, comme le rappelle David Steel dans l’entrée du Dictionnaire Gide consacrée à l’« Angleterre », il prête « à son érudit Michel de L’Immoraliste la connaissance de plusieurs langues, mais pas de l’anglais10 ».
8Si Gide fait des langues une des composantes fondamentales de l’érudition, c’est qu’il voit en leur apprentissage un formidable instrument éducatif. D’une part, parce que les langues ouvrent une voie d’accès privilégiée à un « cosmopolitisme littéraire11 » qu’il cultive lui-même dès son jeune âge et qu’il injectera ensuite dans l’esprit de L’Ermitage, puis de la NRf 12. D’autre part, parce qu’à ses yeux, chaque langue est « un système de pensée qu’il convient de cultiver comme un art » (p. 16) pour les horizons intellectuels qu’elle peut ouvrir, pour les leçons de style qu’elle peut donner et pour les possibilités qu’elle offre de mieux se connaître.
9Un tel intérêt va en effet de pair avec celui que l’écrivain manifeste dès sa jeunesse pour les littératures étrangères. À côté des auteurs grecs et latins, ainsi que de grands classiques de la littérature française, que le jeune Gide cite abondamment, apparaissent très tôt dans son Journal de nombreux auteurs étrangers. C’est ainsi que le 26 juillet 1888, il établit une sorte de calendrier de lectures estivales, dans lequel figurent La Vie intérieure de Sully Prudhomme, les Scènes de la vie bohème et les Poèmes de Henry Murger, Madame Bovary de Flaubert, mais aussi La Fiancée de Messine de Schiller et Crime et châtiment de Dostoïevski13.
10Avant d’être traducteur, Gide est donc un lecteur méthodique et insatiable. C’est ce besoin de se cultiver et de se former qui l’ouvre aux langues et littératures étrangères. En 1889, âgé de dix-neuf ans, il note dans son Journal, avec un enthousiasme qu’il apprendra à tempérer, des principes auxquels il restera toujours fidèle, dans la vie comme dans l’art :
Ce Flaubert est grisant à lire ses lettres, il me prend des rages énormes de voyager, d’éprouver des sensations nouvelles, inconnues, voir du pays et des choses, connaître d’autres langues, et surtout de lire. Je voudrais l’an prochain ne plus me soucier d’autre chose = connaître apprendre le grec, l’allemand, le latin, l’italien, et surtout le français, le travailler de toutes façons, continuellement, en écrivant, en lisant, en observant. Je voudrais connaître Balzac, Dickens, Stendhal et d’autres choses encore que je serais le seul à connaître, comme la façon de parler à ceux qui sont morts et que j’aime14.
11Pour Gide, lire signifie instaurer un dialogue intime avec les auteurs du passé et du présent, ce qui lui permet, au fil des années, de créer son propre panthéon international des classiques de la littérature. Parallèlement, à travers ces lectures, il cherche à « prolonger son univers mental » (p. 18), il tente de mieux se connaître et de mettre à l’épreuve sa pensée. Il explore les affinités entre « sa propre quête intellectuelle et morale » (p. 18) et celles d’autres auteurs qu’il admire et cela se reflète également, par la suite, dans le choix de traduire un autre écrivain. Les auteurs du volume le soulignent bien : pour Gide, « le sentiment de découvrir un artiste novateur est primordial », mais à cela « s’ajoute souvent le fait qu’il pense trouver en lui un allié », comme avec Goethe, Whitman, Keller ou encore Blake (p. 20). Si, comme le rappelle Jean Delisle, « étymologiquement, lire signifie choisir » et que la traduction est elle-même « l’art du choix15 », chez Gide, ce choix est, dans les deux cas, guidé par des exigences à la fois esthétiques et éthiques, par un besoin de se cultiver en tant qu’artiste et en tant qu’individu, ainsi que par la nécessité de trouver « des alliés et des éclaireurs », voire des « anticipateurs » légitimant sa pensée et ses revendications intellectuelles (p. 21).
La vie de Gide traducteur. Un remarquable réseau de collaborations
12C’est ainsi que naît chez Gide un intérêt pour la traduction qui, au fil des années, nourrit considérablement ce « composé de vie et de papier16 » qu’est son œuvre, penchant qui émerge avec celui pour l’écriture et, au début, paraît l’occuper même plus, au point qu’« on dirait que [Gide] a décidé d’être avant tout traducteur, hésitant seulement sur le bon texte à traduire » (p. 20). Grâce à son Journal, l’on sait que dès 1893 il songe à traduire Novalis (Heinrich von Ofterdingen), Adelbert von Chamisso (Peter Schlemihls wundersame Geschichte) et Friedrich de La Motte-Fouqué (Undine), mais aussi Dante (La vita nuova), Pétrarque (Il trionfo dell’amore) et Pedro Calderón de la Barca17. Il tente finalement de traduire Novalis, mais il se retrouve en concurrence avec Maurice Maeterlinck (p. 20). À cela s’ajoutent des événements personnels, dont la mort de sa mère et son mariage, qui finissent par le détourner de l’entreprise.
Du persan à l’allemand. Les débuts à quatre mains
13En cohérence avec la connaissance qu’il a des langues, encore en progression, et son besoin d’échange intellectuel, la véritable activité de Gide, en tant que traducteur, commence en 1897, lorsqu’il accepte d’accompagner Fédor Rosenberg dans la traduction d’un fragment de l’Avesta à partir du persan et, l’année suivante, dans celle de plusieurs textes courts de Dostoïevski. Du travail de reconstruction fait par Masson et Schnyder, il émerge ainsi clairement qu’avant de traduire seul, Gide commence s’initie dans ce domaine avec ce que Jean-René Ladmiral appelle la « traduction en tandem », une forme de traduction qui prévoit la collaboration de deux traducteurs, dont l’un natif de la langue cible et l’autre natif ou spécialisé dans la langue source (généralement une langue rare)18. Et bien que Gide soit appelé à occuper une place de réviseur, et donc à « traduire en second » (p. 21) dans ce projet, il finira, à juste titre, par se considérer rapidement comme un « traducteur à part entière », voire comme cotraducteur, statut tout à fait légitime dans ce type de traduction à quatre mains. « Ah ! », écrit-il dans une lettre à Marcel Drouin, « pour de bons traducteurs, nous avons été de bons traducteurs19 ».
14Tout en ayant envisagé en 1910 de traduire en solitaire des pages de Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke pour la NRf, c’est encore selon un mode collaboratif que se fera cette traduction. Mais cette fois Gide, qui est désormais un écrivain confirmé et, à ce stade, maîtrise l’allemand suffisamment bien, tient « le rôle principal » (p. 30). L’autre traductrice est Aline Mayrisch, amie de Marie Van Rysselberghe et grande admiratrice de son œuvre, qu’il rencontre en 1903 à Weimar (où il avait été invité par le comte Kessler) et qui lui enverra un premier canevas à corriger (p. 30). Lorsque les deux fragments paraissent sur la NRf, Rilke écrit à Gide pour lui exprimer son enthousiasme pour cette « transposition inspirée20 » des deux fragments de son Malte Laurids Brigge. C’est dans ce contexte, lorsqu’il vit un moment de panne d’inspiration pour l’écriture, que Gide amorce également un projet de traduction de la correspondance de Friedrich Hebbel, comme conseillé quelques années auparavant par le comte Kessler, mais de ce travail ne subsiste que le manuscrit d’une lettre repris dans le Choix de textes traduit par André Gide (p. 109-120).
15L’un des nombreux intérêts de l’ouvrage de Masson et Schnyder est ainsi de montrer que si pour Gide la traduction a d’abord une forte dimension collaborative, elle devient progressivement aussi une pratique solitaire.
Le domaine anglophone. Traductions en solo, en groupe et en équipe
16Ce tournant s’accomplit en 1911 en concomitance avec l’émergence chez lui d’une « attitude anglophile » (p. 33), tendance cohérente avec l’intérêt accru de la NRf pour l’anglais qui, comme suggèrent les auteurs du volume, n’est pas sans lien avec le changement du panorama politique international (p. 33). Gide commence à étudier l’anglais et à lire systématiquement des auteurs anglophones. Il séjourne à Londres, où il connaît Edmund Gosse et Joseph Conrad, et, sous l’impulsion de Saint-John Perse, lit Rabindranath Tagore, et notamment son auto-traduction en anglais de Gitanjali. Naissent ainsi des projets de traduction différents, dont deux le mettent en compétition plus ou moins (in)volontaire avec Henri Davray, directeur de la collection d’auteurs étrangers des Éditions du Mercure de France.
17Le premier de ces projets, personnel, est celui de traduire « par relais21 », c’est-à-dire à partir de sa version anglaise (dans ce cas par l’auteur lui-même), le recueil de Tagore, entreprise qu’il entame sans faire recours « à aucune aide » (p. 35) et sans savoir que Davray fait de même, ce qu’il découvre lorsque ce dernier publie une partie de sa traduction dans le Mercure de France. Ce « croc-en-jambe » le bouscule mais ne le fait pas tomber : « peu après », écrit-il à François-Paul Alibert avec l’assurance d’un traducteur qui commence à bien maîtriser la tâche, « je me suis remis en route, après m’être bien rendu compte que ma traduction faisait honte à la sienne22 ». Profitant de l’attribution du Prix Nobel à Tagore en 1913, sa traduction paraîtra la aux Éditions de la NRF et Gide, peu après, se met à œuvrer auprès de l’éditeur Macmillan pour traduire d’autres œuvres de son confrère, dont Post-Office qu’il terminera en 1916, mais seulement après avoir traduit trente-cinq poèmes de Kabîr, en s’appuyant sur la version anglaise de Tagore parue à Londres et pris par une sorte de « frénésie traductrice » (p. 40).
18Ses deux projets suivants sont encore une fois de nature collaborative. L’un est celui qu’il mène avec Jean Schlumberger, Valery Larbaud, Francis Vielé-Griffin, Jules Laforgue et Louis Fabulet, à savoir la traduction de textes de Walt Whitman, qui sortira en 1918 chez les Éditions de la NRF, avec une préface de Larbaud, sous le titre Œuvres choisies. L’autre initiative est celle d’acquérir les droits de traduction de Conrad, possédés par Davray, qui avait déjà entamé le travail, et de lancer un nouveau chantier de traduction de son œuvre (toujours pour les Éditions de la NRF). L’accord est trouvé en 1915 et rapidement Gide prend un nouveau rôle dans ce contexte (celui de « chef de projet », comme on le dirait aujourd’hui), faisant de lui l’un de plus grands passeurs de l’œuvre de Conrad en France et en Europe23.
19Ainsi, en janvier 1916, « il constitue l’équipe de traducteurs, sollicitant les anglicistes de son entourage » (p. 40), notamment plusieurs femmes : Élisabeth Van Rysselberghe (Lord Jim), Marie-Thérèse Muller (Typhoon) et Isabelle Rivière (Victory). Quant à lui, Gide prévoit initialement de traduire Youth et Heart of Darkness, mais son travail de réviseur des traductions l’engage bien plus que ce qu’il ne l’avait imaginé. Il se plaint ainsi, à plusieurs reprises, de l’énormité du travail qu’exige la révision de la traduction d’Isabelle Rivière mais il veille aussi, avec tout le charme dont il est capable, à ne pas trop inquiéter Conrad : « Rassurez-vous », lui écrit-il, « si parfois elle me résiste un peu c’est 1° qu’elle a beaucoup plus d’admiration pour vous que pour moi, ce en quoi je l’approuve ; 2° qu’elle est consciente de sa propre valeur24. »
20Tandis que pour ce qui concerne la traduction de Typhoon, ne se sentant « tenu à aucun égard vis-à-vis de la traductrice », il finit par la réécrire « presque complètement25 ». L’histoire travaillée de cette (re)traduction, qui provoquera l’indignation d’André Ruyters26 (aux prises de son côté avec celle de Heart of Darkness) et qui est parue pour la première fois en 1918 dans la Revue de Paris, en fait un « phénomène fascinant dans l’histoire de la littérature française du xxe siècle, comme dans celle de la traduction littéraire en général27 », selon les mots de Sylvère Monod. Ce dernier la consacre d’ailleurs définitivement en la reprenant dans le volume de la Bibliothèque de la Pléiade de Conrad (1985) et sans y apporter aucune révision majeure28. Déjà largement étudiée29, cette histoire fait dans l’essai de Masson et Schnyder l’objet d’une synthèse la recontextualisant pour la première fois au sein du parcours de traducteur et permettant en même temps de comprendre comment Gide a réussi, « n’en déplaise à Ruyters », à être « reconnu par son entourage comme traducteur de l’anglais » (p. 46).
Shakespeare et d’autres tentations. Traduire et retraduire
21Parallèlement au projet de Conrad s’ouvre le volet shakespearien de sa vie de traducteur, également objet de plusieurs études ponctuelles30 et qui vaut à Gide d’être intégré (pour la première fois), en 1938, à la Bibliothèque de la Pléiade en tant que traducteur31. Sollicité par la danseuse et comédienne Ida Rubinstein, Gide entreprend en 1917 la traduction d’Anthony and Cleopatra, qu’il termine assez rapidement, sentant désormais qu’il sait « de plus en plus ou de mieux en mieux, ce que doit être une traduction32 ». Après un détour par William Blake, dont il traduit en 1922 The Marriage of Heaven and Hell, il se met ensuite à traduire Hamlet, cette fois sous demande de Sacha Pitoëff. Mais le premier acte de la pièce lui fait « pest[er] tout le long du jour contre ce terrible job qu[’il s’est] mis sur les bras33 ». Il décide ainsi de renoncer et l’annonce d’abord à sa traductrice, Dorothy Bussy, ensuite à Pitoëff, qui s’en désole. Le projet devra attendre des années, mais il ne restera pas inabouti.
22Or, à ce stade Gide a traduit ou co-traduit, depuis l’anglais, l’allemand et le russe, des textes en prose, de la poésie, ainsi que du théâtre. Il est désormais non seulement un écrivain affirmé, mais aussi un traducteur mûr. Entre 1922 et 1938, la traduction devient ainsi pour lui une « tentation » (p. 64) à laquelle il cède volontiers et les projets se multiplient. Avec Schiffrin et Boris de Schloezer, il traduit Pikovaïa dama (La Dame de pique) de Pouchkine, puis il travaille seul à celle du chapitre VIII de Der grüne Heinrich de Gottfried Keller, et revient ensuite, toujours avec Schiffrin, à Pouchkine dont ils traduisent des récits et des nouvelles. Ensuite, avec Élisabeth Van Rysselberghe il révise la traduction par Marcel de Coppet de Old Wives’ Tale d’Arnold Bennet et, au début des années trente, il traduit l’écrivain et réfugié allemand Ludwig Tureck pour Commune, la revue dirigée par Louis Aragon.
23C’est à l’issue de tous ces détours — comme le rappellent les auteurs du volume — qu’en 1938, alors que le Théâtre complet de Shakespeare est en préparation pour la Bibliothèque de la Pléiade, Gide revient sur ses traductions. Il révise d’abord celle d’Antoine et Cléopâtre avec Marcel Drouin, travail grâce auquel il développe des réflexions qui confluent dans son avant-propos au volume. Dans le sillage de cette relecture, il reprend ensuite (après vingt ans) sa traduction de Hamlet, que cette fois il termine, animé par la « conviction d’être le meilleur interprète de la valeur des textes » (p. 79). Cette remarque de Masson et Schnyder met en lumière un autre élément central dans ce contexte, à savoir que Gide est bien conscient de travailler à des « retraductions » et que s’il s’engage dans cette entreprise c’est aussi en raison de l’encouragement qu’il tire de « l’“insatisfaction” herméneutique34 » éprouvée à l’égard des traductions précédentes. Son texte se développe en face de l’original, mais aussi des traductions antérieures qu’il lit et compare, entre elles et à la sienne, pour en tirer sa motivation. « J’avais près de moi », dit-il à propos de son Hamlet, « non tant pour m’aider que pour m’encourager les traductions de F[rançois]-V[ictor] Hugo, de Schwob, de Pourtalès et de Copeau. « Cette dernière seule », ajoute-t-il « me semble marquer quelque souci de la langue française35. »
24Comme on le voit bien en parcourant le choix des textes proposés dans le volume, et notamment ceux reproduisant les biffures du traducteur, Gide applique ce même regard critique à ses propres textes. Dans un processus relevant d’une forme d’autorévision, il continue en effet de les corriger, même après leur publication. C’est le cas d’Antoine et Cléopâtre et de Hamlet (paru en 1944 chez Panthéon Books) qu’il révise au moment où Jean-Louis Barrault décide de les porter sur scène à la Comédie française, collaboration dont naîtront aussi l’adaptation du Procès de Kafka et la traduction de Arden of Faversham, texte qu’il avait commencé à traduire en 1932 à la demande d’Antonin Artaud (mais qui ne paraîtra que très récemment en 2019) et faisant partie de ses traductions sorties à titre posthume, comme son Prométhée de Goethe (achevé d’imprimer en 1951). Sur cet « ultime défi » (p. 83) s’achève ainsi la vie de cet écrivain-traducteur et avec elle, la passionnante reconstruction que Masson et Schnyder offrent dans le premier chapitre du livre. Bien que focalisée sur Gide, cette première partie de l’ouvrage parvient à travers lui à se donner comme une fenêtre ouverte sur toute une époque de l’histoire littéraire et culturelle de la France, voire de l’Europe.
Gide : entre glose, théorie et pratique
25Un autre grand point d’intérêt du volume André Gide, écrivain traducteur est d’offrir un parcours mettant en avant l’importance et l’ampleur du discours théorique sur la traduction élaboré par Gide au fil des années, au sein de son Journal, dans ses correspondances et ses entretiens, ainsi que dans ses textes critiques. Les extraits commentés par Masson et Schnyder au long des deux premiers chapitres du livre, font clairement ressortir la tension qui habite Gide-traducteur entre les approches sourcière et cibliste dans cette tâche complexe. En 1922, en commentant son travail de traduction de Hamlet, il le dit bien : « La difficulté n’est jamais tout à fait vaincue, et, pour écrire du bon français, il faut quitter trop Shakespeare36. »
26 Or, tout comme Hans-Georg Gadamer le dira plus tard37, pour Gide aussi la traduction est tout d’abord une lecture, un acte herméneutique : « toute traduction est une interprétation38 », écrit-il à Valery Larbaud en 1914. On le voit bien dans les pages de Numquid et tu…?, lorsqu’il relit les Évangiles dans la version latine et dans des traductions anglaises et françaises, et que ce travail de relecture et de comparaison l’amène à proposer ses propres retraductions du texte :
La version anglaise m’ouvre brusquement les yeux sur un verset de Matthieu qui (comme il advient alors) prend à mes yeux une importance extrême :
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
Les trois versions françaises que j’ai sous la main traduisent : celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Et pourtant est-ce que c’est bien cela que le Christ veut dire ? N’est-ce plutôt : Celui qui ne prend pas sa croix et qui me suit, – c’est-à-dire, celui qui prétend me suivre sans avoir d’abord pris sa croix ?
— Je recours à la Vulgate. Oui, c’est cela : Et qui non acceipt crucem suam, et sequitor me, non est me dignus 39.
27Dans ce travail qu’on pourrait appeler de « retraduction exégétique », le problème central est pour lui celui de l’interprétation de la parole et des enseignements du Christ. Tandis que dans la traduction des œuvres de ses confrères écrivains (du passé comme du présent), à la question de l’interprétation du texte s’ajoute celle du style — une dimension primordiale chez lui, qui le (pré)occupe tout d’abord en tant qu’écrivain et donc aussi à la fois en tant qu’« écrivain-glossateur » (p. 100) et en tant qu’« écrivain-traducteur ». Le cas de Shakespeare est à cet égard particulièrement révélateur. D’une part, Gide écrit : « De nombreux passages de Shakespeare restent à peu près incompréhensibles ou présentent deux, trois ou quatre possibilités d’interprétation, parfois nettement contradictoires, au sujet desquelles les commentateurs ergotent40 ». De l’autre, en se référant à Hamlet en particulier, il dit :
Il ne faut pas croire que ce soient les meilleurs passages, « purple passages », les plus belles scènes, qui exigent le plus de travail, de réflexion. Ce sont ceux que l’on estime soi-même ratés, ou du moins médiocres. On éprouve une sorte de déception à l’égard de l’auteur qu’on admire ; partant, moins d’ardeur ou de goût à la besogne — de l’ennui, si vous voulez ! Que faire dans ces cas ? Essayer de rendre ces morceaux meilleurs ? Mais ce n’est pas trahir ? — ou, au contraire se montrer d’une fidélité scrupuleuse ; mettre au jour les erreurs, les côtés médiocres, les passages bâclés ? C’est un dilemme presque angoissant. Et je ne dis pas cela pour Hamlet seulement, mais pour toutes les traductions en général ; pour celles de Joseph Conrad aussi, que j’ai faites41.
28De ce passage, on le comprend bien : la traduction est pour lui une occasion de (re)lecture critique du texte, mais aussi source de « dilemmes » desquels découle son discours de traducteur et de « traductologue » (p. 99). Ce qui explique pourquoi il parvient à regretter « de n’avoir pas su donner, en pendant à [s]on Journal des Faux-monnayeurs, un journal de [s]a traduction de Hamlet, dont l’intérêt, d’ordre tout différent, eût été […] bien supérieur42 ».
29Cette pensée sur la traduction s’éparpille ainsi dans plusieurs textes évoqués par Masson et Schnyder dont l’un des plus importants est justement sa fameuse « lettre-manifeste » (p. 61) à André Thérive, publiée en 1928 dans la NRf et intégralement reprise dans le volume, dans laquelle il songe à ce journal de traducteur qu’il aurait pu écrire. Il s’agit d’une lettre, en réponse à un article dans lequel Thérive l’évoque parmi les « bons écrivains » qui ont fait des « traductions admirables43 », et que Gide consacre entièrement à « l’épineuse question des traductions44 », en résumant ainsi son éthos d’écrivain-traducteur. « Hélas ! comme vous le constatez fort justement », écrit Gide, « les traductions restent confiées le plus souvent à des êtres subalternes, dont la bonne volonté ne supplée pas l’insuffisance. » Et puis il ajoute :
Un bon traducteur doit bien savoir la langue de l’auteur qu’il traduit, mais mieux encore la sienne propre, et j’entends par là non seulement être capable d’écrire correctement, mais en connaître les subtilités, les souplesses, les ressources cachées ; ce qui ne peut guère être le fait que d’un écrivain professionnel. On ne s’improvise pas traducteur45.
30Ses considérations, comme on le comprend dès ces quelques phrases, s’enchaînent pour donner forme à une image de soi-même en traducteur, mais aussi, plus généralement, à celle du traducteur, que Gide conçoit comme un véritable « recréateur » (p. 26), ou, pour le dire avec les mots qu’il utilise en commentant la traduction de Mardrus des Mille et Une nuits, comme un grand connaisseur de la langue qui doit « faire œuvre de bon écrivain46 ». C’est pourquoi pour lui, « le traducteur a bien peu fait, qui n’a donné d’un texte que le sens47. »
31La traduction est une tâche longue et difficile, répondant à une « morale de l’effort » (p. 105) typiquement gidienne, et à laquelle il dit avoir « consacré plus de temps qu’il ne [lui aurait] fallu pour écrire un livre, plus de temps sans doute qu’il n’en fallut à l’auteur pour écrire le livre qu[’il a] tradui[t]48 ». Ainsi, sans cesse confronté au « souci de littéralité », qu’il juge « excellent en soi », mais aussi « parfois néfaste », le traducteur doit ne jamais oublier que « ce n’est pas seulement le sens, qu’il s’agit de rendre » et que ce ne sont pas des « mots » qu’il faut traduire, « mais des phrases » et « sans rien perdre, pensée et émotion, comme l’auteur les eût exprimées s’il eût écrit directement en français ». Et cette forme de fidélité au texte ne peut se réaliser, dit-il, que « par une tricherie perpétuelle, par d’incessants détours et souvent en s’éloignant beaucoup de la simple littéralité49 ». C’est la raison pour laquelle pour lui, le traducteur doit être toujours, non seulement un bon lecteur, mais aussi un bon écrivain. Il « connaît admirablement les ressources de sa propre langue » et doit être « capable de pénétrer l’esprit et la sensibilité de l’auteur qu’il entreprend de traduire, jusqu’à s’identifier à lui ». Ce qui signifie non seulement que pour Gide traduire équivaut à écrire, mais aussi qu’il faut pour lui « traduire l’auteur comme il pouvait souhaiter être traduit50 ». Une injonction, cette dernière, qu’il adresse à soi-même et aux autres, mais aussi (et sans doute surtout à ce stade de son parcours d’écrivain) aux traducteurs et aspirants traducteurs de son œuvre à lui.
*
32Comme il arrive souvent lorsqu’il est question de Gide, la découverte d’une nouvelle facette de son parcours conduit finalement à en révéler plusieurs. Gide traducteur, Gide traductologue, Gide glossateur : autant de figures d’une même personnalité intellectuelle que Pierre Masson et Peter Schnyder réunissent dans un portrait renouvelé, qui fournit tous les repères nécessaires à la lecture du Choix de textes traduits proposé à la suite des premiers chapitres du volume.
33Les vingt-deux textes anthologisés, allant chronologiquement de 1899 à 1950 (dont des extraits de traductions publiées et des versions restées manuscrites), offrent un aperçu de la richesse et de la variété de son œuvre et de son travail de traducteur — depuis ses premières traductions par relais et à quatre mains jusqu’à celle de Arden of Faversham — et permettent d’apprécier dans son évolution son art de traduire et, partant, celle d’écrire, mais vue sous un angle inhabituel, celui de la traduction. Ainsi, à la lecture, ces textes résonnent aussi comme une invitation à de nouveaux travaux dans ce vaste chantier que les deux spécialistes ont su remettre en lumière, en en démontrant l’importance non seulement pour les études gidiennes mais aussi, plus largement, pour l’histoire littéraire et celle de la traduction en langue française.
34Méthode d’interprétation, dialogue avec des textes et des auteurs du passé et du présent, exercice spirituel, œuvre d’écrivain : la traduction est d’ailleurs, pour lui, aussi un moyen d’inscrire durablement les œuvres dans l’histoire littéraire et, pour l’écrivain-traducteur, de s’y inscrire avec elles : « Je serai Napoléon », écrit-il dans sa lettre à Thérive avec une touche d’(auto)ironie très révélatrice, « j’instituerais une manière de prestation pour littérateurs ; chacun d’eux, je parle du moins de ceux qui mériteraient cet honneur, se verrait imposer cette tâche d’enrichir la littérature française du reflet de quelque œuvre avec laquelle son talent ou son génie présenteraient quelque affinité51. » Une tâche, celle-ci, à laquelle Gide s’est consacré avec art et constance tout au long de sa vie d’écrivain traducteur et qui méritait de faire l’objet d’une reconstruction aussi riche que celle proposée dans ce livre.

