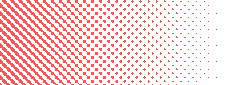« La Fille qu’on appelle » de Tanguy Viel : « zones grises » et pragmatique de l’emprise
Cet article a fait l’objet d’une communication le vendredi 25 février 2022 dans le cadre du programme Lectures sur le fil, proposé par Cécile Narjoux (UFR de langue française de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université. Saison 2, épisode 7). En ligne : https://youtu.be/25CFa6oUF4g
La fille qu’on appelle : une réception critique plutôt très élogieuse
1Ceux qui ont suivi l’actualité des prix littéraires de l’automne 2021 ne sont pas sans savoir que le dernier roman de Tanguy Viel, paru la même année au mois de mai aux Éditions de Minuit, a été sélectionné pour les prix Goncourt, Décembre et Interallié. S’il n’a remporté aucun de ces prix, La Fille qu’on appelle1 a reçu, à quelques exceptions près, un excellent accueil de la part des critiques littéraires, qui l’ont abondamment commenté pour saluer le « grand art » de ce « véritable joyau littéraire2 », ou encore son exceptionnelle intelligence (« un livre exceptionnel d’intelligence3 », selon Olivia de Lamberterie).
2« On n’épuise pas la richesse d’un tel roman, à la construction subtile et savante4 », écrit quant à lui Norbert Czarny, avant de poursuivre : « La façon dont les personnages se croisent, se lient, se lâchent, provoque des rebondissements, donne à cette tragédie sociale les contours du roman noir, de ces romans qui fascinent longtemps ».
3« Noir », « social », « psychologique », « tragique » sont ainsi des étiquettes qui reviennent fréquemment sous la plume des commentateurs pour qualifier le genre du huitième roman de Tanguy Viel, dont certains, à l’instar de Jordi Brahamcha‑Marin dans la revue Le Grand Continent, ne manquent pas de souligner, dans le même temps, que l’auteur « ne publie pas chez Minuit pour rien5 » et que « l’héritage “Nouveau Roman” est sensible6 » dans son écriture : « Quelques gestes anodins peuvent durer deux pages éblouissantes, le temps de décrire tous les mouvements d’âme, les hésitations, les désirs, les peurs, les réticences qui l’habitent et le traversent7 ».
4Tout est dans le style ou presque, pourrait-on dire. Citons à cet égard Mohammed Aïssaoui qui écrit dans Le Figaro du 23 septembre 2021 : « Ce n’est pas simple de louer un roman dont la force principale est le style8 ». Et si, à ce titre, Arnaud Viviant pointe, dans l’émission Le Masque et la plume le 12.09.2021, que le « petit polar chabrolien » est « totalement surécrit » et même « mal écrit » (il lui reproche ses trop nombreuses répétitions), nombreux sont les lecteurs à trouver au contraire que l’écriture est délectable et qu’elle « ne tourne jamais à l’exercice de style gratuit9 », sensibles, comme l’est Nathalie Crom dans Télérama au rythme des phrases « longues et sinueuses10 » (où l’on sent l’influence rémanente de Proust, demeuré une référence séminale pour l’auteur), aux « métaphores délicates ou spectaculaires11 », ou bien attentifs à l’usage intensif du participe présent12 ou à l’emploi du « passé composé comme temps principal de la narration, avec une valeur d’accompli du présent toujours activée13 ».
5Le style est donc bien mis au service de l’intrigue. Une intrigue qui, il faut en convenir, « ne paie pas de mine14 » dans ce roman de 174 pages (166 pages, si on ne compte pas les belles pages et le péritexte éditorial).
6« Ce livre, qui tient sur peu d’événements à l’intérieur desquels je zoome », concède l’auteur, interviewé par Emmanuelle George15, « pourrait se résumer en quelques phrases, tenir dans un titre de faits divers ».
7Pour ceux qui n’ont pas encore lu La Fille qu’on appelle, je proposerai pourtant un résumé expansé, suivant un ordre chronologique qui n’est pas celui de la narration :
8Laura, vingt ans à peine, a quitté Rennes, où elle vivait avec sa mère et faisait du mannequinat, pour revenir vivre avec son père, Max Le Corre, dans une ville bretonne ceinte de remparts qui n’est jamais nommée mais ressemble étrangement à Saint-Malo. Max Le Corre est un ancien boxeur, une vieille gloire en pleine renaissance après des années de disgrâce et d’alcool ; du haut de ses quarante ans, il vient de remporter son trente-cinquième combat. Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max est chauffeur du maire, Quentin Le Bars, la petite cinquantaine bedonnante. Max sollicite l’aide de son employeur pour aider sa fille à trouver un logement. Le maire reçoit la plantureuse jeune femme, promet de l’aider. En fin de compte Laura n’aura pas de logement mais emménagera comme dans une des chambres du casino de la ville où elle sera embauchée comme « hôtesse ». Précisons que ce casino est dirigé par Franck Bellec, un notable qui ne peut rien refuser au maire, toujours de blanc vêtu à la Al Pacino – ce même Franck Bellec a été le souteneur de Max Le Corre ; c’est aussi le frère de la « belle Hélène », une femme vénale, celle-même qui a fait exploser le mariage de Max avec la mère de Laura, Marielle. Il s’agit là d’un arrangement dont la jeune fille devra payer le prix – puisqu’elle devra payer de sa personne, chaque fois que le maire passera au casino, entre deux rendez-vous, pour s’assurer, soi-disant, que Laura va bien et qu’elle est bien installée. Elle va se retrouver enfermée dans l’engrenage de l’emprise, prisonnière à l’air libre, sans bien savoir comment elle y a glissé. C’est la veille d’un combat annoncé par des affiches dans toute la ville que son père comprend ce qui se passe entre le maire et sa fille, prenant conscience qu’il a jeté sa fille dans la gueule du loup. Rongé par une culpabilité qui cristallise ses pulsions d’échec et d’autodestruction, il perd contre un boxeur de huit ans son cadet mais, avec l’énergie du désespoir, il ne lâche pas et son adversaire lui porte des coups qui lui causeront des troubles neurologiques irréversibles. Le pronostic du médecin de l’hôpital où Max reste inconscient huit jours est sans appel : il ne sera plus jamais le même et ne pourra plus travailler, comme lobotomisé. Pour aider son père, Laura tente le tout pour le tout et décide alors d’aller retrouver à Paris Quentin Le Bars qui a entretemps été nommé Ministre des affaires maritimes. Une fois de plus, le maire assouvit son désir à la sauvette, sans aucun état d’âme, sourd aux malheurs de Max, poussant la goujaterie à laisser le soin de régler le prix de la chambre d’hôtel à Laura. Laura se décide enfin à porter plainte contre le Ministre, entendue par deux policiers. Le procureur, de mauvaise grâce et bien décidé à minimiser l’affaire, ouvre une enquête préliminaire pour « trafic d’influence ». Laura prendra un avocat mais son combat est perdu d’avance : Le Bars fait tout pour la discréditer en mettant l’opinion de son côté. Il s’arrange en effet pour faire publier dans Ouest-France les photos de nu qui ont été prises par un magazine pour adultes quand Laura n’avait que 16 ans. Lorsque Max tombe sur le titre de Ouest-France « Affaire Le Bars : elle posait nue à seize ans » (151), il s’enfuit de la maison de repos, va récupérer ses gants de boxe dans le bureau de Bellec, et son esprit dérangé n’a plus qu’une idée en tête : combattre Le Bars de passage à Saint-Malo. Max parvient à déjouer la vigilance des gardes du corps, s’abat sur Le Bars qui n’aura finalement que le nez cassé. C’est là que le roman s’arrête, page 173, plus exactement sur cette image :
Alors quand Le Bars, relevé par les quelques élus qui l’accompagnaient encore, a fini par descendre les quatre marches qui le ramenaient à hauteur de nous tous, il n’a pas cherché à éviter le regard de Laura, plantée droite devant lui et ses yeux dans les siens, comme voulant une dernière fois lui dire que non, ce n’était pas fini, pour elle ce ne serait jamais fini. Mais tout ce qu’elle reçut en guise de réponse, tout ce qu’elle put percevoir par-delà le mouchoir ensanglanté qu’il maintenait sur son nez, ce fut un regard sourd, indolent et comme imperméable qu’il déposa sur elle.
9C’est, il faut l’admettre, une fin en eau de boudin. Et l’on peut comprendre la réaction de lecteur déçu, ou resté sur sa faim, qui est celle de Frédéric Beigbeder : « Et à la fin, on se dit : “C’est tout ?” 16». De fait, Beigbeder est l’un des rares à juger négativement le roman qu’il trouve « lourd » : « C’est le roman le plus prévisible de l’année. […] Je ne sais pas quel est l'intérêt de lire un livre où tout est prévisible du début à la fin17 ».
10La fin du récit est suivie par une autre fin, relevant de l’énonciation auctoriale, ou éditoriale. Après le point final, on peut lire sur la page 174, non paginée, ce péritexte en italique, qui rend compte du dénouement de l’histoire de Laura et de l’histoire de son père, à la façon de ces épilogues au ton laconique que l’on trouve au cinéma, dans les films inspirés de faits réels, avant le générique de fin – et l’on reconnaît bien là, transémiotiquement et transmédialement, la manière cinématographique de l’auteur de Cinéma, le deuxième roman de Tanguy Viel, publié aux Éditions de Minuit en 1999 :
Max Le Corre a été condamné à deux années de prison ferme pour coups et blessures sur personne dépositaire de l’autorité publique et mise en danger de la sûreté de l’État. La plainte de Laura Le Corre a été classée sans suite.
11Ce qu’il faut entendre, entre les lignes, entre les mots, c’est moins ce qui est écrit que ce qui n’est pas dit : le procès et la condamnation de Le Bras n’auront pas lieu. Libre au lecteur de juger scandaleuse cette absence, symptomatique de l’impunité dont jouissent presque toujours les hommes politiques.
12Dès lors, le caractère prévisible que Beigbeder reproche au roman n’est-il pas plutôt celui des affaires telles que celles de Laura et son père ont presque toujours ? En somme, les dominés ne sont-ils pas toujours appelés à perdre et à se briser contre les puissants, aussi malhonnêtes et corrompus soient‑ils ?
Rapports de force, emprise et consentement
13La question des rapports de force sociaux et de l’aliénation est récurrente dans l’univers fictionnel de Viel, corollairement à celle de l’appareil législatif qui les régit. C’était déjà le cas dans Article 353 du code pénal18, paru en janvier 2017, dont La Fille qu’on appelle est « un cousin19 » ou plutôt la « version féminine20 », pour parler comme l’auteur.
14Cette fois‑ci en effet la question de l’aliénation est posée à travers le prisme de la domination masculine et sexuelle. La fille qu’on appelle « est traversé par l’air du temps21 » et les nombreuses affaires de violences sexuelles et d’emprise portées sur la place publique depuis une grosse dizaine d’années, relayées, à l’échelle nationale et internationale, par la presse, les réseaux sociaux ou la littérature, qu’il s’agisse du mouvement #MeToo, Balance ton porc, des accusations de Florence Porcel envers Patrick Poivre d’Arvor, des scandales entre certaines sportives et leurs entraîneurs, ou encore du consentement des mineures envers Gabriel Matzneff dans Le Consentement de Vanessa Springora, paru chez Grasset le 2 janvier 2020.
15À la question d’Emmanuelle George, « [Dans ce texte] de quoi est-il question ? », Viel répond : « De consentement. Même si c’est un sujet à la mode ou plutôt parce que c’en est un22 ». Le mot « consentement » apparaît bien dans le roman de Viel, tardivement, p. 135, en même temps que celui d’« emprise », p. 134, dans le dépôt de plainte rédigé par les deux policiers ; ces mots ne sont pas posés par Laura, ainsi que le donne à entendre le passage suivant, au sujet des faits décrits par Laura, « ceux‑là mêmes qu’elle n’aurait pas su qualifier pénalement, elle qui n’avait parlé ni de viol ni de proxénétisme, encore moins de trafic d’influence ou d’abus de faiblesse, mais seulement décrit dans l’ordre la sinueuse et progressive emprise qu’il avait eue sur elle » (134). La réaction de Laura et la suite de son dialogue avec les policiers confirment d’ailleurs que ce n’est pas elle qui emploie le mot :
Mais emprise, elle a dit, ce n’est pas un délit, n’est-ce pas ?
Ça dépend, a dit le policier, rien n’est exclu […] Il faut déjà qu’il soit jugé. Il y aura une enquête.
Oui mais à la fin, elle a insisté, il sera condamné ?
C’est une affaire délicate. Je ne suis pas juge.
Et la raccompagnant jusqu’à l’entrée, il a ajouté : Je vous conseille de prendre un avocat. (134‑135)
16Le roman de Tanguy Viel met bien en évidence que si, dans les affaires de violences sexuelles, la notion de consentement est complexe, celle d’emprise, « cet obscur pouvoir du prédateur23 » est difficile à qualifier devant la justice et à condamner. Tandis que le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise24 » et que la notion de « consentement » est centrale dans notre code pénal, l’emprise reste difficile à définir car elle n’est pas un élément qui caractérise une infraction. En effet, il faut distinguer entre une emprise « consciente et travaillée » et une emprise presque involontaire, qui serait difficile à condamner. « Les victimes sont d’absolues victimes. Il y a des auteurs qui font des actes positifs de contrainte qui vont mettre l’autre sous emprise », explique Maître Caty Richard, avocate médiatisée qui intervient dans les affaires de violences sexuelles. « Mais l’emprise peut être un sentiment de la victime. Il existe toute une problématique autour de l’emprise vécue sans qu’il y ait une mise en place délictuelle ou criminelle de l’auteur. Il y a seulement emprise parce que l’auteur a une aura, est célèbre ou charismatique ». Dans le code pénal, la notion qui se rapproche le plus de celle de l’emprise est celle de la contrainte. Précisons que la loi votée en juillet 2020 à l’Assemblée nationale a fait entrer dans le code pénal la notion d’« emprise » lors de violences conjugales afin de légitimer l’intervention du corps médical pour réaliser un signalement en cas d’emprise. Il s’agit là d’un premier pas, certes. « Mais la notion d'emprise n’est toujours pas évaluée par les juges car elle n’est pas inscrite dans la loi », rappelle Audrey Darsonville, Professeure de droit pénal à l’université de Paris-Nanterre. « [Or] [l]’absence de consentement repose sur cette emprise, c’est extrêmement important que la notion entre dans la loi car on ne peut que constater que c’est une réalité ».
17Quoiqu’aucune date ne soit jamais donnée dans le roman de Viel, on peut donc supposer que les faits relatés sont antérieurs à juillet 2020 puisque lorsque le procureur du roman cherche dans la « nomenclature des faits » (138) « toutes les qualifications pénales que le récit de Laura lui inspire » (137), il fait défiler dans sa tête des étiquettes autres que celle d’« emprise » : surgissent en effet « corruption sexuelle », « abus de faiblesse », « proxénétisme », avant qu’il n’opte en connaissance de cause pour « trafic d’influence » (p. 137 et 138), l’étiquette « la plus floue, la plus opaque et la plus ouverte à la fois », la plus inoffensive en fin de compte puisqu’elle est celle que « l’opinion publique pourra tolérer le mieux, par ignorance ou lassitude » (138).
18La fiction de Tanguy Viel n’est bien sûr pas sans faire écho à l’affaire retentissante d’un autre maire, celui de Draveil, dans l’Essonne, Georges Tron accusé en mai 2011, en pleine affaire Dominique Strauss‑Kahn, d’agressions sexuelles commises avec Brigitte Gruel, son adjointe à la culture, sur deux employées de la mairie — pendant des séances de réflexologie plantaire dont il était amateur. Après plusieurs rebondissements, le 17 février 2021, cet ancien secrétaire d’État a été reconnu coupable de viol et d’agressions sexuelles en réunion sur l’une des deux plaignantes, Virginie Ettel, mais a été acquitté concernant les accusations de l’autre, Eva Loubrieu25.
19Si Tanguy Viel reconnaît avoir été influencé par l’air du temps, participant, comme il le dit, de « ce mouvement général d’époque qui fait que la littérature s’est politisée, qu’elle est revenue au réel26 », il dénie tout opportunisme littéraire. Il rappelle ainsi que son projet initial était tout autre, celui d’écrire un livre sur la boxe, attaché qu’il est à la figure des perdants, à celle des adultes qui sont restés enfants, à l’instar de Max, dans un monde dominé par les grands, adultes autant que puissants. N’y parvenant pas, il a d’abord renoncé, jusqu’au moment où il a eu l’idée de combiner son projet initial à un autre projet : celui « de mettre en scène une femme aux prises avec un homme de pouvoir »27. Cette femme, ce sera Laura, majeure, mais vingt ans à peine – la fille de Max, le boxeur. À cette étape séminale de la genèse romanesque, il est fait allusion en tête du deuxième chapitre de la première partie, après ce qu’on pourrait appeler un « faux départ », à moins qu’il n’y ait deux départs, comme il y a deux fins :
Peut-être il aurait fallu commencer par lui, le boxeur, quand je ne saurais dire lequel des deux, de Max ou de Laura, justifie plus que l’autre ce récit, mais je sais que sans lui, c’est sûr, elle n’aurait jamais franchi le seuil de l’hôtel de ville, encore moins serait entrée comme une fleur à peine ouverte dans le bureau du maire, pour la bonne raison que c’est lui, son père, qui avait sollicité ce rendez-vous, insisté d’abord auprès d’elle, insisté ensuite auprès du maire lui-même, puisqu’il en était le chauffeur. (15)
20Dans ce passage où l’on aura reconnu la manière méta- ou épilittéraire caractéristique de l’auteur de La Disparition de Jim Sullivan (publié en 2013 aux Éditions de Minuit), toujours attentif à interroger devant son lecteur les outils du romancier, on mesure à quel point les histoires et les destins de Max et Laura sont inextricablement liés dans un rapport de spécularité, suggéré p. 32 notamment :
Presque alors ils auraient pu se croiser par affiches interposées, le père et la fille sur les murs de granit, tous les deux le corps presque à nu et le regard magnétique censé aimanter l’attention, quoique contraires l’un à l’autre, à force de développer chacun les signes les plus archétypaux du masculin et du féminin – lui bête de muscles qui surjouait en chaque veine saillante la force et la virilité, elle toute de courbes lascives et les dents blanchies qui mordillaient les lèvres.
21« Père et fille », explique Viel, « ont un problème avec leur corps, une manière de négocier avec, en étant soumis à des plus forts qu’eux. Ils n’arrivent pas à habiter complètement leur corps, puis apprennent. Peut-être est-ce un roman d’initiation, d’émancipation à partir des corps. Cette fille, très belle, débarque du monde du mannequinat où des agences de mode peuvent embarquer une lycéenne dans un univers qui n’est pas le sien28 ».
22Si Laura est « la fille qu’on appelle » — c’est la traduction littérale de « call-girl » (comme on le lit, p. 11) —, Max est quant à lui l’homme qu’on appelle, « assis au volant de la berline municipale, à attendre qu’on l’appelle comme un simple taxi » (42). Ce « on » qui appelle le père n’est autre que le maire qui se fait conduire au Casino où il fait appeler la fille, selon un rituel mécanique qui se répète durant un peu moins de deux mois, une machine, évoquée p. 85, destinée à assouvir le désir de l’édile, huilée par Franck Bellec sous le regard désapprobateur de sa sœur :
Et tous les soirs ou presque elle l’attendait, vers cinq heures, son seul client en quelque sorte, quand assise sur un tabouret au bar du casino, Bellec se postait à l’autre bout du comptoir, regardait Hélène comme s’il lui demandait la permission et alors s’approchait de Laura, lui signifiant qu’il était là, le maire, qu’il venait d’arriver et qu’il l’attendait là-haut. Alors elle s’excusait auprès des clients, elle avalait d’un coup la flûte de champagne qu’on venait de lui offrir, et elle disait : Je reviens. Et Franck, n’osant regarder Hélène, la suivait des yeux vers l’escalier mal éclairé qu’elle commençait à monter. Et Hélène alors ne manquait pas de marquer son agacement, posait violemment son verre sur le comptoir d’acier, ostensiblement encore elle se levait et souvent se postait à la fenêtre dont elle entrouvrait les rideaux toujours tirés. C’était sa manière à elle de désapprouver, en regardant dehors, en obligeant son frère à se souvenir qu’il y avait là en contrebas, dans une berline noire aux vitres fumées, un vieux boxeur qui attendait sans se douter de rien. Et alors elle restait là de longues secondes, le regard fixe, à se demander comment c’était possible.
23Le roman tient donc sur un quintette de personnages — Quentin Le Bars, Franck et Hélène Bellec, Max et Laura Le Corre — et sur leurs rapports de force, sur un front socio-psychologique. On peut, à l’instar de Beigbeder, trouver ces personnages et leurs rapports « caricaturaux29 ». Si on peut admettre que le trait est un peu forcé, comme il peut l’être dans les contes ou les westerns spaghettis, que Max le boxeur par exemple, est peu loquace et ne brille pas par son intelligence, en réalité, sitôt que l’on regarde de près, comme l’explique Viel à Emmanuelle George, « tout se met à trembler : les identités deviennent instables, on s’interroge sur les ambivalences. Qui domine, qui se soumet et pourquoi ?30». « Le rapport entre dominant et dominé est à la fois clair et trouble. Il y a le méchant et le gentil. Malgré tout, à l’intérieur de cette bipartition, il y a des zones d’instabilité et d’ambiguïté. [E]ntre le maire et Laura, il y a aussi un rapport de domination où j’ai tenté d'explorer tout un mécanisme qui fait qu’il n'y a pas besoin de violence physique pour que les dominations s’installent. Tout se joue dans [les interstices,] les fascinations31 ». « J’espère », confie-t-il encore à Simon Gémon, « que le livre travaille des zones grises, des zones où on ne comprend pas pourquoi ça se passe32 ».
Le travail des « zones grises »
24Malgré son flou référentiel, on devine que le pronom indéfini « ça » désigne au premier chef le mécanisme de l’emprise, ce pronom avec lequel Laura se débat lorsqu’elle cherche à nommer ce qu’il lui arrive ; ce « ça », c’est aussi le pronom neutre « ce » employé dans le discours indirect d’Hélène, à la toute fin du passage précédemment cité, qui renvoient ici (par anaphore pronominale résomptive) à la cécité et à la naïveté de Max et, plus loin, à sa défaite33. Ce sont précisément les « zones grises » qui rendent possibles l’innommable, l’inadmissible et l’incompréhensible. Le syntagme fait évidemment allusion à la nomenclature des affaires d’emprise dans lesquelles les « zones grises » désignent les « moments où la victime ne se sent pas de dire non34 », pour citer à nouveau Maître Caty Richard – ce qui rend le consentement incompréhensible et paradoxal au regard de la logique du sens commun.
25Cet échange entre Laura et les policiers, où l’on retrouve le pronom « ça », est éclairant à ce titre. Laura vient de raconter comment a eu lieu son premier rapport avec Le Bars, à son corps défendant, comment il a pris sa main dans la sienne pour l’approcher très doucement de sa ceinture, après quoi tout s’est enchaîné.
Il a mis sa main sur la vôtre, cela vous en êtes sûre ?
Elle a juste fermé un peu les yeux en guise d’acquiescement.
Mais ensuite ?
Ensuite, ensuite je ne sais pas. Son regard peut-être. Ou une légère traction de sa main ou bien moi toute seule qui ai cru que… Elle, se taisant à nouveau d’un regard vers le sol.
Que quoi ?
Que ça se passait comme ça.
Comment ça, a dit le flic, qu’est-ce qui se passait comme ça ?
Je ne sais pas. Ce genre de choses. Que forcément si vous en êtes là, forcément au bord d’un grand lit dans une chambre avec un homme comme lui, eh bien, voilà, vous, oui, vous le faites.
Vous le faites ?
Oui, vous le faites, c’est-à-dire que vous laissez sa main vous guider jusqu’à son sexe et vous comprenez qu’il vous appartiendra d’entreprendre – et elle a dit ce mot-là, d’entreprendre, que c’est elle qui l’a entrepris.
Il ne vous a rien demandé ?
Non. Pas vraiment.
Donc vous l’avez fait de votre propre volonté ?
Non, je vous dis, c’était ce que je devais faire, ça ne veut pas dire que c’était ma volonté.
Et les deux flics commençaient à s’agacer, insistant :
Attendez, vous dites qu’il ne vous a rien demandé ?
Non, rien. En tout cas il n’a pas dit « Déshabille-toi » ni « Allonge-toi », non, il n’a pas dit une phrase comme ça. (77‑78)
26La plus grande réussite du roman de Tanguy Viel est de travailler ces « zones grises » et, ce faisant, de les éclairer. Ces zones grises ne doivent pas être appréhendées comme un simple milieu entre des zones blanches et des zones noires, métaphoriques sur un plan axiologique du bien et du mal. Elles se déclinent au contraire selon toute une gamme de camaïeux, dans lesquels le noir et le blanc entrent en doses variables, travaillées par des tensions, des tiraillements et des contradictions subtils mais non moins réels, à l’instar de ces « mouvements invisibles de plaques [tectoniques] se subsumant glissant sur [une] sorte de magma » jusqu’à « l’instant du choc » (39-40), mouvements évoquant métaphoriquement la première fois où Le Bars a posé sa main sur celle de Laura, dans son bureau à la mairie.
27Pour l’essentiel, les zones grises que l’écriture de Vieil travaille concernent premièrement les personnages (j’ai envie de dire « caractères », tant il entre de théâtralité dans ces personnages) ; deuxièmement les dits et les non-dits ; et, troisièmement, la scénographie narrative et les configurations de cette forme de dialogisme que sont les discours rapportés.
Les personnages
28Concernant les personnages, se dégage clairement une bipartition opposant le camp des gentils au camp des méchants : celui de Max et Laura, les victimes, celui de Le Bars et Bellec, leurs « bourreaux » — le mot apparaît p. 104 lorsque Max, perché sur le ring « comme un oiseau dans son nid », « fait tout pour ne pas baisser les yeux vers la salle, […] pour ne pas voir sa propre fille installée entre ses deux bourreaux » (remarquons au passage l’ambivalence du possessif, qui peut référer tout autant à Max qu’à sa fille). Et même si Bellec se réjouit que Max mette une raclée à Le Bars en public, sa satisfaction est purement égoïste, sa solidarité avec Max n’étant qu’éphémère – Max apparaît là encore comme un jouet devenu le pantin dont c’est Bellec qui tirerait les ficelles pour le laver de la « gifle » que lui a infligée Le Bars devant tous. Bellec est quand même celui qui a permis à Le Bars de ne pas perdre la face dans « cette sordide affaire » (156) en faisant publier dans Ouest France des photos érotiques de Laura, exhumées de ses tiroirs où il avait aussi soigneusement que malsainement conservé les magazines de charme où elles avaient été publiées. Il n’y a guère qu’Hélène qui soit transfuge, redessinant le camp des forces en présence – elle trahit les dominants, en dessillant Max sur ce qui se passe sous son nez ; si elle continue à travailler chez son frère, c’est parce qu’au fond elle n’a plus vraiment le choix, reine déchue. Pour autant, cette « pute princière » (67) ne se réduit pas à sa vénalité : elle n’a finalement pas la mémoire aussi courte que son frère, pleine d’empathie pour ce roi du ring et de la nuit qu’a été Max à une certaine époque ; elle fait montre de plus de sentiments et de morale que son frère, ce proxénète à la tête de ce que l’avocat de Laura nomme le « système » Bellec » (146), « une machine bien rodée et qui ne s’embarrass[e] même pas de se cacher » (147), un roitelet qui « obéit au maire [qui] obéit à son désir » (102).
29Le Bars est en effet réduit métonymiquement à son désir, à plusieurs reprises : ce n’est pas Le Bars qui entre dans la chambre à Paris mais son désir — « à la manière dont la porte a claqué derrière lui », racontera Laura, « j’ai compris tout de suite que rien d’autre que son désir n’avait franchi le seuil de la chambre, sinon son orgueil peut-être qui s’installerait dans le fauteuil au pied du lit » (124‑125) ; p. 113, il était déjà question de « l’empire d’un désir ». Le Bars apparaît comme un « monstre » (124) orgueilleux, mu par la libido sentiendi et la libido dominandi. Il ne se soucie guère des autres (d’ailleurs on ne lui connaît ni femme ni enfants dans la fiction). La page 24 offre un micro‑portrait de ce Narcisse en homme politique dont les administrés sont les sujets et Laura, rien de plus qu’une « fille » — des gens que son rôle est d’aimer, de se faire croire qu’il les aime « à moins que, oui, c’était possible aussi, il ne s’aimât lui-même en train de les aimer ».
30L’emprise de Le Bars sur Laura est‑elle « consciente et travaillée » ou est-elle presque involontaire ? La question semble déjà posée p. 35, au travers de l’alternative : « Alors sans qu’il mesure en lui ce qui relevait du calcul ou de l’instinct, il a repris : Tu étais où avant ? » pour lui faire dire qu’elle était à Rennes (la ville où elle était mannequin de sous-vêtements). Après la première fois avec Le Bars, Laura aura en tout cas besoin d’imaginer qu’il se sent « amer ou coupable », ayant besoin « de se mentir à lui-même [pour] quitter la chambre avec le sentiment qu’il n’y était pour rien, que ce n’était pas lui, mais bien elle qui avait agi, que son corps à lui avait seulement cédé mais jamais rien de sa volonté propre » (78) – il demeure impossible au lecteur de savoir si Le Bars se ment bel et bien à lui-même pour refouler l’amertume de ses remords ou s’il s’agit seulement d’une projection mentale de Laura.
31L’ensemble du roman fait plutôt apparaître Le Bar comme amoral et dépourvu de sentiments, imperméable à tout, à l’image de ce regard imperméable qu’il pose sur Laura, à la fin du roman. Qu’il soit volontairement coupable ou pas, il n’en est pas moins le bourreau de la jeune femme – sur ce point, l’avis de l’auteur et du narrateur semble tranché qui sont du côté des gentils, même s’ils n’hésitent pas à pointer leurs failles, leurs brèches, celles-là même par lesquelles les dominants prennent possession d’eux.
32Si le rapport entre dominant et dominé est trouble, comme le dit Viel, c’est parce que « tout se joue dans les fascinations », la fascination que les dominants exercent sur les dominés, une sorte d’effet de sidération prolongée dont les dominés se font eux-mêmes complices, victimes d’une sorte de syndrome de Stockholm. Par un effet pervers, plus le dominant se montre dominant, supérieur, étranger à tout scrupule, au-dessus des lois, plus cette fascination s’intensifie. C’est ce mécanisme qui est à l’œuvre dans l’effet produit sur Laura par la dureté de Bellec, ainsi que l’atteste cet extrait :
Et la dureté, a dit Laura plus tard, quand elle est assumée, elle est insurmontable. La seule issue, ce serait de partir en courant mais bizarrement ça ne fait pas ça, bizarrement ça fait comme une décharge électrique qu’on donnerait à un chien pour qu’il n’y revienne pas – oui, ça m’a fait ça, dira-t-elle, c’est fou, hein, ça ne m’a pas énervée, non, ça m’a domptée. (64)
33Le pouvoir fascine et flatte l’amour-propre de qui l’approche. La jeune Laura ne faillit pas à la règle et cède à cette sirène qui ne fait que précipiter sa perte — elle est fière d’avoir rendez-vous avec le maire, se gargarisant en l’annonçant à l’envi au petit personnel de l’hôtel de ville (p. 11‑12), impressionnée par tout le décorum néo-féodal — tandis qu’on sent poindre l’ironie auctoriale lorsqu’il est question de contourner le « grand bureau » (23) du maire-seigneur, dans le château « depuis longtemps transformé en mairie » (9), lorsque sont évoquées la grosse voiture noire du maire puis la voiture noire plus grosse encore du ministre. La jeune Laura quant à elle tombe dans le panneau de cette surenchère et se sent « presque flattée » (113) quand Le Bars, en réponse à son message de félicitations pour sa promotion, lui écrit par texto : « À bientôt j’espère ». Elle avoue aux policiers : « je me suis sentie importante ce jour-là » (113). Et c’est avec ce sentiment en bandoulière qu’elle effectuera tout le trajet en train la conduisant à Paris pour aller voir Le Bars, alors même qu’elle s’avilit plus encore, « se disant encore, oui, un simple arrangement, un dernier deal, voilà, et presque elle aurait eu envie de raconter son histoire à ses voisins, leur dire comme ça, oui je vais à Paris, je vais passer la nuit avec Quentin Le Bars, oui, le nouveau ministre, mais notre histoire est compliquée, soudain persuadée que le wagon entier médite sur son cas et chuchote “Oui, c’est elle, la maîtresse de La Bars, je la reconnais”, quand quelquefois on croirait en place et lieu d’un dieu qui nous observe, il y a seulement la rumeur concentrée de cinq milliards d’humains les yeux tournés vers nous » (122).
34Tous ces mécanismes psychologiques ont beau relever du « b-a-ba de ce qu’on apprend en psychologie » (120), comme dirait Laura, les victimes ne s’en font pas moins piéger.
35Enfin, si Viel parle d’ambivalence s’agissant des identités de ses personnages, c’est parce qu’à l’instar des personnages tragiques, Max et Laura ne sont ni tout à fait coupables, ni tout à fait innocents. Laura est coupable comme l’est, chez Racine, Phèdre ou encore Britannicus — Britannicus que ses confidences à Narcisse perdent. Laura est coupable d’avoir fait des photos érotiques quand elle était jeune, coupable d’avoir eu des relations avec les hommes qui l’employaient ou les photographes eux-mêmes — sans que le lecteur ne sache s’il s’agissait déjà d’emprise à une époque où Laura n’avait que seize ans ; Laura est encore coupable d’avoir omis d’informer de ce passé son avocat qui, mi-énervé mi-ironique, lui demande si elle connaît « la théorie de la victime parfaite ». À Laura qui répond par la négative, il déclare : « Eh bien, c’est tout le contraire de vous. » (145). À l’instar de cet autre personnage tragique qu’est Oreste, à qui Racine faisait dire dans une première version d’Andromaque : « Je me livre en aveugle au transport qui m’entraîne. », Max et Laura s’aveuglent volontairement dans cette tragédie qu’est La Fille qu’on appelle, où sont convoqués à tout bout de champ tant les dieux de la mythologie que les éléments de la tragédie antique : Némésis, Neptune, les Néréides, les Parques (50), « le dieu inconnu » (76) auquel se remet Laura, le temps en figure de « dieu punisseur » (66), Hélène et son sens du tragique (92), le « coryphée antique » (80), la fatalité elle-même, qui apparaît néanmoins comme la forme dégradée du destin (celui même auquel les dieux eux-mêmes ne peuvent échapper dans la mythologie grecque) quand elle prend le visage de « Franck, l’horrible Franck qui regardait la gueule cassée de Max avec le même air fataliste de qui maîtrise la situation, du genre de regard que la compassion, la bienveillance ou plus encore l’amitié ont déserté depuis longtemps » (101). En amont de ce passage est évoqué le moment où « chacun comprend qu’il ne dépend plus de lui d’entrer ou de sortir ni de seulement défendre le peu d’espace où respirer mais qu’est venue l’heure de glisser aveuglément dans la vague et de se laisser faire par elle. Max, sur la civière, il ressentait cela […] » (101). Le motif de la cécité lucide de Max apparaît en pleine lumière p. 92‑93 dans une prise de conscience douloureuse, brutale, qui « n’a peut-être duré qu’un quart de seconde », retracée par les sinuosités d’un long paragraphe, dont je ne cite que la deuxième moitié. L’oxymore vif que constitue l’aveuglement lucide est stylistiquement rendu sur le plan syntaxique par la parataxe (soulignée en caractères gras), l’absence de lien logique – concessif ou adversatif – figurant mieux le paradoxe d’une évidence tenue volontairement masquée :
Et parce que cette vérité criante, cette intuition qu’il ne pouvait pas ne pas avoir eue, il sentait soudain qu’il l’avait isolée dans un parc bien grillagé à l’intérieur de lui, comme une cage qu’il aurait surveillée en lui tournant le dos – et sans savoir qu’en même temps qu’il maintenait la garde devant son rideau de fer, derrière lui la bête creusait et creusait encore. Et sans doute elle a construit un des plus beaux souterrains qui soient, jusqu’à sortir exactement à l’endroit où il montait la garde, en pleine lumière lui soufflant au visage que bien sûr, tu le sais depuis longtemps, tu n’as pas voulu le voir : ta fille est devenue la pute de ton patron. (92-93)
36Ce moment de reconnaissance tragique n’est pas sans faire écho à celui que vit Œdipe dont on sait les conséquences irréversibles qu’il aura : si Max ne se crève pas les yeux, il se laisse démolir par son adversaire, en redemandant des coups encore et encore, attendant la mort (104‑105). Laura non plus, est-il dit à plusieurs reprises par le narrateur ou le personnage lui-même, n’aura jamais perdu totalement sa lucidité.
Dits et non‑dits
37Si les « interstices » dont parle Viel désignent les fêlures et les faiblesses des personnages, de Max et Laura en particulier, ces interstices concernent aussi les interactions verbales qui sont criblées par les non-dits. Les non-dits qui recouvrent aussi bien les silences, les mensonges mais aussi toutes les formes d’implicites, que les présupposés et les sous-entendus prennent la forme de l’aposiopèse, de l’épanorthose ou des points de suspension, dans ce qu’on pourrait nommer une pragmatique de l’emprise.
38Ces non-dits, ce sont aussi toutes les interactions corporelles entre les personnages, celles qui participent à la mécanique infernale de l’emprise. Il y a en particulier ces gestes qui paraissent d’abord anodins : celui, par exemple, qui consiste à inviter une jeune femme à s’asseoir sur un canapé, sous prétexte de s’y trouver plus à l’aise, puis de rejoindre son invitée sur ce même canapé pour converser ; ou encore cet autre geste consistant à prendre la main, qui, sous des dehors paternalistes et protecteurs, vise en réalité à endormir sa proie, à l’anesthésier pour mieux l’attaquer par surprise. Ainsi, Le Bars n’hésite pas à joindre le geste au non-dit verbal. Laura sent sa main se poser sur la sienne en même temps qu’il lui dit : « Je vais faire ce que je peux pour t’aider. » (41) Cette promesse est une fausse promesse : elle ne signifie pas que le maire pourra aider Laura. Rétrospectivement, cet énoncé est cynique : non seulement le maire ne fera rien pour aider Laura à trouver un logement, mais tout ce qu’il fera pour l’aider est abuser d’elle. On retrouve la même association parole-geste lorsqu’il vient lui rendre visite pour la première fois au casino au prétexte de s’assurer qu’elle est bien installée : « Tu vois, il a dit, j’ai tenu ma promesse… » (71) et presque aussitôt, sans hésiter, l’embrasse sur les deux joues, sitôt qu’elle l’a laissé entrer.
39Les points de suspension après le nom « promesse » sont lourds d’implicite, signe d’une attente, moins celle que Laura le laisse pénétrer dans sa chambre, que celle d’obtenir son dû. Comme si la dérivation allusive dont est porteur l’énoncé de Le Bars n’était pas décodable par Laura, Le Bars l’explicite par son geste inapproprié, celui d’un homme qui prélève sans ménagement un acompte, pressé de récupérer le montant total de la dette.
40Viel ne laisse pas systématiquement faire ce travail d’interprétation à son lecteur. Et le narrateur fournit bien souvent le mode d’emploi des non-dits, des silences, par des commentaires longs et appuyés. C’est notamment le cas dans le chapitre où Le Bars vient imposer à Bellec d’embaucher Laura dans son casino. Comme Franck ne coopère pas, faisant entendre à Le Bars par ses hésitations, ses dérobades et ses réponses machinales – « oui », « c’est sûr » – qu’il n’a pas l’intention d’accéder à sa demande, l’autre le met au pied du mur par ce simple énoncé : « Je ne crois pas que ça vous engage beaucoup et par ailleurs… ». Le lourd sous-entendu dont sont prégnants les points de suspension marquant l’auto-interruption dans cet énoncé de Le Bars donnent lieu à plus de deux pages d’explication éclairant les liens entre les deux hommes :
[…] Le Bars n’avait fait que rappeler ce qu’ils étaient l’un pour l’autre : deux araignées dont les toiles se seraient emmêlées il y a si longtemps qu’elles ne pouvaient plus distinguer de quelle glande salivaire était tissé le fil qui les tenait ensemble, étant les obligés l’un de l’autre, comme s’ils s’étaient adoubés mutuellement, dans cette sorte de vassalité tordue et pour ainsi dire bijective que seuls les gens de pouvoir savent entretenir des vies entières, capables en souriant de qualifier cela du beau nom d’amitié. (49‑51)
Scénographie narrative et discours rapportés
41Les zones grises les plus remarquables que travaille le roman et qui sont celles qui interrogent le plus le lecteur sont celles du troisième type que j’ai distingué – la scénographie narrative et les configurations de cette forme de dialogisme que sont les discours rapportés.
42Fidèle au roman où il explore la comédie humaine et les vicissitudes du theatrum mundi, Viel propose, et c’est une première dans son œuvre, un roman à la troisième personne :
Jusqu’ici, j’ai toujours écrit à la première personne, en caméra subjective. Ici, parce que c’est un personnage féminin et que peut-être je ne me suis pas senti la légitimité ou bien que je n’ai pas assez senti en moi la voix du féminin, j’ai eu besoin d'un narrateur extérieur qui soutient les discours des personnages35.
43Précisons néanmoins que le récit de ce narrateur est concurrencé par d’autres récits. D’abord, il y a le récit-témoignage qui sera fait lors du procès de Max, hors champ, hors scène romanesque — celui-là est tout juste suggéré par les incises attributives au futur historique « dira-t-elle plus tard », s’agissant de Laura ou Hélène, ou « dira-t-il plus tard », s’agissant de Max, la locution adverbiale temporelle relative ne permettant pas de connaître avec précision la scène d’énonciation dans laquelle s’inscrivent ces paroles.
44Plus important encore que ces bribes de récit, le récit de Laura — qui apparaît au moins dans 11 chapitres sur les 21 que compte le roman —, celui dont Laura accouche devant les policiers qui, avec leurs questions incessantes, jouent en quelque sorte un rôle de maïeutes. Le mot de « récit » pour qualifier le dépôt de plainte de Laura est d’ailleurs employé et par les policiers et par le narrateur lui-même. Laura en accouche dans la douleur – « Je ne suis pas là pour me faire du bien », dit-elle aux policiers (112). À première lecture, ce récit est principalement donné à entendre dans le dialogue entre Laura et les policiers, que le cadre de l’interlocution soit fixé à priori par le narrateur avant l’échange ou à posteriori. Cet échange est rapporté de façon non canonique : exit les guillemets (pour l’essentiel, présents pour les emplois autonymiques et les formules toutes faites), exit le tiret dialogal marquant la prise de parole ; si les verbes introducteurs sont là, comme les incises discursives, avec ou non l’inversion verbe-sujet canonique, la source énonciative dans les tours de parole n’est pas toujours précisée. Mais cette absence de précision, comme les formes hybrides de discours rapporté fréquemment rencontrées (« que » + discours direct ou encore hybride de discours indirect et de discours indirect libre) ne constituent pas d’entrave à la clarté.
45Ce qui, en revanche, peut perturber le lecteur c’est lorsqu’est employée l’incise « a-t-elle repris » (81), juste après un passage de récit (81). Le lecteur ne peut manquer de s’interroger : est-ce donc Laura qui parlait ?
46En rétrolecture, les segments de discours indirect libre apparaissent nombreux, voire invasifs. Mais, dans le même temps, on constate que le récit du narrateur lorgne constamment sur l’énonciation de discours, qu’il a les mêmes tics langagiers que Laura (l’usage massif de modalisateurs, l’emploi de l’épanorthose et de la reformulation « je veux dire », le déterminant indéfini « je ne sais », etc.). Surtout, il s’agit d’un narrateur homodiégétique de type allodiégétique qui emploie « je » ou, avec une dimension chorale, « nous » (101, 122, 129, 133), personnage dont on ne sait qui il est — un personnage de la foule qui apparaît à la fin, assistant à la débâcle finale de Max (« nous tous », page 173) —, au statut ambivalent, intradiégétique comme personnage mais extradiégétique comme narrateur, s’adressant, quoique fictif, au lecteur réel, qu’il n’apostrophe ou ne prend jamais à partie. Ce narrateur a une position narrative instable qui s’apparente à celle du « narrateur-témoin fantomatique » dont parle Dominique Maingueneau et qu’il présente comme « une sorte de personnage implicite, qui ne serait pas partie prenante dans l’histoire mais resterait à la périphérie36 », « situé sur la frontière entre la scène de narration et le monde [configuré par le récit]37 », doté d’une posture énonciative duelle « dedans »/ « dehors ». Comme ses homologues et ses cousins chez Giono, Echenoz ou Kerangal, le narrateur homodiégétique de La Fille qu’on appelle est un leurre. Il n’est en aucun cas un des personnages de la fiction, bien trop omniscient, pour ainsi dire, pour un simple témoin, mais bien le double de l’auteur, plein d’empathie envers Laura, dont il connaît à peu près tout. De fait, le lecteur se demande constamment : qui parle ? et qui voit ? est-ce Laura ? est‑ce le narrateur ? où commence le récit de Laura et où finit‑il ? où commence le récit, où finit le discours rapporté ? Ces questions sont d’autant plus complexes que les deux points de vue, narratologique et énonciatif, peuvent ne pas coïncider et que la scénographie narrative entremêle les deux récits plutôt qu’elle ne les emboîte : celui du narrateur destiné au lecteur ; celui de Laura, adressé aux policiers et également destiné au lecteur (par un effet de double énonciation/destination, comme au théâtre), qui est l’objet principal de la narration dans certains chapitres (I,3) ou que l’on devine en transparence, dans d’autres, au moyen des discours rapportés, alors même que le lecteur oublie la présence des policiers sur la scène de la fiction. C’est notamment le cas dans le chapitre I, 4 qui est celui de la première rencontre entre Laura et le Bars, dans lequel la mention explicite de la présence des policiers n’apparaît qu’à la fin du chapitre (40), à travers l’incise attributive « a-t-elle expliqué aux policiers », cette présence n’étant que discrètement suggérée au début du chapitre par l’incise « dit-elle » (33), privée de complément d’attribution. Le lecteur oublie ainsi la médiation du récit de Laura, vivant avec elle sa rencontre avec le maire. Bien souvent les deux récits s’entremêlent, à l’image de la terre et de la mer lorsque l’océan est poussé « vers la terre » (43). Le lecteur ne sait pas toujours, comme dans l’exemple suivant, si tel ou tel passage doit être interprété comme du récit à la troisième personne ou comme du discours rapporté :
Elle a fait comme si elle n’était pas surprise qu’il la tutoie si vite, que peut-être à cause de son jeune âge, forcément c’était normal qu’il soit avec elle plus familier qu’avec une autre, et puis parce qu’aussi, bien sûr, elle était la fille de Max, je veux dire, pas seulement la fille du grand boxeur mais d’abord et surtout et surtout la fille de son chauffeur. (33-34)
47Quantité d’éléments plaident pour une interprétation de ce passage en termes de discours indirect libre – les modalisateurs (« peut-être », « bien sûr »), l’adverbe d’énonciation (« forcément »), l’anacoluthe conférant au discours une dimension parlée (deuxième et troisième segments) –, suivi par du discours direct atypique car non introduit par un verbe de parole et non marqué par l’attelage deux-points/guillemets, à partir du marqueur de reformulation « je veux dire ». Pour autant, ce même passage peut se lire comme du « pur » récit à la troisième personne, malgré sa dimension parlée et la prégnance du discours puisque dans La fille qu’on appelle, l’énonciation de récit lorgne constamment sur l’énonciation de discours et que le narrateur a les mêmes tics langagiers que Laura – soit par l’effet d’un mimétisme empathique du narrateur envers Laura aboutissant à une sorte d’homogénéisation des voix ; soit parce que l’auteur veut conférer avec un certain réalisme à son narrateur l’ethos discursif du quidam que l’on peut rencontrer dans la foule.
48Dans d’autres passages, inversement, l’interprétation en termes de discours indirect libre semble compromise, parce que les images rencontrées, le lexique ou les références culturelles convoquées semblent trop sophistiquées pour émaner de la jeune Laura. C’est notamment le cas dans les pages 79 à 81, où il est question du « coryphée antique », des « naïades », et d’« hébétude » et des « dieux ». Pour autant, force est de constater que le point de vue, sinon le discours, est bien celui de Laura puisqu’elle entend les naïades « chanter sur le bord de l’écume » et les dieux « presque rire, la regardant de cet air espiègle que seuls les êtres imaginaires peuvent conserver dans l’air acide […] » (81).
49Ce dialogisme diffus du fait d’une interaction quasi-permanente entre l’énonciation du narrateur et l’énonciation de Laura (et, dans une moindre mesure, celle des autres personnages), crée une perméabilité et des glissements vocaux du type de ceux que l’on rencontre, certes, dans bien des fictions contemporaines38.
50Or, pages134‑135, une nouvelle donnée surgit : Laura, apprend-on, raconte son histoire à la troisième personne :
Et maintenant c’était comme si son histoire n’était pas vraiment la sienne, et même, au fond, c’était pour ça qu’elle était venue là, pour raconter son histoire à la troisième personne […] Et se relisant, elle a senti plus encore que le “je” qui peuplait son histoire s’était transformé en “elle”, presque incapable de faire se rejoindre les deux instances désormais séparées, de sorte qu’elle regardait comme une étrangère cette jeune fille qui se prénommait Laura et qui déclarait sur l’honneur la vérité des faits ci-dessus présentés.
51Le récit que lit le lecteur ne serait-il donc pas celui que Laura a fait ? Passe encore la disproportion entre le récit de Laura qui représente une centaine de pages dans le roman et les « trois pages » (136) qu’occupe finalement l’exemplaire imprimé de son dépôt de plainte… Mais qu’en est-il du « je » utilisé dans son dépôt de plainte ? Est-il l’œuvre des policiers consignant, synthétisant et organisant la déposition de Laura, usant de mots – « fellation », « emprise », « consentement » – absents du discours de la jeune femme dans toutes les pages qui ont précédé pour nommer ce qu’elle-même ne sait pas ou ne parvient pas à nommer ? Et qu’en est-il du récit à la troisième personne que l’on trouve dans bien des passages ? Ce que le lecteur prend pour du récit à la troisième personne ne pourrait-il pas être en réalité du discours direct énoncé par Laura à la troisième personne, pour éviter d’employer la première personne, parce que dépossédée d’elle-même ? C’est ainsi la lecture que l’on pourrait faire des pages 128 à 131, dans lesquelles le « je » qui apparaît sporadiquement pour parler de Laura à la troisième personne serait le moyen employé pour rendre compte du processus d’étrangéisation propre à toute sidération traumatique, un mécanisme qui place littéralement un sujet hors de soi sitôt qu’un comportement le prend par surprise et ne rentre pas du tout dans ses schémas de pensée habituels – ici la goujaterie extrême et cruelle de Le Bars qui insulte, salit et laisse Laura démunie et médusée :
Je ne sais pas ce qu’elle a dit ou pensé à ce moment-là mais la sidération, j’imagine, de le voir se rhabiller si vite, et mesurer toute l’énergie qu’elle avait mise pour venir là, l’argent qu’elle avait dépensé dans son billet de train et le temps nerveux, désormais gaspillé, à voir défiler les plaines de l’Ouest […].
52On le comprend : le lecteur est confronté à une vertigineuse bande de Moëbius quand, rétrospectivement, il s’interroge sur l’identité de la source énonciative dès le début du récit de Laura.
53Ainsi, au terme de ces analyses, le traitement des discours rapportés et le chevauchement des voix doivent être réévalués à l’aune du sujet thématique du roman. De fait, il apparaît particulièrement ingénieux de la part de Viel d’avoir transposé le mécanisme de l’emprise sur le plan métascriptural et énonciatif, et de le donner ainsi à penser sur le plan des territoires énonciatifs : le discours rapporté relève bien en effet d’une question de rapports d’énonciation, de frontières, de tutelle, de domination ou d’émancipation énonciatives. Ce faisant, Viel, en conduisant le lecteur vers un travail herméneutique, lui donne à expérimenter et à vivre de l’intérieur la brume des zones grises, le pousse à reconsidérer les catégories doxiques et les idées reçues pour repenser, sur un plan tant esthétique qu’éthique, les notions de limite et d’emprise.