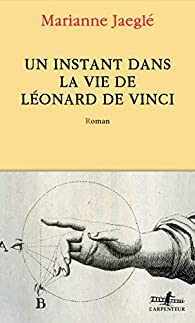Perspectives d’instant : « Un instant de la vie de Léonard de Vinci et autres histoires » de Marianne Jaeglé
Cette communication a été faite dans le cadre du programme Lectures sur le fil, le vendredi 25 mars 2022 à la bibliothèque de l’UFR de langue française de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=FzNbgdfqH3I.
1Marianne Jaeglé est une romancière qui vient de publier, en 2021, dans la collection « L’arpenteur » de chez Gallimard, le recueil de nouvelles Un instant dans la vie de Leonard de Vinci et autres histoires1.
2En 2016, elle s’était fait connaître du grand public par un roman, Vincent qu’on assassine, publié dans cette même collection « L’Arpenteur » chez Gallimard. Derrière un titre choc, qui nous invitait à relire la vie de Van Gogh par la fin, ce sont les deux dernières années du peintre que le récit éclairait, faisant son miel d’une très riche documentation. Ce récit, c’est l’histoire d’un échec : fonder avec Gauguin une maison d’artiste post‑impressionniste dans le sud de la France — à Arles. Mais c’est aussi l’histoire d’une réussite : tout ce qui entoure le peintre (la lumière du sud, les champs de tournesol, le café Raulin, la petite chambre, le docteur Gachet…) alimente, chez Van Gogh, une frénésie créatrice sans limite puisque dans la période il a peint plusieurs centaines de tableaux…
Un instant dans la vie de Léonard de Vinci et autres histoires
3C’est encore de création, selon un point de vue finement ajusté, qu’il s’agit dans cet autre ouvrage que publie Marianne Jaeglé aujourd’hui : les nouvelles Un instant dans la vie de Léonard de Vinci et autres histoires. De création mais aussi d’instants décisifs. Ou plutôt de création au prisme d’instants décisifs : moments où quelque chose bascule soit vers la création, soit, au contraire, vers le silence. Les auteurs de ces drames sont Leonard de Vinci auquel il faut ajouter vingt autres artistes — peintres, cinéastes, romanciers, poètes, musiciens — d’Homère à Picasso et Lee Miller, en passant par Dürer, Romain Gary ou Félix Mendelssohn et bien d’autres. Ces nouvelles couvrent un large empan historique (de l’antiquité au xxie siècle) et une bonne partie de la surface du globe (du Japon à l’Amérique).
4Jouant sur la frontière entre faits et fiction, l’autrice part de détails vrais (qui figurent en annexe de l’ouvrage) et l’intrigue pourrait souvent se résumer en quelques phrases :
C’est l’instant où le maître du haïku Basho renonce à la carrière militaire à laquelle il était promis et écrit son premier haïku.
C’est l’instant où le vieux Verrochio, sur sa mule, revient de Fiesole et retourne à son atelier de Florence, découvrant alors le travail de son apprenti, Leonardo, et devant la merveille qu’a accomplie celui-ci – un ange, dans un coin du tableau de son maître –, doit reconnaitre qu’il est dépassé par son élève. Leonard de Vinci se verra alors confier le département peinture de l’atelier.
C’est Irène Nemirovsky qui choisit, contre l’avis de tous, malgré la menace des Allemands, de rester en zone occupée, proche de Paris et qui achève d’écrire Une suite française – avant d’être arrêtée, comme on l’apprend en annexe.
C’est Joanne K Rowling enfermée dans un compartiment de train entre Manchester et Londres, au milieu de passagers antipathiques et grossiers, et qui transpose en rêve la scène dans un monde de sorciers, livrant son imagination à un scénario qui deviendra celui de Harry Potter. etc.
5Mais tous ces instants ne sont rien quand on les résume. Car alors on rate la saveur douce‑amère de cette plongée dans l’instant, dans l’intime, selon la modalité d’une perspective qui les saisit et nous surprend ; on rate encore tous ces moments d’entre‑deux où le temps séculaire des créateurs rencontre celui de l’œuvre, où les personnages créés habitent l’espace du créateur. Beaux passages où la nouvelle fait vivre l’œuvre dans une pure vibration. On rate enfin les très belles transitions qui font de ces vingt et un instants une véritable fresque sur la création et le temps humains.
6Cet ensemble répond à un art de la nouvelle, qui livre l’écriture à un jeu d’angles de vue ainsi qu’à un parcours cognitif, et qui manifeste une interrogation sur ce qu’est écrire ou créer, réflexion qui habite le livre de notre autrice sur Van Gogh mais aussi son long parcours d’animatrice d’ateliers d’écriture à Paris : d’abord au sein de l’association Elisabeth Bing, ensuite au sein de l’école d’écriture Aleph. Réflexion qui avait donné lieu, en 2014, à un ouvrage, pédagogique, inspiré de l’exemple des écrivains eux‑mêmes : Écrire. De la page blanche à la publication — publié aux éditions Scrinéo. En 4e de couverture figurait cet aveu d’impuissance de Marguerite Duras :
Écrire.
Je ne peux pas.
Personne ne peut.
Il faut le dire : on ne peut pas.
Et on écrit2.
7Que la création soit un processus difficile, qui appelle à procéder par étapes, à surmonter des impossibilités, qui nous laisse toujours insatisfait, c’est aussi ce que nous enseigne Un instant dans la vie de Léonard de Vinci par l’exemple. On peut penser à Colette, enfant, qui voulait être tout sauf écrivain, ou au vieil Homère, qui nous est peint dans l’immense fatigue qui le saisit avant de réciter l’Odyssée. Il revient au récit de donner corps à ces figures de créateurs qui nous accompagnent et de nous faire sentir la contingence de toute création.
Plan d’étude
8Donner corps, c’est d’abord donner un corps, construire un personnage, mettre en récit, faire exister dans l’instant. Pour aborder ce texte dans sa structure et ses jeux de compositions, je voudrais justement partir de ce mot concept : l’instant, qui pourrait être profondément attaché au genre de la nouvelle moderne. Dans un article intitulé « Le contrat énonciatif et la nouvelle brève », Nedret Öztokat la caractérise ainsi :
L’effacement des traits distinctifs propre aux genres est la caractéristique la plus frappante de la nouvelle brève moderne. Les grandes distinctions ne s’imposent plus. Ce qui s’impose c’est le moment dans ce qu’il a de fugitif et d’éphémère. La littérature moderne semble vouloir prendre un essor à partir de cette effervescence de l’instant3.
9Cet instant, justement, Marianne Jaeglé, nous invite à le partager. Le titre fait au lecteur-voyeur la promesse de le faire entrer un instant dans la vie du créateur. Le mot instant pourrait paraître approximatif puisqu’il désigne une durée vraisemblablement plus longue mais par son décalage, il met en avant ses traits propres, qui le différencient précisément de mots voisins tel que moment ou temps : les traits de la fugacité et de la contingence.
10L’exergue qui chapeaute tous les récits opère d’autres déplacements : « Les hommes sont ce qu’est l’instant » déclarait Edmond à l’officier, dans Le Roi Lear, l’invitant à se soumettre aux circonstances. La formule opère un raccourci qui déprend l’homme de toute essence pour le rapporter aux contingences de l’instant.
11Comment Marianne Jaeglé fait‑elle varier les perspectives sur l’instant ? Mon propos sera de rendre compte du jeu des perspectives, en particulier au travers d’une figure clé : celle qui procède d’un raccourci métonymique. Je m’arrêterai sur 3 saisies de l’instant que j’intitulerai Instant 1, Instant 2, Instant 3 :
-
L’Instant 1 est déterminé par niveau de l’histoire racontée, le niveau du personnage
-
L’Instant 2 est déterminé par le niveau de l’œuvre d’art représentée
-
L’Instant 3, c’est l’instant, envisagé à une échelle plus large, celle de l’agenceur de récits, voire celle du lecteur : il est cet instant qui s’ajoute à tous les autres, dans le recueil, jusqu’à peut-être construire une certaine image du temps.
Instant 1- niveau de l’histoire racontée
12L’instant 1 constitue le centre organisateur du récit : l’instant dans la vie d’un artiste que nous promet le sommaire sous la forme d’une liste :
Un instant dans la vie de Matsuo Munefusa, dit Basho
Un instant dans la vie de Mechelangelo Merisi, dit Il Caravaggio
Un instant dans la vie de Théophile Gautier […]
13La contrainte, Marianne Jaeglé sait composer avec. Elle pourrait d’abord peut‑être se formuler ainsi : raconter une journée de la vie d’un créateur au prisme d’un instant disruptif à partir duquel plus rien n’est comme avant. Un instant où tout bascule. Cette contrainte conditionne une « grammaire du récit » selon l’expression de Todorov4, puisqu’on peut repérer une « structure commune » qui relie un nom propre sujet à un ou plusieurs prédicats, représentant des actions. Le nom propre, annoncé d’emblée dans le titre, renvoie à une personnalité connue du lecteur. Quant au prédicat, il se réduit à une action essentielle. Allons même jusqu’à dire que cette action est une intrigue puisque si l’on définit, avec Todorov, l’« intrigue minimale complète », comme le « passage d’un équilibre à un autre5 » (Todorov, p. 96), il y a bien intrigue. Contrairement au nom propre, le prédicat narratif n’est pas attendu, loin de là, il fait l’objet d’un suspens et d’une surprise.
14La narratologie, prenant le conte pour modèle de récit, a fondé sur le renversement le point de bascule d’un équilibre à l’autre :
Un récit idéal commence par une situation stable qu’une force quelconque vient perturber. Il en résulte un état de déséquilibre ; par l’action d’une force dirigée en sens inverse, l’équilibre est rétabli ; le second équilibre est semblable au premier mais les deux ne sont jamais identiques6.
15Le recueil de nouvelles épouse d’abord, pour le transformer ensuite, ce modèle d’intrigue à renversement. La première nouvelle est à ce titre exemplaire. On y dépeint au présent un personnage en mouvement, mouvement dont on ignore s’il est ou non orienté. C’est le jeune Basho qui quitte le monastère, après avoir lu une lettre maternelle, au moment où il aurait dû recevoir une leçon :
Il replie soigneusement la lettre maternelle et la range avec celles qu’il a reçues auparavant. Puis il se lève et sort en faisant glisser la paroi.
« Où vas‑tu Munefusa ? » Un autre moine, qui le voit emprunter l’allée, s’étonne. Munefusa continue sans répondre, quitte la maison du professeur Kingin. Il présentera ses excuses à son camarade pour sa grossièreté, mais pour l’heure il doit tout d’abord faire le calme en lui.
Les mots de la lettre envoyée par sa mère le hantent. Ce qu’on attend de lui, il ne saurait s’y résoudre. Mais désobéir à son devoir le remplit d’une honte qui lui donne envie de mourir. Une angoisse sans nom l’accable qu’il entend affronter dans la solitude. Au nom de quoi décevoir sa famille ? (« Un instant dans la vie de Matsuo Munefusa, dit Basho », p. 13)
16Basho part et le lecteur s’interroge d’autant plus sur sa destination que cette interrogation est relayée, dans une forme de coénonciation, par l’apostrophe que lui adresse un moine : « Où vas-tu Munefusa ? ». Un peu plus loin, celui que sa mère et la société destinent à être guerrier, laisse vagabonder sa pensée au bord du lac :
Et maintenant que son frère est mort, où se trouve sa place dans le monde ? Voilà ce qu’il cherche vainement à comprendre, depuis des semaines et des mois qu’il est venu étudier ici.
À côté de lui, le coassement s’amplifie. Le soir tombe.
Un rayon de soleil oblique illumine encore la mare. Le silence se fait. Et voici que l’une des grenouilles, soudain, détend ses pattes, se propulse vers l’eau et y disparaît absorbée, tandis que le bruit de ses congénères se renforce. Les cercles concentriques liquides se propagent, s’agrandissent, atteignent le jeune moine agenouillé, le traversent. Munefusa demeure immobile, terrassé. En lui, l’onde circule, propageant une félicité stupéfiante. La perfection. C’est elle qui le traverse en ce moment précis.
La perfection du geste du petit animal, perfection de la lumière rasante sur l’eau, sonorité parfaite. « Hosomi », songe-t-il fugitivement. La beauté des choses humbles. L’espace d’un instant, Munefusa se tient dans le temps aboli. Le pin, l’or lumineux, le bruit liquide se fondent harmonieusement et traversent son corps immortel.
Tous ses doutes s’en trouvent balayés, soufflés par le vent de cette éternité brièvement entrevue.
En lui, quelques mots se sont formulés.
Paix du vieil étang
Une grenouille plonge
Dans le bruit de l’eau (Ibid., p. 15‑16)
17Inutile d’insister pour montrer que c’est ici l’instant où tout bascule, où le drame s’inverse. Les formules passives disent assez ce pur instant, pur présent, dont les linguistes savent qu’il échappe au temps, par cette conversion qu’il opère continûment du futur en passé.
18Basho embrasse décidément et définitivement, en cet instant, une carrière de poète : il sera le premier haïdjin (on dit aussi haïkiste). La vérité contenue en germe dans l’instant vient du fait que ce que qui est vécu s’est écrit.
19C’est le Discours Indirect Libre (DIL), modalisation privilégiée du récit, qui accomplit d’abord le glissement du vivre à l’écrire, la plongée dans la conscience d’un personnage. Par le rythme des tours de dislocation, par les répétitions, par les interrogations en DIL, l’on suit les sensations ambivalentes de Basho de la culpabilité informulée (« une angoisse sans nom ») à la plénitude qui se dit en s’écrivant dans trois vers — j’y reviendrai.
20Cette première nouvelle prend une valeur programmatique ; elle configure une matrice narrative et profile l’horizon d’attente du lecteur pour les récits à venir. Ceux‑ci développeront leur propre intrigue au prisme d’un mouvement et d’un regard, tendu vers l’instant. L’isotopie du mouvement, du déplacement va régulièrement structurer les étapes de l’action avec une information distribuée elle aussi par étapes. Lorsque le personnage d’une nouvelle se met en branle, la cause, le but, les circonstances mêmes de son mouvement sont inconnues et ne seront révélés qu’au fil de la lecture, parfois à la toute fin. Par une forme de synecdoque7 narratologique, le personnage est vu de si près que l’on ne voit pas d’abord son contexte. Ce défaut d’information est à proportion de sa présence que les intonations d’une voix, le déroulé du point de vue instituent dans l’épaisseur d’une émotion ambivalente.
21Une fois le modèle établi, tout l’art du récit consistera dans le jeu des variantes.
22Dans l’une des nouvelles, on assiste ainsi au déplacement de Curzio (il s’agit de Malaparte) à Varsovie, entouré de deux SS. Malaparte porte un uniforme de capitaine italien. Et le passage du trio terrifie les passants. Le ton est bien différent de celui de la nouvelle avec Basho. Peu à peu se dévoile le lieu où évolue le personnage et la finalité de son déplacement :
En sa qualité de correspondant de guerre du Corriere della Sena, en tant qu’officier italien et donc d’allié du Reich, Curzio Malaparte a le droit, et même pourrait-on dire le devoir, de tout voir. Certains chercheraient à s’éviter les spectacles trop éprouvants, pas lui.
Le voici donc qui remonte la rue principale du ghetto en compagnie d’un garde noir. Il est venu voir, il est venu jouer son rôle de témoin. Il voit. Les visages hâves, les lèvres décolorées par la faim, les enfants qui mendient un peu de nourriture. Une femme en guenilles, un petit corps sans vie serré contre elle, sur le visage une grimace muette de désespoir dans l’indifférence des passants. Les cadavres nus abandonnés par terre, dans la rue, à même le sol gelé. (« Un instant dans la vie de Curzio Malaparte », p. 82)
23Ces images terribles du ghetto (qui se passent d’autres commentaires) vont alors côtoyer dans une collusion obscène les bribes de conversation et les souvenirs gustatifs du dîner donné la veille avec le gouverneur général de Pologne et celui de Varsovie (il s’agit d’une analepse, d’un flash back) :
« Pourquoi n’irais‑je pas dans le ghetto ? » demande Malaparte. La terrine de lièvre est somptueuse : grasse, parfumée, garnie de clous de girofle, fondante.
« C’est si triste ! assure Frau Fischer, avec une petite grimace.
— Qu’est-ce qu’il y a de triste dans le ghetto ? » demande‑t‑il encore. Il n’ignore pas ce qu’il risque d’y trouver : on est en 1942. Depuis deux ans, en tant que correspondant de guerre, il parcourt le front à la suite des armées allemandes. Il est allé en Ukraine, en Roumanie.
En posant la question à Frau Fischer, il veut seulement entendre sa réponse à elle.
Frau Fischer soupire, hésitante ; c’est une jeune épouse totalement dévouée à la carrière de son conjoint. « Eh bien. ». Elle jette un petit coup d’œil latéral à son mari. « C’est si sale. »
Malaparte opine. Évidemment, les Juifs sont sales. Ils sont même tout à fait répugnants, c’est certain. (Ibid., p. 83‑84)
24Les phrases « Malaparte opine », « les juifs sont sales », « ils sont même tout à fait répugnants, c’est certain » nous introduisent par le DIL, dans la pensée de Malaparte : de manière complexe, le point de vue de Curzio est médiatisé par celui de Frau Fischer, ce qui favorise bien sûr un rendu ironique mais cela pointe aussi, sans le dire, une situation pour le moins ambivalente : même si Curzio feint l’acquiescement, n’éprouve‑t‑il pas le sentiment d’une compromission en évoluant au milieu de cette société nazie ? Ne rapporte‑t‑il pas du reste, dans ses articles, les prouesses des troupes de l’axe ? L’analepse, les discours ou pensées rapportés infèrent le malaise intérieur du personnage témoin : « Malaparte » (du mauvais côté) dont il est dit que son pseudonyme, « lui va comme un gant ». Par ailleurs, par rapport à l’économie narrative des nouvelles du recueil, où faut‑il arrêter le curseur de l’instant ? Ce dernier semble se déplacer au fil de la nouvelle. L’instant décisif, d’abord, c’est la terrible « visite » du ghetto, mise en perspective avec la conversation de la veille, mais, à la toute fin de la nouvelle, le curseur se déplace peut‑être vers un autre moment :
À cette heure, seul avec lui‑même, il n’est plus le correspondant du Corriere, ni l’homme du monde, ni le capitaine italien, allié objectif des puissants du Reich. Remonté des Enfers pour quelques heures, seul, sans plus avoir besoin de feindre, il relate les différents cercles traversés ; raconte ceux qui sont morts, ceux qui vont mourir, ceux qui voient mourir leurs bien‑aimés, ceux qui en bénéficient, toutes les strates de ce rêve morbide dont l’Europe ne se réveille pas.
Tout cela qui brûle en lui continuellement, comme le feu éternel décrit par Dante, il l’écrit et rassemblera tout sous un nom évoquant la faillite, le chaos, la destruction ; un mot allemand, d’origine juive, un mot pour dire cassé, foutu, massacré, détruit à jamais, irréparable. Kaputt.
Il est Malaparte, né du mauvais côté. À lui le rôle impossible de celui qui témoignera. (Ibid., p. 89‑90)
25L’instant décisif, in fine, c’est cette scène de solitude qui fait pendant aux scènes publiques : c’est ce supplément de temps. Le retardement du nœud narratif accompagne la temporalité de l’histoire dans un jeu de miroir avec le temps vécu qui donne à vivre avant d’écrire. Dans le mouvement de résistance qui oppose l’écriture aux forces du mal, le style s’enfle alors dans les deux derniers paragraphes d’un souffle presque oratoire. La répétition d’appositions (« seul »), la métaphore filée de l’enfer, la tension entre la glose et le nom Kaputt qu’elle fait attendre, puis, dans un chiasme, celle entre le nom Malaparte et son commentaire, tout cela reproduit, à l’échelle de la phrase, ce qui s’opère dans les dimensions du texte : une redynamisation des signes, leur pénétration de l’intérieur par la saisie d’une ambivalence fondamentale : celle qu’il y a à témoigner du chaos. L’ambivalence qui a traversé d’un bout à l’autre la nouvelle est pour ainsi dire cristallisée dans les deux mots de la fin : Kaputt, Malaparte.
26L’instant est multiface. Il témoigne d’un renversement dramatique, d’un dédoublement ou encore du déplacement imprévu du point de vue focalisateur. Marianne Jaeglé joue à tromper les attentes du lecteur. Tandis qu’on assiste à la fonte de la fresque peinte par Leonard de Vinci au Palazzio Vechio de Florence, se révèle tardivement, comme tapi en secret, le point de vue focalisateur du récit : celui du jeune Michel Ange, qui peignait justement le mur d’en face. Le lecteur pensait s’introduire dans la vie de Léonard de Vinci et voilà qu’il est plongé dans celle du jeune rival jaloux.
27Ainsi, par les manipulations du point de vue qui font se croiser les histoires, par le déplacement du curseur de l’instant en fonction des informations dont dispose le lecteur, ou encore par la mise en vedette, tardive, de personnages de second plan, l’instant du personnage ne se départ jamais d’une perspective, intérieure ou extérieure, qui affiche les ressorts de la fabrique du récit.
Instant 2 : instant de l’histoire de l’œuvre d’art : l’ekphrasis
28Venons‑en à présent à l’instant de niveau 2, celui de l’œuvre d’art. C’est le temps qui émane des créations. Or, de créations, il est beaucoup question dans ce recueil : qu’il s’agisse du haïku de Basho sur quoi s’ouvre le livre, de l’écriture de Harry Potter par Joanne K Rowling, du Saint Mathieu écrivant guidé par l’ange du Caravage,… et j’en passe. Ce sont autant d’œuvres que les nouvelles tentent de … dire ? raconter ? capter ? Ici le verbe me manque car l’entreprise de Marianne Jaeglé, en la matière, est suffisamment originale pour que l’on veuille bien s’arrêter à la caractériser.
29Pour commencer, on peut sans doute s’entendre sur un terme, celui d’ekphrasis qui désigne la relation d’un texte avec l’œuvre d’art dont il rend compte. Les nouvelles, pour beaucoup, sont des ekphrasis, comme l’étaient de nombreux passages de Vincent qu’on assassine, le roman de 2016.
30Partant d’une aporie — la difficulté qu’il y a à décrire ou expliquer une œuvre d’art, car alors on la réduit à un objet que l’on peut s’approprier —, Georges Didi‑Huberman a intitulé, en 2014, un de ses ouvrages Essayer voir8 : titre qui souligne l’inachèvement de toute ekphrasis authentique. « Essayer voir », c’est essayer une forme nouvelle qui soit capable moins peut être de représentation ou de description que — je cite ici Ginette Michaud — de « performativité, d’affect et d’intensification, de recréation et d’événement d’écriture9 ».
31Dans son recueil de nouvelles, Marianne Jaeglé essaye voir. Plutôt que de représenter, même partiellement l’œuvre, elle tente une rencontre.
32Revenons sur le titre Un instant dans la vie de Leonard de Vinci : la préposition dans y est employée en lieu et place de la préposition de, plus attendue. Là où de aurait plus abstraitement exprimé une partition temporelle, dans inclut, suggère un emboîtement heureux, l’entrée d’une vie dans une autre, d’un instant dans l’autre. L’œuvre d’art, plutôt que d’être peinte, sera donc vécue.
33La première nouvelle que nous avons citée assez longuement tout à l’heure en témoignait déjà. Le haïku de Basho, cet objet culturel qui a traversé le temps, y jaillissait comme une parole vivante et intérieure :
L’espace d’un instant, Munefusa se tient dans le temps aboli. Le pin, l’or lumineux, le bruit liquide se fondent harmonieusement et traversent son corps immortel.
Tous ses doutes s’en trouvent balayés, soufflés par le vent de cette éternité brièvement entrevue.
En lui, quelques mots se sont formulés.
Paix du vieil étang
Une grenouille plonge
Dans le bruit de l’eau (« Un instant dans la vie de Matsuo Munefusa, dit Basho », p. 16‑17)
34Dans son cours sur La préparation du roman, Roland Barthes voit dans le haïku « un acte minimal d’énonciation, une forme ultrabrève, une sorte d’atome de phrase qui note ». L’étrange familiarité de cette forme résiderait dans le fait que « le haïku est la conjonction d’une “vérité” (non conceptuelle, mais vérité existentielle, de l’Instant) d’une part, et d’autre part, d’une forme10 » : « L’espace d’un instant, Munefusa se tient dans le temps aboli ».
35Cet « espace d’un instant », c’est le temps vécu et le temps dit. On trouve là, dépourvue d’artifice, une figure qui sera à l’œuvre dans tout le recueil : l’identification métaphorique de l’Instant 2 (instant représenté dans l’œuvre d’art) avec l’instant 1 (instant de la vie de Basho où tout bascule). Le haïku se mêle au cadre d’un contexte qui le fait advenir comme en témoignent les filières lexicales qui trament une chaîne référentielle : l’eau, le son, la grenouille… Quant au récit, il unifie les deux trames du narrant et du narré par une mention continue de l’instant que disent l’adverbe fugitivement et l’emploi de la voix pronominale passive (« tous ses doutes s’en trouvent balayés, soufflés », « quelques mots se sont formulés ») qui, comme on l’a déjà dit, resserre au maximum cet « espace d’un instant », faisant coïncider la borne initiale de l’action et sa borne finale, le vivre et l’écrire dans un seul point T qui, paradoxalement, flirte avec l’éternité. Contrairement à la durée, à la période, à tout ce qui pourrait organiser le temps (jour, semaine, mois, année), « l’instant » se soustrait au temps tout en s’y rapportant. C’est du reste peut‑être d’avoir su s’abandonner à lui que Basho a pu quitter le temps séculaire (et la carrière militaire pour laquelle il était né) pour s’adonner à l’Instant singulier de la création. Articulant donc instant et éternité, humilité et brièveté mais aussi poésie et vérité, le haïku, ainsi vécu, participe d’une révélation.
36L’insertion du temps de l’œuvre dans le temps qui l’a vue naître, donne à la nouvelle avec Joanne K Rowling une dimension fantastique. Dans un train, la jeune femme se fait jauger négativement par les passagers qui l’entourent alors qu’elle s’installe puis essaie de croquer une pomme. Soudain une passagère antipathique prend le vent qui s’engouffre par la fenêtre et se remplit d’air :
Désormais, Dieu merci, tout le monde l’ignore. De l’autre côté de la vitre, le vent de novembre souffle. Manchester s’éloigne. Le vent s’infiltre même à l’intérieur du wagon ; à travers la fenêtre mal fermée, elle le sent. Bercée par le mouvement régulier du train, elle ferme les yeux et se laisse glisser. Emportée par le vent. Gonflée de vent. Aérophagie. Sous l’effet de la brise venue de l’extérieur, la grosse femme assise à sa gauche se met peu à peu à enfler, enfler encore, bouffir comme une baudruche puis décolle du sol, si bien que son mari et son fils se voient contraints de l’attraper chacun par un pied dans l’étroit compartiment pour l’empêcher de s’envoler, au prix d’efforts comiques. Cette vision est si réconfortante que Joanne ne peut retenir un léger sourire. (« Un instant dans la vie de J.K. Rowling », p. 71)
37Comme lecteur, on saisit la création dans sa genèse, littéralement dans son souffle premier, mi‑réelle mi‑imaginaire. Nous est ici restituée, dans une phrase longue, la force hallucinatoire du premier jet d’écriture qui n’est dénommé « vision » qu’après coup. Personnes et personnages, réel et imaginaire se fondent. « Le monde des Moldus et celui des sorciers, son centre, l’école de Poudlard, et sa périphérie, [etc.] » tout cela vient développer le réel vécu, apparaissant à Joanne dans ce que Marianne Jaeglé appellera, en annexe, « un moment de saisissement créateur » (p. 192) qui n’est pas sans rapport avec la manière dont notre recueil de nouvelles rêve ses personnages.
38Cette confusion des plans référentiel et fictif produit un burlesque savoureux dans certaines nouvelles. Car il se fonde sur un raccourci métonymique très caractéristique. Les proustiens se souviendront sans doute du passage où le Duc de Guermantes, en train de déguster des asperges, manifeste son mépris à l’égard des asperges d’Elstir (quelques indices signalent au lecteur qu’il est fait allusion au tableau d’Édouard Manet représentant une botte d’asperges) :
Je sais bien que ce sont de simples pochades, mais je ne trouve pas que ce soit assez travaillé. Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une botte d’asperges. Elles sont même restées ici quelques jours. Il n’y avait que cela dans le tableau, une botte d’asperges précisément semblables à celles que vous êtes en train d’avaler. Mais moi je me suis refusé à avaler les asperges de M. Elstir. Il en demandait trois cents francs. Trois cents francs une botte d’asperges ! Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeurs11 !
39Ce mot d’esprit, qui exploite une anecdote, tire son ressort comique d’une « ekphrasis amphibologique », selon l’expression de Joana Masó12, puisqu’elle repose sur « une double langue, à la fois représentationnelle‑picturale et référentielle‑vécue13 ». Le contexte du repas fait se côtoyer d’abord, jusqu’à les confondre ensuite, les asperges servies à la table du duc et le tableau représentant les asperges … Basin peine davantage à « avaler » les secondes que les premières, compte tenu de leur prix… Le bon mot « Je me suis refusé à avaler les asperges de M. Elstir » est certes fondé sur le double sens (propre et figuré) de « avaler » mais aussi sur une synecdoque : « les asperges » étant mises ici pour « le tableau représentant des asperges ».
40Ce raccourci métonymique (on emploie ici métonymique au sens large), qui confond deux plans de réalité en un seul, est à l’œuvre dans la nouvelle mettant en scène, sous le regard du petit Beppo, Michelangelo Merisi, dit Il Caravaggio. Le peintre est rentré furieux d’un entretien avec les frères Contarelli qui lui ont refusé sa toile. Il observe son tableau :
Le peintre s’est accroupi devant son tableau, qu’il extrait précautionneusement du linge dans lequel il était enveloppé. Il examine sa toile. Le saint est représenté sous les traits d’un homme âgé, assis de trois quarts, une jambe croisée sur l’autre, dans une pose familière. Debout à côté de lui, une jeune femme souriante, nue sous des voiles transparents, guide la main avec laquelle le saint s’apprête à écrire. Saint Matthieu rédigeant l’Évangile, aidé par l’ange. Une composition originale, neuve, audacieuse. (« Un instant dans la vie de Michelangelo Merisi, dit Il Caravaggio », p. 20)
41Ce premier paragraphe décrit la toile avec le regard d’un peintre qui semble voir du point de vue de son commanditaire. Puis, d’intersubjectif, le regard pénètre la toile, devient plus personnel et subjectif :
Le vieux Giuseppe a l’air humble qui sied à un évangéliste ; quant à cette salope de Guglielmina, son visage en amande, ses cheveux lâchés, ses formes charmantes font merveille. Non, les modèles sont bien… (Ibid., p. 20)
42Ici par un glissement métonymique, le saint et l’ange font surgir leurs modèles : le modèle se confond avec le représenté, ce qui produit un effet d’autant plus burlesque que l’ange est peint sous les traits d’une femme presque aguicheuse, qui plus est désignée par une insulte. Continuons :
Mais retoquer son tableau, l’un des meilleurs qu’il ait jamais peints, assurément… Et sous quel prétexte ? La vulgarité ! « Stronzi, coglioni », grince‑t‑il entre ses dents. C’est vrai que saint Matthieu a les pieds sales ! Et alors ? N’est‑ce pas un effet de l’art du peintre que de représenter des pieds ayant vraiment cheminé ? Ne savent‑ils pas, ces hypocrites, qu’il y a de la poussière en Palestine, et que le Christ lui‑même devait se laver les pieds ? (Ibid., p. 21)
43« C’est vrai que saint Matthieu a les pieds sales » : la formule est ambivalente et elle touche au cœur d’un débat esthétique. Le « Saint Matthieu du Caravage », référent du Saint Matthieu représenté est désigné immédiatement par le nom du saint comme si c’était ce dernier qui avait les pieds sales et non la figure peinte. Le glissement métonymique opère un raccourci qui est au cœur de tout processus de figuration et de fictionnalisation. Le peintre conjugue avec des types plus larges (le type des personnages saints tels qu’on a coutume de se les représenter, peu « humains » il est vrai) et ce que lui‑même a figuré. Toutes ces figures de saint et d’ange, se superposant dans le regard du peintre, font exister l’œuvre comme possible, à venir. Du reste, passant de la colère à l’orgueil, puis de l’orgueil au doute, celui qui « sait saisir l’instant », Michelangelo Merisi (dit Le Caravage) va essayer voir à nouveau. Il essaye voir un nouveau Saint Mathieu et l’ange, faisant asseoir Giuseppe et interpellant par surprise Beppo afin qu’il monte sur une armoire branlante pour figurer l’ange au‑dessus du saint : « Je te peindrai avec des ailes, elles te tiendront en l’air », lui dit‑il dans un savoureux raccourci. Puis dans une vision épiphanique, Le Caravage voit saint Mathieu et l’ange non pas dans un tableau statique mais dans l’instant d’un échange :
Michelangelo inspire profondément. Devant lui, ce ne sont plus le vieux Giuseppe et Beppo, qui menace de se casser la figure du haut de son armoire branlante. Devant ses yeux, le saint se tourne vers l’ange, qui chuchote à son oreille.
« Aide‑moi », semble murmurer Matthieu, son front plissé par l’effort, l’œil brillant. Tout son être est tendu vers le message qu’il s’efforce d’entendre. « Aide‑moi à accomplir ce que je dois. » Au‑dessus de lui, l’ange entrouvre les lèvres, c’est à peine s’il murmure. (Ibid., p. 26)
44On reconnaît ici l’instant 2, instant pur, fugitif, contingent lui aussi, de l’œuvre, qui se fond dans l’instant présent. On l’aura compris, les ekphrasis sont fondées sur des hypotyposes. Ainsi, l’œuvre saisie dans son défigement, saisie comme possible est rendue vivante dans l’écriture. Ici la soudaine désignation du saint par son prénom, « Matthieu », produit un effet de proximité, de présentification. Les modalisations qui portent sur les verbes (« qu’il s’efforce d’entendre », « à peine s’il murmure ») font envisager cet échange dans sa fragilité vivante. Cet instant, le peintre le préfigure, le voit, le crée dans l’instant même de notre lecture.
Instant 3 : instant de l’agenceur de récits
45Tempus fugit… Venons‑en à l’instant 3, autrement dit à l’instant 1 et 2 mais considéré, à une échelle plus large, celle de l’auteur‑agenceur de récit ou celle du lecteur. En saisissant le geste artistique dans ses prémisses, ses ébauches, dans ses possibilités et impossibilités, Marianne Jaegle en vient à démultiplier indéfiniment les plans de référence. Cet emboîtement vertical s’ajoute à une collection horizontale d’histoires que soulignent les transitions.
46Beaucoup de transitions concourent en effet à relier les nouvelles pour tirer, à partir d’elles, des enseignements car, selon le fameux topos cicéronien, historia magistra vitae, l’histoire est maîtresse de vie.
47Il y a beaucoup d’anges par exemple. L’ange de Leonardo de la 4e nouvelle, qui fait écho à celui du Caravage de la 2nde — tous deux s’opposant à l’ange noir qui accompagne Malaparte dans sa traversée du ghetto.
48Il y a aussi la guerre qui rôde dans le ghetto comme dans les nouvelles (consécutives) où évoluent respectivement Romain Gary, Irène Némirovsky et Lee Miller, photographiée dans sa baignoire aux côtés d’un cliché représentant Hitler.
49Et puis, aussi, renversant complètement le procédé fondateur de la fabrique du récit, il y a tous les fils négatifs, ces instants où tout aurait pu basculer mais où rien ne bascule. Les rendez‑vous manqués avec l’histoire — petite ou grande. C’est Leonardo assistant à la fonte de son chef d’œuvre au palazzio Vechio, c’est Albrecht Dürer, à cheval, aux Pays‑Bas, harassé par le soleil et la fatigue, qui cherche, pour la peindre, une baleine qu’il ne trouvera jamais. Mais c’est encore toute cette lignée de femmes, de Fanny Mendelssohn à Camille Claudel, dont le nom a été si bien éclipsé par l’histoire qu’elles figurent symptomatiquement, au sein du recueil, dans la vie de leur entourage masculin : Paul pour Camille Claudel, Felix pour Fanny Mendelssohn. Décidément les noms ont de l’importance, et les métonymies aussi. Fanny Mendelssohn seconda beaucoup son frère dans ses compositions et écrivit elle‑même des lieder. Dans sa fabrique à histoires, Marianne Jaegle lui donne voix, comme dans ce passage où Fanny ose enfin poser à son frère la question qui lui brûle les lèvres :
« Penses‑tu que je pourrais maintenant faire éditer mes œuvres ? »
Félix s’est immobilisé dans la contemplation d’un dessin de morse réalisé par Albrecht Dürer. Quelle précision ! Quel fini dans le museau de l’animal… Leur père adorait ce dessin. Il citait parfois le peintre : « Je ne sais pas ce qu’est la beauté. L’art est dans la nature ; qui sait l’en extraire la possède. » Leur père. Comme il lui manque…
« Pourquoi tiens‑tu tellement à publier ? demande Felix avec douceur. Tu as les dimanches musicaux… » (« Un instant dans la vie de Felix Mendelssohn, p. 52‑53)
50En cet instant raté, le récit adopte un tour résolument ironique par les silences et distractions du personnage de Felix qui n’aura pas le courage d’entendre la demande de sa sœur et qui publiera certains lieder de celle‑ci sous son nom à lui. Dans le récit, chaque mot, chaque phrase, chaque notation met en évidence une ironie narrative à proportion de l’ironie tragique d’un destin non advenu.
51Prédicats positifs et prédicats négatifs se combinent donc dans un recueil qui nous invite, dès le départ, à réfléchir sur l’instant et sa mise en récit.
52Revenons aux deux citations mises en exergue au début de l’ouvrage. J’ai cité tout à l’heure Shakespeare :
Les hommes sont ce qu’est l’instant.
William shakespeare
Le Roi Lear
53La citation est suivie d’une autre épigraphe, qui emprunte cette fois-ci à Margaret Atwood :
À la fin, nous deviendrons tous des histoires.
margaret atwood
Moral Disorder
54Ces deux énoncés, qui partagent une même visée généralisante, se fondent sur un canevas syntaxique et rhétorique semblable : une structure attributive, un raccourci métonymique. Les hommes sont d’abord réduits aux propriétés de « ce qu’est l’instant » dans les particularités d’une circonstance déterminée mais aussi dans ce qu’il a d’essentiel. Quant au nous de la seconde citation (« At the end, we’ll all become stories »), il désigne « une vie » (la nôtre aussi) vouée à être réduite et déformée dans « des histoires ». Le pluriel indéfini tire l’histoire du côté du récit, et même du récit fictif tant le mot histoires, au pluriel, est chargé de subjectivité. En lui résonne même un trait /péjoratif/, celui de la /fausseté/ tel qu’actualisé dans les locutions raconter des histoires, faire des histoires, c’est des histoires. Les histoires ne sont pas forcément à prendre au sérieux. Et c’est tant mieux. Marianne Jaeglé assume la part de la fiction, dès qu’elle le peut, dans les annexes. Par exemple,
[…] alors que nous avons tendance à nous […] représenter [Homère] en auteur des origines, en père de la littérature, pour ainsi dire, les historiens s’accordent à considérer que l’Iliade et l’Odyssée sont sans doute une sorte de compilation de récits antérieurs.
De là à imaginer un sentiment d’imposture chez l’aède antique, il n’y avait qu’un pas. Je l’ai franchi sans hésiter. (« Quelques informations au sujet de ceux dont il est question dans ces nouvelles », p. 196)
55La formule de Margaret Atwood, « À la fin, nous deviendrons tous des histoires », est ambiguë. La locution à la fin est elliptique de son complément. Or ici deux compléments sont possibles : à la fin de la vie bien sûr, mais aussi à la fin de l’ouvrage.
56Justement rapportons‑nous, pour conclure, à cette fin d’ouvrage. La vingt et unième nouvelle fait apparaître pour la troisième fois Leonardo da Vinci (cette fois, il aura droit aux honneurs du titre). On l’avait découvert, tout jeune, au début du livre ; il était l’homme du Kaïros ; son petit ange dessiné dans un coin du tableau de son maître avait changé sa destinée. Il est ici vieux, pauvre, abandonné de ses protecteurs italiens. Qu’en est‑il de l’instant ? Voyons voir :
« Voulez‑vous qu’on s’arrête ici, ser Leonardo ? » demande à nouveau Melzi, montrant du doigt cette fois un hameau en lisière de forêt.
Leonardo lève la tête vers le ciel qui s’assombrit.
Ses jambes le font souffrir. Depuis un moment, les mules ont ralenti le pas et soufflent bruyamment, signe de leur fatigue. Mais il reste peut-être encore une heure de jour et le temps, il le sait aujourd’hui, est ce qui existe de plus précieux. Il aimerait se reposer mais il serait fou de ne pas mettre à profit ce dernier instant de lumière. « Avançons encore un peu », décide‑t‑il. (« Un instant dans la vie de Leonardo da Vinci » ?, p. 186)
57On l’a déjà dit. L’intrigue est, depuis le début, structurée autour du mouvement. Un personnage se met en branle, qu’il sorte de chez lui (comme Basho) ou y retourne en mule (Verocchio) ou à pied (Mendelssohn), qu’il monte les escaliers en courant porté par un fol enthousiasme (c’est Théophile Gautier le soir de la première représentation de Gisèle) ou qu’il descende péniblement les étages (comme Primo Levi dont on sait qu’il finira par se suicider), qu’il se déplace en train d’une ville à l’autre (comme Joane K Rowling), traverse la ville (on a évoqué la traversée glaçante du ghetto de Varsovie par Malaparte entouré de dignitaires nazis) ou simplement qu’il s’agite dans ses draps (Chaplin à l’instant de sa mort). Sans doute n’est‑il pas nécessaire de souligner ce que le récit, et en particulier la dernière nouvelle, métaphorise sans le dire : que la vie est un long chemin, qu’il faut continuer c’est‑à‑dire « avanc[er] encore un peu » et peut-être trouver, au bout de ce moment, l’instant décisif. Tandis que s’esquisse la possibilité d’une œuvre dans cette « heure du jour » où la « lumière » est belle, c’est la vie comme mouvement et imperfection, la vie à la tombée de la nuit qui clôt le recueil. « À la fin », au fil de notre lecture, par la fenêtre du mouvement, l’instant nous apparaît pour lui-même, sur toutes ses coutures, finalisé ou erratique, magistral, catastrophique ou ordinaire.