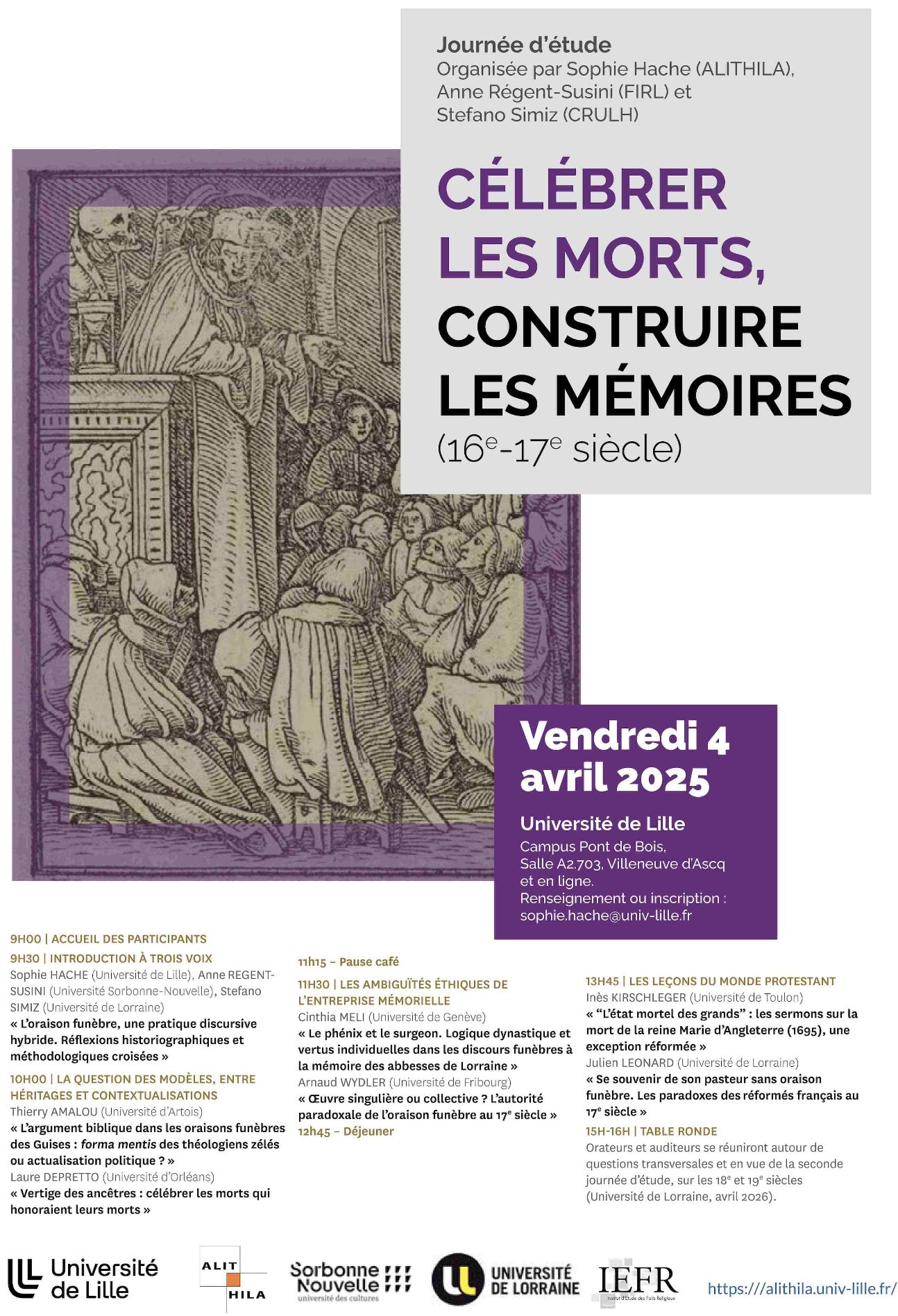
Célébrer les morts, construire les mémoires (16e -17e siècle)
Université de Lille (site Pont-de-bois), vendredi 4 avril 2025
—
La première modernité constitue un « âge d’or » de l’oraison funèbre, discours problématique car hybride, aux enjeux conjointement religieux, sociaux, culturels, voire politiques – mais ce genre existe bien en-deçà, et bien au-delà de cette période. Or l’oraison funèbre n’est pas seulement une performance orale : elle est aussi souvent un texte, qui circule selon des modalités diverses : manuscrite ou imprimée, publication séparée, intégration dans un recueil factice ou dans un recueil imprimé.
Nous aimerions nous interroger sur les formes et les enjeux mémoriels de ce genre si particulier, apparemment convenu, et dont le caractère monologique, voire monolithique est pourtant trompeur. À quelles catégories d’auditeurs, de lecteurs, les oraisons funèbres s’adressent-elles ? Dans quelle mesure la publication des discours témoigne-t-elle d’une transmission contrôlée de la mémoire ? Celle d’un personnage dont on affirme le caractère illustre, dont certaines facettes biographiques sont soulignées, voire reconstruites ? Celle d’une famille, d’une lignée, d’une communauté qui fait corps autour du mort ?
Alors que l’on a souvent valorisé jusqu’à présent des styles d’auteur, faisant de l’oraison funèbre un texte littéraire dont Bossuet est sans doute le plus célèbre représentant, on pourra ainsi s’interroger sur la dimension collective et plurielle de ce discours, du côté de sa production (l’orateur travaille souvent à partir d’une documentation qu’on lui fournit ou qu’il se constitue) comme du côté de sa réception (que nous disent les témoignages d’époque, ou encore l’histoire du livre, des usages collectifs de ces discours ?). Il s’agira ainsi de saisir les évolutions d’un genre en prise directe avec la société, que l’on ne saurait figer dans un canon de la fin du xviie siècle, et qui témoigne aussi d’une certaine forme de construction, de sélection, de promotion de la mémoire. Comment comprendre par exemple l’élargissement relatif mais bien réel au fil du temps des statuts sociaux des défunts auxquels sont consacrés des oraisons funèbres ? Et comment analyser la part fluctuante qu’occupent les figures féminines dans ces discours ? Ou encore, comment la leçon morale qu’impose le cadre religieux s’articule-t-elle avec les multiples enjeux pragmatiques du discours ?
Menée par un groupe de spécialistes issus de disciplines différentes, et s’appuyant sur des sources variées, la démarche, qui assume une ambition programmatique, entend cerner un objet religieux mal identifié et percevoir ses évolutions dans la durée, de la Renaissance jusqu’au milieu du xixe siècle. Une première journée d’étude se tiendra à l’Université de Lille, le vendredi 4 avril 2025, et sera consacrée aux xvie et xviie siècles, pendant lesquels le genre de l’oraison funèbre s’élabore et s’affirme en tant que tel. Elle sera suivie d’une deuxième journée à l’Université de Lorraine, au printemps 2026 ; nous nous pencherons alors sur la période allant du xviiie siècle aux années 1850, qui voit l’oraison funèbre se transformer, chargée de différentes missions politiques et sociales tout autant que religieuses.
—
Programme
Matinée
9h – Accueil
9h30 – Introduction à trois voix
Sophie HACHE (Université de Lille), Anne RÉGENT-SUSINI (Université Sorbonne-Nouvelle), Stefano SIMIZ (Université de Lorraine) : « L'oraison funèbre, une pratique discursive hybride. Réflexions historiographiques et méthodologiques croisées »
10h – La question des modèles, entre héritages et contextualisations
Thierry AMALOU (Université d’Artois), « L’argument biblique dans les oraisons funèbres des Guises : forma mentis des théologiens zélés ou actualisation politique ? »
Laure DEPRETTO (Université d’Orléans) : « Vertige des ancêtres : célébrer les morts qui honoraient leurs morts »
Pause
11h30 – Les ambiguïtés éthiques de l’entreprise mémorielle
Cinthia MÉLI (Université de Genève), « Le phénix et le surgeon. Logique dynastique et vertus individuelles dans les discours funèbres à la mémoire des abbesses de Lorraine »
Arnaud WYDLER (Université de Fribourg), « Œuvre singulière ou collective ? L’autorité paradoxale de l’oraison funèbre au 17e siècle »
12h45 – Déjeuner
Après-midi
13h45 – Les leçons du monde protestant
Inès KIRSCHLEGER (Université de Toulon) : « “L’état mortel des grands” : les sermons sur la mort de la reine Marie d’Angleterre (1695), une exception réformée »
Julien LÉONARD (Université de Lorraine) : « Se souvenir de son pasteur sans oraison funèbre. Les paradoxes des réformés français au 17e siècle »
15h-16h – Table ronde
Une table ronde réunira orateurs et auditeurs autour de quelques questions transversales, et permettra notamment de préciser les objectifs de la seconde journée d’étude sur les 18e et 19e siècles (Université de Lorraine, avril 2026).