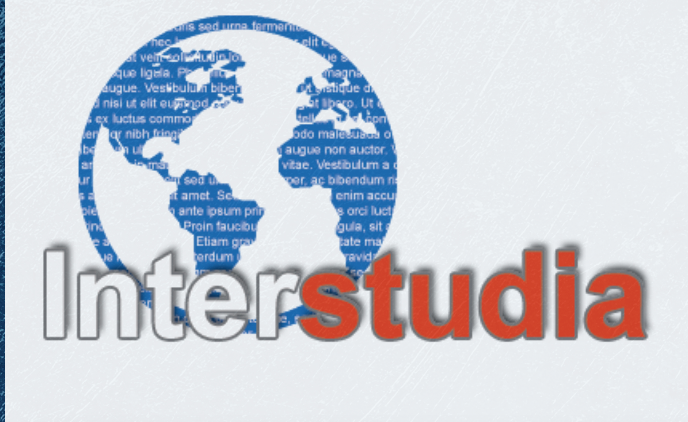
Interstudia, n° 34 : "Miroirs culturels du passé et du présent : mythes et technologies numériques modernes dans le discours culturel contemporain"
Miroirs culturels du passé et du présent : mythes et technologies numériques modernes dans le discours culturel contemporain
L’interconnexion du passé et du présent a toujours été inhérente à l’effort humain visant à percevoir, comprendre et interpréter le monde intérieur et extérieur. Une connaissance approfondie du passé et du présent peut également offrir des principes solides pour une prédiction de l’avenir et des moyens par lesquels nous pouvons l’accueillir. La mythologie représente une manière significative par laquelle le passé a toujours offert des instruments pour la création du sens. En tant que partie intégrante de la culture humaine, la mythologie a servi de véhicule pour transmettre des valeurs, expliquant l'inexpliqué et fournissant un cadre narratif pour comprendre le monde. Les Grecs de l’Antiquité avaient leur panthéon de dieux et de héros, les Nordiques avaient leurs sagas et d’innombrables autres cultures ont créé des mythes pour donner un sens à leur existence. La littérature à travers les âges a fait un usage intensif des références mythologiques anciennes pour éclairer et enrichir les images, les personnages et les actions.
L’internet et les médias sociaux servent désormais d’agora contemporaine où se déroule le discours culturel. Les mèmes, les tendances virales et les récits en ligne deviennent les mythes de l’ère numérique, diffusant des valeurs, de l’humour et des critiques sociétales. Ainsi, le discours culturel sert de miroir, reflétant nos peurs, aspirations et incertitudes collectives. Il joue un rôle crucial dans la détermination des récits qui perdurent et s’enracinent dans la conscience sociale.
Les crises de toutes sortes qui ont frappé la scène mondiale ces derniers temps ont démontré l’importance indéniable de la construction de la différence dans le discours culturel, d’autant plus que tout est désormais interconnecté. Malgré leurs effets regrettables, les crises peuvent être un moteur nécessaire du développement, étant donné que « les gens n’acceptent le changement que lorsqu’ils sont confrontés à une nécessité, et ne reconnaissent la nécessité que lorsqu’une crise les menace » (Lehne, 2022). En tant que phénomènes affectant les personnes à l’échelle mondiale ou locale, les crises créent des expériences qui peuvent être transférées et partagées.
Les moyens de communication dont nous disposons aujourd’hui rendent cet échange d’informations très dynamique et transformateur. Les médias peuvent en effet être définis comme une voie d'information ou comme un quatrième pouvoir doté du pouvoir de créer, de modifier ou d'anéantir les réalités (Fairclough, 1992 ; van Dijk, 2006 ; Chomsky, 2002). La plupart de ce que nous savons nous est parvenu via les médias (sociaux), ce qui nous rend vulnérables aux tentatives potentielles de désinformation et de propagande. Cependant, notre présence sur les réseaux sociaux nous permet également de produire, de négocier et d’améliorer des discours à travers lesquels des changements de perspective peuvent conduire à des changements significatifs dans l’administration, la politique, la diplomatie et la société en général.
Les études retenues dans le présent numéro prouvent donc que l’interconnexion entre passé et présent, mythes, intelligence artificielle, technologie numérique et discours culturel constitue un dialogue aux multiples facettes qui façonne la manière dont nous percevons et naviguons dans les complexités de notre monde contemporain. En reconnaissant l'influence durable des mythes anciens, en comprenant les dimensions mythiques de l'IA et de la technologie numérique et en nous engageant de manière critique dans le discours culturel, nous pouvons mieux comprendre le réseau complexe de récits qui définit notre relation avec le passé, le présent et l'avenir en constante évolution.
Introduction
Santiago Guillén
Le mythe au futur antérieur. Après la singularité technologique et le transhumanisme, Prométhée et Pandore : étude linguistico-sémiotique de quelques mytopoïèses et mythifications structurales dans les discours médiatiques contemporains
Laurent Di Filippo
La réception des mythes nordiques dans les productions des industries culturelles et créatives
Stefanos Pnevmatikos
La rémanence des mythes pendant la crise grecque des années 2010
Cătălin Bărbunță
Mythologie grecque et littérature juvénile: le cas de Percy Jackson et les dieux grecs
Elenys Mușat, Elena Ciobanu
Bringing myth into the very heart of the moment: revelatory chronotopes in Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway
Maricela Strungariu
Temps et mémoire dans Si le grain ne meurt d’André Gide
Cédric Hounnou, Carole Fagadé
Mise en visibilité de la désinformation sur Twitter. Une approche socio-discursive
Simina Mastacan
De l’usage argumentatif du passé
Felicia Dumas
Orthodoxie(s) en temps de crise. Évoquer le présent et le passé d’une église ukrainienne déchirée par la guerre sur un blog orthodoxe francophone
Florinela Şerbănică
Le discours des enseignants roumains face à la pandémie de COVID-19 à travers un corpus d’articles et de témoignages
Mihaela Chapelan
La multi-temporalité cinématographique
Oriane Chevalier
L’Asie à travers les yeux de l’animal : Mémoires d’un éléphant blanc de Judith Gautier et The Autobiography of a Chinese Dog de Florence Ayscough
Bernadetta Jankowska
Considering Aboriginality: hauntological and feminist perspectives on the "third space" in Jane Harrison's plays Stolen and Rainbow's End
Alice Vasseur
Innover dans la recherche historique sur les relations internationales : l’exemple de la guerre du Pacifique (1879-1884)
Agata Rupińska
Is pain beauty? – The strife for the feminine appearance ideal and its consequences in Louisa Young’s My Dear, I Wanted to Tell You
Nadia Nicoleta Morărașu, The Stylistic Identity of English Literary Texts, Ed. Alma Mater, Bacău, 2014 (Cătălina Bălinișteanu-Furdu)