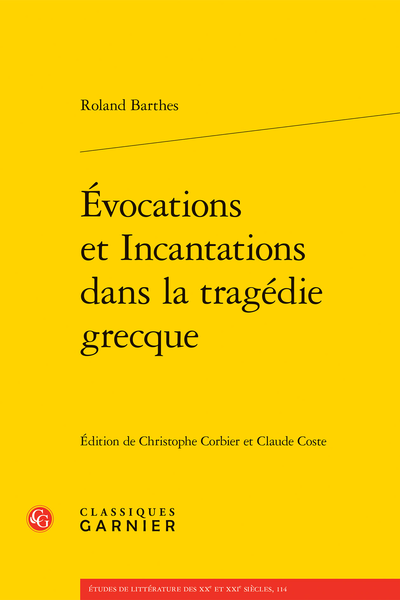
Édition de Christophe Corbier et Claude Coste
En 1941, Roland Barthes soutient son diplôme d’études supérieures à la Sorbonne sous la direction de Paul Mazon. Le mémoire qui porte sur les évocations et incantations dans la tragédie grecque analyse les passages où les hommes appellent les dieux et les morts à se manifester grâce au chant. Inédit jusqu’à ce jour, cet écrit de jeunesse dialogue désormais avec la totalité de l’œuvre de Barthes dont il révèle à la fois les permanences et les métamorphoses.
"L’admiration de Barthes perce en bien des pages devant le miracle de la tragédie d’Eschyle, qui réside dans la coïncidence d’Apollon et de Dionysos, de la déduction logique et de la violence pathétique. Ainsi, écrit-il dans le sillage de Nietzsche, « nous savons maintenant que chez [les Grecs] les moments d’émotion profonde, de lyrisme total, de plus grande ivresse musicale, coïncident jusqu’à la confusion avec les moments d’intense volonté déductive, de plus grande rigueur logique de la pensée ». Les Modernes ont perdu le secret de cet art admirable et miraculeux, et le code de la choreia s’est évanoui. Toutefois, grâce à une lecture attentive aux mots grecs, on peut en apercevoir encore la splendeur et l’inépuisable richesse. Treize ans avant la représentation de Mère Courage de Bertolt Brecht à Paris, les scènes d’incantation et d’évocation des Perses, des Suppliantes et de l’Orestie ont révélé à Barthes un théâtre capital, vieux de deux mille cinq cents ans et toujours actuel." (extrait de la Préface).
—
Table des matières
Préface
Le premier mot de Roland Barthes 7
Note éditoriale 21
ROLAND BARTHES
ÉVOCATIONS ET INCANTATIONS DANS LA TRAGÉDIE GRECQUE
Bibliographie 29
Introduction 33
I – Survivances rituelles dans les incantations
de la tragédie 39
A. Éleusis 40
B. Rites orientaux 41
C. Oniromantique et nécromancie 43
D. Héroïsation des rois morts 44
E. Actes rituels 45
F. Rites oraux 46
II – Structure formelle 49
A. Structure verbale 51
1. Pouvoir magique du mot 51
2. De l’exclamation au mot 52
170
3. Substance sonore du mot 55
4. Figures de pensée 57
5. Caractères généraux de la langue incantatrice tragique 63
B. Mise en scène 64
1. Pouvoir magique de la danse et du geste 65
2. Mouvements corporels σχήματα / skhèmata 67
3. Évolutionsφοραῖ / phoraï 72
4. Coordination des mouvements de mise en scène 74
5. La question du masque 76
III – STRUCTURE INTERNE 77
A. Structure logique 78
1. Incantations à forme responsoriale 79
2. Formes à refrain 92
B. Structure cultuelle 96
1. Éléments de l’hymne cultuel 96
2. Évocation desPerses 98
3. Incantations funèbres 101
4. Incantation aux dieux : Suppliantes, 111-176 106
5. Incantations de malédiction 108
6. Chœurs de bénédictions 111
7. Conclusion 113
IV – ἮΘΟΣ ou caractère lyrique 115
A. Rythme progressif des incantations 115
B. Formes sans refrain 118
1. Les Perses, 633-680 118
2. Choéphores, 315-475 118
3. Troyennes, 1301-1316 120
4. Euménides, 916-1020 120
C. Formes à refrains 120
1. Suppliantes, 111-175 120
2. Euménides, 307-396 121
3. Euménides, 777 122
4. Suppliantes, 630-709 122
D. Conclusion : les mètres les plus usuels de l’incantation 122
Conclusion 125
—
Postface
Les mots d’après… 133
Annexe
Roland Barthes, « Les Perses d’Eschyle » (1936) 153
Glossaire 155