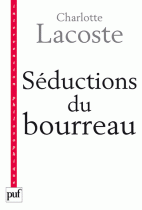
Éthique & politique du témoignage littéraire
1L’essai Séductions du bourreau. Négation des victimes, de Charlotte Lacoste, présente au moins deux grands mérites : le premier est de contribuer de manière substantielle au débat sur les relations entre histoire et littérature ; le second, de recentrer la question du crime de masse sur ses enjeux éthique et politique1. En s’appuyant sur une analyse précise des textes, Ch. Lacoste aborde la question de la légitimité de l’historien confronté au texte littéraire traitant d’une matière historique. Elle montre que l’argumentation et la justification des romanciers sont parfois teintées de mauvaise foi. En effet, quand la critique conteste la fiabilité de l’impression référentielle, la tentation est grande pour l’écrivain de se défendre en évoquant une importante documentation et les travaux des historiens ; en revanche, si le doute est porté sur des « affirmations discutables du point de vue de la rigueur historique » (p. 180), la réponse renvoie alors à la liberté souveraine de « l’écrivain qui a tous les droits sinon ce n’est pas de la littérature2 ».
Se dérober à la critique
2Ch. Lacoste précise que l’équivoque ne date pas d’aujourd’hui, puisque dès les années 1930, Jean Norton Cru3 dans son livre Témoins attirait déjà
l’attention sur cette catégorie toute particulière d’auteurs de fresques guerrières (et bientôt génocidaires), qui bénéficient à la fois du crédit que l’on accorde à un témoin fiable et de la liberté absolue que l’on reconnaît au romancier — un double statut qui fera durablement du roman sur la violence extrême un vecteur privilégié de la contrefaçon historiographique. … Cette confusion annihile la possibilité même de la critique (p. 85).
3La force du raisonnement de Ch. Lacoste trouve ainsi son origine et une forme d’exemplarité dans la lecture de Témoins. C’est une preuve de plus du formidable pouvoir critique du livre de Cru ainsi que de son actualité. L’interprétation qu’on en fait s’avère toujours révélatrice de la valeur heuristique que l’on accorde au témoignage. Luc Rasson ne s’y est pas trompé, puisque dans sa recension de Séductions du bourreau, il établit une filiation directe entre ce qu’il appelle le « mépris » du livre de Ch. Lacoste et le « présupposé antilittéraire qui présida à la démarche de Jean Norton Cru.4 » L. Rasson laisse penser que Cru serait incapable de se hisser au-dessus d’une plate fascination pour le fait, pour le détail vrai, c’est‑à‑dire qu’il serait victime d’un littéralisme niais. Pourtant, même si l’on ne partage pas toutes les conclusions de Témoins, il est difficile de soutenir devant l’ampleur du travail et la rigueur de la méthode que les réserves formulées contre certains écrivains-témoins proviennent de préjugés caricaturaux : il faudrait plutôt voir dans le « mépris » de Cru, comme dans celui de Ch. Lacoste, le signe d’une exigence intellectuelle.
4La lecture de Témoins trace une ligne de partage entre deux conceptions antagonistes, dont les différends portent essentiellement sur la poétique des œuvres de témoignage, initiée et mise en pratique par Cru. Il s’agit en effet d’admettre ou de refuser, car jugée trop réductrice, la spécificité du genre que François Rastier présente ainsi :
Quand il fait œuvre littéraire, l’engagement éthique du témoin dirige ses choix esthétiques, car la responsabilité à l’égard de l’histoire narrée aux vivants suppose une recherche de l’exactitude et de la rationalité, comme la responsabilité à l’égard des défunts récuse les outrances complaisantes qui font l’ordinaire des faux témoignages et des romans historiques5.
5Ch. Lacoste soutient que Cru était non seulement conscient de cette responsabilité du témoin, mais également de la dimension littéraire du témoignage :
Si Cru valorise les auteurs qui ont cherché à cerner la « nudité de la chose vue », il n’est en rien travaillé par le fantasme de la transparence et ne donne jamais dans la mystique du « fait brut » — pas plus qu’il n’est un ennemi de la littérature. Vérité et littérature ne s’opposent pas dans Témoins, au contraire. Cru critique certes les ouvrages dans lesquels « l’intention littéraire a le tort de primer l’intention testimoniale » (Cru, 2006, p. 249), mais il ne cesse d’insister sur les qualités à la fois documentaires et littéraires que recèle l’éloquence maigre de la prose testimoniale. (p. 28)
6« Éloquence maigre » — la formule est heureuse et rend parfaitement compte de l’esthétique en débat. Cru s’attaque à une véritable intoxication littéraire qui sévit chez certains témoins et qui consiste à raconter la guerre en s’inspirant de genres qui ne lui sont pas appropriés, comme, par exemple, l’épopée (p. 25). Si l’éthique justifie son travail, on notera toutefois que sa critique ne porte pas sur la littérature en général (ce qui serait absurde), mais sur les méfaits de l’affabulation qui conduisent à « l’usurpation testimoniale ». L’enjeu est loin d’être négligeable, car il engage effectivement une herméneutique des œuvres de témoins. Il n’est donc pas surprenant que L. Rasson, en refusant les apports de Cru, puisse lire un autre grand témoin, Robert Antelme, comme un adepte de la fabulation au service de la vérité :
Constatant que « la vérité peut être plus lassante à entendre qu’une fabulation », l’auteur de L’Espèce humaine affirme, à l’instar de Dorgelès, qu’il « faut beaucoup d’artifice pour faire passer une parcelle de vérité ». … Bref, fiction et témoignage ne sont pas mutuellement exclusifs : il est faux d’affirmer, comme le fait Ch. Lacoste, que les témoins « se défendent de faire de la littérature »6.
7Pourtant, associer Dorgelès7 et Antelme relève d’une alliance discutable. Cru cite de ce fait ces propos de Dorgelès :
« Quand j’ai retrouvé les feuilles d’un carnet] dans mes paperasses, je les ai jetées au feu. Pour ne pas mentir. … J’ai incorporé dans un récit imaginaire des éclats de vérité. Ce n’est pas du roman, ce ne sont pas des choses vues : c’est de la réalité recréée. Pas un instant je n’ai songé à tenir le journal de mon régiment. J’avais une ambition plus haute : ne pas raconter ma guerre, mais la guerre. … L’histoire d’espionnage que je raconte ne repose sur rien, je l’ai imaginée pour faire naître l’angoisse… Partout ainsi, j’ai déformé, imaginé, refondu, et il s’est fait dans mon esprit un si tragique alliage que je ne saurais plus reconnaître aujourd’hui la fiction de la réalité8.
8Antelme aurait-il repris à son compte cette dernière phrase ? On peut en douter si l’on se reporte aux pages de L’Espèce humaine où les déportés connaissent pour la première fois l’épreuve et l’expérience du témoignage9. Le texte montre avec une grande acuité comment la libération tant attendue renvoie le déporté de manière brutale à sa propre étrangeté, qu’il découvre par le biais du regard et des attitudes des soldats. La déportation a radicalement changé les positions d’énonciation et de réception, et la dissymétrie n’a pu que s’accroître au point de paraître insurmontable. « Le soldat d’abord écoute, puis les types ne s’arrêtent plus : ils racontent, racontent, et bientôt le soldat n’écoute plus. » Le déporté va donc devoir réfléchir aux moyens de se faire entendre. La première mise en forme du récit, celle qui est la plus proche de l’expérience vécue, se double et se heurte à une autre expérience, celle de l’incompréhension, de l’absence d’écoute. Dans la scène décrite ici, le narrateur commence à prendre conscience de la grande difficulté du partage d’une expérience radicale, mais cela ne signifie pas qu’il va devoir basculer tout à fait vers une fiction qui nierait l’expérience elle-même, mais qui se trouverait dans l’horizon d’attente de l’interlocuteur. Quant au mot « artifice » qui pourrait prêter à confusion, il est ici synonyme d’apprêt, c’est-à-dire d’une mise en forme qui soit lisible pour ceux qui ne possèdent pas la connaissance du camp. L’artifice est donc moins le produit d’une volonté du témoin que la conséquence de l’incapacité de celui qui écoute. Tout le problème va consister à savoir quelle part — s’il faut lui en donner une —, il est nécessaire d’accorder à cet artifice. Ainsi, si le récit est un artifice, au sens d’une technique d’utilisation de la langue, Antelme ne dit pas qu’il est artificiel.
Une lecture des Bienveillantes de Jonathan Littell
9Ch. Lacoste poursuit ensuite sa réflexion sur le discrédit du témoin dont l’un des aspects, parmi les plus insidieux, consiste à valoriser la position du bourreau. Une grande partie de la controverse se porte alors sur le livre de Jonathan Littell, un « roman-symptôme qui cristallise toute la fantasmagorie pousse-au-crime » (p. 6). La longue étude des Bienveillantes (p. 143-246 et p. 291-294) montre que les choix esthétiques de J. Littell doivent être pensés en fonction de leur incidence politique. On ne peut pas, en effet, choisir le sujet du nazisme et de l’extermination sans questionnement sur la conception de l’homme ainsi exprimée. Ch. Lacoste analyse dans le détail le dispositif narratif du roman, qui en vient à piéger le lecteur :
Le narrateur est un bourreau, sorte de machine à tuer qui, une fois mise en marche, ne s’arrête plus —il faut bien cela pour « réchauffer » l’histoire que les historiens s’étaient acharnés à geler. Dès lors, la focalisation interne vaut toute l’omniscience du monde, puisque son statut d’exterminateur assure au lecteur une vue imprenable sur l’événement. Et tant pis s’il faut piétiner avec lui les cadavres des victimes ; la connaissance est à ce prix, puisque, encore une fois, l’enjeu est d’en connaître plus, sur le crime de masse, que n’en ont dit les historiens. Le dispositif d’immersion rend décidément bien des choses possibles (p. 155).
10Ch. Lacoste ajoute encore que « Max Aue ne se contente pas de relativiser : il travaille à nous faire partager son relativisme » (p. 193).
11Outre l’immersion dans la « conscience » d’un nazi, le second « point fort » des Bienveillantes, qui sert de caution au premier, résiderait dans le travail de compilation des matériaux historiques. Ch. Lacoste établit pourtant que le dispositif romanesque, tel qu’il apparaît dans le livre, doit s’autonomiser par rapport au savoir historien : en effet, la fiction se prévaut d’un savoir historiographique, incarné par la figure d’autorité d’Hilberg, pour ensuite l’instrumentaliser de manière outrancière (p. 160). Citations à l’appui (p. 157-160), elle récuse l’attitude intellectuelle qui tend à promouvoir une légitimité supérieure de la fiction et à laisser entendre du même coup que le bourreau n’est pas aussi coupable qu’un jugement hâtif pourrait le laisser croire, mais qu’également, dans un renversement de perspective, le lecteur, dans son confort moral, n’est pas celui qu’il croit être, car lui aussi fait partie de l’espèce humaine et, à ce titre, partage les caractéristiques présentées par le héros des Bienveillantes :
Le lecteur, forcé de constater que Max Aue lui ressemble en tout point, est incité à se remettre en question, et à pratiquer au cours de sa lecture une introspection qui, si elle porte ses fruits, pourrait lui permettre de découvrir le monstre qu’il nourrit en lui sans le savoir (p. 217).
Un défaut d’analyse politique
12Si le succès des Bienveillantes est pour Ch. Lacoste « symptomatique » (p. 146) et mériterait à ce titre un long développement, il serait dommage de limiter Séductions du bourreau à une critique en règle du livre de J. Littell. La thèse défendue déborde largement le cadre de ce roman pour mettre en évidence de manière plus générale un « défaut d’analyse politique » caractérisé par « une thèse biologico-mystique qui essentialise la méchanceté de l’homme, et nous éloigne d’autant des vraies causes de cette violence » (p. 296). La conception que l’on se fait de l’homme, la part affectée au « système » et celle dévolue à la « nature humaine » ainsi que la relation entre la lecture et la pratique sous-tendent tout un débat sur la responsabilité des écrivains. Les lieux communs du monstre en nous et de la figure du bourreau banal se retrouvent aussi bien dans le traitement de la guerre d’Algérie vue du côté des tortionnaires (Rotman), du génocide des Tutsi (d’Ormesson, Gatore, Waberi), du procès Eichmann (Brauman, Sivan), de l’Holocauste (Bauman), ou encore chez Michel Onfray dans une perspective antikantienne10. Ch. Lacoste vise ces œuvres qui, en naturalisant la part de tortionnaire que recèlerait chaque être humain, minimisent la responsabilité du système politique qui place l’individu dans une situation de bourreau :
Face à tant de confusion — celle-là même qui profite aux assassins et dont profite le crime — on rappellera une dernière fois que Primo Levi n’a jamais considéré la zone grise comme un lieu d’indistinction entre victimes et assassins : « J’ignore, et je ne suis guère intéressé à le savoir, si un assassin s’est niché dans mes profondeurs, mais je sais que j’ai été une victime sans culpabilité et pas un assassin ; je sais que les assassins ont existé, pas seulement en Allemagne, et qu’ils existent encore, retraités ou en service, et que les confondre avec leurs victimes est une maladie morale ou une coquetterie esthétique ou un signe sinistre de complicité ; c’est surtout un précieux service rendu (volontairement ou non) à ceux qui nient la vérité11.
13En dernier lieu, Ch. Lacoste s’intéresse à l’expérience dite de Milgram et rappelle avec justesse que l’intention du psychosociologue américain ne consiste pas à mettre en évidence « une supposée inclination de l’humain au mal » (p. 308), mais plutôt le fait que la soumission à l’autorité est avant tout un problème politique. Cru dénonçait de la même manière l’idée que l’homme posséderait un goût naturel pour la lutte, et donc la guerre, dès lors assimilable à un sport12. Ch. Lacoste montre que ce type de naturalisation du mal contribue à occulter les conclusions de Milgran, à savoir que l’individu solitaire est plus susceptible de se soumettre à une obéissance aveugle et que la résistance à l’autorité a indéniablement besoin des luttes collectives. Elle conclut :
L’union fait la force… Comment s’étonner de ce que le message politique de Soumission à l’autorité qui démontre le bien-fondé de l’action collective soit aujourd’hui phagocyté par une lecture essentialiste qui, spéculant sur la cruauté naturelle de l’espèce humaine, correspond tellement mieux au paradigme idéologique de notre temps ? (p. 318)
14.

