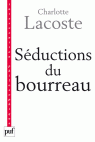
De la critique littéraire considérée comme un exercice de mépris
1Quoi qu’on puisse penser des Bienveillantes, la publication de ce roman en 2006 aura au moins eu le mérite de susciter des débats passionnants révélant que, plus de soixante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous continuons à nous définir par rapport à cet événement majeur. À l’instar de la Révolution française, cette guerre qui fut la dernière à ravager le continent européen (si l’on exclut la crise yougoslave des années 1990) constitue un écran sur lequel les générations actuelles continuent à projeter leurs débats, leurs doutes, leurs contradictions afin de mieux circonscrire leur propre identité démocratique. Le roman de Jonathan Littell, on le sait, provoqua une véritable scission au sein du lectorat, les contempteurs vouant aux gémonies une fiction qui ose rendre compte du génocide à partir de la perspective du bourreau, les thuriféraires saluant l’audace d’un texte qui, justement, prend le risque de s’interroger sur ce qui se passe dans la tête d’un organisateur du génocide. Certes, le projet de J. Littell n’était pas original : dès 1952 Robert Merle, dans La mort est mon métier, donna la parole à Rudolf Lang, alter ego de Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz qui supervisa l’installation des premières chambres à gaz1. Mais par son ampleur, par son souffle épique, par sa dimension encyclopédique, par son protagoniste-narrateur échappant aux simplifications réductrices qu’appelle certain stéréotype du nazi en littérature (et au cinéma), ce roman frappa les esprits. Aussi vit‑on paraître aussitôt des ouvrages critiques — souvent des pamphlets, à vrai dire — qui s’en prirent au roman, à son protagoniste SS et à son auteur2. Il est d’ailleurs notable que, face à cette prolifération de livres dénonçant le roman, il n’existe, jusqu’à aujourd’hui, à ma connaissance, aucun ouvrage de quelque dimension qui en prenne la défense3.
Réhabiliter le nazi ?
2À cette floraison d’ouvrages critiques vient de s’ajouter celui de Charlotte Lacoste qui est sans doute le plus informé et le mieux étayé des ouvrages qui dénoncent les Bienveillantes. Livre qui, à vrai dire, ne se limite pas à être un commentaire critique du roman de J. Littell : son ambition est plus vaste, même si ce « roman-symptôme qui cristallise toute la fantasmagorie pousse‑au‑crime » (p. 6) constitue le déclencheur de la réflexion et occupe l’ensemble de la deuxième partie de Séductions du bourreau. La thèse de Ch. Lacoste a l’avantage de la clarté : il existe une mode qui consiste à donner la parole au bourreau. Cette mode est dangereuse car elle révèle une fascination morbide de nos contemporains pour le point de vue du tortionnaire et du génocidaire et elle risque, à terme, de « recrédibiliser le personnage du nazi » (p. 228), voire de contribuer — excusez du peu — à la « nazification du lectorat » (p. 224). L’interprétation est d’une cohérence à toute épreuve : puisque J. Littell « a choisi de faire alliance avec un SS » (p. 456), Les Bienveillantes est un « roman à thèse » (p. 256) dont l’objectif est la « revalorisation du “système de valeurs” et de la “pensée” nazis » (p. 457).
3Voilà quelques-unes des affirmations à l’emporte-pièce qui émaillent ce livre. Que l’on ajoute à l’outrance des énoncés, un ton péremptoire, une écriture sarcastique, voire l’expression du mépris à l’égard de ceux qui auraient l’outrecuidance d’apprécier Les Bienveillantes, ou, plus généralement, de souscrire aux thèses de Christopher Browning sur « l’homme ordinaire » ou de Zygmunt Bauman sur la « modernité » de l’Holocauste et l’on se demande s’il ne faut pas retourner contre Ch. Lacoste le reproche qu’elle adresse aux lecteurs qui prennent au sérieux la liberté de l’artiste : « L’émotion fait loi en lieu et place de la critique » (p. 173).
4Or, l’émotion première qui imprègne tout ce livre est, comme je l’ai déjà suggéré, le mépris. Regardons cela de façon systématique. Mépris du roman, pour commencer. Face à l’historiographie, face au témoignage, la fiction est suspecte. S’inspirant du présupposé anti‑littéraire qui présida à la démarche de Jean‑Norton Cru face aux témoignages de la Grande Guerre, Ch. Lacoste distingue « deux lignées » qui « s’affrontent tout au long du siècle » et qui opposent les romanciers à succès « maîtres de l’épouvante lucrative » aux « défenseurs du témoignage » (p. 46) — ceux que Jean‑Norton Cru appelait les « témoins probes ». Ce qui préside à une telle suspicion, c’est qu’il existe une vérité de l’événement, toujours menacée par une littérature malhonnête aux aguets, prête à la déformer : c’est la littérature « ballonnée, surhormonée » (p. 137) sacrifiant à une « logique du spectacle » qui, et ce n’est sans doute pas une coïncidence dans l’esprit de Ch. Lacoste, était « celle des nazis eux-mêmes » (p. 109‑110).
5Face à cette littérature « hyperbolique » qui fonctionne selon une « mécanique de l’exagération » (p. 103) — comme Les Bienveillantes ou, en amont, Le Feu, car Ch. Lacoste adopte volontiers les cibles que Jean‑Norton Cru avait déjà visées —, l’auteur valorise une esthétique qu’on pourrait qualifier de classiciste, où l’écrivain se garde « de tout excès inutile ou superflu » (p. 113) en fonction du double idéal de la « sobriété » et de la « précision » (p. 78). C’est d’une littérature moralisante qu’il s’agit dont la fonction première est « d’éclairer les consciences » (p. 86) car, apprenons-nous dans une affirmation qui écarte d’un revers de la main toute l’évolution esthétique depuis le xviie siècle : « le beau et le bien vont nécessairement ensemble » (p. 175). La mise en accusation d’un certain romantisme est d’ailleurs assumée dans une sortie contre Barbey d’Aurevilly dont Le Cachet d’onyx encouragerait le lecteur à reconnaître « la grandeur de la violence », à l’instar de « l’esthétique romantique » des Bienveillantes qui « mise sur la présence de spectateurs fascinés », car Max Aue ne s’emploie‑t‑il pas « à faire de son lecteur un bourreau » (p. 214) ? Ch. Lacoste reprend ainsi l’argument magique qu’avaient déjà employé Husson et Terestchenko dans Les Complaisantes : par une étrange surestimation du pouvoir attribué à la littérature, ces critiques estiment qu’elle a le pouvoir de changer le lecteur — pour le mal : « quoi de plus facile pour un narrateur bourré de mauvaises intentions que d’éveiller les pulsions sadiques de son lecteur4 ? » (p. 213).
6Mais le problème est peut‑être moins le traitement que les « fictionneurs » (comme Ch. Lacoste appelle systématiquement les romanciers qui ne l’agréent pas) font subir à la matière du génocide, mais le fait même qu’un roman rende compte de l’expérience concentrationnaire. On retrouve là l’argument que Jean Cayrol avait déjà invoqué au moment de la parution de La mort est mon métier, argument décrétant le caractère incommunicable de l’expérience des camps — ce monde « inabordable » qui « ne doit pas être mis à la portée de tous5 », car, enchérit Ch. Lacoste, « le sujet lui-même met la fiction en échec » (p. 79). Et l’on ne s’étonnera pas d’apprendre que tout traitement fictionnel de cette matière constitue « un premier pas vers le révisionnisme6 » (p. 90). Voilà les futurs romanciers avertis : il existe des thèmes entourés d’une aura de sacralité auxquels il est interdit de toucher. Tout comme le livre de Husson et Terestchenko constitue un appel à peine voilé à la censure7, celui de Ch. Lacoste incite à l’autocensure.
7Le roman n’est pas à la hauteur. Le lecteur non plus, on nous l’assène à chaque page. Autre manifestation de mépris. Quelle est l’image proposée du lecteur ? En fait, il n’y a en a que deux : le lecteur malveillant et le lecteur naïf — Ch. Lacoste ne conçoit à aucun moment le lecteur intelligent. Le premier a l’effronterie d’apprécier le roman — Les Bienveillantes ou tel autre texte mettant en scène une parole de bourreau. Et puisqu’il est toujours bon de discréditer d’avance ceux qu’on attaque, il s’agit d’un lecteur qui, par définition, n’a pas lu, comme « ces critiques de métier dont très peu poussèrent le scrupule jusqu’à aller voir ce dont le livre [Les Bienveillantes] était fait8 » (p. 146). Il est, bien sûr, assoiffé de sensations fortes — puisque J. Littell l’enjoint constamment à « se délecter du spectacle » (p. 157), ce dont il ne se prive pas —, et il est enfin, et nécessairement, borné — il fait partie d’un « public qui réclame une confirmation de ses préjugés » (p. 102). Le lecteur naïf, pour sa part, n’est pas plus perspicace que le premier, car il se laisse constamment prendre aux pièges que lui tendent l’auteur et le narrateur alliés et animés des pires intentions : il est « manipulé » et « mystifié » (p. 185), il est « contraint » à gracier Max Aue (p. 192), sa « vigilance » est « endormie », de sorte qu’il est « empêché » de prendre la mesure de ce qui se passe (p. 195). Déjà foncièrement fragile, « désarmé », il est « abruti » par le narrateur » (p. 212) et son manque de jugement est tel qu’il finit par « avaler la pilule » (p. 196), si du moins il ne se convertit pas au sadisme (p. 212) après la lecture de ce roman décidément dangereux. Bref, les lecteurs des Bienveillantes sont « faits comme des rats » (p. 225), voire, carrément foulés aux pieds : « Voyez le lecteur à terre, et voyez comment le bourreau nazi le piétine » (p. 244).
8Mépris du roman, mépris du lecteur, mépris, enfin, mais cela ne surprendra pas, de l’auteur. Son agenda est transparent : il s’agit de rien moins que de « déjudaïser la Shoah » (p. 291) afin « d’éveiller le monstre qui est en nous » (p. 293) et de « recrédibiliser le personnage du nazi » (p. 228). Son « intention raciste », dès lors, ne fait pas de doute : J. Littell dépasse le négationnisme, car il « fait pire que nier le génocide des juifs, il le rend “fascinant” » (p. 164). Qu’est‑ce qui permet de lancer ces accusations graves ? Le fait que toute distance entre auteur et le narrateur s’abolit : J. Littell est le « complice » (p. 183), « l’adjuvant », « l’avocat » (p. 215) de Max Aue, parce qu’il lui « donne si longuement la parole sans qu’on puisse l’interrompre ». La conclusion s’impose : « Jonathan Littell fait siens les arguments de son narrateur » (p. 221), tant il est fatal que « les fictionneurs », incapables de réflexe critique, « croient sur parole les bourreaux » (p. 340). Et puisque Les Bienveillantes est ce roman où tout se confond aux yeux de Ch. Lacoste, on ne sera pas étonné de constater que le duo Littell/Aue est en fait un trio, car « le personnage d’Aue tel que l’a construit J. Littell est destiné à jouer, pour le lecteur, ce rôle de “foyer optique” qu’Hitler joua pour les Allemands » : Jonathan Littell, Max Aue, Adolf Hitler, même combat !
Délégitimations & contre-discours
9Tant d’outrance laisse perplexe. Il faut, avant tout, dénoncer le manque de confiance dans le lecteur que Ch. Lacoste manifeste à chaque page. Car s’il est vrai que Les Bienveillantes — ou tel autre récit fictif de bourreau — a le pouvoir de paralyser le jugement du lecteur, d’endormir ses compétences interprétatives, et dès lors de le rendre réceptif aux thèses national‑socialistes les plus extrêmes, comment alors expliquer la réaction critique de Ch. Lacoste elle-même ? Quelles sont les qualités qui font d’elle la bonne lectrice qui aurait réussi à dévoiler le complot nazi tramé par J. Littell et quelques autres ? Ce qui est sûr, c’est que ces qualités ne résident pas dans la mise en œuvre subtile de l’analyse littéraire, car l’auteur de Séductions du bourreau fait preuve, pour commencer, d’une incapacité criante de mettre en œuvre les distinctions narratologiques les plus élémentaires. Reprenons l’argument de la fusion des voix auctoriale et narrative : la distinction de ces deux niveaux, on est gêné de le rappeler, constitue le fondement même de toute analyse sérieuse du roman homodiégétique, c’est-à-dire écrit à la première personne : Marcel n’est pas Proust, Bardamu n’est pas Céline — même si certains éléments biographiques permettent d’établir un rapport entre eux. Max Aue n’est pas Jonathan Littell, même si l’auteur a eu la coquetterie d’attribuer à son personnage-narrateur sa propre date d’anniversaire. Mais — pour ne donner qu’un exemple — lorsque Max Aue revendique, dès l’ouverture du roman, son statut d’homme ordinaire, montrant par là qu’il a bien assimilé les hypothèses récentes visant à cerner la personnalité nazi ou génocidaire, la suite du roman suggère que cette revendication est infondée : ce personnage à la sexualité hors du commun, qui, en dehors même de ses responsabilités dans l’extermination de Juifs, tue gratuitement ou par intérêt, n’a rien d’ordinaire : même les « ordinary men » dont parle Christopher Browning n’avaient pas l’habitude d’assassiner leur mère et leur meilleur ami et la plupart n’avaient sans doute pas eu de rapports sexuels avec leur sœur. Bref, Max Aue ne peut pas être cru sur parole : en racontant son histoire, il se délégitime lui-même — à l’instar d’ailleurs de tous les nazis qui prennent la parole dans ce roman. Et c’est dans cette délégitimation involontaire de soi‑même qu’on peut reconnaître l’intervention de l’auteur : décidément, Les Bienveillantes ne saurait appartenir au genre du roman à thèse. Ne pas voir ces subtilités capitales, c’est faire preuve soit de mauvaise foi, soit de compétences interprétatives limitées.
10Le déficit herméneutique dont fait preuve l’auteur de Séductions du bourreau n’est pas que narratologique. Certes, tout lecteur pose un regard idiosyncratique sur le texte qu’il lit, en fonction de son histoire, de sa personnalité, de ses compétences, mais il est des lectures qui confinent à l’aveuglement : comment ne pas voir que Les Bienveillantes est une énorme entreprise à dénoncer le nazisme et son projet racial délirant ? Car il n’y a pas que le phénomène textuel de la délégitimation : le roman est parsemé de ce qu’on pourrait appeler des contre-discours qui lancent un défi ouvert au monopole narratif du nazi qui est loin d’avoir, comme le veut Ch. Lacoste, « les pleins pouvoirs dans le temps de la narration » (p. 211). Le contre-discours le plus impressionnant est celui de Voss, ce lieutenant de la Wehrmacht qui est aussi linguiste, spécialiste des langues caucasiennes. Dans une longue intervention, il tord le cou à deux concepts qui constituent le fondement même de l’idéologie national-socialiste, celui d’origine et celui de race. L’origine n’a pas de sens, lance-t-il à un Max Aue médusé, car elle se perd dans la nuit des temps, elle a fait l’objet de mélanges incessants et, enfin, elle est « la plupart du temps rêvée9 ». Pour ce qui est de la race, il la qualifie de « concept scientifiquement indéfinissable et donc sans valeur théorique » (p. 435). Aussi les anthropologues raciaux au service du régime sont-ils des « fumistes » (p. 435), et Voss d’ajouter : « Si c’est des critères comme les leurs qui vous servent à décider de la vie et de la mort des gens, vous feriez mieux d’aller tirer au hasard dans la foule, le résultat serait le même. » (p. 439).
11Comment Ch. Lacoste interprète‑t‑elle cette intervention qui constitue, à l’intérieur même des Bienveillantes, une réfutation puissante du nazisme ? En fait, elle se réfère deux fois à Voss, mais uniquement dans le but de dénoncer le stéréotype du nazi cultivé : le linguiste trouve ainsi sa place à côté de Eichmann tentant d’adapter l’impératif kantien au national‑socialisme, ou encore à côté de l’ingénieur Osnabrugge, « l’esthète du pontage » (p. 229). Aussi Voss est‑il aux yeux de Ch. Lacoste un « homme de science dégénéré » (p. 370) qui « n’est introduit que pour faire la preuve qu’en cas de génocide les érudits sont les premiers à s’en laver les mains » (p. 229). Sur le contenu du discours de Voss, pas un mot — rien sur la dénonciation radicale du national-socialisme dont il se fait le porte-parole.
12L’argument est facile, j’en suis conscient, mais on en vient, à propos de Ch. Lacoste, à se poser la même question qu’elle adresse à ceux qui apprécient Les Bienveillantes : a‑t‑elle lu le roman ? Et si elle l’a lu en effet, son cas s’aggrave, car, dans cette hypothèse, elle fait preuve d’une incapacité manifeste à percevoir l’ironie dont est imprégné le roman : ainsi Osnabrugge, cité dans le contexte de Voss, est ce personnage satirisé qui, ayant appris à construire des ponts, ne fait que les détruire tout au long de la campagne russe, montrant par là l’absurdité de la guerre — Osnabrugge qui est peut-être la réplique de cet autre ingenieur comique malgré lui que Céline met en scène dans l’épisode africain du Voyage au bout la nuit : Tandernot qui tient le compte des routes qu’il a construites mais que la forêt tropicale envahissante recouvre progressivement… On pourrait multiplier les exemples de scènes empreintes d’une ironie féroce, comme celle où Himmler parle de son collaborateur tué dans le bombardement de Hambourg — par un pot de fleurs reçu sur la tête (p. 771)10 — et que Ch. Lacoste ne veut ou ne sait pas voir.
13Mais il faut s’arrêter un instant à la dichotomie qui traverse tout le livre et qui est empruntée à Jean‑Norton Cru, celle qui oppose le témoin probe écrivant en fonction d’un souci moral et la littérature qui consiste en une « entreprise d’oubli organisé » (p. 25). L’opposition est‑elle aussi tranchée ? Le moins qu’on puisse dire est que certains témoins — dont personne ne peut nier la probité — ont eux-mêmes ressenti le besoin de rendre compte des expériences extrêmes qu’ils ont vécues en ayant recours à la fiction. C’est le cas, dès la Grande Guerre, de Roland Dorgelès — certes, décrié lui aussi par Jean‑Norton Cru. Toute invention est‑elle à proscrire dès lors qu’on se propose de rendre compte de la réalité de la guerre ? Voici la réponse de l’écrivain : « J’ai incorporé dans un récit imaginaire des éclats de vérité. Ce n’est pas du roman, ce ne sont pas des choses vues : c’est de la réalité recréée11 ». Des anciens déportés tels que Robert Antelme ou Jorge Semprun vont dans le même sens. Constatant que « la vérité peut être plus lassante à entendre qu’une fabulation », l’auteur de L’Espèce humaine affirme, à l’instar de Dorgelès, qu’il « faut beaucoup d’artifice pour faire passer une parcelle de vérité12 ». Et Jorge Semprun, récusant la notion d’indicible lorsqu’il s’agit de l’expérience des camps, signale, dans un écho à l’affirmation de Robert Antelme : « Seul l’artifice d’un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage13 ». Bref, fiction et témoignage ne sont pas mutuellement exclusifs : il est faux d’affirmer, comme le fait Ch. Lacoste, que les témoins « se défendent de faire de la littérature » (p. 54). Opposer une Vérité du fait qui serait seulement transmissible par un texte répondant aux critères esthétiques du classicisme — et qui serait, par là, forcément nourri d’une intention morale — aux pratiques « suspectes » des « romanciers à succès maîtres de l’épouvante lucrative » (p. 46), c’est refuser de prendre la mesure de la complexité de la démarche littéraire dans sa confrontation avec la situation extrême.
Le nazi pense-t-il ?
14Il faut conclure. Ce livre qui vitupère, dénonce, condamne, plus qu’il n’analyse, met en place un interdit : à chaque page on nous affirme que le point de vue du bourreau n’est pas recevable. Ni en littérature, ni ailleurs, car « chaque fois que l’on cherche à “comprendre” les bourreaux, le discours tourne vite au plaidoyer » (p. 323). Les seules perspectives envisageables — moralement acceptables — sont celle de la victime et celle de l’historien. Certes, il ne s’agit pas de nier la valeur de ces deux approches, celle, mémorielle, du survivant et celle, historienne, du chercheur. Mais on ne voit pas en quoi cette double approche devrait exclure l’intérêt porté au bourreau. Ne fut-il pas un actant capital dans l’entreprise génocidaire ? Suffit-il de décréter sa non‑appartenance à l’humanité commune ? Ch. Lacoste le répète à l’envi : « le meurtrier ne pense pas » (p. 381) et, a fortiori, le « nazi ne pense pas » (p. 376)14. La vision du monde proposée est d’une simplicité désarmante : il y a d’une part les victimes, parmi lesquelles certaines ont laissé des témoignages moralement recevables — Primo Levi, par exemple, mais pas Jorge Semprun ; et d’autre part il y a les exécuteurs qu’il faudrait exclure de l’humanité : c’est du moins ce que suggère, a contrario, le passage où Ch. Lacoste commente La Part de l’autre, roman dans lequel Éric‑Emmanuel Schmitt oppose le Hitler historique à celui, uchronique, qu’il eût pu devenir s’il avait réussi son examen d’entrée à l’Académie de Vienne : ce qui est reproché à É.‑E. Schmitt, c’est précisément d’avoir tenté de réintégrer Hitler à l’humanité, alors que, dans l’esprit de Ch. Lacoste, le Führer — ou Max Aue — se situe nécessairement en dehors, dans un espace tératologique inaccessible au commun des mortels. Comment ne pas comprendre qu’une telle démarche le place en dehors de la sphère de la responsabilité15 ?
***
15Une telle analyse est tout compte fait rassurante. Elle nous conforte dans l’idée que le monstre, c’est forcément l’autre, comme le suggèrent aussi les critiques que Charlotte Lacoste adresse à la thèse de « l’homme ordinaire » ainsi que sa lecture biaisée de Hannah Arendt qui « excluait Eichmann de l’humanité » (p. 287) — alors qu’elle a fait précisément le contraire. Le livre de Ch. Lacoste est un anesthésiant qui encourage le lecteur à s’installer dans le confort moral de sa propre rectitude morale et psychologique en ignorant la part obscure qui l’habite et en sous-estimant les pressions subtiles mais efficaces qu’un contexte socio-politique, surtout en régime totalitaire, peut exercer sur des individus, par la « redéfinition de l’univers d’obligation16 ». « Keep in mind », signale John Lukacs dans son livre consacré à l’image historienne de Hitler depuis 1945, « that evil as well as good is part of human nature » (p. 43).

