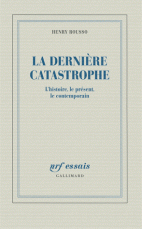
Écrire le temps présent, écrire la catastrophe
1Les historiens ont identifié depuis longtemps l’un des cadres les plus essentiels où s’est engagée notre modernité : le terrain instable et problématique où se nouent et se dénouent, depuis le début du xxe siècle, l’histoire et la mémoire. Devenue un paradigme intellectuel, un objet de pensée, une obsession, un instrument médiatique, la mémoire, qui maintient la trace vive du passé dans le présent, polarise nos sciences humaines comme la démarche et le champ de l’histoire. Celle‑ci, comme sous l’effet d’une contrainte, est ainsi sommée de se tourner aussi vers une histoire moins distante, celle du temps présent. Comprendre l’émergence de cette nouvelle manière de faire l’histoire est la tâche que s’est donnée Henry Rousso dans La Dernière catastrophe. Si le livre prend soin de débattre avec les différentes théories historiques et philosophiques, avec leurs grandes figures cardinales, il n’a pourtant rien de polémique. Son audace et son ambition sont tout autres. Car, au siècle des mémoires et de leur hypertrophie, au moment où notre société consomme de la mémoire et de l’histoire, à l’ère de l’éclatement de l’histoire et de l’attention portée aux pratiques discursives, il est peut‑être temps de faire le point sur l’évolution de nos rapports au présent et à l’histoire qu’on en fait, c’est‑à‑dire à la manière dont on a pu, voulu ou dû les comprendre.
2Si l’essai d’H. Rousso propose une progression ferme, appuyée sur un parcours chronologique et une forte cohérence thématique, il ne cherche pourtant pas à formuler des prescriptions définitives sur la manière dont il faudrait faire ou penser l’histoire du temps présent. Tout au long des différents chapitres, l’assertion péremptoire est délaissée au profit d’une interrogation toujours relancée et transmise au lecteur, celle de savoir comment penser l’histoire présente au sein même de l’histoire. Or cette question ne s’adresse pas uniquement au spécialiste ou au savant. Elle est la question que tout un chacun est en droit de se poser : sur ses propres rapports au présent, au passé et à la mémoire. Entreprendre l’archéologie d’une telle pratique de l’histoire du temps présent n’est donc pas prétendre établir une sorte de philosophie de l’histoire, une typologie des pratiques historiques ou un mode d’emploi pour historien, mais bien esquisser quelque chose qui serait aussi une forme d’anthropologie en ce sens que c’est plus largement l’homme qui y est impliqué. L’histoire du temps présent pose en effet « des questions beaucoup plus universelles sur la place de l’historien, l’écriture de l’histoire, les enjeux des relations entre observateurs et acteurs » (p. 187). Plus encore, se dégagent des interrogations sur notre pratique des sciences humaines comme sur notre rapport au monde, à la mémoire, sur le statut du témoin et du témoignage, autant de questions qui, parce qu’elles y sont abordées dans l’espace singulier de la pratique historienne, y apparaissent avec une clarté et une force qu’elles n’ont assurément pas ailleurs. Poser ces questions au sein de l’écriture de l’histoire, c’est saisir notre rapport au passé à l’endroit où se croisent nos pratiques sociales, médiatiques, culturelles et scientifiques. C’est donc aussi questionner nos désirs intellectuels et nos habitudes de pensée, c’est prendre en compte les demandes sociales et les interactions avec le champ universitaire, c’est interroger nos paradigmes intellectuels et axiologiques qui, en lien avec une époque et une histoire, déterminent en profondeur toute notre pensée.
Petite histoire de l’histoire du temps présent
3H. Rousso a donc fait le pari d’une mise en perspective historique pour comprendre la situation actuelle de l’histoire du temps présent. De la sorte, le projet qui soutient la réflexion est double : périodiser l’évolution de l’histoire du présent afin d’identifier et de mieux comprendre le moment où celle‑ci a connu une sorte de mue. H. Rousso l’affirme à plusieurs reprises : pour lui, le tournant épistémologique et axiologique s’est réalisé dans les années 1970. Quels sont les ébranlements et les métamorphoses de l’histoire comme de la conception de l’homme qui ont conduit à ce virage ? Telle est bien la ligne d’horizon qui guide l’ensemble de l’essai.
4On sera alors peut‑être frappé par un point particulier : implicitement, comme dans une mise en abyme méthodologique, le texte met en œuvre la proposition la plus essentielle qu’il formule à l’égard de la pratique de l’histoire du temps présent. À savoir : se déprendre du leurre d’une histoire instantanée au profit d’une histoire qui réintroduise de la distance pour lire le présent. Or c’est précisément ce double niveau de lecture qui est fécond. Exorcisant les affects et les risques du débat passionné, la longue durée restaure une démarche heuristique afin de comprendre un objet qu’H. Rousso a lui‑même contribué à forger. Au‑delà de toute perspective téléologique, le parcours des différentes conceptions de l’histoire du temps présent de l’Antiquité à nos jours dévoile ainsi une série de virages et de soubresauts où la science historique du présent tâtonne, s’essaye, s’avance ou recule. C’est seulement dans ce clignotement incessant de lueurs et d’ombres que les difficultés et les enjeux de cette pratique sont plus exactement mis en lumière pour nous. Car la perspective historique choisie ne vise nullement à solidifier notre perception des choses mais au contraire à nous en faire sentir les articulations mouvantes et leur tendance à la dispersion. Dans ce portrait en actes d’une science en voie de formation, la situation historique sert de cadre conceptuel pour retracer une histoire générale de notre pensée du passé et du présent. Il apparaît alors que la question de la contemporanéité n’est pas une innovation de notre époque mais qu’elle a été présente, même en filigrane, de tout temps. Seulement, ce sont ses conséquences, ses enjeux et la manière de la poser qui diffèrent. Car la contemporanéité « peut désigner des régimes temporels très différents » (p. 53) ; elle n’a ni la même signification ni les mêmes implications d’une époque à l’autre.
5Retraçons donc à grands traits ce parcours. Dans l’Antiquité, chez Hérodote et Thucydide notamment, la contemporanéité est inhérente à toute démarche historienne si bien qu’elle ne peut constituer une catégorie identifiée en tant que telle. Au Moyen‑Âge, c’est le sentiment d’une fixation du temps qui entraîne une sorte de dilution de la conscience historique, marquée par la théologie et l’eschatologie, empêchant une réelle pratique de l’histoire contemporaine. La Renaissance s’est ensuite opposée à ce paradigme, détachant soigneusement le passé du présent, mais en délaissant le témoignage oral si prégnant au Moyen‑Âge, pour se tourner vers les sources écrites. C’est alors au xviie siècle qu’une distinction essentielle s’impose : le passé, le présent et le présent de l’historien ne sont pas une seule et même chose. Ce dernier devient dès lors un homme placé en observateur à distance de son objet. À ce moment et de manière presque paradoxale, « c’est parce que l’histoire cesse d’être essentiellement contemporaine que l’histoire contemporaine, qui ne constitue qu’un aspect de ce qui n’est pas encore une discipline, va peu à peu être identifiée en tant que telle » (p. 49). Mais c’est surtout une césure majeure qui joue dans la modification de notre perception du contemporain : celle de la Révolution française, tournant épistémologique et axiologique qui prend ensuite consistance au cours du xixe siècle. Puisque la Révolution a introduit une coupure, une brèche dans le temps, écrire l’histoire du présent ne peut avoir la force de l’évidence. C’est donc « parce qu’elle s’est singularisée » que l’histoire du passé proche « a pu susciter en retour des formes de rejet » (p. 73). Avec l’idée du progrès qui devient obsédante, l’histoire cherche à penser le mouvement de l’humanité dans une visée universelle. Ainsi, entreprenant une interprétation globalisante, elle fraternise avec la démarche philosophique. Et cela n’est pas innocent dans « une perception de l’histoire en marche entièrement fondée sur l’accélération du temps présent, perçu désormais comme une transition instable » (p. 58). D’où cette sorte de discrédit qui pèse sur une histoire contemporaine conçue comme « trop dépendante des réalités de son temps » (p. 64). Puisque le présent est variable et inscrit dans une histoire inachevée, il devient vain de tenter d’en rendre compte.
6Avec la Première Guerre mondiale, un seuil est ensuite franchi. Le bouleversement est sans précédent du fait de l’intensité des destructions. L’histoire se redéfinit alors de façon plurielle, notamment parce qu’elle est mobilisée au service de la guerre et est ainsi conviée à se lier de manière étroite au présent. « L’engagement devient la norme, la neutralité impensable » (p. 90) : l’historien doit désormais être utile. L’histoire du temps présent ne court pourtant pas « seulement le risque d’être prisonnière des passions de l’heure, elle devient elle‑même l’une des passions les plus vives de l’après‑guerre au plan national et international » (p. 91). Le ton et le tempo de notre siècle semblent donnés. En tout cas, puisque impliquée politiquement, l’histoire objective et distante perd de ses prérogatives, et ses arguments à l’encontre de l’histoire du temps présent s’amenuisent. « La posture subjective, autrefois hérétique, se répand chez les historiens d’après‑guerre » (p. 103). Ce déclin du paradigme de l’objectivité est d’ailleurs conforté par l’établissement de liens accrus avec les autres sciences sociales qui entraînent une attention plus grande pour le contemporain1. La Grande Guerre a ainsi engendré ce qui sera une constante dans notre siècle : une véritable demande sociale de compréhension du passé qui taraude notre regard sur le monde et implique une mue de notre conscience historique. Désormais, « les souvenirs de l’histoire la plus proche ont envahi le champ social et politique » (p. 103). Demeure pourtant quelque chose de l’ordre de l’ambiguïté et de l’oscillation qui parcourra finalement le siècle :
le passé proche se voit à la fois rejeté comme souvenir d’épouvante tout en obsédant les consciences à une échelle jusque là inédite (p. 101)
7La coupure entre le passé et le présent ne peut donc plus être affirmée aussi fermement qu’après la Révolution, si bien que l’histoire du temps présent commence à se dessiner.
8De toute évidence, la dernière césure essentielle s’impose avec la Seconde Guerre mondiale. Les séquelles y fonctionnent comme un alambic où se distille « un intérêt encore plus marqué pour l’histoire du temps présent » (p. 114). L’urgence est celle‑ci : comprendre le présent. Mais, comme entre la Révolution et la Grande Guerre, la différence dans l’ampleur de la catastrophe redéfinit les enjeux et confère une autre extension à ces questions. Toutes les interrogations sur l’histoire, la mémoire et la politique, soulevées après la Première Guerre, sont décuplées. Et, ici, c’est assurément la nature singulière d’un événement qui a joué : le génocide des Juifs. Car cet événement demeure la blessure non cicatrisée de nos sociétés, « l’élément central d’une culture de la mémoire qui marque profondément notre régime d’historicité » (p. 116). H. Rousso rappelle à ce titre qu’au cœur même du génocide plusieurs tentatives de préserver des traces pour l’avenir se sont fait jour (p. 116). La pratique de l’histoire du présent commence dans un monde livré au chaos, à l’anarchie et au non‑sens. Malgré les retardements, les réticences, les refoulements, les problèmes d’ordre moral, c’est donc cette période et sa mise en récit « qui ont durablement structuré l’écriture de l’histoire du temps présent » (p. 135). Elles ont posé les jalons de cette pratique : le travail sur les relations entre histoire et mémoire, la réflexion sur la place à accorder à la morale, la question du point de vue des victimes et des bourreaux, du rôle du témoignage :
Écrire l’histoire n’est plus seulement un exercice de compréhension et de réflexion, c’est une confrontation, un combat avec un passé toujours présent (p. 136).
9Une lutte toujours réentreprise, une question incessamment relancée.
10Le panorama est‑il achevé ? Pas exactement. Si l’institutionnalisation de l’histoire du temps présent amorcée après 1945 s’est poursuivie au cours du siècle, ce sont ensuite les années 1970‑1980 qui, principalement, marquent « la fin des dernières réticences épistémologiques » (p. 145) à son égard. Au‑delà de cette évolution interne au champ historique, c’est encore une fois toute la société qui porte ce mouvement. Les dernières décennies du siècle ont été caractérisées par une demande sociale d’histoire accrue, issue d’un besoin tenace et impérieux de comprendre le passé proche. Évidemment, ont joué ici les événements de 1968 et l’incroyable levée des tabous qui en a résulté, tout comme la chute du Mur de Berlin qui a relancé ce processus. Aussi l’intérêt pour l’histoire du présent n’a‑t‑il cessé de croître. Le présent est bien « devenu le régime d’historicité dominant » (p. 144) et « a même acquis le statut d’étalon de mesure pour appréhender d’autres périodes de l’histoire ». Après les années 1970 et aujourd’hui encore, l’histoire du temps présent occupe en effet « une place inédite dans l’espace public et la culture populaire » (p. 170). Car « l’histoire générale devient un objet de consommation de masse, d’investissement culturel et de divertissement » ; la mémoire s’est muée en une catégorie intellectuelle et sociale soutenue par la multiplication des commémorations, la vague sans précédent de patrimonialisations, et la place nouvelle que lui ont accordée les médias.
11De ce regard rétrospectif, on peut donc déduire quelques caractéristiques de la pratique de l’histoire du temps présent aujourd’hui. La longue durée y demeure « de faible pertinence pour analyser les sociétés de masse contemporaines, marquées par la vitesse et la succession d’événements construits et perçus comme autant de ruptures dans une continuité historique qui a perdu de sa lisibilité. » (p. 152) C’est pourquoi aujourd’hui « la contemporanéité ne définit pas un moment figé du temps mais un mouvement en cours » (p. 175). « L’aporie fondamentale de toute histoire contemporaine » est alors que l’analyste est « obligé de créer sa propre distance » (p. 174‑175). Trois points peuvent ainsi être identifiés dans le renouveau de l’histoire du temps présent. D’abord le fait que les événements ne peuvent plus être pensés comme les manifestations d’autres événements plus souterrains et à plus long terme. Ils sont porteurs de significations diverses et non isolables de manière simple. Ensuite le rôle des médias, de la société et des autres sciences sociales qui sont aussi des objets d’étude et des vecteurs d’information. Enfin la place primordiale de la mémoire qui ne cesse de raviver les bords d’une plaie incapable de se refermer.
Du traumatisme à la catharsis : écrire l’histoire du présent comme réponse à la dernière catastrophe
12Au cœur de cette analyse, il est pourtant comme une basse continue sur laquelle H. Rousso nous invite à nous interroger : la catastrophe. L’essai, afin de nous en faire mesurer la portée, prend soin d’en rappeler l’étymologie. Kata‑strophê désigne un renversement complet, un retournement de situation. Il semble ainsi que, dans ce panorama historique de l’histoire contemporaine, qui réintroduit de la distance dans le proche, la catastrophe soit l’élément constant sur lequel l’homme n’a cessé de butter. Or ce retournement absolu et brutal s’inscrit dans l’ordre de l’instantané et occulte pour un temps toute perspective de longue durée. À chaque catastrophe, à chaque suppression de l’horizon du passé, la soif de comprendre a eu des répercussions sur la pratique de l’histoire du présent. Les conséquences tirées de la Révolution française semblent y répondre logiquement en constatant une brèche qui rend le contemporain inexplorable, alors même que la période se caractérise par un regain énergique et disparate d’intérêt pour l’histoire présente à travers des approches extrêmement diverses, avec Michelet, Dumas, Thiers ou Tocqueville. Ce qui fait que, malgré les doutes et les réserves, l’histoire du présent préoccupe, voire obsède, et se développe malgré tout en empruntant des chemins de traverse. Notre xxe siècle, lui, s’est fondé sur ce qui relève plus manifestement d’une sorte de paradoxe, mais qui n’est peut‑être que de surface : les deux grandes catastrophes qui ont occulté la longue durée ont fait surgir une histoire du temps présent alors même que celle‑ci ne peut fonctionner qu’en rétablissant du lointain dans le proche et l’immédiat. À ce titre, ce sont donc les événements les plus extrêmes, ceux qui semblaient pourtant interdire le plus violemment toute prise de recul, qui ont accouché d’un sursaut de l’histoire du temps présent et donc d’une greffe de distance sur l’instantané propre à la catastrophe. Mais ce paradoxe est moins radical qu’il ne semble dès lors qu’on prend en considération non seulement l’événement mais ses répercussions, c’est‑à‑dire les blessures et les processus de cicatrisation qu’il a fait naître et qui passent, de manière privilégiée, par la mémoire.
13Si penser la catastrophe n’est donc pas le cœur même de l’essai d’H. Rousso, il s’agit d’une question qui, revenant régulièrement, donne sa coloration à la réflexion en éclairant de manière inédite l’histoire du temps présent. Le titre donne l’alerte pour le lecteur. Mais il est en réalité à double entente. Il s’agit évidemment de souligner comment l’histoire du passé le plus proche est souvent histoire de la dernière catastrophe mais surtout comment l’histoire du temps présent s’est elle‑même redessinée avec vigueur après chaque grande catastrophe. Car cette histoire du présent, H. Rousso la retrace à l’aide d’une périodisation précise qui repose sur des césures épistémologiques scandées par les catastrophes. Celles‑ci doivent donc nous apparaître comme des ruptures historiques mouvantes qui impliquent des retournements intellectuels dont l’onde sismique a affecté la manière d’en faire et d’en concevoir l’histoire. Comme une ombre portée, le titre de l’essai accompagne donc le lecteur dans sa découverte des manières de faire l’histoire du temps présent et ne cesse de lui rappeler que le traumatisme historique n’est pas seulement un objet de prédilection dans la pensée historienne mais qu’il vaut aussi par ses répercussions intellectuelles. On constate alors que les débats épistémologiques les plus vifs autour de l’écriture de l’histoire du temps présent se sont déroulés dans les périodes qui ont suivi les catastrophes les plus importantes où le passé proche était devenu un enjeu crucial dans l’espace public. La catastrophe doit ainsi être considérée comme une sorte de mécanisme souterrain qui agit sur notre histoire comme sur la façon dont nous l’écrivons. Il ne faut donc pas se leurrer : entre l’histoire qui s’est déroulée et le récit historique qui en est fait, il y a plus qu’un simple rapport entre un objet et son analyse. Notre manière de faire l’histoire est aussi le produit de son propre objet dont elle ne peut être dissociée.
14La question demeure néanmoins brûlante : comment construire un discours heuristique dans la proximité, la passion, la mémoire vive, l’urgence, voire le refoulement ? L’une des oppositions les plus récurrentes à une histoire du temps présent est assurément le besoin d’un temps de latence qui permet la distance, le tri des sources, l’apaisement des partis pris, l’achèvement complet des processus historiques. Bref cela suppose de se dégager des affects impliqués par la mémoire et les traumatismes de la dernière catastrophe. Ce qui est vrai pour toutes les phases « post‑traumatiques ». Se dévoilent ainsi des affinités troublantes de l’écriture du temps présent avec le travail du deuil, la perlaboration, la cure analytique ou, pour prolonger les potentialités théâtrales contenues dans le mot « catastrophe », une forme de catharsis2. Si ce n’est que l’histoire du temps présent ne peut être limitée à une dimension thérapeutique et doit avoir conscience de cette proximité dont elle ne peut rester prisonnière. Le traumatisme pose en effet nécessairement la question de la nature de l’événement réel qui l’a engendré comme celle de ses réactions, qui peuvent se dérouler dans l’ordre du fantasme, de la pathologie, de l’obsession ou de la censure. Aussi l’histoire du temps présent doit‑elle avoir conscience des réactions subjectives de la société, dans lesquelles elle est elle‑même prise, qui l’influencent elles aussi, pour pouvoir construire au mieux son propre discours. H. Rousso induit ainsi l’existence de deux attitudes antagonistes face à la catastrophe que l’on retrouve aussi dans la pratique de l’histoire : une réponse non traumatique et une réponse traumatique. Si celles‑ci empruntent des chemins divers, elles se télescopent parfois, comme dans la période postrévolutionnaire et l’après‑guerre, recourant aussi à d’autres modes d’expression que l’histoire scientifique lorsque celle‑ci se replie sur le refus en choisissant délibérément le non traumatique ou l’amnésie. D’où un complexe jeu d’influences réciproques entre ces deux approches. Dialoguant aussi bien avec Arendt qu’avec Pierre Nora, H. Rousso affirme ainsi que
l’obsessionnelle présence du passé dans laquelle nous vivons ne relève pas seulement d’une perte de la tradition, d’une rupture inconsidérée avec le passé, d’une inconscience quasi prométhéenne qui enfermerait les sociétés post‑modernes (…) dans un présent perpétuel et nous ferait ainsi consommer de l’histoire (…). Elle ressortit aussi, peut‑être même plus, à la nécessité impérieuse de se libérer du poids des morts, des dizaines de milliers de morts, des destructions sans précédent occasionnées par la folie humaine et non par une quelconque fatalité. D’où cette autre tension entre exigence du souvenir et nécessité de l’oubli qui caractérise les débats récents autour des dernières catastrophes du siècle (p. 173).
15H. Rousso ne pense donc pas que l’accroissement de l’histoire contemporaine aujourd’hui soit le signe d’un repli sur le présent mais bien une manière de lui résister puisque celle‑ci vise à réintroduire de la distance et de la perspective, elle en « constitue un antidote et non un symptôme » (p. 202) :
Faire l’histoire du temps présent, c’est au contraire postuler que ce présent possède une épaisseur, une profondeur (…). Comme toute bonne histoire, il s’agit (…) de proposer un ordre d’intelligibilité qui essaye d’échapper à l’émotion de l’instant, ou pour user d’un vocabulaire lacanien, d’instituer un peu de symbolique là où l’imaginaire a tout envahi (p. 206).
16Face à un réel impossible et inatteignable et contre la défaillance du symbolique, l’histoire, à la manière de l’analyse, ferait ainsi valoir sa capacité à la représentation à la fois en élevant l’imaginaire au symbolique et en pénétrant le réel par le symbolique3. Si on avait pu reprocher à H. Rousso d’analyser l’Occupation et sa mémoire dans Le Syndrome de Vichy à l’aide de catégories psychanalytiques, justifiées par un dessein heuristique et épistémologique, ce modèle ne semble donc pas entièrement absent de La Dernière catastrophe où, malgré un usage parcimonieux et prudent, il est pleinement opératoire. L’essai équilibre en effet très discrètement la rationalité historique par un point de vue psychologique ou psychanalytique et inversement. Il fait circuler les pratiques des sciences humaines pour enrichir le regard historique, l’empêcher de s’enfermer dans des logiques autarciques, mais c’est surtout parce que toute histoire du temps présent l’impose. Ainsi comprend‑on mieux que, face à l’événement catastrophique, tout récit a nécessairement une dimension thérapeutique et cathartique dont il faut être conscient, puisque celle‑ci soulève des questions d’importance quant à l’objectivité, au témoignage et au jugement moral. Le récit qui est fait doit donc nous apparaître, qu’il soit récit du passé proche, de l’événement lui‑même, de ses suites, de ses séquelles ou qu’il tente de l’oublier, comme une nécessité mais aussi comme une réaction, sans quoi nous resterions prisonniers d’une vision scientifique et idéalisée de la pratique historique.
L’historien & le transfert : du témoin au juge
17Si l’historien ne peut être ramené au rôle de l’analyste, son statut fait pourtant problème d’une autre manière devant la catastrophe dans la mesure où l’historien fait face à ceux qui l’ont connue, à ses témoins qui la vivent de manière individuelle et subjective. La catastrophe étant le temps déréglé, imposant une réponse qui cherche soit à réorganiser le temps et les mémoires, soit à rendre compte de leur désordre, l’histoire du temps présent affronte la désynchronisation des vécus. Ces décalages omniprésents, l’essai les interroge dès son ouverture à l’aide d’une anecdote qui vaut pour un apologue signifiant. H. Rousso se voit lui‑même rétorquer, au sujet de travaux sur la période de Vichy, « vous n’y étiez pas ! ». Ce désaveu pose en réalité la question de la conjonction de deux statuts usuellement séparés lorsqu’il s’agit d’écrire l’histoire d’une période ancienne : celui du témoin et celui de l’historien. Écrire le passé proche conditionne nécessairement ce genre de recoupements et modifie la participation de l’historien à l’histoire dont il traite. D’autant plus qu’avec la Seconde Guerre, la dimension politique a été encore plus cruciale que dans la première. Avec une lutte qui était idéologique, à laquelle ont participé des historiens, des philosophes, des écrivains et des savants devenus collaborateurs de Vichy ou du régime nazi, ou devenus opposants ou résistants. Dans cette rencontre entre l’historien et le témoin, qui est aussi une friction, le traumatisme soulève alors les problèmes de l’objectivité et de la subjectivité, de l’histoire et de la mémoire, de la distance et de la proximité. Pour l’historien du temps présent, il ne s’agit donc « pas simplement de mesurer le temps historique mais de comprendre la relation entre le passé étudié et [son] présent » (p. 204).
18Mais ces tensions valent plus largement pour la relation entretenue par tout historien avec les témoins. Dès la Première Guerre, ces deux figures se tiennent face à face. Le témoin est celui qui parle au nom des morts et qui trouve sa place dans l’espace public. La mémoire collective s’y nourrit et s’y construit avec les premières politiques mémorielles. Mais celui‑ci entretient des relations complexes avec les discours savants jusqu’à devenir parfois un rival de l’historien. Leurs difficiles relations de complémentarité et d’opposition vont se prolonger tout au long du siècle, des relations dont les bornes extrêmes vont de la sacralisation à la suspicion. Car H. Rousso refuse de faire du témoin une simple idée ou une fonction mobilisée à dessein par l’historien : il s’agit d’une personne réelle, incarnée, avec ses blessures, ses réussites, son propre regard. Ce qui explique qu’il est possible d’entrapercevoir dans ces rapports complexes un mécanisme qui n’est pas dénué de parentés avec celui du transfert. Mais plutôt que de contourner cet aspect de la pratique historienne, de refuser catégoriquement ne serait‑ce que l’idée du divan, il s’agit plutôt d’y être attentif pour ne pas en être la dupe. Ayant à travailler sur des questions particulièrement sensibles, les historiens du temps présent ont donc
dû inventer sinon des méthodes, du moins une manière de se placer dans le paysage. Ils ont dû créer leurs hiérarchies à l’égard des témoins, en essayant de maîtriser leurs affects sans pour autant renoncer à leurs émotions. Ils ont dû accepter que le « Mal » s’incarnât dans des individus de chair et de sang qu’il fallait approcher, apprivoiser, interroger, sans perdre de vue ce qu’ils avaient fait, et que les figures héroïques, les martyrs, les vaincus de l’Histoire ne pouvaient être considérés comme des intouchables, indignes d’un regard critique (p. 162).
19Il a donc fallu faire « le choix d’une subjectivité assumée » plus que celui « d’une objectivité forcée ». « Plutôt que d’ignorer ses propres inclinaisons ou sa propre identité, l’historien doit s’en servir pour poser à sa manière des problèmes qui ne peuvent être traités de façon “neutre” » (p. 162). Le degré zéro de la subjectivité et de la responsabilité est un leurre. Et c’est bien à une véritable éducation critique du regard que l’historien a été appelé après‑guerre alors même que la présence du témoin risquait de l’empêcher. L’histoire ne peut être ni sceptique ni dogmatique et la critique des sources, à travers une mémoire qui peut contenir de la fabulation, est une nécessité.
20En creux, une question essentielle est donc soulevée : celle de la place de l’historien dans la Cité. C’est ainsi un autre type de transfert dont il s’agit. Celui qui fait migrer l’historien sur d’autres terres, celles du philosophe, du moraliste, de l’expert ou du juge. La Dernière catastrophe propose ainsi un portrait disséminé de l’historien en transfuge sur les rivages des pratiques sociales du jugement. Celui‑ci n’est plus la boîte noire ou le simple scribe dévolus à l’enregistrement neutre du passé mais un spécialiste convoqué à formuler son diagnostic et, parfois, des principes thérapeutiques. H. Rousso insiste en effet sur le changement de paradigme intervenu au xixe siècle où, avec la notion de progrès, « l’histoire devient une instance ultime de jugement » (p. 59). Proche du philosophe, l’historien est alors capable de lire le présent et le passé pour en tirer des leçons. Après la phase de propagande durant la Première Guerre, l’historien, plongé dans les nécessités d’interpréter le traumatisme, a été contraint de se poser comme expert, collaborant aux traités et à l’établissement des frontières (p. 95). Bien sûr, après la Seconde Guerre, ces enjeux se cristallisent avec plus d’intensité encore, en ouvrant à une phase de judiciarisation de l’histoire sans précédent. H. Rousso rappelle ainsi que beaucoup d’institutions qui ont pris en charge l’histoire du présent ont participé aux procès et procédures contre les criminels nazis. C’est la préparation des procès, avec la réunion des preuves et des témoignages, qui devient alors le vaste chantier préparatoire au travail de l’historien du présent. C’est la multiplication de ces procédures judiciaires qui, finalement, a donc aussi accéléré la mise en récit du passé proche (p. 126). L’historien est invité à prendre place à la tribune où s’assouvit le besoin social si puissant du jugement, qu’il soit d’ordre juridique, moral ou scientifique. Dans cette ébullition mémorielle et intellectuelle, le discours historique encourt cependant des risques. Ceux d’outrepasser son rôle, de perdre en lucidité et aussi de demeurer second par rapport à l’analyse judiciaire.
21Ce nouveau régime de justice n’est pas indifférent aux nécessités de la réparation qui parcourront alors le siècle et les autres catastrophes :
cette marque originelle va influer durant des décennies, et jusqu’à aujourd’hui, sur l’écriture de l’histoire des grandes catastrophes du xxe siècle et explique que l’historiographie du temps présent entretienne encore des liens à la fois étroits et conflictuels avec le droit et la justice (p. 127).
22Reste que c’est ainsi que l’histoire du temps présent affronte peut‑être le plus directement ses limites mais aussi la question de son sens et de son rôle profond.
***
23Plongée au cœur de la Cité, l’histoire du présent revêt une dimension politique et anthropologique exceptionnelle. Elle est confrontée plus que jamais à son rôle dans la définition du bien et du mal, dans la vision du passé, la compréhension du présent et la préparation de l’avenir. Elle rappelle à l’historien qu’il est « embarqué » et qu’il doit répondre de ce mot que Sartre avait imposé à tout intellectuel après‑guerre : la responsabilité.

