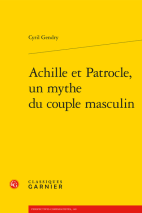
Achille et Patrocle : itinéraire et cartographie d’un couple devenu mythique
I knew I’d stumbled on something too private to be witnessed. There were always those, then and later, who believed Achilles and Patroclus were lovers. Theirs was a relationship that invited speculation […]. And perhaps they were lovers, or had been at some stage, but what I saw on the beach that night went beyond sex, and perhaps even beyond love. I didn’t understand it then — and I’m not sure I do now — but I recognized its power1.
1Dans son article précurseur consacré aux liens entre « mythes, littérature et gender », Véronique Gély pose la question de l’existence de « mythes masculins2 », regrettant le manque d’études sur les masculinités en comparaison de celles menées sur les « mythes féminins », plus particulièrement sur « l’âge d’homme », défini comme « la maturité active, de celui qui est censé [...] exercer charges, responsabilités, pouvoir3 ». Semblant répondre à cet appel, l’ouvrage de Cyril Gendry vient retracer la réception d’un couple supra-célèbre qui restait en attente d’une « étude d’importance » (p. 25) d’ordre diachronique s’intéressant à la nature de leur relation, de même qu’il apporte un éclairage bienvenu au domaine de l’étude des mythes, alimenté par les études de genre et les études gays. L’auteur met à profit sa formation en lettres classiques dans cette publication qui reprend sa thèse de littérature comparée, dirigée par Véronique Gély et soutenue en 2020 à Sorbonne Université : l’ouvrage prend en effet à bras-le-corps cette vision « anachronique » (p. 19) faisant d’Achille et de Patrocle un couple homosexuel, qui circule dans les productions culturelles contemporaines (notamment de l’aire anglophone4) et fonde l’hypothèse de recherche à l’origine de l’étude (p. 29), dont le lecteur est invité à observer les évolutions au fil des introductions et conclusions partielles.
2Les réflexions de Cyril Gendry s’inscrivent en ce sens dans l’héritage des débats historiographiques ayant eu cours dans les années 1980 et 1990 à partir des travaux de John Winkler et de David Halperin, lesquels postulent que l’Antiquité grecque se situe « before sexuality5 », c’est-à-dire qu’il s’agit d’une « société où les catégories d’homo– et d’hétérosexualité n’existent pas mais aussi [d’]une société dans laquelle le sexe n’est pas un critère identitaire6 ». Si, depuis ces débats, l’Antiquité a cristallisé de nombreuses réflexions sur les identités de genre et les sexualités7, l’ouvrage éclaire avec précision cette période tout en considérant sur le temps long la perception de la nature de la relation entre Achille et Patrocle, se situant en ce sens dans le sillage d’études d’ampleur comme celles de Véronique Gély sur Psyché ou de Sylvie Ballestra-Puech sur Arachné (p. 28). En remettant en question ce qui a caractère d’évidence dans les productions contemporaines, mais également l’accusation de « surinterprétation des textes » dont souffrent les « études gays et lesbiennes » (p. 13), Cyril Gendry montre que cette lecture provient paradoxalement de lettrés et que cette association coïncide avec la construction d’une identité homosexuelle au xixe siècle, qui fut étudiée par Michel Foucault dans Histoire de la sexualité (1976-1984). Par une « pratique contrôlée de l’anachronisme8 », en faveur de laquelle plaidait Nicole Loraux, cet ouvrage permet de montrer l’actualité des antiques et de « reconfigurer nos propres catégories à la lumière d’une altérité » (p. 21) constitutive du monde antique conçu comme « territoire des écarts9 ».
3Cette enquête vise à revenir au moment poétique du mythe d’Achille et Patrocle, au sens étymologique du terme (au moment où ils sont créés dans et par les œuvres), selon le processus du « devenir-mythe10 » convoqué à plusieurs reprises dans l’ouvrage : la démarche s’inscrit ainsi dans le domaine de la « mythopoétique » qui vise « à historiciser et à analyser les mythes à travers leurs variations, leurs réinventions et leurs reconfigurations » (p. 15) selon une vision anti-essentialiste des mythes portée par Véronique Gély, Pierre Brunel et Ute Heidmann. La première partie de l’ouvrage se livre à ces analyses en adoptant une démarche diachronique qui cherche à embrasser un immense corpus d’œuvres, afin d’éclairer les absences et les temps forts de cette réception à partir de la figure secondaire de Patrocle. En ce sens, l’ouvrage s’apparente à « une archéologie visant à retracer les traditions rhétoriques, philosophiques, culturelles qui ont pu reconfigurer les mythes en dehors du champ poétique11 ». L’une des originalités de l’étude est en effet la large part laissée à la tradition rhétorique et aux ouvrages non-fictionnels, qui sont étudiés en deuxième partie pour leur double intérêt : leur rôle de conservatoire en ce qui concerne ces deux figures issues des épopées homériques, ainsi que leur paradoxale participation à la création d’un mythe pourtant associé au domaine du récit. La troisième partie se concentre sur la nature de cette relation, retraçant son association au fil des époques avec les formes variées que revêtent les relations entre hommes (le compagnonnage, l’amitié, la relation amoureuse), pour mieux montrer que se dessine derrière le couple formé par Achille et Patrocle « une forme d’idéal de la relation masculine » (p. 42). Ce compte rendu suivra l’organisation de l’ouvrage afin de mettre en lumière les apports théoriques de cette étude, qui s’impose comme une référence essentielle par ses analyses à la fois larges et pointues sur un corpus d’ampleur.
Patrocle « dans l’ombre d’Achille » (p. 25)… et d’Homère
4Pas moins de 909 ouvrages recensés via des outils numériques sont en effet convoqués par Cyril Gendry afin de retracer l’itinéraire du couple, depuis les épopées d’Homère jusqu’à l’« Iliade gay » (p. 294) de Madeline Miller. Outre cette « approche diachronique » (p. 18) que préconise la démarche mythocritique telle que définie par Sylvie Ballestra-Puech12, l’ouvrage prend en compte de « grands espaces » (p. 18) en considérant des textes en grec ancien, en latin, en anglais et en français, qui dépassent les frontières de l’Europe occidentale (le chercheur précise que l’intégration d’œuvres en italien aurait été profitable pour le sujet traité, p. 31).
5La présence en annexe d’un immense tableau (p. 647-687) détaillant le corpus primaire, ainsi que l’intégration de graphiques commentés avec soin à plusieurs moments de l’étude témoignent de l’exhaustivité de la démarche. L’auteur parvient à dresser un « panorama général » par un mouvement de va-et-vient entre « distant » et « close reading13 » (p. 29) qui révèle la problématique du traitement de larges corpus en littérature comparée14. Cela lui permet d’élaborer des connaissances sur le fonctionnement dynamique des mythes faits de répétitions et de variations, sur des périodes historiques, dans leur dimension culturelle comme politique, ainsi que sur le rapport, parfois conflictuel ou admiratif, à l’Antiquité grecque et plus particulièrement à la matière troyenne et à la figure d’Homère. L’étendue du corpus ainsi recensé explique le choix de l’auteur de se concentrer sur les occurrences visant Patrocle, moins cité qu’Achille et systématiquement présenté comme le compagnon de ce dernier, ce qui lui permet de déterminer que c’est la relation entre les deux protagonistes qui est d’abord mythique. Patrocle est en effet un « personnage‑couple » (p. 302) ne jouissant d’aucune autonomie en dehors des épopées homériques qui sont les seules du Cycle épique à lui donner une « place prépondérante » (p. 53). Cette première partie permet ainsi de livrer une étude inédite de la figure de Patrocle et s’inscrit en ce sens dans un mouvement récent qui envisage les mythes à partir de la perspective de personnages mineurs15, problématisée au long de l’ouvrage au prisme de la relation entre les deux hommes.
6L’auteur examine le rôle narratif d’importance occupé par Patrocle dans l’Iliade, dont il assure « toute l’unité d’action » (p. 58), tout en mettant au jour le caractère secondaire d’un personnage dénué de qualificatif propre dans sa relation avec Achille : c’est ce paradoxe qui va pouvoir nourrir les interrogations futures, ainsi que les scènes intimes dans lesquelles les deux héros « partagent une vie domestique16 » (p. 58). En outre, leur association au genre épique va participer de leur exemplarité et expliquer leur présence accrue dans l’exégèse homérique, les manuels de rhétorique et les réflexions philosophiques. L’étude montre ensuite plusieurs tournants dans la réception de Patrocle, directement imputables à la réception d’Homère au fil des siècles : celui‑ci est en effet convoqué à des moments charnières, dans le but d’asseoir une domination culturelle « dans des périodes de reconfiguration politique » ou de légitimer de « nouvelles esthétiques » (p. 300).
7L’Antiquité occupe quantitativement la plus grande place dans cette première partie, en raison du nombre de siècles représentés permettant des développements clés en ce qui concerne la relation d’Achille et Patrocle, notamment, dans l’Athènes classique, sa relecture pédérastique par Eschyle et Platon, ainsi que son association à la philia par Aristote. Ces propositions ne trouvant cependant pas d’échos immédiats, c’est paradoxalement l’emploi rhétorique qu’en fait cet ensemble « de rhéteurs, grammairiens, philosophes et poètes » (p. 107) constituant la Seconde Sophistique, qui influence la réception de Patrocle sur un millénaire et participe à conserver et transmettre les épopées par le biais de manuels, résumés et commentaires. Dans ce cadre, « le recours à l’exemplification à travers ces figures est absolument dépendant du propos et […] l’interprétation qui est donnée de l’œuvre d’Homère n’est pas tant un commentaire de son épopée qu’un appui passager à la réflexion des philosophes » (p. 85). Cyril Gendry montre qu’« en plus de quinze siècles, la figure de Patrocle n’[a] pas connu de caractérisation profondément différente de ce qu’a pu en dire Homère » (p. 71), car il est avant tout convoqué comme personnage tiré de l’Iliade. Considéré comme l’éducateur de la Grèce (p. 72), Homère dispose en effet d’une autorité culturelle auprès des Grecs et dans la littérature latine qui cherche « à gagner ses lettres de noblesse par la recréation d’un patrimoine littéraire vernaculaire » (p. 97). C’est ce qui explique que l’étude puisse s’attarder sur des ouvrages qui ne présentent « pas d’originalité » (p. 138) ou, au contraire, qui restent absolument exceptionnels, et proposer des hypothèses quant à l’absence de conservation de certaines sources, dans le but de dessiner en négatif la réception de Patrocle et d’expliquer la « perpétuation de son souvenir » (p. 138).
8Le déclin de l’autorité d’Homère à partir du iiie siècle et la perception de la guerre de Troie en tant que « fait historique dont il fallait rendre compte selon des critères de vérité » (p. 163) vont autoriser des réécritures de la matière troyenne dans l’Antiquité tardive qui adoptent une perspective plus large sur les événements. Ces réécritures latines donnent naissance à de nouvelles versions alternatives au Moyen Âge, notamment celle, majeure, de Benoît de Sainte-Maure au xiie siècle (Le Roman de Troie, fondé sur le récit de Darès le Phrygien et popularisé par Guido delle Colonne, p. 192), et se distinguent en ce qu’elles considèrent davantage le point de vue des Troyens pour des raisons politiques et reconfigurent la figure d’Achille au prisme de la passion, en valorisant les intrigues amoureuses avec Polyxène ou, plus rarement, Briséis (p. 178). Si, entre 1453 et 1609, ces traditions vont continuer de coexister aux côtés de la version donnée par les épopées homériques, ce dont témoigne la pièce de William Shakespeare (Troilus and Cressida), certains humanistes, comme François Rabelais, reviennent au texte homérique et en proposent des lectures érudites. La Renaissance marque ainsi le grand retour d’Homère et de ses épopées, après leur édition en 1488 par les frères Nerli à Florence, qui s’accompagne de discussions dans les siècles suivants sur sa place dans l’histoire littéraire, notamment par rapport à la figure tutélaire de Virgile. Cependant, les épopées en elles-mêmes ne sont pas véritablement considérées avant leur traduction intégrale en prose par Anne Dacier, qui cherche à donner une version fidèle du texte et à défendre Homère auprès de ses contemporains17, bientôt suivie de celle d’Houdar de la Motte donnant lieu à la Querelle d’Homère. L’apparition de la question textuelle à ce moment-là marque le retour de Patrocle (dont le sort est décidément lié à l’Iliade) dans les lettres, notamment au théâtre. Le fleurissement de diverses traductions des épopées homériques au moment de cette Querelle, notamment celle de référence dans les lettres anglaises, livrée par Alexander Pope, permet à Homère de retrouver sa vocation didactique et de s’imposer comme « une référence essentielle dans la culture lettrée » (p. 216).
9Ce retour à un mode de citation similaire à celui de la rhétorique grecque pour appuyer une démonstration est ensuite réinvesti idéologiquement au début du xxe siècle, à l’aune d’une réflexion sur l’héroïsme en temps de guerre (p. 265). C’est dans ce cadre que de rares textes s’intéressent spécifiquement à Patrocle « comme l’incarnation d’une forme différente d’héroïsme, souvent empreint de délicatesse et d’innocence » (p. 266) en raison de sa « douceur18 » : dans L’Iliade ou le poème de la force par exemple, Simone Weil voit dans le « sacrifice pour autrui » de Patrocle un « idéal moral » (p. 267). Cette période marque surtout la reconfiguration de la relation d’Achille et Patrocle au prisme de l’homosexualité, alors que celle-ci est théorisée comme phénomène médical (p. 269). En ce sens, l’autorité dont bénéficie Homère va permettre de défendre indirectement « l’acceptabilité de relations homo‑sexuelles » (p. 276), en faisant d’Achille et Patrocle le premier couple homosexuel de l’histoire littéraire européenne, de même qu’elle va paradoxalement nourrir des productions littéraires se confrontant directement à l’autorité du poète et puisant à d’autres sources pour développer cette relation. Pour les interprètes de l’époque, l’amour qu’ils se portent relève alors de la « doxa » (p. 281) et, une fois que cette homosexualité « n’est plus à définir ou à défendre en tant que telle » (p. 280), cette lecture peut être trouvée au sein de fictions, attestant du dialogue entre poétique et rhétorique propice à l’émergence de ce mythe.
Le paradoxe d’« un mythe sans récit » (p. 316)
10Cette étude diachronique a révélé qu’Achille et Patrocle apparaissent davantage en emploi « rhétorique » que « poétique » (p. 305), ce qui invite Cyril Gendry à se demander dans quelle mesure l’on peut considérer cette relation comme relevant du mythe, alors que celui-ci est défini de manière récurrente comme récit19 (le terme mythos renvoyant chez Aristote à la mise en récit d’une fiction, p. 308). L’opposition entre ces deux domaines, développée à partir de la Poétique d’Aristote, relue par Gérard Genette20 et Paul Ricœur21 (p. 307-312), repose sur le fait que le produit du récit (mythos) « n’a pas d’autre vocation qu’être ce récit », quand le produit de la rhétorique (logos) « s’intègre dans une démarche de conviction et de développement de la pensée » (p. 311). En fondant son corpus sur un « entrecroisement » (p. 18), l’étude se propose en « décalage » (p. 311) des autres études sur les mythes reposant essentiellement sur « des analyses de textes appartenant au domaine poétique » (p. 311) : la démarche semble pertinente pour approcher d’autres figures issues des épopées homériques, qui furent elles aussi modelées par les discours et commentaires, comme Circé22 ou Hélène23. L’observation des phénomènes de « circulation » (p. 312) entre domaines poétique et rhétorique, recoupant le « déplacement » et la « transformation » en contexte rhétorique, puis le « retour » dans « une forme dynamique narrative » (p. 316), permet ainsi de « réévaluer notre compréhension du mythe littéraire et de ses liens avec la poétique » (p. 17) en considérant des éléments d’exégèse et en montrant leur potentiel narratif. L’ouvrage s’inscrit en ce sens dans le sillage d’autres études visant à montrer la potentialité mythique, même sous des formes réduites — que l’on pense au phénomène d’« irradiation24 » développé par Pierre Brunel ou aux travaux sur l’image, l’archétype et le symbole25. Cyril Gendry cherche ainsi à montrer que c’est parce qu’Achille et Patrocle ont fait l’objet d’une dénarrativisation (qu’il nomme « délittéralisation », p. 306, ou « démythoïsation », p. 315) qu’ils peuvent ensuite faire l’objet d’une renarrativisation (« relittéralisation », p. 307 ; « remythoïsation », p. 410) et devenir mythiques.
11Cette deuxième partie de l’étude considère Achille et Patrocle en tant qu’exemples rhétoriques, sous quatre formes (p. 315) : le paradigme (« cas exemplaire qui exemplifie à la perfection une règle ou une idée ») ; l’illustration (« l’exemple comme échantillon ») ; le modèle (« exemple visant à l’imitation et contenant donc une portée morale ») et la liste (« accumulation d’exemples »). L’auteur montre à partir de ces exemples la manière dont le récit s’est progressivement retiré, réduisant la relation d’Achille et Patrocle au statut de « topos rhétorique » (p. 359). La démarche synchronique permet de proposer une distinction entre ces différents emplois et d’observer leurs influences sur les représentations de cette relation. Sont d’abord considérés conjointement l’illustration et le modèle, qui confèrent à Homère un rôle éducatif et font de son œuvre un « recueil d’exemples » (p. 320) et de modèles de comportements : l’illustration d’un propos via l’exemple d’Achille et Patrocle, non nécessaire à la démonstration (c’est le « degré zéro de l’exemple », p. 347), joue en effet sur « l’autorité de la référence » (p. 325) et permet d’évoquer indirectement Homère. Le caractère allusif des occurrences rencontrées montre bien que la pertinence de l’exemple vaut si l’on connaît le récit et que l’on comprend le sous‑entendu. Achille et Patrocle constituent d’abord une « référence partagée par tous », avant de devenir une « référence érudite » (p. 330) témoignant d’une transformation des deux héros épiques en personnages de l’Antiquité grecque, ce qui favorise des discours distanciés sur celle-ci, parfois dans une perspective anthropologique de réflexion sur les mœurs et coutumes grecques (notamment les pratiques funéraires). Cet écart explique que se développent des usages non-exemplaires, plaçant Achille et Patrocle au sein d’ouvrages mythographiques, de dictionnaires, de manuels ou de résumés qui donnent accès « en substance » (p. 343) à Homère à des fins didactiques.
12L’exemplarité de la relation est davantage développée dans le cas du paradigme et de la liste, qui ont une incidence sur la représentation du couple et visent à opérer une généralisation à partir d’un « cas remarquable » (p. 347) ou d’une collection de cas (les plaçant sur un axe paradigmatique). Ces usages vont permettre le développement d’analogies, pour dire l’amitié ou l’amour, introduisant de la poétique dans la rhétorique, et inversement au moment de l’essor du roman au xixe siècle (p. 255-258). Si Cyril Gendry montre d’abord que le caractère exemplaire d’Achille et Patrocle est corrélé à leur apparition dans le domaine de l’épopée, les associant à une forme d’excellence aristocratique, et développé dans les réflexions philosophiques centrées sur les relations entre hommes, c’est surtout la liste qui retient son attention comme « processus de démythoïsation » (p. 354). La pratique de la liste se situe en effet au carrefour de la poétique de la copia (p. 366), de la didactique comme support d’apprentissage et de la rhétorique comme forme exemplaire permettant d’établir des généralisations. Si la liste peut être le support d’une réflexion sur la nature de la relation — par exemple chez Xénophon (p. 355-356) et Pierre-Joseph Proudhon (p. 384-385) —, elle répond également à une logique de la compilation qui va rapprocher Achille et Patrocle d’autres figures et participer à les caractériser (par rapport à Oreste et Pylade ou à David et Jonathan), tout en les rendant paradoxalement interchangeables. Au sein de ces listes, les deux héros ne sont plus que des noms, réduisant le mythe à la « métonymie » (p. 386) qui peut être mise au service d’une démonstration d’érudition, y compris dans les ouvrages poétiques au moment de la Renaissance. En conséquence, Achille et Patrocle ne sont plus l’exemple de l’amitié, mais son incarnation ; qu’importent les séquences narratives de leur action, leur simple identité suffit : « ils sont l’amitié, rien que l’amitié, sans même que cette notion soit investie de sens » (p. 393).
13Aussi au tournant du xxe siècle, « la reconstruction de ces deux figures au prisme de l’homosexualité [leur] confère à nouveau une polysémie » (p. 393) et relance une dynamique poétique : leur relation n’est plus « évidente » (p. 409), elle peut alors devenir mythique26. Cyril Gendry analyse ce changement de paradigme, par lequel Achille et Patrocle ne figurent plus « l’amitié en général », mais « l’homosexualité en particulier » (p. 395) et participent à sa défense ainsi qu’à sa définition — un processus qui rappelle le destin d’un autre couple de figures relu par les féministes au xxe siècle, Philomèle et Procné27. Pour John Addington Symonds28, premier théoricien à associer Achille et Patrocle à l’homosexualité en ces termes (p. 270), les deux protagonistes sont le paradigme de l’amour héroïque au moment de l’époque archaïque, durant laquelle Homère aurait composé ses épopées, et les dépositaires d’un « amour grec » (p. 270) qui « fut ensuite oublié », « condamné » et « remplacé » (p. 271). Edward Carpenter29 les intègre de son côté au sein d’une liste opérant comme le « témoignage historique de la permanence des figures masculines amoureuses à travers les époques » (p. 385). Le retour au mythe peut avoir lieu lorsque, vidées de toute substance, les figures d’Achille et Patrocle nécessitent un réinvestissement littéraire : le paradigme fonctionne comme l’image qui appelle « en puissance » (p. 427) le mythe, le caractère heuristique de ce dernier permettant de dire une nouvelle réalité du monde. Ils n’incarnent plus l’amitié, mais permettent de l’approcher par un processus de ressemblance que Cyril Gendry lie à la métaphore (A=B), telle qu’elle fut théorisée par Paul Ricœur dans La Métaphore vive. Pris dans un processus définitionnel, Achille et Patrocle permettent l’« élaboration de similarités entre les formes présentes et passées de relation homo-sexuelle » (p. 415) : ce n’est qu’à partir de cette relecture que « les divers masques de ces figures employées à travers les époques deviennent des avatars d’un même mythe trouvant son incarnation nouvelle selon les contextes et époques » (p. 415). Ces conclusions permettent à Cyril Gendry d’avancer une nouvelle définition du mythe, comme « construction narrative qui modélise un paradigme encore insaisissable sur l’expérience humaine » (p. 416).
14Ce changement de paradigme amène en effet à de nouveaux récits sur la relation d’Achille et Patrocle, qui n’est pas seulement investie d’un nouveau sens : pour devenir mythique, elle ne doit pas se réduire à être un exemple d’homosexualité « circonscrit à des ouvrages rhétoriques », mais « être dynamique » (p. 411) et susciter un réinvestissement poétique. L’auteur analyse en particulier la « réinvention » (au double sens de retrouver et reconfigurer, p. 411) pionnière de Marguerite Yourcenar dans deux nouvelles de Feux (1936) intitulées « Achille ou le Mensonge » et « Patrocle ou le Destin », anticipant les premières fictions des années 1960 qui commencent à s’emparer du sujet, avant que ces réécritures ne se généralisent au xxie siècle. À travers l’exemple de The Song of Achilles, il montre également comment la tradition rhétorique a influencé la représentation poétique : dans ce roman, Madeline Miller reprend à son compte les théorisations de l’homosexualité en tant que « nature propre à l’individu » (p. 624) et en fait la matrice du récit, au prix d’une représentation anachronique du couple qui entre en contradiction avec la volonté « didactique » (p. 422) de cette universitaire cherchant à véhiculer des savoirs socio-culturels. L’auteur montre ainsi comment la matière poétique est reconfigurée afin que soit motivée l’intrigue amoureuse, déplaçant la matière héroïque dans le domaine de l’intime et du quotidien, selon des conceptions « contemporaines de l’amour » (p. 422). À ce titre, Achille et Patrocle restent exemplaires (p. 423), mais cette exemplarité signifie autre chose une fois actualisée au prisme d’un nouveau paradigme de compréhension. Cyril Gendry propose plus loin une piste d’interprétation intéressante au sujet de cette « remythoïsation » (p. 610) : si ce changement de paradigme relance une dynamique fictionnelle, c’est notamment parce que la passion amoureuse est davantage dramatique que l’amitié. Considérée comme la forme parfaite de la relation masculine, l’amitié serait en effet ancrée dans un quotidien difficilement racontable et relèverait plutôt du domaine intellectuel, favorisant de ce fait les réflexions philosophiques. Ce développement s’appuie notamment sur la permanence d’Achille et de Patrocle dans le genre théâtral, où l’intrigue repose le plus souvent sur le caractère passionnel d’Achille : cette passion permet de creuser au contraire l’« imperfection » (p. 612) d’Achille, son humanité et donc sa mortalité, directement liées à Patrocle dans l’Iliade.
L’« amour flou » (p. 574) d’Achille et Patrocle
15Encore faut-il s’entendre sur la nature de cette passion en examinant ses expressions contradictoires. La troisième partie de l’ouvrage est ainsi consacrée à une analyse terminologique dans les quatre langues, en distinguant trois types de relation s’inscrivant dans le « large spectre des formes de sociabilité » (p. 629) : le compagnonnage (hétaïros, socius et sodalis, compagnon et companion), l’amitié (philia, amicitia, amitié, friendship) et l’amour-passion (éros, amor, amour, love). Cette analyse permet de répondre à cette question cruciale suscitant des débats encore vifs chez les antiquisants, mais également dans des milieux moins spécialisés sur internet, à partir du hashtag #Patrochilles30 : Achille et Patrocle forment-ils un couple gay ? La réponse est évidemment complexe selon les siècles, les aires et les auteurs ; elle appelle en cela une étude comparatiste à même de développer une étude contextualisée sur les formes prises par la relation masculine : celle-ci se conçoit à partir de réalités mouvantes, que ce soit dans le caractère sentimental de la relation, dans les actions qui en découlent ou dans la terminologie adoptée. Parce que les trois types de relation peuvent se recouper, le sujet de l’amour est éminemment complexe lorsqu’il est question de l’amitié d’Achille et Patrocle. La difficulté réside encore dans le fait que cette relation n’est le plus souvent pas définie, ni même nommée, ce qui permet de voir que sa caractérisation accompagne le plus souvent des périodes où les relations masculines sont redéfinies ou bien valorisées. Les deux héros forment alors un « noyau stable » sur lequel « s’agrègent, se modifient, se cristallisent » (p. 432) les représentations des relations entre hommes. Cette étude s’inscrit en conséquence dans le sillage de l’histoire des mentalités et des sensibilités telle qu’elle s’est développée dans les années 1970 et 198031 en posant la question, sur le temps long, de l’affection masculine, y compris dans des formes qui sont « peu compréhensible[s] selon des critères contemporains » (p. 488), rappelant l’importance de ne pas penser ses propres conceptions de la sexualité comme universelles et intemporelles (p. 432).
16Tout en définissant avec précision ce mode de sociabilité guerrier et ses implications (p. 438-440), l’étude passe rapidement sur la question des compagnons d’armes, car elle ne trouve que peu d’échos après l’Iliade (où déjà Patrocle se distingue des autres hétaïroï) et constitue plutôt un « point de départ » (p. 451). En revanche, Cyril Gendry remarque que la (re)qualification de la relation entre Achille et Patrocle comme celle de compagnons ou d’amis, conçus comme termes « par défaut » (p. 450), revient lorsqu’il est question de défendre leurs mœurs et de lever toute ambiguïté sexuelle qui condamnerait cette relation selon une « vision conservatrice et homophobe » (p. 451). Xénophon cherche par exemple par ce biais à dédouaner Socrate des accusations de corruption de la jeunesse (p. 87), par opposition à la lecture pédérastique du couple, introduite par Eschyle dans le domaine théâtral (Les Myrmidons), puis développée dans le Banquet de Platon. Dans le discours de Phèdre s’inscrivant dans les débats sur l’âge des héros et leur « statut dans la relation pédérastique supposée » (p. 84), Achille et Patrocle incarnent un idéal philosophique qui prend la forme de l’« amour platonique » (ou « socratique », p. 536), au sens où Patrocle désire à travers Achille, incarnation de l’excellence, « le Beau » (p. 526). C’est moins l’éros que la mise en valeur de la relation masculine qui marque ensuite la réception : Cyril Gendry montre ainsi comment s’établit en France, notamment au moment de la Renaissance, une distinction entre l’amour et l’amitié qui repose sur une bipartition genrée : dans « De l’amitié », Michel de Montaigne relit Platon en proposant de séparer l’amour du corps (hétéro-sexuel), de l’amour de l’esprit (homo-sexuel), qui lui serait supérieur (p. 196 et 552-554). Cet éloge de la relation masculine se fonde également sur les réflexions philosophiques majeures d’Aristote (Éthique à Nicomaque) et de Cicéron (De Amicitia), ayant participé à faire de l’amitié masculine une vertu citoyenne fondée sur la « bienfaisance réciproque » (p. 465). Au moment de la Renaissance française, cette amitié prend la forme d’une « sentimentalité individuelle » (p. 493), mais elle reste « une relation raisonnable et vertueuse » (p. 499) entre des « hommes mûrs et maîtres d’eux-mêmes » (p. 501), par opposition à l’amour‑passion qui est condamné. Le corpus anglophone n’établit pas une telle distinction, mais voit l’amitié comme une « relation sentimentale » (p. 515) entre des êtres libres (friend étant dérivé de free, p. 506).
17Ces différentes relations permettent d’interroger la secondarité de Patrocle dans sa relation à Achille : par rapport au compagnonnage ou à l’éros, l’amitié se définit comme une relation choisie et réciproque (p. 466) entre des semblables (p. 582), qui reste rare et exceptionnelle (p. 466). L’insistance sur cette réciprocité permet de comprendre que l’enjeu de la relation se situe davantage du côté du genre que de la sexualité. Cyril Gendry montre en effet que c’est à une vision très particulière de l’homosexualité qu’Achille et Patrocle sont associés, au moment de sa définition comme relation entre deux hommes, alors qu’elle était auparavant liée à la théorie de l’« inversion sexuelle » (p. 614) conçue comme une déviance de l’ordre du genre : tributaire des évolutions sociétales et des cadres juridiques, l’homosexualité est en effet une identité « complexe et plurielle » (p. 22). Par leur exemplarité, Achille et Patrocle sont les garants d’une « masculinité hégémonique » (p. 642) reposant sur leur ethos guerrier (p. 592), qui va permettre à l’amour entre hommes de se particulariser et de gagner une légitimité au prix de discours misogynes (p. 586-591). C’est ce qui explique que cette relation soit rarement condamnée — le « seul angle d’attaque » (p. 601) touche aux relations sexuelles — et qu’elle soit finalement peu caractérisée au fil des siècles : ses représentations répondent à une « vision naturaliste » (p. 450) de la relation masculine, qui ne se définirait que par l’exclusion de certains comportements. Le mythe d’Achille et Patrocle est donc bien masculin, tel que le définit Véronique Gély, parce qu’il porte sur la différence sexuelle : les deux hommes « incarnent à diverses époques la fiction d’une sociabilité élective propre à conforter un modèle de société guerrière reposant sur l’honneur et l’élection » (p. 626). Si « aucun autre mythe antique ne tient une telle positivité dans sa représentation d’une sexualité et d’un amour entre hommes » (p. 642), c’est parce que cette relation ne remet pas en question « l’ordre établi » (p. 631), elle témoigne au contraire du fait que les « structures sociales du patriarcat se reproduisent dans les normes sexuelles » (p. 540) : en concluant sur l’« homo-normativité » (p. 643) de ce couple masculin, Cyril Gendry se situe dans la continuité de l’ouvrage fondateur pour les études gays et lesbiennes, Épistémologie du placard (1990), dans lequel Eve Kosofsky Sedgwick montre les liens entre misogynie et homosexualité, afin de penser les luttes féministes dans le prolongement des luttes contre l’homophobie.
18Il faut cependant considérer le fait que l’on a pu profiter de l’autorité conférée aux deux héros pour défendre une forme mineure de sexualité, longtemps perçue comme le fait d’une déviance, voire d’une pathologie. Le fait qu’ils soient difficilement attaquables a permis de discuter des mœurs des puissants et d’en faire l’éloge, à l’instar d’Alexandre le Grand (p. 130), d’Henri III ou d’Édouard II (p. 593-596). On pourrait ainsi se demander si Achille et Patrocle sont toujours les dépositaires d’un « idéal de virilité » (p. 591) : dans une intervention sur les reprises fanfictionnelles des deux héros32, Cyril Gendry a montré qu’Achille et Patrocle sont associés à un modèle de masculinité qui ne sert plus le patriarcat, mais le combat. Cette association est permise à partir d’un « female gaze33 », révélateur du fait que les femmes ont participé activement à associer Achille et Patrocle à l’homosexualité dans la fiction et à explorer celle-ci, que l’on pense aux récits de Marguerite Yourcenar (p. 416-420), au poème « The Triumph of Achilles » de Louise Glück (p. 612) ou au roman de Madeline Miller (p. 420-423), conçu « comme le parachèvement du potentiel poétique du mythe d’Achille et Patrocle où l’entièreté de la guerre de Troie est vue au prisme de leur amour et d’une érotique gay » (p. 628). Si l’auteur semble considérer comme acquis qu’Achille et Patrocle forment un couple gay dans les productions culturelles contemporaines, on pourrait également s’interroger sur la permanence de cette virilité digne d’éloges dans le but de « réaffirmer un statut social propre à la domination masculine » (p. 639) : par exemple, dans le genre du péplum qui entretient des rapports particuliers à la masculinité, comme en témoigne le film Troy, réalisé par Wolfgang Petersen en 2004, qui fait l’économie de ces débats en supprimant toute ambiguïté possible quant à l’hétérosexualité d’Achille, incarné par Brad Pitt.
*
19En prenant à rebours son propre postulat de départ, à savoir que la relation d’Achille et de Patrocle formerait un « mythe de l’homosexualité en général » (p. 29), l’ouvrage de Cyril Gendry permet de remettre en perspective nos propres représentations en ce qui concerne les mythes, appréhendés à travers une multiplicité de versions et alimentés par la rhétorique, ainsi qu’à l’égard des conceptions contemporaines quant aux formes prises par l’affection et la sexualité, certes anachroniques, mais qui constituent le point de départ d’une enquête permettant d’appréhender le rapport aux Anciens, dans leur altérité et leur actualité. La mise au jour de ce mythe masculin est particulièrement bienvenue alors que s’opère, dans la création comme dans la recherche, un mouvement de retour vers les mythes à l’aune d’enjeux contemporains, parmi lesquels le genre34.

