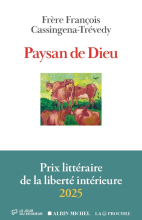
Un journal spirituel ultracontemporain
Cette communication a été faite dans le cadre du programme Lectures sur le fil, le vendredi 24 janvier 2025 à la bibliothèque de l’UFR de langue française de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université. En ligne : https://shows.acast.com/lectures-sur-le-fil.
1D’un journal de marche à un journal de vie rurale, Fr. François Cassingena-Trévedy est devenu auteur de « lignes de terre1 ». Au moment où paraissait le Cantique de l’Infinistère2 (Desclée de Brouwer, 2016, « Arpenter le sacré »), son auteur s’est installé sur le massif du Cézallier. Cette première année d’expérience a laissé sa trace dans Paysan de Dieu (Albin Michel, 2024). L’œuvre de notre auteur, moine bénédictin, était déjà riche d’un journal spirituel publié dans les années 2000, ainsi que d’essais et de recueils dont ses chroniques de la revue Études, mais aussi de traductions de l’œuvre d’Ephrem de Nisibe, poète de langue syriaque. Dans l’un de ses ouvrages, intitulé Quand la parole prend feu, François Cassingena-Trévedy représente la lectio divina comme un « travail agricole3 ». Il n’en est pas resté à ce travail métaphorique : Paysan de Dieu réunit en effet travail littéral au service des exploitations agricoles auvergnates et travail poétique des gammes d’écriture journalières, dont la synthèse forme une incessante actualisation des Écritures.
2Cette circulation entre l’écriture, les travaux et les jours se dit à merveille dans le journal4. La prose va des notations journalières aux fragments poétiques, dans un mélange tonal et stylistique qui tient son harmonie du projet d’ensemble d’une incarnation. C’est l’actualisation5, nous semble-t-il, qui confrère leur unité à la vie et à l’écriture, l’une se faisant sans cesse le répondant, voire l’interprétant de l’autre. Comment le projet le plus littéraire peut-il ainsi se soutenir dans la vie la plus laborieuse (Fr. François Cassingena-Trévedy pense à la « condition ouvrière » de Simone Weil, et aux prêtres ouvriers) ? Et à quel point ce « comment » constitue-il justement le principe de la « vérification » (p. 166) de Virgile et des Écritures ? Il faut d’abord considérer rapidement le parcours de François Cassingena-Trévedy, écrivain, pour observer la façon dont, énonciateur, il se situe dans le temps du monde par l’écriture diariste du temps. Temporelle, l’incarnation implique aussi une réflexion sur les figures comme manifestations de l’accomplissement, au cœur du sens de la prose poétique de Paysan de Dieu.
Itinéraire
3Dans une réflexion toute récente sur « la nature entre nostalgie et espérance », François Cassingena-Trévedy estime que ce que nous demandons à la nature, « c’est d’ajuster notre présence au monde », « dans une coexistence modeste et pacifique avec tous les vivants où la hiérarchie des règnes officiels se fait oublier au profit d’une tacite amitié6 ». S’il écrit un journal, genre qui répond à une pratique de l’authenticité singulière, il ne s’inscrit pas moins dans une histoire et dans une époque de la littérature — et l’on parlera aussi d’une langue littéraire, non spectrale mais stratifiée, « polychronique7 ». L’idée de posture nous aide à comprendre l’élaboration réflexive de l’image de l’écrivain et de son ethos qui doivent, dans une situation de l’ordre de celle de François Cassingena-Trévedy, être particulièrement justes. Son itinéraire suit un mouvement à la fois inverse et parallèle à celui d’un Péguy, puisque François Cassingena-Trévedy ne vient pas d’un milieu paysan ni populaire, il est normalien, spécialiste de langues anciennes, et devient paysan après un quart de siècle de vie à Ligugé. Il n’y a pas de préoccupation d’un discours des origines chez François Cassingena-Trévedy comme c’est le cas pour Péguy dans Victor-Marie, comte Hugo ; en revanche, tous deux sont attentifs à l’enjeu de la distance effective entre les cultures. Ils mènent une réflexion sur la possibilité d’être lu par les personnes avec qui l’on vit et dont on parle8, réflexion commune à Pierre Michon et Marie-Hélène Lafon.
4L’entreprise de François Cassingena-Trévedy aboutit à une situation mixte. Les Lectures montagnardes de Marie-Hélène Lafon peuvent nous aider à le comprendre. Dans un texte d’abord paru dans 303, l’autrice évoque la marche de Julien Gracq sur le Cézallier :
[…] échappons à la pesanteur des choses, du monde et des temps, cédons à ce que Julien Gracq appelle le vertige horizontal, celui que suscitent en lui, et selon lui, ces hauts plateaux déployés, Cézallier ou Aubrac ; Julien Gracq donc serait là, il marcherait sur la route d’Allanche au déclin de l’après-midi, dans la blondeur du soir et la félicité tranquille des pâturages : on le verrait passer, on, nous, les autochtones, les naturels, […] on serait occupés, nous, à renforcer une clôture, ou à rassembler les bêtes, veaux et vaches [etc.]9
5François Cassingena-Trévedy est désormais passé de l’autre côté, vers ceux qui renforcent les clôtures et rassemblent les vaches. Mais ce changement de vie s’accompagne de la traduction des Géorgiques de Virgile. Comme Péguy dans Victor-Marie, Comte Hugo, il cherche à réunir énonciation littéraire et langage parlé, souvent par citations. S’il n’est pas issu de ce milieu paysan, il choisit de venir vivre en un lieu qu’il aime et connaît depuis les vacances de son enfance, il le considère proprement comme le lieu où il va, non d’où il vient.
6Dans cette perspective, le discours de François Cassingena-Trévedy sur son attachement à la terre dans laquelle il « s’enracine » ne relève pas d’un retour identitaire, ni même nostalgique, à quelque vérité rassurante du terroir. Il nourrirait plutôt la sorte d’« attachement » terrestre dont parle Bruno Latour10. Venu vivre au cœur du monde rural, l’auteur de Paysan de Dieu a pour ambition de s’y « incarner » parmi les autres. Lui qui insiste sur le sentiment romantique de la nature11, rejoint le propos que développe Michel Collot sur un Nouveau sentiment de la nature : le sujet ne se considère pas comme extérieur au paysage, il en fait partie et le « fondement physique » de sa perception en « est l’incarnation 12 ». Quand Fr. François Cassingena-Trévedy ramasse des perce-neige pour les transplanter dans son jardin, il remarque : « Ces nouveaux pensionnaires appartiennent au même règne que les mésanges pour lesquelles j’ai suspendu une mangeoire dans le lilas, et c’est à ce règne, aussi, que j’appartiens moi-même. » (p. 31-32) Cette reprise du nom « règne » qui indique une chaîne de solidarité avec le règne du vivant, tend bien sûr aussi à désigner le « règne » de Dieu, mais en évitant l’antanaclase autant que la syllepse.
7C’est en tant que moine que François Cassingena-Trévedy s’immerge dans ce pays du Cantal, et en tant que moine qu’il écrit. Après vingt-cinq ans passés à l’abbaye de Ligugé, l’auteur a revêtu la condition d’anachorète (statut réservé à ceux qui ont déjà une longue pratique de la vie communautaire13). Toutefois, comme il le précise dans une interview au Monde14, il n’est pas un ermite, mais un « solitaire social ». Cette condition de « solitaire » (rappel explicite de ceux de Port-Royal) rejoint de façon plus contemporaine aussi la condition paysanne. On sait qu’elle est souvent confrontée à une solitude15, qui y est vécue plus qu’ailleurs. Je dirai d’ailleurs que la réalité de la solitude est le point évoqué de la façon la plus forte et la plus pudique dans ce livre, et où sans doute se joue une part essentielle de la communion que cherche à vivre François Cassingena-Trévedy.
8Au terme de cette première année, il formule ainsi son projet :
[…] j’ai pris mes distances par rapport à un monde que je peine à comprendre […] Que sert-il de tout voir et de tout savoir si l’on n’accueille pas, dans l’hôpital d’un cœur compatissant, éclairé et efficace, toute cette masse de mal — peccata mundi — qui assomme plutôt qu’on ne l’assume ? […]
J’ai préféré raconter par le menu la terre, et les tâches d’obscur avancement d’un commerce de proximité dont l’amitié fait tout le fonds. Sans être idéaliste, ni idéologue, ni idolâtre, j’ai simplement voulu laisser retentir, laisser resplendir, avec toute la délicatesse et la discrétion qui étaient de mise, la réalité ordinaire du monde le plus humble qui compose désormais « mon univers16 », la poser comme un pansement sur le grand (dont il y a fort à craindre que sa folie ne le perde) et la proposer aux hommes et aux femmes de bonne volonté comme une espèce d’évangile. En un mot, le Royaume qui lève ici-bas. (p. 218-219)
9Toute sa vie s’organise autour de la recherche de Dieu, dans un travail d’ouvrier agricole bénévole, qui s’inspire de l’expérience des prêtres-ouvriers, des réflexions de Simone Weil sur la condition ouvrière. Le journal du « paysan » a pour exergue une phrase du Journal d’un curé de campagne :
Travaille, fais les petites choses, au jour le jour […] Les petites choses n’ont l’air de rien, mais elles donnent la paix. C’est comme les fleurs des champs, vois-tu. On les croit sans parfum, et toutes ensemble elles embaument. La prière des petites choses est innocente. Dans chaque petite chose il y a un ange17.
10François Cassingena-Trévedy évolue en équilibre entre la figure solitaire du « garçon de ferme » et celle du pasteur, qui remontent toutes deux à de très anciennes métaphores christiques. Sa vie de bénédictin se passe dans une prière continue, une vie doublement pastorale, dans l’étable et à l’étude. Ce n’est pas sans humour que s’applique la métaphore de la ruminatio monastique. Marie-Hélène Lafon écrit à la fin de son Album de beaux fragments sur les « vaches » :
Les vaches portent sonnailles. C’est la première musique. Dans la nuit, ça ne s’oublie pas. Les vaches ont des yeux. Surtout. Immenses. Mouillés.
Les vaches ruminent. Moi aussi18.
11La ruminatio est l’une des modalités de la méditation.
Cantal (Chantal, en patois)… Je vois, j’écoute dans l’air sublimé à l’extrême et perméable à toutes les clarines19 : vrai ! Il y a du chant là-dedans, et de la lumière ! Cantal, cantate, candeur. J’évoque spontanément les « psaumes du Règne » : « Cantate Domino omnis terra… » Chantez au Seigneur, toute la terre ! […].
12L’auteur rattache la « candeur » non seulement à candide, mais aussi à un vieux radical gaulois cant- « qui signifie “brillant”20 ». La relation de François Cassingena-Trévedy au pays est médiatisée par la langue, par l’oreille et par la rêverie proustienne. Le tout subsumé dans la modalité monastique de la rumination : pour le moine, l’imprégnation des textes des Écritures et des Pères se fait par une lecture quotidienne selon les heures, à voix haute ou minimalement subvocalisée. La lectio divina ainsi incorporée l’accompagne à tout instant dans le paysage et dans la vie et l’Écriture devient « parole21 ».
13De cette lectio, selon dom Jean Leclercq,
[…] résulte une mémoire corporelle des mots prononcés, une mémoire auditive des mots entendus. La meditatio consiste à s’appliquer avec attention à cet exercice de mémoire totale ; elle est donc inséparable de la lectio. C’est elle qui, pour ainsi dire, inscrit le texte sacré dans le corps et l’esprit. […] Cette façon d’unir lecture, méditation, prière […] est lourde de conséquence pour toute la psychologie religieuse. Elle occupe et engage la personne entière, elle y enracine l’Écriture, qui peut alors porter ses fruits. Elle explique le phénomène, si important, de la réminiscence, autrement dit le rappel spontané de citations et d’allusions qui s’évoquent les unes les autres, sans aucun effort, par le seul fait de la similitude des mots ; chaque mot fait agrafe, pour ainsi dire : il en accroche un ou plusieurs autres qui s’enchaînent et constituent la trame de l’exposé22.
14Le titre de Paysan de Dieu exprime directement un prédicat, le nom en emploi intensionnel est celui de la catégorie où se verse l’énonciateur textuel : paysan avec les autres paysans (catégorie socio-professionnelle), et paysan de Dieu. Mais ce titre annonce aussi réciproquement, dans son intension, le programme de ce que veut dire « être paysan de Dieu ». Ainsi se trouve-t-il glosé à la fin du journal :
Mais, en définitive, de quel Dieu suis-je le paysan ? D’un Dieu qui est Paysan lui-même. Et comment se pourrait-il qu’Il fût autre ? D’ailleurs, son grand Fils l’a dit clair et net : Mon Père est le Paysan23. On traduit généralement par « vigneron » parce que le début du verset est : « Moi je suis la vraie vigne. » Mais cette traduction par « paysan » est tout à fait légitime, car le terme grec est geôrgos, littéralement « le travailleur de la terre ».
Paysan, donc, je le suis : de Père en Fils. J’ai de la naissance. Mon Dieu n’est pas très officiel, pas très rationnel, pas très conventionnel. C’est un Dieu qui pousse, et qui fait pousser, et que l’on fait pousser (car il faut bien être un peu paysan pour s’y connaître en lui). […] (p. 215-216)
15Dans cette glose du titre, on reconnaît une écriture méditative et familière, capable de se prêter à une analyse poétique. Elle travaille avec la Bible et avec la langue : dans un court essai récent sur la nature24, François Cassingena-Trévedy rappelle le « sens concret originel » de la racine indo-européenne qui a donné physis, racine dont il choisit d’évoquer le signifié par le verbe « pousser ». Si le verbe « pousser » au sens de « croître », pour un végétal, vient d’une origine différente (qui donne pulsare en latin), la proximité sonore est propice à la méditation.
16« Paysan de Dieu » est un programme dont l’accomplissement christique est celui du « je » du diariste, je effacé dans le titre (dont la référence est médiate) et je actualisé dans le texte du journal.
Journal
17Deux passages courts du début donnent le ton :
Ce matin, sur la neige qui lentement se sublime, les pas des passereaux ont marqué des étoiles : du regard, la pâture aujourd’hui sera le minuscule.
*
Sur le thème inépuisable de la neige, je ferai donc chaque jour mes gammes, mes exercices d’écriture. Peut-être sera-ce désormais mon unique journal. Ce « Journal » dont une montagne, ici, porte d’ailleurs le nom. La neige, non pas seulement actualité d’un quotidien sans éclat, mais Acte pur auquel tout en moi pour toujours aspire à se suspendre25.
*
18Le « journal » est aussi la mesure qui correspond à la journée de travail du temps paysan, elle délimite la surface labourable en une seule journée » (p. 13826). La notion d’« acte pur » renvoie à la réflexion thomiste sur la Création. Ces deux passages associent le plus humble et le sublime, que l’on ne saurait trouver en se détournant de la matière. Dans son très beau livre intitulé Plume en main. Journal intime et exercice spirituel, Emmanuelle Tabet illustre le rôle de l’écriture comme « exercice de vie 27», en insistant sur ses liens avec la méditation, qui est orientée vers la vie. « Le journal a ceci de particulier qu’il trouve sa définition non dans un contenu mais dans une pratique et un rythme28 ». Ce genre relève d’une cohérence processuelle de transformation du sujet. En choisissant la pratique du journal, François Cassingena-Trévedy manifeste plusieurs propriétés du genre : son journal est écrit majoritairement au présent ou au passé composé ; il ne relève pas d’un récit, au sens où l’enchaînement de « fragments narratifs » et de « notations » « ne compose pas une histoire, ne s’inscrit pas dans un projet global de récit » mais relève plutôt de la « chronique 29» ; il fixe par écrit la « trame » d’une « existence30» qui se déroule selon la linéarité du temps du monde ; enfin, ce passage du temps voit advenir des transformations et l’évolution d’une identité racontée « au fur et à mesure ». Or cette inscription dans le temps moderne, illustrée par la temporalité du journal, se conjugue dans le projet de François Cassingena-Trévedy avec l’observance d’un rythme religieux, mais sans projection d’un destin sur la ligne du temps. Pour reprendre les catégories de Michel Braud, le diariste « refuse de se placer dans une position transcendante vis-à-vis de sa propre existence 31». La transcendance est ici divine, et François Cassigena-Trévedy en observe la présence cachée, le déploiement imprévisible du sens, et la trace. En effet, la « fidélité scrupuleuse à la célébration liturgique » est « indemne » « alors même que le questionnement relatif à la substance de la foi et l’incertitude au sujet des lointains de l’existence demeurent entiers » (p. 37)32. La perspective empruntée est donc celle d’une existence considérée comme une « condition » (Quatrième de couverture et p. 38) à expérimenter et à vivre dans son corps, un devenir que l’on note au fil des jours, articulant temps liturgique et temps d’une aventure singulière — ceci grâce aux deux autres temps qui structurent cette vie : le temps cosmologique, et le temps collectif de la vie paysanne au Cézallier.
19Tous ces temps impriment leurs rythmes sur le journal. Cependant, loin d’enfermer le présent, ils en approfondissent l’expérience : ils sont au principe de l’attention et de la méditation de chaque jour. François Cassingena-Trévedy aime le mot d’« avancement », il dénote une « direction » tout en conservant la « tension » propre au journal (on s’interroge « sur le devenir du diariste » et on a de la « curiosité pour la continuité de son expérience » comme le dit Michel Braud 33). Le journal constitue une forme pertinente pour dire un processus d’incarnation dans le partage d’une condition qui n’est pas un destin — tout en épousant les rythmes qui sont des formes de cette « condition ». C’est ainsi que dans ce journal de François Cassingena-Trévedy se retrouve la dimension d’« exercice spirituel », tant au sens antique34 qu’au sens chrétien avec la méditation. La pratique du journal cultive une disposition intérieure qui vise à faire coïncider le sujet dans sa pensée, ses intentions, son affect, sa méditation, avec le présent de son écriture. Tel est aussi l’esprit de la prière (où se rencontrent le livre d’Emmanuelle Tabet et la règle du bénédictin citée par notre auteur) : dans l’oratoire, on doit prier non pas « avec des éclats de voix mais avec toute l’intention du cœur35 ». Comme la prière, l’écriture vise une « consonance » avec l’être dans sa parole. Toutefois, même si la prière infuse dans l’existence, l’écriture du journal représente une activité distincte. Prière et écriture recherchent toutes deux une coïncidence entre l’être du sujet et sa parole, mais cette coïncidence n’aboutit pas à la même fonction illocutoire.
20Un certain nombre d’usages du présent dans le journal relèvent d’une convention puisque l’écriture a lieu le soir, après les événements de la journée. Beaucoup d’activités sont énoncées au passé composé. Mais d’autres passages maintiennent le présent là où il pourrait commuter avec des passés simples ou des imparfaits. L’écriture est conçue comme une émanation de l’expérience et comme participant de ce moment :
Quatorzième jour d’août — À cause de divers services à rendre et de ces visites que les vacances estivales poussent nombreuses, trop nombreuses sans doute, à ma porte, j’ai récité à une heure tardive les premières Vêpres36 de l’Assomption. Maria virgo assumpta est ad aethereum thalamum in quo Rex regum stellate sedet solio37. Tel est le texte de la seconde antienne de l’office. En sortant sur le seuil de la maison pour goûter quelques instants la fraîcheur réparatrice de la nuit, je saisis, juste au-dessus de la marquise de verre, une étoile filante dans sa trajectoire vertigineuse. In quo Rex regem stellato sedet solio… Il est difficile de ne pas consentir de toute son âme à l’enchantement du langage liturgique lorsqu’on en découvre avec une pareille immédiateté l’enluminure au-dessus de sa tête. Homme des clartés obscures, je reçois cette nuit confirmation du firmament. (p. 118)
21Le présent de « saisis » et de « reçois » ne coïncide que conventionnellement avec le moment de l’expérience, mais l’énonciateur est le même, qui réactualise fictivement cette saisie (perfective) et cette réception (« reçois » est moins ponctuel à cause de la deixis plus large de « cette nuit »). Ce présent d’un moment vécu plus tôt est sauvé par le dispositif de l’écriture du journal : il est celui de l’expérience du monde dont l’écriture se fait à la fois la trace et le renouvellement. Le travail sur le latin avec confirmer et firmament ne vient guère « confirmer » quelque certitude arrêtée, il ouvre l’énonciateur, cet homme des « clartés obscures » à l’infini de son mystère. Comme François Cassingena-Trévedy l’écrit face au paysage du Cantal dans son Cantique de l’Infinistère,
Ce paysage-là n’assène nulle réponse, n’oppose nul obstacle, n’affiche nulle coquetterie. Fenaison profuse de pur espace, il renvoie à l’âme l’image de ce je ne sais quoi d’inguérissable et d’éperdu qui est son état le plus foncier et dont elle ne se devrait jamais départir, et ceci dans un accordement si exact, si poignant, qu’il fait sourdre des larmes. (p. 149)
22Dès lors, l’écriture de ce présent correspond à une dilatation de l’âme et à une entrée dans la durée de son expérience, seul moment où elle est libre et seul moment où elle expérimente la rencontre avec l’Autre. Il y a donc un enjeu de vie et de littérature, les deux ensemble, à dire ce nouveau commencement, écrire c’est aussi entrer dans la nouvelle vie : l’incipit du journal permet de le comprendre.
Écrire le commencement
La page est tournée. Tout ce qui précède n’était sans doute que préface. Comme si ce qui précédait n’existait déjà plus. L’Antan seul existe, l’Antan qui est bien plus que tout ce qui précède. Je vais donc célébrer quotidiennement mon enterrement volontaire et somptueux. De ma propre vie je suis désormais l’unique survivant.
J’ai fait tourner la clef dans les deux trous du cadran de la comtoise, j’ai remonté les poids à hauteur inégale et, posant un geste fondateur — un geste créateur —, j’ai imprimé au balancier son mouvement pour la première fois. Alors le Temps a commencé. J’entends enfin le Temps. L’Antan ressuscité. J’ai exhumé le Temps que l’on n’entendait plus, le Temps mort, parce que tout le monde a maltraité son existence animale, c’est-à-dire son corps, son visage et sa voix (toutes choses que l’horloge rend sensible et sauve de l’abstraction). Clocher domestique, l’horloge, dont la mécanique — non, l’âme — est désormais entre mes mains, l’horloge sonne mon enterrement qui est aussi ma béatitude. En introduisant l’horloge comme le premier meuble, le premier hôte de la maison, j’ai installé, j’ai restauré le Temps. Et devant le petit astre captif qui palpite à l’abri de la porte ajourée, je donnerai du Temps la seule définition dont soit capable un philosophe rustique : « le Nombre d’or ». J’ai fait en mon for interne le serment que je ne m’absenterai de la maison jamais au-delà du temps nécessaire pour que les poids descendent, sans y atteindre tout à fait, jusqu’à ce point où le cœur s’arrêterait de battre. Car la vie du Temps est entre mes mains, et mon plus grand effroi est que le Temps expire.
23Il y a d’abord un effet de seuil du livre. La métaphore lexicalisée de l’époque comme « page » que l’on tourne (au sens de la locution tourner la page, « changer d’époque », « sans se retourner38 ») est défigée dans la première phrase ; page est employé avec une syllepse de sens, puisqu’on a tourné la page au sens littéral, en entrant dans le livre. Le sens figuré reprend ses droits avec le passé considéré comme une « préface » au livre de la vie. Un tel incipit manifeste quelque chose de relativement original pour l’écriture du journal en solennisant un moment fondateur, comme une Vita nova (Dante inaugure cette vie en parlant du « livre » de la mémoire). Le texte de François Cassingena-Trévedy rappelle aussi plus discrètement le poème inaugural du Prologue de l’Évangile de Jean, qui est aussi un écho du début de la Genèse.
24D’où ces gestes de défigement, de la « page tournée » et de « l’enterrement ». Le verbe enterrer lui aussi est employé avec une syllepse de sens, c’est « mourir au monde », et en plus de l’hyperbole familière (s’éloigner et mourir à la vie sociale pour des raisons géographiques), « s’incarner dans le pays de terre » où il habite désormais. Il ne faudrait pas se hâter d’évacuer le premier sens, usuel, d’enterrer dans le cas de ce rapport à l’Auvergne : c’est « là », pour l’écrivain « une répétition des semailles ultimes de [s]on propre corps en cette terre obscure qui fera de [s]a poussière même une énergie39 ». Toutefois, la solennité du début du journal n’est pas dénuée d’humour, là où elle pouvait paraître grandiloquente (« Je vais donc célébrer quotidiennement mon enterrement volontaire et somptueux »). Dans une formulation ralentie et alourdie par les mots dérivés, par une coordination de deux adjectifs qui ne sont pas sur le même plan, le diariste donne à comprendre une pratique paradoxale, celle d’un faste quotidien. Il s’y attarde avec humour.
25Dans cette première page de journal, une parole s’inscrit dans un temps nouveau ; elle s’ouvre aussi à ce temps nouveau. Le présent d’énonciation inaugure la série de tous ceux qui vont suivre dans l’année à venir. On commence par situer le présent par rapport à l’accompli : ainsi par rapport à « tournée » (forme morte du verbe), la tension verbale est portée par être qui fait entrer dans le nouvel état de vie présent. Ce présent se situe aussi par rapport à l’imparfait : « tout ce qui précède » définit le passé qui maintient sa position, vu depuis le présent – mais il est réévalué : « Tout ce qui précède n’était sans doute que préface » : l’imparfait (était) interprète a posteriori le sens de ce passé à la lumière du présent. La situation du je est exprimée au présent, ainsi que dans une forme d’origine sécante : « De ma propre vie je suis désormais l’unique survivant ». La thématisation du complément du nom survivant transforme de ma propre vie en locatif et produit l’impression d’un processus d’émergence. Les adverbes de temps situent aussi l’homme dans ce moment inaugural entre le « déjà plus » qui regarde la cessation après-coup, et le « désormais » qui ouvre une nouvelle époque. L’entrée dans cette nouvelle ère est représentée par un mouvement ancré dans le présent : même s’il y a grammaticalisation dans « Je vais donc célébrer quotidiennement mon enterrement », aller retrouve malgré son auxiliarisation une certaine rémanence de l’idée d’« entrer », d’« aller vers ».
26Une série de passés composés vient cependant marquer l’articulation entre le passé récent et le présent : celle des actes fondateurs qui scandent l’introduction du « temps » comme réalité : « J’ai fait tourner la clé dans les deux trous du cadran de la comtoise », « j’ai remonté les poids… », « j’ai imprimé », « J’ai exhumé le temps que l’on n’entendait plus », « J’ai installé, restauré le temps », « alors le temps a commencé ». Ce sont des passés composés en lien avec ce présent d’énonciation : ces éléments sont donc « fondateurs » de ce présent qui est configuré par lui, à la différence de ceux qui font partie de la « préface ». Y répond le présent par eux rendu possible : « J’entends enfin le temps. » Avec le changement de thème (« J’ai fait tourner la clef »), on est entré dans un nouveau temps : « L’Antan seul existe, l’Antan, qui est bien plus que tout ce qui précède ». Il s’agit du temps du monde premier, d’un temps que l’on pourrait dire phénoménal, au sens où il est purement présent, hors des temporalités sociales : c’est le battement de la vie du monde, correspondant au rythme cosmique. Avec l’existence de l’« antan », le présent coïncide avec le moment de l’énonciation et s’élargit dans la relative : « Qui est bien plus que… » pose un présent de caractérisation générale. Advient ce temps qui est sujet. Adviennent d’autres sujets au monde, que l’énonciateur textuel va laisser être et dont il confesse l’existence, dans un décentrement de soi pour écouter le pouls du monde. Dès lors se rencontrent et se complètent deux sujets : l’homme et le temps, l’homme qui s’« enterre » et le temps qu’on « exhume ».
27Le sujet se pose ici en rôle d’agent fondateur, même créateur. Cette responsabilité se formule selon différentes nuances de futur. Premier futur dans la subordonnée complétive (où l’absence de concordance des temps marque la valeur absolue de chacun des engagements sur la ligne du temps où se profère l’énoncé) :
J’ai fait en mon for interne le serment que je ne m’absenterai de la maison jamais au-delà du temps nécessaire pour que les poids descendent, sans y atteindre tout à fait, jusqu’à ce point où le cœur s’arrêterait de battre.
28Il n’est pas indifférent que François Cassingena-Trévedy retrouve ici l’image médiévale de Dieu horloger40 qui tient le temps entre ses mains et fait participer l’homme à sa Création — mais ailleurs il récuse la notion de Dieu horloger. L’horloge est aussi une représentante de la mesure moderne du temps, il n’y a donc pas de passéisme dans le choix de l’horloge, qui a participé à l’inauguration de la poésie moderne, de l’horloge d’Igitur à celle de Claudel : « J’entends mon cœur en moi et l’horloge au centre de la maison41 ».
29Deuxième futur : « je donnerai du Temps la seule définition dont soit capable un philosophe rustique : “le Nombre d’or”. » Le futur ici modal solennise l’énonciation de la définition en accompagnant la cataphore discursive qui projette la parole vers l’avant : d’abord effet d’annonce, puis entre guillemets autonymiques, formulation de la définition. Ce futur, pour être modal dans la langue courante (dont il garde ici la valeur pragmatique de précaution dans l’énonciation), dramatise ici malgré tout un rapport au temps, perçu comme un objet de pensée et de méditation.
30On pourrait dire que François Cassigena-Trévedy a des « égards42 » pour le temps. D’abord, sa nomination est préférée à la reprise pronominale : « alors le temps a commencé » se poursuit non par « je l’entends enfin », mais par : « j’entends enfin le temps, le temps ressuscité » Plus loin : « La vie du temps est entre mes mains et mon plus grand effroi est que le temps expire » (et non pas : « qu’il expire »). D’où une allure formulaire qui ne répond absolument pas aux habitudes que nous avons d’anaphoriser une fois le référent catégorisé ; ici, le nom est inséparable du mystère de son référent.
31Le temps peut ainsi se définir : « Nombre d’or » comme celui qui donne sa mesure à tout, avec un éventuel jeu sur la forme de la lettre O devant l’astre du balancier. Cette considération passe aussi par la renomination : « la mécanique », « — non, l’âme » dessine une paradiastole. Non seulement milieu où se situe l’énonciateur, le temps est pour lui un objet de réflexion, et encore au-delà, un autre sujet, une créature.
32La deixis du « maintenant » est dédoublée (elle est subjective et objectivée), entre l’ancrage du discours dans le présent, et le regard porté sur cette réalité en elle-même, dégagée comme une présence : « l’antan existe ». En employant le déterminant défini, Françoise Cassingena-Trévedy mobilise une propriété du mot antan, qui est d’abord un substantif employé adverbialement (l’an, l’antan ; de l’antan, d’antan). Le mot antan double phoniquement l’épaisseur du mot temps et l’on en retrouve les syllabes disséminées dans le texte : dans entends (du verbe entendre), et particulièrement peu après l’incipit dans « hâtant » (où l’on peut aussi entendre « attend ») : « La neige est une horloge hâtant l’éternité ».
33Pour matérialiser le temps et le rendre audible, il y a les deux balanciers de l’horloge.
34Celle-ci est elle-même métaphorisée, de façon à la fois affective et raffinée : sa « mécanique » est une « âme » et son balancier est un « petit astre captif qui palpite à l’abri de la porte ajourée ». La série de voyelles ouvertes [a] et fermées [i] remotive sémantiquement la « palpitation » en rendant le battement d’un temps sensible. L’écoute du Temps se fait aussi dans le choix d’une mesure : métrique ou quasi-métriques dans les formes d’un ordre (qui pourrait être perçu comme extérieur, mais où le sujet est inclus dans son existence même — de même qu’il a choisi de se conformer à la « règle » bénédictine). La prose évolue ainsi selon un rythme où se trouve inclus le mètre.
Prose poétique et « physique spirituelle » (p. 221)
35La prose de ce début, mais aussi de nombreux passages dans Paysan de Dieu, est caractéristique de la liberté formelle du journal. L’écriture peut y prendre les formes de la simple notation et aller jusqu’à la prose poétique. Dans notre passage du début, la prose suit plusieurs allures : celle de la phrase brève qui reconduit une simple formule, avec éventuellement des ajouts en forme d’hyperbates, suivant un rythme d’amplification partant de phrases courtes, avant une prise de souffle et un élargissement du dire. Ce dire peut rechercher la mesure et créer une allure poétique : celle de la phrase construite en groupes cadencés, avec des couplages et des reprises de sons (« de ma propre vie je suis désormais l’unique survivant » où l’inversion du complément du nom permet une symétrie sensible du thème et du rhème se répondant grâce à l’isolexisme).
36Cette allure poétique rejoint l’écriture de la rumination dans des formes de synthèse, comme peuvent en présenter les jeux sur les préfixes latins : « Tout ce qui précède n’était sans doute que préface ». L’effet d’encadrement morphologique porte l’effet sémantique d’élucidation dans la construction attributive qui va de « précède » à « préface ». La réécriture de « tout ce qui précède » en « comme si tout ce qui précédait » (polyptote) médite un rapport changé au passé.
37L’allure de la phrase longue (alternant avec la phrase courte) peut reposer sur des effets de groupements rythmiques : des groupes binaires, ternaires, des esquisses de parallélismes créant des effets de balancement43 : mais c’est sans crainte de rupture de cette allure cadencée, notamment selon les besoins de l’explicitation qui relinéarise l’écriture.
J’ai exhumé le Temps que l’on n’entendait plus, le Temps mort, parce que tout le monde a maltraité son existence animale, c’est-à-dire son corps, son visage et sa voix (toutes choses que l’horloge rend sensible et sauve de l’abstraction). Clocher domestique, l’horloge, dont la mécanique — non, l’âme — est désormais entre mes mains, l’horloge sonne mon enterrement qui est aussi ma béatitude. En introduisant l’horloge comme le premier meuble, le premier hôte de la maison, j’ai installé, j’ai restauré le Temps. Et devant le petit astre captif qui palpite à l’abri de la porte ajourée, je donnerai du Temps la seule définition dont soit capable un philosophe rustique : « le Nombre d’or ».
38Très souvent est cultivée la cadence comme ici sur « le nombre d’or », avec un effet d’attente et de clôture dans le deuxième membre d’une quasi-période, où dans les quatre syllabes finales à l’articulation nasale et labiale, le son paraît un écho du sens et procure un effet de perfection, maintenu grâce à la consonne finale allongeante.
39L’insertion de vers blancs est aussi un trait remarquable de cette prose (au cours des premières pages, ils sont particulièrement nombreux, sans être toujours strictement métriques). Par exemple dans la clausule du premier paragraphe du journal : « Et mon plus grand effroi est que le temps expire44 ». On pourrait même imaginer une disposition de prosimètre, cependant François Cassingena-Trévedy choisit d’autres passages pour proposer une disposition en vers hétérométriques alternant avec de la prose :
Ô la sérénité que procure l’hiver !
Le très bas du jour fait une sorte de toiture.
Car l’ombre de décembre est encore un abri. (p. 20)
40Le souvenir matriciel de la prose artistique45 est également prégnant dans cette écriture élaborée et souvent érudite. L’un de ses plus grands intérêts est la densité figurale, qui recouvre un ensemble d’échanges entre métaphore et incarnation, trope et figure typologique, véritable creuset où se reconfigure le langage poétique. Cet échange perpétuel est l’une des modalités de l’actualisation des Écritures. À cet égard, il n’est pas indifférent que François Cassingena-Trévedy soit traducteur. L’écriture du journal s’ouvre à tous ces registres, parce qu’il parle d’un lieu absolument singulier, qui peut constituer une marge – en même temps qu’il offre un espace de réconciliation entre les mots et les choses dans une vie qui réunit tous les aspects (labeur et contemplation, esprit, âme et corps).
Sur la route de Sainte-Anastasie à Condat, devant les étendues candides du Cézallier et les estives désertes métamorphosées par le gel en fenaisons de cristal, j’ai eu une illumination ; l’accomplissement de la prophétie d’Isaïe, première lecture de la messe, m’a sauté aux yeux :
Ah ! Si Tu déchirais les cieux et descendais,
Devant Ta face les montagnes seraient ébranlées,
Comme le feu enflamme les brindilles […]
Tu es descendu…
Que désiré-je sinon que ces paroles ardentes soient le fond sonore de tous les gens de ce pays, et du regard qu’ils posent sur lui, et de toutes les tâches qu’ils y accomplissent ? Je crois en la vertu sociale de la Beauté46. (p. 204, les italiques sont de l’auteur)
41Cette « illumination » qui dit un moment mystique47 jaillit de la pratique des textes, elle s’ancre dans l’accompli d’une expérience encore perçue en lien avec l’actualité de l’énonciation, et qui la dépasse. Cette expérience articule nostalgie de la transcendance (portée par un désir sans fin) et actualité, plénitude qui investit les signes du texte (portée ici par le désir et la manifestation entre « descendais » modal et « es descendu » temporel dans le texte, comme dans le moment de « l’illumination »). Le contexte de l’écriture du journal permet typiquement de refondre les acceptions du verbe actualiser, relevant linguistiquement de l’opération sémantique de la référence et spirituellement de la lecture de la Bible dans le présent (et dans la considération de l’accomplissement des Écritures). L’exemple par excellence se trouve en Lc, 4, 16-21 (la parole christique : « Aujourd’hui, vous l’entendez, cette écriture est réalisée 48»). L’allusion au Buisson ardent (qui ne consume pas la matière) apparaît jusqu’à l’idée de la « vertu sociale de la Beauté ». On la reconnaît encore dans une notation comme celle-ci : « La Présence rougeoie entre les fleurs de givre. Je crois en un Dieu qui a froid » (p. 204, vers blanc). Comme souvent dans cette prose, la forme sonore de l’énoncé avec ses reprises en [wa] s’efforce de donner consistance matérielle à l’idée de présence divine.
42 L’actualisation, comme dans les paraphrases et la poésie spirituelle, n’obéit pas à une logique figurale reposant seulement sur un jeu nominaliste, mais elle est figurale au sens poétique, ainsi que typologique. La prose de François Cassingena-Trévedy est nourrie des figures du poète syriaque, « ancrées dans une lecture typologique de l’Écriture49 » et ouverte à la prolifération d’autres actualisations portées par la lectio divina, qu’elles relèvent de la reconnaissance, de rapprochements, de métaphores, d’allusions — le texte qu’il a consacré à la lectio divina étant lui-même particulièrement métaphorique. La différence ontologique50 entre figure typologique et métaphore a été soulignée par Auerbach : « la figura est quelque chose de réel et d’historique qui représente et qui annonce autre chose de tout aussi réel et historique51 ». Cette figura invite à approfondir la complexité des choses humaines insérées dans une histoire (les tropes se transportent du champ linguistique à la lecture de l’histoire comme accomplissement52). Or cette logique figurale de l’Histoire est étendue au quotidien dans le journal et constitue une « vérification » de la parole (et non une imitation), ainsi pour l’Ascension :
En suivant le troupeau, j’entends encore l’écho de Bach, comme en écoutant Bach avant de partir, je voyais déjà monter le troupeau. Même matinée, même solennité, même monde, même joie. Dans l’homélie de la messe d’onze heures à Allanche (juste le temps de changer de mise après la montade), j’ai dit aux braves gens, en substance, que tout le monde montait. […] Viri Galilei ; quid admiramini, aspicientes in caelum, alleluia53… Hommes de Galilée. Hommes du Cézallier… Le bois gercé des piquets, les crampillons rouillés, les tenailles, le marteau, le barbelé qui laisse sur les mains d’inévitables stigmates, tout cela donne je ne sais quelle présence réelle à la Passion, tandis que l’Ascension s’affirme toute seule, comme une certitude, dans le ciel énorme et tangible au-dessus de nos têtes. Tout le mystère pascal résumé dans l’ouvrage du matin. Entre Bruno et moi, le courant passe à merveille. C’est un rude, un bosseur qui ne se ménage guère malgré son insuffisance cardiaque. C’est aussi un chasseur de lièvre. Sa guimbarde qui sent la clope froide me rappelle la cabine d’un chalutier.
J’ai passé une journée en pleine terre, en pleine mer, en plein ciel. Je ne sais plus très bien. Là-haut. Paradis. (p. 68-69)
43La figuralité typologique traitée de cette manière marque une continuité, contiguïté indicielle à partir d’un même mystère. Elle influe sur les autres manières de rapprochements opérées dans la méditation de Paysan de Dieu. La tendance à tirer le comparant de sa virtualité apparaît constamment dans le journal, dans l’usage des comparaisons (où les termes restent littéraux). Les comparaisons confirment une lecture « pratique » : « […] “Oui, le peuple est comme l’herbe : l’herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours” Car la lecture sainte des Écritures, ici, s’accompagne toujours d’une leçon de choses, et l’on n’escamote jamais le sens littéral. » (p. 220, les italiques sont de l’auteur) Ainsi l’éternité des Écritures indéfiniment actualisables se comprend-elle par rapport à l’expérience des saisons et de la mort.
44La « leçon de choses » peut se faire métaphorique en rapprochant un terme existant, singulier (le poids de l’horloge) d’un terme relevant d’une autre sphère conceptuelle (l’amour qui engendre). La tension métaphorique devient directe dans l’oxymore apparent de la « physique spirituelle » qui s’inspire d’Augustin :
« Tout corps tend, en vertu de sa pesanteur, vers la place qui lui est propre. […] Mon poids, c’est mon amour ; où que je sois porté, c’est lui qui m’emporte » […] Les poids de l’horloge, organes génitaux du Temps, gravitent naturellement vers le bas, mais la contrariété qu’on leur oppose en les remontant vers le haut suggère une gravitation inverse et propre au Temps lui-même, lorsque, cessant de peser lourd à celui qui passe, il s’en va doucement vers une éternité54. (p. 221)
45Mais si l’on postule une continuité ontologique entre l’amour et la création (ou le maintien dans l’être), alors le conflit conceptuel et la métaphore se dissipent dans l’« horizon conceptuel » d’une « expérience symbolique » harmonieuse55. Si l’on perçoit toutefois cet alliage comme métaphorique, c’est que la langue habituelle y résiste (la prédication métaphorique relève d’une analogie imposée, d’une « image du monde56 » qui l’emporte sur la combinatoire des unités lexicales, car il n’y a pas de rectification linguistique de « mon poids, c’est mon amour »). Le sentiment de la continuité ontologique se retrouve, différemment, dans d’autres exemples de métaphores qui manifestent une prédilection pour un foyer homogène avec le monde qu’elles redécrivent. Cette homogénéisation passe par des métaphores à fondement métonymique. Le « petit astre captif » du balancier l’inscrit dans l’ordre cosmique ; la « pâture » offerte au « regard » et les « fenaisons de cristal » assimilent l’énonciateur à l’agriculteur. Une tension métaphorique est préservée, tout en renforçant la consistance de l’univers pastoral et religieux mis en place. Mais cette familiarité entre le prédicat métaphorique et son sujet n’affadit pas l’image, elle contribue plutôt à l’effet global d’animation de l’univers géorgique.
46Certaines métaphores affirment davantage d’hétérogénéité, tout en s’inspirant de l’expérience racontée où elles trouvent leur cohérence. Ainsi devant le feu : « La solitude aussi est une combustion. Ce sont les morceaux de ma vie passée qui brûlent, de soir en soir, dans la cheminée. » (p. 67) L’intelligibilité de la « métaphore énoncé » surmonte la rupture d’isotopie en assimilant la solitude à un dépouillement, en activant les connotations ambivalentes d’un feu qui tient de la destruction et de l’amour – dont les signes doivent se lire ici à l’envers. Ainsi s’unissent un pathos fondé sur la force de l’image et un éthos dont la justesse est fondée sur sa réserve.
*
47À plusieurs égards, Paysan de Dieu se lit comme un précipité de littérature et de vie, comme si l’exaltation et l’humilité, l’hymne collective et la rumination intime, venaient n’y faire qu’un. Sa langue est à la fois ancrée dans la diachronie et incarnée dans la diatopie, sociale et individuelle, elle est investie fraternellement. En ce sens, une telle œuvre est contemporaine en plusieurs sens : temporellement par son régime d’écriture diaristique, littérairement par les échos qu’elle nous fait entendre avec d’autres œuvres voisines dont elle partage certains mots, certaines inquiétudes et extases, notamment celle de Marie-Hélène Lafon, éthiquement (on pensera à la « réparation57 »), spirituellement, dans l’attention extrême aux vies qu’elle considère et célèbre, et par la communion qu’elle aspire à instaurer. Esthétiquement, sa richesse ne l’éloigne pas du temps qui est le nôtre : au-delà d’une illustration actuelle de la « belle langue », elle actualise librement, et en plusieurs sens, bien des potentialités58 de langues littéraires et poétiques trans-séculaires, d’une langue cumulative et qui vient « rouler […] au bord » d’une mystérieuse « éternité ».

