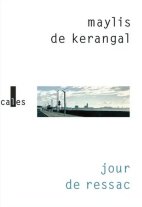
« Une affaire vous concernant » : lecture stylistique de Jour de ressac de Maylis de Kerangal
Cette communication a été faite dans le cadre du programme Lectures sur le fil, le vendredi 28 mars 2025 à la bibliothèque de l’UFR de langue française de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université. En ligne : https://shows.acast.com/lectures-sur-le-fil.
1On était impatient de découvrir le dernier livre de Maylis de Kerangal, Jour de ressac, notamment parce qu’il explore l’écriture à la première personne : on pourra se demander quel est son impact sur le style de l’œuvre.
2L’intrigue est assez mince : le corps d’un homme a été retrouvé au Havre, avec le numéro de téléphone de la narratrice dans sa poche. Elle est donc convoquée au commissariat du Havre, ville de sa jeunesse. Pour décliner son identité au commissariat, elle doit se « rallier » au gabarit du PV d’audition et à ses questions « curieusement rédigées à la première personne — je me nomme…, […] j’exerce la profession de … » (p. 32) : manière de pointer l’implication de la narratrice dans cette affaire la concernant, et, de manière décalée, le choix énonciatif de l’auteure.
3Avec la première personne, selon Maylis de Kerangal1, ce qu’on perd en « déploiement narratif », on le « gagne en sentiment de la présence ». On verra qu’en penser.
4Précisons tout d’abord que la narratrice n’est pas l’auteure. Mais elle s’y retrouve avec ce retour au Havre, où Maylis de Kerangal a vécu sa jeunesse. Et l’on peut voir dans le métier de la narratrice — elle est doubleuse — un double de l’écrivaine, qui se coule dans la voix des personnages : on reconnaît l’importance des voix chez Maylis de Kerangal — voix du vieux marin aux « cordes vocales distendues, fatiguées comme de vieux élastiques » (p. 200) ; voix de la narratrice qui se brise en évoquant la radio de secours de son père : « cette radio, c’est l’objet mythique de mon enfance, un objet qui respirait comme un homme » (p. 195). De plus, le conjoint de la narratrice est imprimeur, ce qui renvoie aux deux visages de l’écriture, entre littérarité et oralité d’une voix.
5Par ailleurs, le parcours intérieur d’un je livré au tout-venant de ses réminiscences et de ses rencontres engendre un certain désordre — tel ce désordre du quotidien régnant dans des poches pleines de miettes, sur lequel s’ouvre le livre, ou ce « vrac » du sac-à-main, listé dans les dernières pages : « un ticket de pressing de 2017 », « des glands », « des épluchures de mandarine, mon passeport tout fatigué », etc. (p. 238-239).
6Le désordre narratif rappelle aussi « ces petites narrations mal foutues et sauvages, hoquetées » (p. 49) que Maylis de Kerangal évoque au sujet de son personnage — et je fais l’hypothèse qu’elle fabrique ici une histoire volontairement « mal foutue » : une histoire en queue de poisson, livrée au hasard des rencontres et au ressac de la mémoire.
7Ce « vrac » narratif noue cependant assez systématiquement trois éléments autour de la disparition : le cadavre de la digue, la ville du Havre détruite en 1944, et l’histoire d’un premier amour. L’homicide rappelle l’urbicide, celui d’une ville fantôme disparue sous les décombres, qui a « des poussées de croissance adolescente » (p. 28), et il rappelle la « fantomisation2 » (p. 120) d’un premier amour — syllepse superposant un sens géologique avec celui du terme ghosting, né des sites de rencontre.
Sur la piste d’un faux polar
8Maylis de Kerangal écrit ici un livre sur presque rien : une enquête sur les « traces matérielles de ce qui a disparu » — et qui n’aboutit à presque rien : il s’agit d’un pseudo-polar non élucidé, mêlé à des éléments d’autofiction.
9Le faux polar évolue alors vers un voyage dans l’intériorité, avec un parallèle entre la ville et cet homme qui voulait téléphoner à la narratrice, qui « avait quelque chose à me dire » (p. 102). D’entrée, le plan du Havre accroché dans le bureau du commissariat évoque « une bouche béante », « qui voulait dire quelque chose mais suffoquait » (p. 43), rappelant ce lieu commun de série, la victime qui expire sans dire son secret. S’effectue alors un travail de déplacement, une expérience d’anamnèse, qui va conduire la narratrice au resurgissement d’un premier amour, Craven.
La fiction policière : incorporation et défamiliarisation
10Le roman incorpore des lieux communs de série policière : déposition, autopsie de la légiste, reconnaissance du corps, ainsi que la piste du narcotrafic au Havre. Ces lieux communs s’inscrivent dans la banalité du quotidien, ce qui inverse le rapport à la fiction : « cela m’a troublée de le dire comme ça — je veux voir le corps —, j’ai eu la sensation de me porter à l’orée de ces dialogues de fiction que j’enregistre » (p. 166) ; de même pour l’attitude du conjoint, « très inspecteur Columbo en cet instant » (p. 19)3.
11On pourrait parler d’une naturalisation du polar — d’autres, moins convaincus, y verraient un plaquage plutôt artificiel ?
12Ce rapport complexe à la fiction est bien représenté par un lieu symbolique, celui du cinéma Channel en bas de la cour d’immeuble où la narratrice a habité : « point de contact entre la surface du monde réel et son soubassement de fiction » (p. 52). En effet, le numéro de la narratrice est inscrit sur un ticket de cinéma ; et le portrait-robot du mort est effectué, par un jeu de décalage, non par un policier, mais par l’ouvreuse du cinéma — celle qui donne accès à la fiction.
13Ce sont les paroles du policier qui déclenchent le récit, rapportées au discours direct libre : « Nous aimerions vous entendre dans le cadre d’une affaire vous concernant » ; puis au discours indirect :
le policier m’a déclaré que le corps d’un homme avait été retrouvé il y a deux jours sur la voie publique, au Havre, un individu non identifié, que j’étais censée pouvoir fournir des informations, qu’il fallait que je vienne. (p. 12)
Le brassage des registres : familiarité et littérarité
14« Ce parler neutre et factuel » du policier (p. 12) s’insère en contraste stylistique avec la déflagration produite dans la vie intérieure de la narratrice. La phrase initiale revient, désarticulée, par bribes, comme des « données » à « trier » : corps d’un homme, voie publique, Le Havre (p. 13). Ces échos ressassés, intériorisés mais jamais vraiment assimilés (toujours en italiques) viennent clore le prologue4, au cœur de l’insomnie : « Une affaire vous concernant. » (p. 20), et ils reviennent encore à la page 210, associés au processus de mémoire.
15Ce « phrasé standard de la police », volontiers elliptique, se réduit parfois au mot seul : « Homicide. » (p. 34) ; ou « narcotrafic ». (« J’ai voulu savoir ce qui était arrivé à Vinz, et Zambra, on ne peut plus concis, n’a prononcé qu’une parole : narcotrafic », p. 179). Le langage policier infuse dès lors le récit, à l’instar de l’amateur de séries policières, le pelleteur qui a découvert le corps : « Des lambeaux de parler policier infusaient son récit » (p. 96). Les termes techniques tels rubalise5 voisinent avec la langue familière ; Maylis de Kerangal emploie flic aussi bien qu’officier de police ; de même que les abréviations familières (« le proc », p. 95) côtoient les acronymes : OPJ (p. 97) ; TPTS (p. 95), IML (p. 240)6.
16Mais la langue familière qui infuse le récit est loin de relever du seul milieu policier (« ils ont chopé la came, mais pas les gars » (p. 36) ; c’est aussi celle du personnage se réappropriant l’affaire : « Putain écoute-moi, le type, ils l’ont retrouvé sur la plage, avec mon numéro de téléphone dans la poche de son jean ! » (p. 46). La langue narratoriale épouse également le langage de l’adolescente : « J’ai compris depuis longtemps que c’était foiré » (p. 122) ; « J’ai raconté un cake pour passer la nuit dehors » (p. 125) ; il se peut aussi qu’elle affiche un ethos d’écrivaine décontractée (citons les verbes se défiler, p. 18 ; galérer, p. 82 ; ou se palucher tranquille, p. 99, avec l’emploi adverbial de l’adjectif).
17Le contraste stylistique dépasse la seule problématique de la défamiliarisation du familier. Le langage relâché s’invite au cœur d’une langue tantôt savante7 (la description des bateaux sur la Tamise, ou des porte-conteneurs au Havre), tantôt marquée littérairement — depuis le style substantif (« Au loin, le phare projetait son désœuvrement sur l’avant-port », p. 105), jusqu’à une poésie plus innovante, évoquant le vent comme « une force invisible qui liait tout ensemble, sanglait le ciel sur la mer » (p. 89). Comme ailleurs, le brassage des registres relève d’une véritable stratégie d’écriture. Même si la motivation est moins visible que dans Corniche Kennedy, les deux registres cohabitent au sein d’une même phrase : « Le silence dans l’habitacle me pétait les tympans » (p. 169) — la voiture est désignée aussi par bagnole et caisse perso (p. 168) ; la coexistence se fait oxymore au sein du syntagme, tel le très représentatif « boucan du ressac » (p. 105), voire même syllepse, comme cette fantomisation qui superpose la langue de spécialité géologique et celle des sites de rencontre.
18Ce brassage des registres est plus motivé lorsqu’il reflète le mixage social évoqué à propos de la plage du Havre en été, en une longue phrase dont la langue littéraire aboutit en clausule sur un familier « mal au cul » :
[…] la clameur monte, une nappe suave et bourdonneuse, et ce bruit-là est bien celui que je préfère, celui qui dit la turbulence et l ’allégresse, […] d’autant que ces jours-là la hiérarchie sociale se dénude et se couche, […] elle s’étale, des plus modestes côté digue aux plus cossus côté cap, partage du sensible, échantillon réparti d’est en ouest selon des revenus croissants, quand c’est bien un même cordon de galets sur lequel on se pose, et qui fait mal au cul. (p. 83)
« un individu non identifié » : l’enquête reconfigurée en anamnèse
19La composition du roman s’inspire également du polar dans sa dramaturgie : le premier entretien avec le policier retarde le dévoilement de la pièce décisive qui a déclenché la convocation :
[…] la seule chose, pour l’instant, c’est ça. Il a plaqué la paroi du sachet sur un morceau de papier, […] puis m’a demandé de lire ce qui était inscrit. Dix chiffres à l’encre bleue. Des risées ultrarapides ont balayé la surface de ma conscience. C’était mon numéro de téléphone. (p. 42)
20Mais cette dramaturgie policière est méthodique, quand celle du roman, liée aux émotions, est plus désordonnée, non linéaire : par exemple, la date de ce Jour de ressac n’est livrée qu’à la fin de la deuxième partie — le 16 novembre (p. 101). Le passé resurgit au détour des réminiscences du je narrant : les informations sont donc présupposées et non posées, les indices liés à la quête du passé sont retardés et inscrits par touches successives, en une série de « flashs », au gré des déambulations dans Le Havre. Le parcours de la ville imposé par l’intrigue policière évite d’ailleurs à Kerangal, comme elle le dit lors d’une interview, d’écrire un « livre des souvenirs8 ».
21Car l’enquête policière se trouve reconfigurée en un exercice d’anamnèse — autour de la notion d’identification.
22Des éléments très concrets du polar, autour de l’identification d’un corps, enclenchent une réflexion autour de l’identité — jusqu’à l’évocation du bracelet d’identification de la fille de la narratrice (p. 226), tandis que les photos montrées au commissariat, ou le portrait-robot du mort de la digue Nord libèrent une poétique des traces mémorielles, à laquelle Maylis de Kerangal associe également un langage scientifique, celui du « gyrus fusiforme » dans le cerveau, qui archive les informations faciales (p. 77). Les images de Craven « demi-effacées, demi-revenantes » (p. 240) rejoignent le flou de la disparition dans la dernière page de l’œuvre : « et dans un flash j’ai revu Craven en chemise claire sur le quai de la gare du Havre, […] son visage déjà flou s’effaçant à travers la lucarne voilée de poussière » (p. 242).
23Quant aux « signes particuliers », Maylis de Kerangal en déploie l’expression page 205 — et elle revient au sujet de « ces trois grains de beauté » de Craven au creux du coude : « Le signe particulier de Craven » (p. 242), qui restera justement le point aveugle du récit. « Le corps d’un homme », cadavre sur la digue, peut appeler celui de l’intimité amoureuse.
24À partir de l’« individu non identifié » découvert sur la plage, une piste va s’esquisser en effet : l’éventuelle ressemblance entre le mort de la digue Nord et Craven, ce premier amour de la narratrice adolescente, qui resurgit subitement. Cette piste enclenche une dramaturgie de l’identification, qui se rejoue stylistiquement par une approche référentielle du dévoilement progressif, de l’opacité jusqu’à l’élucidation.
25Surgies de la mémoire du je narrant, les désignations sont d’abord opaques, passant par des repérages déictiques et des noms propres : un prénom, Craven, un toponyme : le Ponant.
26L’apparition de Craven est d’abord préparée par une allusion aux étudiants du Ponant, au détour d’une insertion entre tirets, au moment où la narratrice va au bar des Sirènes : « L’un des jeunes à la table du fond – j’ai pensé à des étudiants du Ponant — s’est retourné » (p. 117).
27Le toponyme, opaque lors de sa première occurrence, désigne en réalité par synecdoque l’école d’hydrographie du Ponant fréquentée par Craven (un lieu fantôme lui aussi puisqu’on apprend par la suite qu’il est désaffecté). En même temps, ce nom propre inscrit la mémoire d’une langue plus ancienne (Ponant désignait l’étendue maritime à l’Ouest de la France, par opposition au Levant qui désignait la mer Méditerranée).
28Puis apparaît le prénom Craven, tout aussi opaque ; enfermée dans la salle de bains, la narratrice en pleurs se remémore brusquement son drame d’adolescente, ce premier amour disparu sans jamais donner de nouvelles — on est juste au milieu du livre (p. 120 sur 242) :
Ces perceptions m’ont rappelé la salle d’eau mêmement carrelée où je m’enfermais […] Craven avait disparu depuis si longtemps que je me demandais si ce que nous avions vécu était réel, si ce sentiment entre nous avait bien existé, […] je me repasse le film […] pour repérer ce qui cloche, ce qui présage sa fantomisation, la mienne, déclenche cette fin de crête amoureuse. (p. 119-120)
29À la faveur de ce carrelage très proustien, cette histoire d’un premier amour est alors livrée à rebours, depuis le drame de la disparation jusqu’à la première rencontre9. Les désignations restent ici en creux, avec les pronoms indéfinis ou interrogatifs ce que, ce qui, et avec l’hyperonyme « ce sentiment », spécifié par amoureuse seulement en fin de phrase.
30Or ce n’est qu’à la page 211 que revient ce nom de Craven, comme possible identification du cadavre. La piste est déclenchée par l’idée de disparition volontaire évoquée par le policier :
[…] j’aurais prononcé ces segments de phrase qui auraient su éclaircir ce qui se jouait en moi, le corps d’un homme, la voie publique, Le Havre, [...] je les aurais vus tels de petits îlots plongés dans le bac de révélateur, […] cette opération lente, flagrante, irréversible, étirée jusqu’à faire apparaître Craven, mon numéro de portable au fond de sa poche. (p. 212)
31Non seulement ce rapprochement n’est qu’une hypothèse, mais l’opération mentale même qui y préside reste virtuelle, à l’irréel du passé ; et elle est présentée indirectement, par la métaphore du révélateur photographique. Le rapprochement est suggéré seulement par la construction détachée qui noue le prénom de Craven à l’affaire : « Craven, mon numéro de portable au fond de sa poche. »
32Mais le roman s’achève sur une non élucidation. Quand la narratrice pourrait « savoir enfin », elle ne demande pas à l’IML qu’on découvre le bras du cadavre pour repérer si y sont les trois grains de beauté.
Variations sur le thème du ressac
33Mais repartons du titre : Jour de ressac. Il contient une syllepse qui repose sur le sens propre et figuré du mot ressac, et qui se décline subtilement dans l’œuvre : ressac en effet, terme de marine d’origine espagnole, dérive du verbe resacar formé sur le préverbe latin re- et signifie au sens propre : « mouvement de va et vient de la mer », plus exactement « retour violent des vagues vers le large, après qu’elles ont frappé avec impétuosité une terre, un obstacle. » (TLF) ; puis au sens figuré : « retour brutal d’une émotion refoulée ». Sont présents, au propre comme au figuré, les deux sèmes de /retour/ et de /brutalité/.
34Cette brutalité est présente dans la frappe de la vague, qui agit comme une claque au cœur du récit. Y correspond aussi le coup de téléphone initial, « sa frappe sourde » (p. 13) remotivant le sème concret de choc.
35Le choc émotionnel se concrétise également dans l’image du choc électrique, lié à la verbalisation du souvenir : « et j’ignore encore de quoi était faite l’émotion qui m’a électrisée tout entière quand je suis parvenue enfin à lui déclarer […] que j’avais vécu dans cette ville il y a très longtemps » (p. 45) ; ou bien, à la redécouverte du tract sur les morts de la rue, qui la projette en arrière, comme si elle avait reçu « un coup de jus » (p. 108).
Le préverbe RE : revenir, retourner
36La morphologie même du mot ressac se décline dans toute l’œuvre, avec l’afflux massif du préverbe re-, lié à la fois au sens propre et au processus de remontée brutale du souvenir. Il ne s’agit pas du sens itératif, mais du sens de « retour à l’état initial », ou « mouvement fait en sens inverse ».
37Le préverbe est même épinglé dans le roman, à propos de l’architecture du Havre, qui nous dit « quelque chose qui n’est ni la Reconstruction, ni la Renaissance, ni la Réparation tout ce qui commence par re pour que reviennent les rêves perdus, non, elle est la trace matérielle de ce qui a disparu » (p. 71).
38Ce préverbe est d’abord présent dans le verbe revenir (qui présuppose une absence) — c’est celui du retour au Havre : « Si longtemps que je ne suis pas revenue au Havre » (p. 29) ; « je suis revenue une fois au Havre, il y a dix ans » (p. 190)
39Partir, revenir, repartir, ce sont ces mouvements d’aller-retour Paris-Le Havre qui structurent ce « jour de ressac » (tandis que retenir exprime un élan en sens inverse lors du retour à Paris : « quelque chose me retient dans ce train qui repartira au Havre dans quelques heures », p. 231)
40Ce mouvement d’aller-retour est figuré en miniature par celui de la promenade sur la digue Nord, en cette phrase binaire : « Sur la Digue, l’aller enclencherait la décongestion de l’esprit tandis que le retour, inversant le point de vue, prendrait la réalité à rebours, pour faire apparaître sinon une réponse, du moins une autre formulation : l’art de revenir sur ses pas » (p. 106-107)
41Mais ce verbe revenir, qui présuppose également au sens figuré une disparition de l’espace mental, est aussi lié à l’enquête policière : « Appelez-moi si quelque chose vous revient » (p. 44). Cet emploi va informer tout le processus d’anamnèse de la narratrice : « C’est que vous y avez repensé, quelque chose a dû vous revenir » ; « mais y penser avait pris la forme d’une ville, d’un premier amour, d’un porte-conteneurs » (p. 189)
42Deux verbes figurent dans les paroles du policier, repenser impliquant le contrôle du sujet, contrairement à la construction de revenir, avec le datif d’intérêt et l’indéfini « quelque chose », marquant un processus mémoriel non contrôlé. De fait, l’écriture de Jour de ressac oscille entre les efforts de remémoration volontaire, et le surgissement du passé enfoui.
43L’absence de contrôle est encore plus flagrante dans l’emploi du verbe revenir sans datif d’intérêt, gommant le siège de la mémoire. Comparons les deux emplois :
J’avais hâte d’être dehors, […] exfiltrée d’une nuit bousillée par des réveils successifs, réveils où la phrase du flic me revenait aussitôt, ondoyante, récursive, telle une ligne de basse (p. 26).
Et les photos vues ce matin sont revenues (p. 26)
44On note également se réimposer, forme auto-causative effaçant totalement le contrôle du sujet : « puis dans la foulée les dix chiffres à l’encre bleue de mon numéro de portable se réimposent. Putain. » (p. 75)
45C’est le juron qui prend ici en charge la brutalité du choc en retour.
46Quant au verbe ramener, il fait du sujet pensant un objet, accentuant l’absence de contrôle des associations d’idées : « je me suis souvenue que ce petit homme10 travaillait le béton et la lumière, la monumentalité, le mystère, ce qui, évidemment, m’a ramenée au Havre » (p. 15).
Ramener est employé au passif quand la narratrice reconnaît son vieux professeur d’anglais : ça revient, sa peau est parcheminée, jaunâtre, mais ses traits le restituent, je lui tends une main maladroite, empoissée de malaise, car ramenée dans l’instant à ce jour de décembre où j’avais triché lors d’un devoir sur table (p. 58)
47Les associations d’idées comportent même quelque chose de presque magique, comme le note « l’expression sorcière » qui rappelle l’interview pour un exposé sur Le Havre, au lycée : « la ville aplatie, laminée, rasée par les Alliés, lesquels n’y étaient pas allés de main morte, expression sorcière qui a fait revenir la voix striée […] de Jacqueline » (p. 64-65).
48La grande histoire, le bombardement du 7 septembre 1944, racontée par la survivante, est ici amorcée par la petite : le souvenir d’un exposé.
49On notera enfin un jeu intéressant sur le verbe retourner et son déploiement actanciel, entre emploi intransitif, pronominal ou transitif. Il évoque la promenade aller-retour sur la digue : « Ainsi retournée, le vent dans le dos, […] j’avais un autre point de vue sur ce qui m’arrivait » (p. 110). On retrouve ce verbe dans l’expression figée retourner une question, qui rejoint bien l’idée de choc en retour : « Ce mec qu’on a retrouvé, tu le connais ? […] Trois fois aujourd’hui qu’on me retournait cette question » (p. 160)
50L’emploi transitif est plus atypique, exprimant la remémoration : « Un matin au réveil je m’affole, j’ai fait ou dit quelque chose qu’il ne fallait pas, je retourne l’été qui vient de s’écouler » (p. 12).
51Enfin, ce n’est pas un hasard si la dernière phrase du roman mobilise les deux verbes retourner et revoir : « Bientôt, on viendrait emporter le corps qui retournerait au noir total, […] et dans un flash j’ai revu Craven en chemise blanche sur le quai de la gare du Havre, […] » (p. 242).
Ressac et figuralité
52Déclinant la syllepse initiale du ressac, Kerangal va entrelacer les deux fils sémantiques.
53Liées au sens propre, les métaphores marines s’infiltrent, déjà avant l’arrivée au Havre : « La situation a pris de la vitesse, j’avais la sensation d’être projetée dans une forte houle » (p. 36) ; jusqu’à la démarche du conjoint de la narratrice, qui se tourne « tel un cargo qui change de cap » (p. 18)11.
54Les comparaisons associent très concrètement le monde policier aux objets maritimes, au sujet de l’officier « enroulant lentement le câble noir de l’ordinateur autour de sa main, comme un marin love un cordage » (p. 44). Et la comparaison marine caractérise également le premier amour : « notre sentiment […] est concret comme un caillou, réel comme la proue qui fend l’eau » (p. 176).
55Dans le contexte du roman, la métaphore marine est métonymique, alliée à l’espace fluvial et maritime du Havre. Le meilleur exemple se rencontre à la fin du livre, à l’avant-dernier chapitre, avec la question ouverte du conjoint lorsque la narratrice rentre du Havre : « un « alors ? » face auquel je suis restée silencieuse, impressionnée par cette question en forme d’estuaire, cette question si vaste, qui appelait un récit qu’il était encore trop tôt pour moi de lui faire » (p. 235). Une question qui appelle un récit lui aussi ouvert sur le large, en forme d’estuaire.
La vague marine : de la métaphore au symbole
56Quant à la vague marine, elle est présente également sur le mode métaphorique : à la crête de la vague correspond cette fin de crête amoureuse sur laquelle s’interroge la jeune fille (p. 120). La vague comme force concrète de ressac revient pour décrire à la fois l’émotion présente, devant le Ponant désaffecté, et passée, celle du premier rendez-vous avec Craven. Le passage superpose en effet les deux époques : « j’entendais les vagues rouler au bas de la falaise, l’une d’entre elles s’est levée entre toutes […] et m’a expulsée sur la route du Cap trente ans auparavant » (p. 173). La vague évoque alors la marche d’autrefois vers Craven, et la montée de l’émoi amoureux :
Et une fois dehors, alors que je passe le coin de la rue, je sens la vague revenir dans mes jambes, douloureuse et jouissive, la vague qui accélère mon pas, le rendez-vous a été fixé au Ponant, il faut grimper sur le plateau de la Hève, et plus je me rapproche et plus la vague insiste […] je ne suis pas persuadée d’être amoureuse de ce garçon, c’est beaucoup plus fort que ça, je ne sais pas nommer la vague, [...]. (p. 172)
57Maylis de Kerangal semble en fait remotiver la métaphore quasi figée de la « vague de désir » qui submerge — le Ca s’affranchit du Cé, la vague et l’amoureux s’alignent comme sujets des propositions :
la vague augmente sa vitesse, elle est speed et légère, Craven m’embrasse sur la bouche (p. 174)
Craven rigole, la vague est haute, elle me décolle du sol, il me prend par la main (p. 175)
58La métaphore de la vague devient donc allégorie.
59Surtout, elle se fait symbole concret, avec cette vague qui trempe la narratrice sur la digue. Cette frappe réelle et symbolique de la vague est au cœur du récit — comme une synchronisation concrète entre itinéraire intérieur et réalité :
Je me suis demandé si cette histoire […] n’avait pas pour dessein secret de me faire revenir au Havre, et à l’instant où je me formulais cette hypothèse, à cet instant exactement, comme si la réalité se synchronisait pile-poil à mes cogitations, je me suis pris une énorme vague. (p. 111)
60Le verbe brasser, qui peut aussi avoir un sens émotionnel, prolonge la syllepse de ressac : « J’ai fermé les yeux et de nouveau revu la vague, ce flot violent qui […] m’avait brassée » (p. 118). La vague concrète, c’est aussi la prise en charge symbolique de l’épopée intérieure : la claque de la vague — comme un retour du refoulé, une claque, voire « une personne » : « je l’avais appelée, elle était venue. » (p. 118)
Une paronomase constituante
61Le sens marin de ressac est celui d’un mouvement brusque mais aussi inlassablement répété. Le processus à l’œuvre dans Jour de ressac se situe de fait entre soudaineté de la réminiscence et itération du ressassement, deux faces d’un même choc émotionnel : « Je n’avais fait pratiquement fait que penser à ça depuis ce matin » (p. 189).
62Le verbe ressasser émerge alors, avec la figure du premier amour : « son départ me laissera toute latitude pour ressasser l’été radieux que nous venons de vivre » (p. 120).
63C’est dans le même sens que Kerangal emploie, on l’a vu, le verbe retourner : « je retourne l’été qui vient de s’écouler, je filtre juin, juillet, août, je tamise » (p. 121).
64Et justement, le premier sens de ressasser, déverbal de sas, « le tamis », c’est « tamiser » (ressasser du plâtre, de la farine) – d’où le sens figuré « revoir en esprit ; revenir sans cesse sur les mêmes choses ». Et comme par hasard, c’est le substantif sas, au sens propre, qui est employé pour le pont de Tancarville, « sas entre deux mondes » (p. 205).
65Or, ressac et ressassement se trouvent subtilement associés par l’entremise de l’élément marin, après la claque de la vague sur la digue Nord : « la mer ressassait de plus belle derrière la muraille, son mouvement très audible » (p. 111).
66Un jeu de paronomase vient donc lier le monde marin aux émotions, entre choc émotionnel et ressassement. Le ressac figure alors cette tension entre le trauma d’un jour J, et sa réitération continue, cyclique.
67La vague est dès lors reliée étroitement au temps, sous toutes ses formes, comme elle l’était dans Réparer les vivants. Mais aussi au tempo particulier du récit et de la phrase — marque de fabrique du style de Kerangal.
Temps et tempo
Temps long, temps court
68Kerangal dans Jour de ressac noue plusieurs strates temporelles, comme elle aime à le faire : la concentration du récit en une journée s’ouvre en estuaire sur le temps de l’Histoire, celui du bombardement du Havre, et sur le temps encore plus long de la géologie, de cette « histoire lithique » des galets (p. 83).
69Une seule phrase juxtapose ainsi les rythmes « naturels », en une sorte de polyrythmie qui pourrait être aussi, on le verra, la marque stylistique de l’œuvre. La plage du Havre est en effet « un plateau où s’enchevêtrent les rythmes sur lesquels les humains n’ont pas encore de prise, celui de la lune et celui des nuages, celui de la houle et celui de l’érosion, la durée nécessaire pour qu’un éclat de silex devienne un galet ou celle qui suffit à faire fondre un esquimau dans la main d’un enfant » (p. 84). Les anaphores non coréférentielles (celui, celle) arriment ici des temporalités opposées.
70Se jouent aussi le temps de la « métamorphose lente » de l’adolescence (p. 229), ou celui qui sépare les générations : quand le père répond à sa fille qu’elle pourra aller sur Mars « de son vivant », l’expression suggère « un entrelac de durées qui avait coulissé dans l’air comme un lasso et nous avait noués tous les trois, nous rappelant au même instant qu’un jour nous serions séparés » (p. 87).
71Le temps est souvent perçu comme matériau, que ce soit à l’échelle géologique, à celle d’une vie, ou à celle d’une journée. Il se rompt comme une matière dès l’élément déclencheur du récit, le coup de téléphone du policier : « on a raccroché, et le temps s’est aussitôt rompu contre mon oreille, crac, cassé en deux, matin et après-midi désormais inconciliables » (p. 12). Cette métaphore était déjà présente dans Réparer les vivants : « La sonnerie du téléphone a fendu la continuité du temps12 ». C’est justement un passé composé qui rend compte de cette rupture dans le fil des événements, par une « saisie résultative de l’événement » qui détermine « un avant et un après ». Ce temps accompli mais non borné présente l’événement à la fois comme procès et comme résultat, depuis la borne finale de son accomplissement13.
72Dans Jour de ressac, le récit à la personne 1 élimine le passé simple en faveur de la proximité du passé composé : le point de perspective s’ancre dans celui de l’énonciation, que l’événement soit proche ou éloigné dans le temps.
73Cette proximité avec le je narrant naît aussi de l’effet d’oralité du récit : « je me suis pris une énorme vague ». Cet énoncé, avec l’emploi de prendre et son datif d’intérêt (me), pourrait nous être directement adressé par la narratrice, de retour de sa promenade sur la Digue. La voix de la conteuse se rend familière, proche, comme avec cet emploi de l’adverbe décidément, décroché entre tirets : « les herbes hautes trempaient de nouveau mon jean à hauteur des mollets – décidément –, […] » (p. 170).
Présent/passé
74À l’emploi du passé composé, qui ne permet pas d’ordonner une chronologie, se mêle une composition non linéaire. Le repérage dans le temps et dans l’espace traduit l’errance de la narratrice au gré des lieux du passé retrouvés ou perdus (tel bar a été remplacé par une agence bancaire, l’École du Ponant est désaffectée).
75Les raccords du présent au passé sont marqués souvent très simplement, soit
76— par une subordonnée temporelle démarquée par le tiret : « je suis allée me recroqueviller sur une banquette — quand je vivais juste derrière, le Bar des Sirènes était un bar de gens de bateau » (p. 113-114)
77— par une comparative : « hop, hop, exactement comme je courais ici, enfant » (p. 84) ;
78— ou par une relative : « J’ai balisé ce parterre au faux air de land art […] où j’avais tant de fois galéré à étaler ma serviette » (p. 82). (Rappelons « la salle d’eau mêmement carrelée où je m’enfermais », p. 119-120).
79Le raccrochage est parfois plus libre à propos de l’aire de jeu de l’enfance : « un éclair, et le contact métallique des barres de la cage à poules me brûle les paumes, j’entre dans le préau » (p. 38) : une phrase nominale interrompt le flux syntaxique et balise le surgissement au présent de la sensation d’autrefois.
Composer le ressac : les analepses
80Paradoxalement, c’est le présent qui est employé pour ces analepses replongeant dans le passé du je narré, tandis que l’actualité du je narrant privilégie le passé composé et l’imparfait. Le processus d’anamnèse, en forme de ressac, met donc en branle en effet une série d’hypotyposes.
81L’exemple précédent d’analepse surgie au cœur d’une phrase est rare14 ; l’analepse forme plutôt une séquence au sein d’un chapitre, comme celle du rendez-vous avec Craven trente ans auparavant, déclenchée sur la route du Cap : « C’est un samedi de juin » (p. 171). L’analepse est indiquée par un alinéa, puis un alinéa double en marque la sortie : « Ce qui m’a frappée quand je suis ressortie sur la route du Cap, […] » (p. 177)
82Trois séquences au présent d’hypotypose occupent tout un chapitre, brisant la linéarité du récit : l’une d’elles, concernant le baptême de l’Hirondelle dix ans avant, donne son nom à la deuxième partie du livre. Figure également le chapitre narrant une sortie à Rouen à l’âge de huit ans (p. 212).
83Le repérage est moins aisé avec le chapitre qui revient sur l’aller-retour à Londres pour un doublage (il s’avère un échec et permet de poser la question, au passage, de l’IA). Ce chapitre participe de cette relative désorientation du récit non linéaire, de cette narration peut-être volontiers « mal foutue » ; l’on infère qu’il se situe trois jours avant d’après l’indication donnée page 109. Cette désorientation s’accentue avec l’incipit nominal : « Aube livide gare du Nord » (p. 140), alors que le récit principal concerne un trajet depuis la gare Saint-Lazare.
84Une dernière analepse, celle du dernier chapitre qui s’ouvre cette fois au plus-que-parfait, revient en arrière de quelques heures, pour retracer la scène cruciale de la vue du corps à l’institut médico-légal de Rouen. Le retour final à Paris est donc placé dans l’avant-dernier chapitre : cette interversion permet de déplacer la scène décisive à la toute fin, de différer le récit — comme le récit de la narratrice à son compagnon (« je te raconterai »). Les analepses se rapprochent de plus en plus de l’actualité du je narrant : de trente ans en arrière, à quelques heures.
85La dernière phrase, au conditionnel de perspective, ou d’anticipation, prend alors un relief saisissant, seule prolepse sur cette série d’analepses : « Bientôt, on viendrait emporter le corps qui retournerait au noir total, […] ». Très littéraire, l’emploi de ce temps produit en clausule un rare effet de pathos.
La phrase de Kerangal : le « jeu de vitesses »
86Enfin, l’univers stylistique de Kerangal s’articule à une polyrythmie, et à des variations de vitesse et de tempo qui sont sa signature. Le tempo signifie en musique : « fréquence des pulsations » ; pour le texte littéraire, ce serait la vitesse de lecture, l’interprétation d’un rythme15, qui est suggéré dans le texte par des indices et se révèle à la lecture. On peut distinguer la vitesse représentée (diégétique), de la vitesse rejouée dans la phrase.
Rallentando et ressassement
87Tandis que la phrase longue accélère le tempo, la phrase brève, plus isolée chez Kerangal, le ralentit — comme cette marche lente et difficile sur la plage du cadavre : « Je marche sur les cailloux et le sol bouge sous mes pas. Il roule et se fragmente, il rague dans un bruit de chaînes lourdes. » (p. 84).
88On peut aussi rattacher au rythme ralenti du ressassement les effets de relance, au sein d’une phrase longue :
J’avais hâte d’être dehors, hâte, [...] exfiltrée d’une nuit bousillée par les réveils successifs, réveils où la phrase du flic me revenait aussitôt, ondoyante, récursive, telle une ligne de basse. (p. 26)
89Participent de ce ralentissement-ressassement ces bribes de phrases désarticulées, échos elliptiques du discours du policier, revenant en italiques, comme l’équivalent phrastique d’un arrêt sur image : « le corps d’un homme », etc. Même effet avec les hyperbates en clausule de la deuxième partie, qui réarticulent tardivement l’impact de l’affaire sur la narratrice, de « cet homme vraisemblablement assassiné. Qui avait eu l’intention de me téléphoner. Qui avait quelque chose à me dire. » (p. 102)
90Particulièrement adaptée au mouvement du ressac, on notera la phrase plus périodique, comme celle qui décrit le mouvement d’aller-retour sur la digue16, où « la grammaire du corps s’indexe » sur celle de la pensée.
91Sur ce modèle à deux versants, la phrase avec quand adversatif est récurrente – on peut aller jusqu’à parler de tic stylistique. La construction revient même trois fois, en se combinant au mouvement de relance, à propos de la rue principale du Havre. La structure à ressac se démultiplie, mêlée au ressassement de la longue phrase à relance (« voir la mer » est répété trois fois, de même que la structure en quand — pour opposer la réalité havraise au désir des visiteurs, en une figure de paradiastole (opposition de deux points de vue) :
[…] une perspective créée pour faire croire au rêve d’un horizon marin visible dès la descente du train […] quand l’apparition de la mer est ici un événement qui relève de la scénographie […] voir la mer, initiation alpha pour ceux qui ne l’avaient jamais vue, se l’imaginaient bleue quand la nôtre était autre chose, rude, complexe, à la fois pétrolière et impressionniste, prosaïque et rêveuse, voir la mer, oui, […] quand pas un seul d’entre eux, of course, ne se serait attardé ici. (p. 63)
92C’est sur ce modèle qu’est construite une phrase essentielle du roman, celle qui évoque le possible rapprochement entre l’homme de la Digue et Craven ; le subordonnant y oppose le virtuel au factuel :
Puis il a regardé l’heure, nous y sommes dans vingt minutes, quand j’aurais voulu que l’on s’arrête là, sur le bas-côté, j’aurais prononcé ces segments de phrase [...] jusqu’à faire apparaître Craven, mon numéro de portable au fond de sa poche. (p. 210)
Accélérations
93L’accélération du tempo est favorisée par l’accumulation dans une seule phrase de propositions en parataxe, ou par les insertions multiples, spécialement lorsqu’elles s’accompagnent d’ellipses : « lumière de cyanotype17, jamais vu un ciel si net, si lisible » (p. 177) : à la phrase nominale sans déterminant succède l’ellipse du sujet je.
94Contribue à l’accélération l’alignement d’éléments hétérogènes, constructions détachées, ou discours rapportés — comme cette coordination entre un discours indirect et direct libre : « On me dit qu’une telle conduite […], et s’il te plaît sors de la salle de bains » (p. 123).
95Ou bien de simples virgules séparent des éléments qui n’ont pas le même statut syntaxique, énonciatif, ni même informatif — c’est la virgule « polyvalente » définie par Cécile Narjoux18 :
La veille de Noël, des heures que je suis là-dedans c’est pénible19, elle a besoin d’entrer, le sang gicle sur le lavabo, je reçois à Noël des bottines bleu canard, je suis surveillée comme le lait sur le feu. (p. 123)
96La juxtaposition engendre ici un nivellement des informations (entre le cadeau des bottines, et la tentative de suicide). L’événement crucial reste à inférer d’une proposition cachée dans le reste de la phrase : « le sang [et non mon sang] gicle ». L’accélération du tempo, c’est dans le style de Kerangal la marque de l’intensité, là où se refuse un pathos plus explicite.
97L’alignement peut générer une variation de tempo à l’intérieur même de la phrase, lorsqu’à une séquence de discours indirect libre intérieur est juxtaposée un élément diégétique également à l’imparfait :
Le passé […] se rechargeait au cours de la vie, le passé restait vivant, l’autoroute s’enfonçait à présent dans les terres, elle gagnait l’intérieur du continent […] (p. 211)
98Le coup d’accélérateur rejoue l’accélération du véhicule sur l’autoroute.
99Autre exemple de phrase offrant une variation sensible du tempo :
[…] c’est un samedi au début des années quatre-vingt-dix, juin, la ville est ensuquée dans mon dos, la Manche méditerranéenne, azurée, iridescente, […] (p. 174)
100L’on passe ici d’une insertion elliptique libre, rapide (« juin »), à une ellipse plus traditionnelle portée par un rythme ternaire qui ralentit la suite : « La Manche [est] méditerranéenne, azurée, iridescente ».
101L’écrivaine joue de cette polyrythmie notamment avec les appositions :
Au loin, le phare projetait son désœuvrement sur l’avant-port, flou et solitaire, résigné à attendre le soir pour émettre sa signature lumineuse : un éclat rouge toutes les cinq secondes visible à vingt et un mille nautiques. Le battement cardiaque de la nuit portuaire. (p. 105)
102La période cadencée se clôt sur la relance rythmique de la double apposition, typique du style de Maylis de Kerangal, avec l’épiphrase en clausule — un ralentissement qu’on pourrait presque nommer un arrêt sur rythme.
Tempo et diégèse
103Surtout, dans ce livre Kerangal a une manière particulière de nouer, de « sangler » le tempo à la diégèse. L’incipit, en particulier, constitue un prologue en « allure de bobsleigh ».
104La vitesse, d’abord diégétique, est rejouée par le tempo bousculé de la première phrase, longue d’une page. L’entrée in medias res décompose l’élément déclencheur (« j’ai reçu l’appel vers quatorze heures »), très concrètement, en une série précipitée de gestes depuis la quête fébrile du téléphone (« j’ai tâté mes poches, senti le boitier pulser à travers l’étoffe »), jusqu’à « j’ai décroché » — tout cela entre les deux adverbes aspectuels, encore et déjà, « j’avais encore mon manteau » et « car le sol, déjà, roulait sous mes pieds » (p. 11).
105Cet appel téléphonique en prologue va générer un emballement de la phrase, mais aussi de tout le récit : on se souvient de l’alarme de Simon, dans Réparer les vivants, à partir de laquelle « tout s’est emballé ».
106Par ailleurs, Maylis de Kerangal combine dans cet incipit deux formes d’intensité. D’une part une forme très classique à laquelle elle n’est pas accoutumée — rien moins que deux systèmes d’intensité-consécution sur une page : « J’éprouvais une telle sensation de vitesse que j’ai cherché un point fixe où accrocher mes yeux » et « matin et après-midi si divergents, déjointés, qu’ils étaient devenus incapables d’assembler une même journée » (p. 12). Et d’autre part, l’intensité marquée par une onomatopée, « crac » (tout comme le juron putain peut être marqueur d’intensité).
107Mais le tempo peut être contraire au temps diégétique :
108— ou bien il ralentit un moment très court : ainsi, la phrase de la vague retarde et ralentit le moment où elle explose :
[…] j’ai levé la tête une fraction de seconde vers les milliers de gouttelettes qui scintillaient dans l’air, vers ce dôme où convergeaient les eaux de la mer et du ciel, si bien que le corps de la vague, son soubassement marin, s’est abattu sur moi, splach ! (p. 111)
109Ici l’onomatopée (« splach ») n’est pas médiane, comme acmé d’une période, mais souligne justement la retombée de la phrase — qui accompagne celle de la vague — avec une chute en cadence mineure.
110— ou bien c’est un tempo rapide qui scande une durée longue : on pourrait prendre comme exemple d’accélération la séquence du rendez-vous amoureux au Ponant ; mais j’ai choisi celle qui déroule le temps de l’attente vaine de l’adolescente, liée à la disparition de Craven. Les phrases au présent d’analepse font défiler le temps à partir du départ de Craven, de septembre à juin : là encore, Maylis de Kerangal évite le pathos en une sorte d’écriture plate, évitement compensé par la bousculade intense du tempo. « Une semaine se passe. Les cours reprennent au lycée, le ciel fraîchit. » (p. 120). Les mois défilent, pointés par des phrases nominales :
Octobre, et maintenant l’attente me harcèle, […] (p. 121)
Avril à présent, avril de bruyère et de pulls shetland, je sors de la salle de bains, je déchire la photo et la jette au bourrin. (p. 123)
Quand juin se pointe, je repars bronzer sur les galets. (p. 124)
*
111En s’essayant à la première personne, Maylis de Kerangal choisit l’éviction du passé simple, ainsi qu’une narration non linéaire, enchevêtrant les pistes, les temporalités ; malgré le foisonnement et l’effet « vrac » de l’œuvre, on note cependant, par rapport aux autres romans, un certain retrait à l’égard de l’invention stylistique, peut-être en compensation de ce je mis en avant.
112Va-t-on plus loin dès lors dans l’intériorité, comme l’affirme l’écrivaine ? et dans l’empathie ? « Une affaire nous concernant » ? Pas sûr, car on peut ressentir un certain malaise avec ce faux polar, prétexte peut-être un peu artificiel au « livre souvenir » dont Maylis de Kerangal dit refuser la forme.
113Nous sommes pourtant en présence d’un roman au charme étrange — entre classicisme et modernité, entre familiarité et défamiliarisation, banalité et originalité, entre lenteur et précipitation. Si l’on est embarqué malgré tout, c’est par ce rythme intense et changeant comme les eaux et la lumière du Havre.

