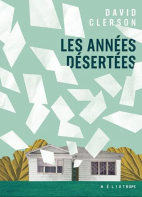
Des contes magnifiques et imparfaits
Cette communication a été faite dans le cadre du programme Lectures sur le fil, le vendredi 11 avril 2025 à la bibliothèque de l’UFR de langue française de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université. En ligne : https://shows.acast.com/lectures-sur-le-fil.
1Le livre que je vais présenter ici est sorti en 2024 au Québec, aux éditions Héliotrope et s’intitule Les Années désertées. Son auteur, David Clerson, a déjà acquis une reconnaissance non négligeable au Québec, reçu entre autres un prix pour son premier roman, Frères, et deux de ses livres ont été traduits en anglais. Il enseigne en cegep. Ses cinq livres, romans ou recueils de nouvelles, sont brefs, et dessinent un univers imaginaire singulier, où l’inquiétude fantastique s’insinue dans le noyau domestique le plus moyen et le plus familier, sous la forme d’un body horror transgressant les frontières entre humains, mammifères, arachnides et moisissures.
2Les Années désertées se situe soi-même entre le roman et le recueil de nouvelles. Le narrateur raconte que son grand-frère a quitté le domicile familial au moment où il était adolescent, sans prévenir et sans laisser de trace.
Pendant près de trente ans, je ne sus rien de lui, puis j’appris sa mort. Mon père avait perdu la vie deux ans plus tôt, à l’âge de soixante-dix-huit ans, malade du ventre. Depuis, ma mère vivait dans une maison de retraite, qu’elle ne quittait presque jamais, à moins d’un kilomètre de la maison de banlieue où j’avais grandi. Quand, en mai 2020, je lui annonçai la disparition définitive de son fils aîné, elle me répondit par un silence.
3Le narrateur apprend peu après que son frère lui a légué une maison à la campagne (un bungalow des années 1960). Dans la cave sont entreposés des cartons de manuscrits rédigés et imprimés par le frère. Les cent brefs récits qui suivent sont le résumé, par le narrateur, des cents textes écrits par le frère. Le dispositif narratif est donc familier : il reprend le motif ancien du manuscrit trouvé. Le dispositif énonciatif en revanche, quoique simple (il n’y a qu’un énonciateur, le narrateur fictif), parasite le motif du manuscrit retrouvé. La voix du frère auteur n’est pas audible, elle est presque intégralement filtrée par celle du narrateur qui résume, évalue, partage ses impressions de lecture, citant parfois, mais rarement, une des formules étranges écrites par son frère. Voici le premier de ces textes, qui permettra de situer l’atmosphère d’ensemble :
Dans Les pendus divinatoires, des frères jouent au jeu du pendu. Ils dessinent, au bout de potences, des corps souvent incomplets, et écrivent, sous les pendus, des mots qu’ils inventent : razure, clibouille, chiengouffre. Ils s’en gravent d’autres sur la peau : clistrouille, gouffrecanu, rezure. Avec leurs propres corps, ils jouent au pendu. À eux aussi, il manque des membres. L’un est manchot, l’autre cul-de-jatte, un autre encore, dépourvu d’oreilles. Le sixième n’a pas de tête. Il leur arrive de se prêter des bras, des pieds, des mains. Parfois l’un d’eux se retrouve ainsi avec trois bras ; un autre avec deux têtes. Pour six, ils n’ont qu’une langue, qu’ils se passent sans cesse. Aucun ne se rappelle à qui elle appartient. (p. 15)
4On perçoit assez intuitivement l’intertexte mythologique antique avec cette langue que se passent les frères et qui évoque les Grées ; mais l’Antiquité n’est pas une source d’inspiration si notable pour Clerson, et il faut bien sûr prêter plutôt attention au double sens de langue : organe de chair (qu’on peut d’ailleurs se passer sur les dents ou sur les plaies) et langage. Ces jeux de langue sont inscrits dans le texte avec les deux séries de néologismes ; mais ce qui est curieux dans ces deux séries, c’est leur construction en miroir, leur similitude, y compris pour gouffrecanu, qui fait jouer le paradigme morphologique de chien en diachronie. C’est là une dimension importante du livre : le fonctionnement combinatoire, à partir d’éléments très simples, tirés du corps, de la vie quotidienne et familiale (jouer au pendu), qui ensuite se contaminent les uns les autres.
5Tout cela forme en effet un réseau (Chiengouffre est aussi le titre d’un des récits suivants). Le titre de ce premier texte, Les pendus divinatoires, est aussi le titre du centième et dernier. Malgré le caractère hétéroclite et non suivi des textes, l’ensemble dessine donc une architecture. Les mêmes images et situations reviennent, et l’auteur lui-même commente cette récurrence :
Comme souvent chez mon frère, c’est un monde sans adultes, où les enfants vivent seuls avec leurs angoisses et leurs cauchemars (Naître mère et mourir, p. 44)
Dans Chien de père, six frères et sœurs vivent sous la tyrannie d’un père qui les bat, les martyrise, puis chaque soir avant le coucher les console, laisse ses larmes dégouliner sur eux en les serrant contre son corps obèse. Comme ailleurs chez mon frère, le sixième d’entre eux n’a pas de tête. (p. 60)
6Pour commencer, je me laisserai porter un peu par ces motifs corporels, la tête et le ventre, avant de proposer une analyse :
Dans Les enfants du lombric, un enfant naît du bras de son frère, tranché par leur père d’un coup de couteau. Cet enfant se génère à partir du membre mort qui repose dans la poussière. Ainsi, il devient le double presque parfait de son frère. Comme son aîné, le nouveau-né est infirme : chacun n’a qu’un bras ; ils ne semblent complets que côte à côte. Ce n’est que debout l’un près de l’autre, l’aîné à peine plus grand, qu’ils sont munis de leurs deux membres : leurs épaules sans bras se touchent, se collent ; on croirait un être bicéphale, dont le corps est large et puissant, muni de quatre jambes. Les frères sont inséparables. Ils courent ensemble sur les dunes et sur la plage, écrasent des crabes, mutilent les cigales, broient les lucioles entre leurs doigts. Dans leurs cauchemars, ils décapitent leur père ; dans leurs cauchemars, ils le démembrent. Dans les histoires qu’ils se racontent, le ciel est incomplet, sans soleil. Ils disent que c’est un ciel infirme, sans tête. La violence de leur père est injustifiable, à la violence de leur père ils ne trouvent pas de raison. Cette violence, ils l’associent à l’absence de leur mère, et ils font un parallèle entre elle et la violence des vagues que l’océan jette sur la grève. C’est un père marin. C’est un père qui part des journées entières. C’est un père qui sur la mer ne les emmène jamais […].
7De même que pour les Grées, je n’insisterai pas sur la réécriture gore du mythe du Banquet. Sans trop m’attarder non plus sur le jeu mère-mer, je crois que ce passage, comme les précédents, suffit à qualifier le livre de névrotique. C’est un livre qui revient en permanence, de façon symbolique, sur un noyau non résolu. J’insiste au passage sur le terme de noyau, puisque malgré la taille variable des fratries imaginaires, ce qui travaille l’auteur, c’est la famille nucléaire. Ce réseau d’image autour du père, du soleil, de la décapitation, de la castration, rappelle, dans le désordre, les analyses de Racine par Barthes, le soleil cou coupé d’Apollinaire, ou l’acéphale de Georges Bataille.
8Ce nœud psychanalytique nous montre également dans quelle chronologie ambivalente s’inscrit le livre : à la fois historique et anhistorique. Historique, parce que la structure familiale nucléaire (papa, maman, mon frère et moi) est celle de la famille occidentale depuis la première modernité (fin du Moyen Âge), et la famille modèle nord-américaine en particulier (comme on la voit sur ces vieilles publicités vantant l’American way of life). Anhistorique, parce qu’elle traverse toute la littérature occidentale, qu’elle nous semble hors de la temporalité historique, qu’elle est le cadre de vie de n’importe qui. Autrement dit, le cadre socio-psychologique de l’œuvre, c’est la petite-bourgeoisie « universelle », qui vit dans un pavillon de banlieue — avec comme membre supplémentaire de la famille : le chien. Les textes de Clerson sont donc à la fois irréalistes, voire tout à fait délirants pour certains, et en même temps ils ont pour toile de fond cet univers petit-bourgeois, moyen (c’est-à-dire celui d’un prolétariat accédant à la petite propriété), réduit à ses unités fondamentales.
9La rivalité mimétique ou caïnique semble toujours déjà résolue dans le texte, qui s’ouvre je le rappelle sur la disparition puis la mort du grand frère : « C’est un frère que son cadet voudrait voir disparaître, mais qui n’existe que pour lui » (p. 95). Ce qui travaille le texte, c’est plutôt le manque du frère — pour se construire dans un alter-ego, et se construire face aux parents. C’est un texte qui, je crois, permet de penser la figure du grand frère, à la fois figure dangereuse (plus fort, castrateur, mais aussi renvoyant à notre propre vieillissement et mort imminente) et nécessaire (comme résolution symbolique de la castration, comme celui qu’on voit s’émanciper avant nous, mais aussi sans nous). Et dans le livre, il est fréquent, comme ici, que les frères s’associent dans le meurtre du père — à la manière de ce que décrit Freud dans Totem et Tabou, à propos de la « horde primitive ». Tout cela est dépeint depuis le point de vue du petit frère, du dernier, qui assez logiquement n’a pas de tête (ou ne sait pas trouver les mots, etc.) : c’est le sujet, ego, celui qui doit se construire, qui ne voit pas sa propre tête — mais qui aussi ne manque pas de manque.
10J’ignore si David Clerson est un jungien, mais il a raconté ceci lors d’un entretien autour du livre : « Il s’est produit cette coïncidente étonnante, presque inquiétante. Au début de janvier, j’étais ici, dans mon bureau, quand mon téléphone a sonné et qu’on m’a annoncé la mort subite d’un de mes frères. Deux minutes après, mon éditrice m’appelait pour me parler d’un détail qui restait à régler pour la quatrième de couverture1. » Or le frère en question, le frère réel, était un genre de marginal, à l’image du frère disparu du roman.
11La réflexion sur la place singulière du grand frère dans le triangle œdipien se poursuit dans l’extrait suivant :
Dans Laisser la parole au renard, un homme abandonne amis et famille, se retire dans une maison près d’une forêt en Mauricie, pendant des années, jour après jour, y écrit, le fait jusqu’à tard, le fait jusqu’à ce que la fatigue l’oblige à cesser de le faire, puis au réveil recommence. Le manuscrit ne dit pas ce que racontent ses textes, il décrit ceux qu’il imprime, qui s’accumulent dans le sous-sol de sa maison et qu’il ne relit jamais, son corps qui au fil des ans se transforme, la vieillesse et l’usure, sa vie méthodique et répétitive, la solitude permanente, le relâchement des chairs, son ventre qui grossit, son dos qui se courbe, le papier noirci par l’encre, l’herbe haute devant sa maison, les vesses-de-loup et les agarics qui y poussent et s’y reproduisent, la neige qui la recouvre, la boue printanière, l’intérieur où rien ne change, où la décoration reste la même, le corps de l’homme qui, d’année en année, toujours se gonfle, son ventre qui derrière la table où il travaille prend désormais trop de place, ses rêves qu’habitent ses amis et sa famille, aux formes inquiètes, aux comportements dangereux, imprévisibles, […], de plus en plus souvent dans ses rêves et dans sa tête la présence de plus en plus prégnante de sa mère, un renard qui, après plus de vingt ans passés par cet homme dans sa vie recluse, prend chaque matin l’habitude de s’arrêter devant la fenêtre où il écrit, d’y rester, la gueule ouverte, la langue pendante, d’y échanger avec l’écrivain qui s’alimente à elle, qui écrit ce que dans la gueule de l’animal il parvient à lire, il parvient à voir, de même que le renard dans sa langue de goupil traduit aussi ce qu’il imagine de ces paroles humaines, les réinvente pour lui. (p. 61)
12Ce texte est une mise en abyme, ce n’est pas la seule du recueil loin de là. C’est aussi un des rares textes écrit presque d’une traite, en deux phrases dont la première se gonfle cumulativement, comme le ventre du personnage et comme sa création. Le ventre est une métaphore tout à fait topique de la création (on pense au ventre de Balzac) ; mais ici il en est aussi la métonymie. Le ventre désigne métonymiquement l’écriture, parce qu’il en est la conséquence symptomatique, à cause de l’inertie, du repli (le dos se courbe en même temps). Notons aussi « la présence de plus en plus prégnante de sa mère » (on est en environnement bilingue). En même temps, le ventre est une image paternelle, masculine (voir le récit Le ventre du père), étouffante aussi. Là aussi, je crois que l’on retrouve l’historique-anhistorique, d’un côté le père énorme, figure anhistorique, œdipienne, de l’autre le gros ventre assez typique des pères de la génération des Trente Glorieuses, toutes classes confondues (et il y a quelque chose de troublant à grandir avec cette image physique de la masculinité). D’ailleurs, l’auteur est un maigre.
13Je reviens sur la phrase de Laisser la parole au renard, car il y a deux choses à en dire. D’une part, elle est au présent comme tout le reste des récits (sauf le récit enchâssant, qui est au passé simple). Comme l’a montré Gilles Philippe à propos d’autres textes, on hésite beaucoup à qualifier ce présent, entre présent synchrone (énonciatif, correspondant à l’effet produit sur le vif par les textes que le narrateur lit et résume) et présent asynchrone, rétrospectif, forme narrative moderne (qui s’accompagne d’ailleurs du passé composé ailleurs dans le livre)2. Le contenu des phrases ne nous aide vraiment pas à trancher entre les deux. Dans tous les cas, le présent est un non-temps, adéquat à l’absence d’ordre chronologique réel : il accompagne une série équivalente de constatation, sans post hoc, et donc sans plus de propter hoc.
14Ensuite, la coulée de la phrase asyndétique produit des perturbations textuelles et sémantiques. On est ainsi porté à interpréter « un renard » comme apposé à « mère » (et il y a plusieurs occurrences du livre où la mère est une renarde ou une louve, comme la mère de Romulus et Rémus, modèles de « frérocité »3). De même plus loin, l’incidence du pronom « elle » dans « il s’alimente à elle » est trouble : par proximité, il s’agit de la langue, ou de la gueule, mais on voudrait spontanément reconstituer « il s’alimente à la mère ».
Références et métalittérature
15Je laisse maintenant de côté ces élucubrations psychanalytiques, pour en revenir à l’aspect métalittéraire. Le livre est constitué d’un résumé de cent livres imaginaires. À plusieurs reprises, ces livres imaginaires renvoient à leur auteur fictif, le frère disparu, et les derniers textes racontent l’histoire d’un frère qui hérite d’une maison, trouve des manuscrits dans une cave, les remonte pour les lire, etc. Il y a donc un jeu spéculaire, une sorte de métalepse narrative, où la fiction enchâssée semble s’introduire dans la fiction enchâssante (et on a vu que la fiction semblait même s’être introduite dans le réel de David Clerson). Ce n’est pas la seule métalepse d’ailleurs (dans l’un des textes, le narrateur après avoir lu une histoire de chien, est pris de l’envie d’aboyer4).
16Tous ces jeux narratifs et formels esquissent un univers de références littéraires, dont certaines sont d’ailleurs présentes de façon plus ou moins explicite : Borges, Bolaño, Lovecraft, Volodine, Lewis Carroll, Kafka, bref, les littératures de l’imaginaire, de l’irréalisme, du réalisme magique. Cet univers irréaliste n’est pas anodin de la part d’un écrivain qui affirme volontiers que la littérature ne sert à rien5 et qui est attaché à cette inutilité dans un « monde consumériste obsédé par le succès, l’argent et la pérennité » — un monde excluant les personnalités marginales comme ce frère disparu. Le texte Au verso fait, entre autres, référence à Bolaño (La littérature nazie en Amérique) et à Volodine (Slogans de Maria Soudaïeva)6. Une littérature mineure fait référence indirectement à Kafka, mais peut-être aussi à Des anges mineurs de Volodine :
Dans Une littérature mineure, le professeur soviétique Vassili Koustodiev, de retour d’un séjour en République tchèque, se fait punir d’avoir entretenu une liaison avec une chercheuse bourgeoise et britannique spécialiste de Lautréamont. Dès lors, ses recherches ne porteront plus sur la poésie futuriste, lui impose-t-on à Moscou, mais sur la littérature canadienne d’expression française. Koustodiev est désespéré. Le sujet qu’on lui impose, chez lui, n’intéresse personne : ses exposés dans les colloques ne sont suivis qu’avec un insoutenable ennui ; ni étudiante ni étudiant ne s’inscrit à ses cours, sinon pour combler des trous à leur horaire ; personne en URSS ne se soucie de Germaine Guèvremont, d’Émile Nelligan, d’Anne Hébert ou de Réjean Ducharme, encore moins de Louis Fréchette ou de Laure Conan, pas plus des écrits de la Nouvelle-France, des sujets qui ne suscitent également chez lui aucun intérêt. Aussi se venge-t-il. Pour répondre aux attentes de ses supérieurs, il s’attaque à une vaste entreprise : l’écriture d’une encyclopédie de la littérature d’expression française en Amérique, mais cette littérature, il l’invente : parmi les œuvres de Nelligan, Ducharme ou Conan, il fait naître celles d’Huguette Beauchemin, de Pierre-Marc Quenneville, de Simone Uskashish, de Paul Deraps, de Mathias Revok, de Sheryl Ibghy, qui deviennent pour lui des auteurs majeurs, aux œuvres radicalement ambitieuses et transgressives, sorte d’avant-garde méconnue de la littérature mondiale risquant les expérimentations les plus audacieuses, et qui apparaissent comme le reflet baroque et critique des productions culturelles du Québec de la Révolution tranquille7, dont la portée émancipatrice paraît dès lors vaine, aveugle à son propre enlisement et à l’échec de ses ambitions libératrices : par ce subterfuge est violemment exposée la haine de la littérature québécoise et de son espace culturel. L’œuvre de Koustodiev s’étale sur des années, il n’en prévoit la publication, ainsi que le dévoilement de la supercherie, qu’après son décès, comme si son inventivité lui donnait l’occasion d’une gloire posthume, l’illusion d’une existence au-delà de la mort. Ce récit est fait par Pierre-Luc Saint-Louis, jeune chercheur universitaire montréalais et comparatiste spécialiste de Pelevine8, qui, en 2007, trouve et vole l’encyclopédie dans les archives de l’Université d’État de Moscou, fantasme un temps sur l’idée de développer la supercherie en écrivant lui-même, sous pseudonyme et avec quelques amis, les œuvres de Revok, de Quenneville, d’Uskashish et des autres écrivains inventés par Koustodiev, mais perd l’encyclopédie une nuit d’ivresse insensée, où, pris d’amour pour un jeune Abkhaze, il monte avec lui dans un train pour Soukhoumi et, à la septième des trente-deux heures du trajet, voit ses bagages disparaître et ne les retrouve jamais. (p. 37-39)
17Avec l’invention de cette littérature imaginaire, entièrement virtuelle, nous sommes en plein dans la veine borgésienne, reprise par Bolaño dans La littérature nazie en Amérique, ou encore par le Volodine d’Écrivains ou du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. Outre l’univers soviétique et post-soviétique, on reconnaît encore, dans la composition onomastique, l’habitude volodinienne de forger des noms cosmopolites, avec un prénom russe ou italien suivi d’un nom arménien, tibétain, mongol, etc. Si j’insiste sur la référence spécifique à Volodine, c’est parce que David Clerson a suivi une formation universitaire et écrit un mémoire sur l’œuvre d’Antoine Volodine. Pour reprendre la distinction de Gilles Philippe9, il y a à la fois référence (par le biais de l’énigme littéraire et par les thèmes) et influence (dans un stylème repérable, adapté à la manière québécoise, Uskashish étant un nom innu).
18L’autre élément savoureux du texte c’est bien sûr l’auto-dérision, annoncée dans Au verso avec cet « essai déployant pendant des pages sa haine de la littérature québécoise ». L’univers de référence dans lequel s’inscrit Clerson est international, mais exclut méchamment le Québec. Ce texte exprimerait-il ce complexe d’infériorité nationale, fréquent dans les littératures de la périphérie francophone (on pense à l’analyse de Cioran par Pascale Casanova) ? Mais qualifier la littérature québécoise de « mineure », c’est en même temps la mettre sur le même pied que le Kafka de Deleuze, écrivain « germanophone », dont la valeur littéraire est indépendante du beau style national. Et surtout c’est peut-être ouvrir aussi un mode de création qui ne soit pas régi par une figure auctoriale d’autorité. Non pas parce que l’œuvre laisserait place à d’autres auteurs imaginaires (ce serait une simple supercherie évidemment) ; mais parce que l’œuvre devient elle-même secondaire. Soit parce qu’elle prolonge des univers littéraires préexistants ; soit parce qu’elle se contente d’imaginer des livres possibles (voire des livres impossibles), mais sans les écrire (on retrouve une démarche analogue dans Le Livre des incompris d’Irène Gayraud). Et puis, beaucoup de ces récits ont un côté récit de rêve, genre mineur et éminemment démocratique.
19On assisterait peut-être, avec cette conjonction d’éléments (situation périphérique, forte inscription référentielle, poétique de la virtualité littéraire), à l’émergence d’un régime de subauctorialité, qui n’empêche ni l’inventivité, ni le plaisir textuel, mais qui permet d’échapper à la recherche romantique du génie littéraire, ainsi qu’à l’enthousiasme forcé consistant à auctorialiser des auteurs qui ne s’y prêtent pas tant (et je le dis aussi bien pour Michel Houellebecq que pour Annie Ernaux) — la nécessité commerciale étant plus déterminante dans ce processus que la pulsion romantique, bien sûr.
20Il y a un stylème, récurrent chez Clerson, qui participe de cette littérature plus virtuelle qu’effective, c’est l’emploi de l’adjectif beau. Les adjectifs en général sont un ressort de l’amplification. Or, ici, l’adjectif résume un texte plus ample, quoiqu’inexistant. L’adjectif beau en particulier vient se substituer à une description possible, mais qu’on a du mal à concevoir.
désormais la langue s’allonge vers le ciel, belle et dégoulinante (p. 19) ;
Le texte […] présente des bêtes qui m’ont paru à la fois belles et faibles ; il décrit des animaux blessés pour qui approche la mort. (p. 21) ;
Leurs voix sont belles et vieilles. (p. 23) ;
[à propos d’une mésange assommée :] « Ses ailes, longues et belles, sont dépliées sur le plancher. (p. 70) ;
[les araignées] mordent, grises, innombrables et belles. (p. 80) ;
C’est un enfant écrivain auteur de contes magnifiques et imparfaits. (p. 118)
21L’adjectif est généralement associé à un autre, qui rend la beauté en question contre-intuitive, sinon contradictoire. Or, ce n’est pas une faiblesse littéraire ou une solution de facilité (comme cela peut arriver quand un prosateur moyen ne sait pas rendre la beauté d’un spectacle). Il y a un effet de suggestion qui invite à imaginer quelle beauté peut bien correspondre à une araignée, aux ailes brisées d’un oiseau, à la déambulation d’une aveugle dans une ville étrangère. C’est là une autre contribution à l’esthétique des univers imaginaires (Lovecraft aussi a ses adjectifs obsessionnels, « impie » par exemple).
Zoopoétique et stylistique
22Après la dimension organique-psychanalytique et la dimension métalittéraire du livre, je terminerai par sa dimension zoopoétique ou écopoétique. Celle-ci se manifeste thématiquement d’abord : j’ai évoqué la transgression des frontières entre humains, mammifères, araignées et champignons. Plusieurs de ces textes ont pour héros des chiens, qui sont des animaux humanisés, anthropisés, des demi-sujets, membres de la famille banlieusarde typique. Du point de vue de la nature, le livre est traversé par une angoisse écologique, ce qui est après tout compréhensible pour un livre de notre temps : plusieurs récits se déroulent dans des univers ravagés, rendus inhabitables.
23Mais dans l’écriture elle-même — puisque nous parlons depuis l’UFR de langue française de la Sorbonne — qu’est-ce qui en ressort ? Qu’est-ce qui nous permet d’aborder cette dimension par la langue ? Les indices sont faibles. Si l’on récapitule les stylèmes les plus saillants de David Clerson, il y a la structure [adj. + et beau] ; l’apparition de phrases longues cumulatives (dans un texte qui privilégie globalement les phrases courtes) ; la répétition en anaphore et la parataxe (qui vont volontiers ensemble).
24Il y a aussi une série de procédés stylistiques qui sont des procédés de contamination, à mi-chemin de l’hypallage et de la synesthésie : « Son aboiement est malade, son aboiement a mauvaise haleine » (p. 17), « les paroles sont avariées » (p. 75, à propos d’un monde où la pourriture envahit tout). Dans le même registre, on peut s’étonner d’un usage assez rare de la métaphore, et de la préférence donnée aux comparaisons, aux « comme », « comme si », « également ». La prose de Clerson articule des réalités hétérogènes, mais situées sur le même plan ontologique. Le comparant n’est pas relégué à une figure d’analogie abstraite. C’est précisément cette continuité ontologique et cette hybridation qui nourrissent l’aspect monstrueux des textes.
25Pourtant le narrateur évoque aussi le caractère métaphorique et poétique de certains récits de son frère :
La vie des bêtes m’a paru inintelligible. La vie urbaine y est racontée du point de vue des animaux et des insectes qu’on retrouve en ville. Mon frère, ici, tente d’échapper à l’anthropomorphisme, de présenter la perspective des bêtes détachée de toute conception humaine. Son entreprise est poétique. Il sait qu’il ne peut y parvenir sans leur imposer, même involontairement, même en la masquant, une vision en partie humaine des choses. Il sait aussi que la langue de son texte pervertit leur rapport au monde, qu’elle l’humanise. Aussi tente-t-il de la détruire, d’écrire comme en aboyant, en feulant, en hululant sous les feuilles d’arbres. Parfois il s’essaie aussi à imiter le bruissement des insectes. Son entreprise est imparfaite. À terme il échoue sûrement. (p. 44)
26Ici se manifeste une tension du texte. D’un côté, plusieurs récits vont dans le sens d’un lyrisme monstrueux, d’un lyrisme de l’ignoble (tout un texte est consacré à un catalogue de champignons imaginaires). Comme avec le passage sur les insectes, le texte témoigne d’une fascination pour les formes de vie radicalement différentes des nôtres, et qui posent la question d’une subjectivité végétale et non-humaine (selon une problématique philosophique qui traverse tout le vitalisme français, de Diderot à Deleuze).
27En même temps, la mise en scène d’espèces des règnes supérieurs ne se fait pas dans un sens positif : on n’a aucune envie d’être à la place de ces chiens agonisants, de ces hiboux et de ces singes mutilés. Au fond, quand ils ne sont pas purement personnifiés (ce qui arrive), la communauté essentielle qui nous unit à eux est la communauté de la souffrance. Ce ne sont même pas des êtres doués d’une pensée analogue à la nôtre quoique rudimentaire, à la façon des Dialogues de bêtes de Colette. Le devenir-animal ouvert par le texte n’est pas désirable ; il renvoie plutôt à notre puissance de nuire et à notre capacité à déchoir. Autrement dit, j’ai l’impression que le texte déploie une grande puissance imaginative concrète (c’est un univers mental saisissant), et une grande puissance compassionnelle (ces créatures blessées sont éminemment touchantes), sans nourrir vraiment la puissance d’agir. L’auteur ne prétend pas autre chose, qui semble d’ailleurs avoir une foi limitée dans la puissance de l’écriture. Cela va au-delà de l’échec d’une écriture zoopoétique, comme le montre le dernier extrait :
[Temps mort] décrit un monde précédant la conscience ou celui d’une conscience obscure et souterraine. Bien sûr il le fait imparfaitement. Le texte surtout évoque, tente de faire ressentir, procède par métaphores et par effets sonores. (p. 91-92)
28Les Années désertées est un livre qui parle de l’impuissance de l’écrit à rendre compte des expériences limites : la conscience animale, mais aussi la conscience prénatale. En même temps, ce livre permet peut-être de comprendre pourquoi des approches zoo– ou écopoétiques sont en vogue aussi chez les stylisticiens et stylisticiennes (alors que nous sommes les cartésiend et cartésiennes positivistes de la bande). En effet, les approches qui s’intéressent au devenir-animal ou végétal font écho à une discipline qui est elle-même foncièrement gagnée à l’idée d’une confusion des règnes, exemplifiée par la contamination réciproque du signifiant et du signifié.
29En somme, il y a quelques raisons évidentes pour lesquelles le texte est bon, et plaît : il est souvent drôle ; il est encore plus souvent trash ; il y a du métier (je parle de la qualité de son écriture) ; et, malgré sa brièveté, le texte est assez obsessionnel pour produire des effets de familiarité et de reconnaissance, internes (par les motifs) et externes (par les références). Mais au-delà de ça, je crois aussi que c’est un texte qui, avec les moyens de l’imagination romanesque, pense (les névroses familiales, la place de l’auteur, notre attitude désarmée et nuisible face à la nature), et a le mérite de ne pas prétendre offrir plus que cette forme singulière de pensée.

