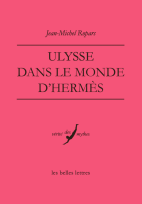
Hermès et Ulysse, partout, tout le temps
1Dans Ulysse dans le monde d’Hermès, Jean-Michel Ropars reprend deux objets déjà étudiés dans de précédents travaux. Dans son article « Le dieu Hermès et l’union des contraires1 », fondé sur une analyse de l’Hymne homérique à Hermès, il démontre que cette figure complexe peut trouver une unité dans sa capacité à rassembler des éléments opposés, ce qui la rend insaisissable. Dans un autre article, « Ulysse et son double2 », l’auteur suggère que, dans les poèmes homériques, Ulysse affronte des figures qui constituent ses propres doubles, avec qui il partage plusieurs caractéristiques sombres témoignant de sa complexité, telles que la perfidie, la lâcheté ou la grossièreté. Ces deux approches sont réunies dans le présent ouvrage, où l’auteur se propose de démontrer que les aèdes à l’origine de l’Iliade et de l’Odyssée ont façonné Ulysse sur le modèle divin d’Hermès, de sorte que le héros peut être compris comme une version humanisée du dieu.
2Pour ce faire, Jean-Michel Ropars développe un plan clair, mais qui nous semble par moments manquer de cohésion. La première partie (« L’épopée et le mythe, les relations entre Ulysse et Hermès ») débute par une section introductive sur les liens entre mythe et épopée (« L’épopée et son rapport au mythe »), qui aurait pu trouver sa place dans la brève introduction générale. La suite de cette première partie fait alterner une section portant sur la proximité entre Hermès et Ulysse (« Hermès et Ulysse : une grande proximité ») ; une section au sujet de personnages secondaires qui partageraient des traits communs avec le dieu et le héros (« L’élimination d’un double contradictoire ») ; une section concernant divers traits communs aux deux figures (« Hermès et Ulysse : autres attributions communes ») ; deux autres sections portant sur des personnages tiers reliés à et reliant Hermès et Ulysse (« La médiation d’une figure “hermaïque” : Ulysse averti par Tirésias » et « Ulysse, Épéios et Hermès »). Peut-être aurait-il été possible de regrouper d’une part les points communs directs, d’autre part les points communs par personnage interposé.
3La seconde partie associe dans son titre deux aspects qui sont articulés de manière assez distendue (« Ulysse comme figure souffrante et lunaire »). Cinq sections visent à montrer qu’Ulysse comme Hermès sont des incarnations de la douleur, de la mutilation, voire de l’automutilation — thèse qui s’appuie de nouveau sur des rapprochements avec d’autres personnages (« Ulysse “bourreau de lui-même” ? » ; « Le massacre des prétendants » ; « Sinon et Mélanthios suppliciés » ; « Hermès mutilé ou fouetté » ; « Un autre dieu (proche d’Hermès et d’Ulysse) fouetté : Pan »). Quant à la dernière section (« L’allégorie lunaire »), elle développe l’idée selon laquelle les poèmes homériques associent Ulysse et Hermès à la Lune, ce qui constituerait ainsi une véritable allégorie facilitant la compréhension du texte.
4L’ouvrage est facile à suivre. Les notes de bas de page sont très nombreuses et très étoffées. On regrettera peut-être que les textes qui s’y trouvent ne soient pas cités de manière uniforme, puisque les uns le sont en grec, les autres en traduction seulement, d’autres encore dans les deux langues. Corolaire de ces notes nombreuses, l’ouvrage est complété par une bibliographie étoffée. Le lecteur trouvera également à la fin du livre des index très complets des sources textuelles et iconographiques, des termes grecs, des indications géographiques, des chercheurs cités, et plus généralement des noms propres, des thématiques et des concepts mobilisés. Il est néanmoins dommage que l’index des sources iconographiques ne soit pas accompagné de figures les reproduisant.
La question des sources
5Avant de présenter les thèses de Jean-Michel Ropars, il nous semble primordial d’interroger l’usage qu’il fait des sources antiques. De toute évidence, le terrain d’enquête de l’ouvrage est constitué par les deux poèmes homériques, l’Iliade et surtout l’Odyssée. La première section de la première partie est précisément centrée sur la question du rapport entre l’épopée et le mythe : l’auteur s’intéresse à l’insertion du héros épique dans un système socialement construit de valeurs. Une deuxième section, se concentrant sur l’Odyssée, l’amène à présenter l’hypothèse de l’ouvrage : « Le personnage fictionnel (Ulysse) a été pensé par les aèdes comme le reflet historicisé et socialisé d’un dieu (Hermès) » (p. 21). De fait, les poèmes homériques constituent le matériau premier de l’ouvrage : il n’est qu’à voir l’index final, qui témoigne de nombreuses références à l’Iliade et à l’Odyssée.
6Néanmoins, et cela nous semble constituer un défaut majeur de méthode, l’auteur ne se contente pas d’étudier les phénomènes internes à ces deux poèmes. Au contraire, il élabore de multiples liens entre les textes homériques et des productions postérieures, qui rassemblent plus ou moins la littérature grecque dans son ensemble, et parfois des textes latins. Pourtant, l’auteur précise au début de l’ouvrage que « le mythe […] est indissociable de la parole qui l’énonce et du texte qui le produit » (p. 17), citant en note un extrait de Claude Calame insistant sur l’importance de prendre en considération la singularité de chacune des versions d’un mythe et du contexte historique et matériel de leur production. Cependant, dans le reste de l’ouvrage, Jean-Michel Ropars ne tient pas cette exigence comme un principe, et semble considérer Hermès et Ulysse comme deux êtres fixés et unifiés au sein d’un mythe unique qui s’étendrait d’un bout à l’autre de l’Antiquité, et non comme des personnages littéraires mouvants et évoluant à travers les époques et les régions. Il explique ainsi à de multiples reprises tel rapprochement entre les deux figures dans les poèmes homériques en convoquant des œuvres qui leur sont largement postérieures.
7L’auteur construit notamment des ponts nombreux entre l’Odyssée et l’Hymne homérique à Hermès, en suggérant qu’il existe entre les deux textes épiques une structure commune. Mais s’il est envisageable que l’Hymne, composé vraisemblablement au tournant des vie et ve siècles, se situe dans un rapport d’intertextualité, éventuellement de parodie, avec le poème homérique, la chronologie ne permet pas de tirer des analyses réellement fructueuses et convaincantes dans le rapport inverse. L’auteur utilise d’ailleurs des textes génériquement, temporellement et spatialement plus éloignés encore des poèmes homériques : tragédies d’Eschyle ou d’Euripide, comédies d’Aristophane, passages d’Hérodote ou de Thucydide, notices mythographiques de l’époque impériale, extraits de Plutarque, de Pausanias, de Lucien, de Quintus de Smyrne et de tant d’autres. Or, s’il est fructueux d’étudier comment un auteur tel que Lucien incorpore et remodèle les différentes versions d’Hermès proposées par la tradition littéraire grecque d’Homère jusqu’à son époque, il semble plus douteux d’expliquer un phénomène interne aux épopées homériques par un recours à des textes plus ou moins postérieurs et comportant chacun son propre programme esthétique et idéologique. L’auteur semble d’ailleurs avoir conscience de ce biais, lorsqu’il émet une réserve sur sa reconstruction d’un rituel « en combinant des témoignages éloignés dans le temps » (p. 124) ou lorsqu’il reconnaît que son « témoignage est certes unique et tardif » (p. 165). C’est pourtant la démarche qu’il adopte dans l’ouvrage, alors qu’il aurait été plus convaincant de restreindre son analyse aux poèmes homériques.
Les proximités entre Hermès et Ulysse
8L’auteur parvient à mettre au jour un ensemble de points de rapprochement entre le dieu et le héros grec. Il analyse ainsi tous les passages des deux poèmes homériques où ils sont explicitement associés, dans ce qui nous semble constituer la section la plus solide de l’ouvrage (p. 34-44). Il rappelle par exemple les missions données à Hermès par les autres dieux pour venir en aide à Ulysse, chez Circé et Calypso ; la récurrence des invocations à Hermès tout au long du trajet, comme chez les Phéaciens ou chez le porcher Eumée ; les liens généalogiques qui les unissent par la mention d’Autolycos, fils d’Hermès et grand-père d’Ulysse ; l’ambivalence des deux figures. Une autre section s’intéresse à des rapports plus variés et plus souples, plus ou moins convaincants, puisqu’ils ne reposent pas sur une étude interne des poèmes homériques : la surveillance des seuils, le vol, les liens avec le végétal. Deux paragraphes, consacrés à la transmission des messages et à l’accès au monde des morts, nous paraissent plus solides (p. 85-93) : les fonctions de messager des dieux et de psychopompe propres à Hermès y sont judicieusement mises en regard avec le statut de héraut occupé par Ulysse dans l’Iliade et avec sa catabase dans l’Odyssée.
9Dans le reste de l’ouvrage, le rapport entre les deux figures est envisagé à partir d’un nombre important de traits physiques et moraux, d’attributions et d’attitudes considérés comme des caractéristiques propres au dieu Hermès. L’auteur les désigne par l’adjectif « hermaïque », qui est utilisé de manière récurrente et dont les guillemets systématiques témoignent peut-être du flou de la notion. Il en résulte donc un ensemble souple de traits qui donnent l’impression, selon le mot de l’auteur lui-même, d’un grand « vrac » (p. 101) : parcours complexe, polytropie, mobilité, changement d’identité, mètis, union des opposés, discours double, présence aux portes, messager, gloutonnerie, lâcheté, cleptomanie et bien d’autres encore. Or, tous ces traits ne se retrouvent pas dans l’Hermès de l’Iliade et l’Odyssée, mais sont pour la plupart tirés d’œuvres postérieures, ce qui amène à bâtir des parallèles parfois peu solides. Ce systématisme « hermaïque » est par ailleurs traduit sur le plan stylistique par les récurrentes phrases interrogatives qui invitent le lecteur à considérer comme évidents les rapprochements entre Hermès et Ulysse : « Doit-on s’étonner si Ulysse […] ? » (p. 84) ; « Coïncidence ? […] » (p. 97). Pourtant, cette systématisation se fait parfois au prix d’une interprétation forcée, voire, dans certains cas, d’un contre-sens.
10L’exemple de la voracité est particulièrement révélateur. L’auteur juge que ce trait est commun à Hermès et Ulysse, dans le cadre d’une comparaison avec le mendiant Iros. Au sujet d’Ulysse, le dossier n’est pas très solide. L’auteur cite l’épisode de l’ambassade au chant IX de l’Iliade, où Ulysse, d’après lui, « ne trouve rien de mieux que de commencer par parler nourriture à Achille, type même du héros que ces préoccupations normalement indiffèrent » (p. 61). Or, c’est précisément Achille qui, à l’arrivée de l’ambassade, demande qu’on serve vin et viande, comme l’exigent les lois de l’hospitalité (v. 202-204), tandis qu’Ulysse lui-même affirme que ce n’est pas pour un banquet, mais pour une discussion qu’il est venu (v. 225-230). Dans l’Odyssée, le thème de la nourriture est à mettre en rapport plus vraisemblablement avec la condition de naufragé d’Ulysse qu’avec sa supposée goinfrerie. Quant à Hermès, rien dans les poèmes homériques ne lui prête un goût prononcé pour la nourriture. L’auteur doit alors se fonder sur l’Hymne homérique, dont la dimension parodique est vraisemblable, puis sur des pièces d’Aristophane, où le thème de la voracité touche la majorité des personnages dans une visée comique. La comparaison d’Hermès avec un goéland est analysée comme une image non pas de son vol rapide, mais de sa goinfrerie, à l’appui d’une citation de Lucien, qui écrit près d’un millénaire plus tard. Comme d’autres rapprochements entre Ulysse et Hermès, le thème de la voracité n’est donc pas convaincant, puisqu’il se fait au prix de lectures biaisées et de références largement postérieures.
Le ressort des doubles « hermaïques »
11Outre ces rapprochements directs entre les deux figures, la plupart des analyses de l’ouvrage reposent sur des équations à trois termes mettant en relation Hermès, Ulysse et plusieurs autres personnages mythologiques. Une section importante met ainsi en lumière que les figures entourant Ulysse se caractérisent souvent par les mêmes traits que lui — des traits évidemment « hermaïques » selon l’auteur : la ruse et l’intelligence, ou au contraire l’invective et la couardise. C’est le cas de ses adversaires, comme Thersite, Dolon ou le mendiant Iros, mais aussi de ses adjuvants, comme Eurybatès, Euryloque, Épéios ou Tirésias. L’auteur réussit ainsi à tisser un réseau serré de correspondances entre les différentes figures auxquelles Ulysse est associé tout au long des poèmes homériques.
12Pourtant, là encore, l’auteur semble parfois forcer les lectures afin de mettre en rapport ces différents personnages. Par exemple, si certaines analyses parviennent à convaincre de la proximité entre Dolon et Ulysse, sur le fondement de leur ruse et de leur lâcheté communes ou de leur rapport avec le loup, ses rapports avec Hermès sont plus difficiles à prouver. L’auteur se concentre ainsi sur le casque du guerrier troyen, confectionné en peau de martre, animal digne d’être qualifié d’« hermaïque » selon l’auteur (p. 58), dans la mesure où elle habite le même environnement que les humains, qu’elle vit la nuit et qu’elle est carnivore. Or, la martre ressemblerait à peu près à la belette, animal considéré comme rusé, comme en témoignent Ovide et Élien, des auteurs bien éloignés des poèmes homériques. Une telle analyse ne saurait convaincre d’un véritable lien entre les deux figures. Sont également convaincants les rapprochements entre Ulysse et Thersite, qui apparaît lui aussi comme lâche, injurieux et mutilé, ainsi qu’Iros, présenté comme un mendiant querelleur et couard, à l’identité problématisée. L’auteur montre bien que ces différents doubles constituent dans les poèmes des antagonistes à Ulysse, et la mise en lumière de cette tension entre rapprochement et affrontement est intéressante. Pourtant, de nouveau, les liens avec Hermès sont assez distendus dans le cadre de ces comparaisons. Par ailleurs, les parallèles effectués avec des personnages extérieurs aux poèmes homériques constituent là encore une approche problématique et anachronique. Il en va ainsi de Palamède ou Sinon, qui n’apparaissent pas chez Homère mais dans d’autres versions du cycle troyen, ou encore de Pan, dont l’étude repose sur des extraits d’auteurs largement postérieurs et peu propices à fournir une meilleure compréhension de ce qui se joue dans les deux épopées. En définitive, c’est souvent le systématisme des caractéristiques considérées comme « hermaïques » qui dirige les comparaisons entre Hermès, Ulysse et les autres personnages, ce qui tend à diluer l’intérêt des authentiques réseaux mis au jour par l’auteur.
Les hypothèses de la souffrance et de la Lune
13Les explications du rapprochement entre Hermès et Ulysse, qui occupent la deuxième partie de l’ouvrage, pâtissent des mêmes problèmes méthodologiques. Qu’Ulysse incarne une figure de la souffrance laisse peu de doutes — même si c’est une situation partagée avec beaucoup d’autres personnages homériques. L’auteur analyse par exemple assez finement la comparaison filée entre Ulysse et le cerf pourchassé (p. 108-111). En revanche, la démonstration visant à prouver qu’Hermès est sujet à un traitement similaire n’emporte pas l’adhésion (p. 118-131). En effet, l’auteur s’appuie sur des sources largement postérieures, peu nombreuses et non emblématiques : une représentation iconographique sur une pélikè attique du ve siècle ; le scandale sacrilège des Hermocopides à la fin du ve siècle, où des statues d’hermès sont mutilées ; une anecdote fragmentaire de Callimaque ; une fable d’Ésope ne mentionnant pas même Hermès ; un certain rituel spartiate reconstitué par des sources éparses ne convoquant pas Hermès non plus. Par ailleurs, l’analyse psychologisante, filée à travers l’ouvrage, d’un Ulysse autodestructeur, dans ses affrontements avec des adversaires qui lui ressemblent et dans les souffrances qui lui sont infligées dans son périple de retour, n’emporte pas vraiment l’adhésion.
14La dernière section de l’ouvrage est consacrée à la mise en lumière d’une isotopie lunaire qui constituerait une allégorie permettant de mieux comprendre les liens entre Hermès et Ulysse au sein des poèmes homériques. L’auteur met au jour des éléments intéressants, notamment la récurrence des actions nocturnes et de la lumière lunaire tout au long de l’Odyssée, ainsi que l’image du printemps qui intervient au moment du retour à Ithaque. Cependant, là encore, l’auteur nous semble forcer quelque peu son interprétation, par exemple en reliant le fait d’être perché dans un arbre à ce thème lunaire. C’est aussi le cas de la thèse secondaire de l’ouvrage, selon laquelle « toute l’architecture de l’Odyssée a été bâtie sur le cycle lunaire » (p. 153). Cette analyse repose sur la division du périple d’Ulysse en douze étapes qui correspondraient aux douze phases lunaires. Mais l’auteur doit pour cela omettre l’étape chez les Phéaciens, qui est pourtant primordiale, puisqu’il s’agit de la dernière avant le retour à Ithaque : l’auteur précise d’ailleurs lui-même, au terme de sa démonstration, qu’Ulysse est « victime d’un dernier naufrage sur l’île des Phéaciens » (p. 159). Pour faire coïncider sa théorie, selon laquelle le voyage d’Ulysse correspond à un seul cycle lunaire d’un an, avec la durée réelle du trajet, à savoir dix ans, l’auteur affirme dans une simple parenthèse qu’il ne s’agit que d’une question de vraisemblance touchant à l’éducation de Télémaque (p. 160). Par ailleurs, les liens qui unissent la Lune, Hermès et Ulysse sont eux aussi tirés de sources disparates et postérieures, et semblent assez ténus, comme en témoigne la succession de très brefs paragraphes dévoilant d’« autres rapprochements » (p. 167-170). Enfin, l’importance de cette allégorie lunaire semble parfois reposer sur des métaphores purement ornementales et peu convaincantes, comme l’auteur semble lui-même en avoir conscience : « Laërte, cette “vieille lune” (?), dont Pénélope prétendait justement tisser le linceul, prend dans le récit l’allure d’un pauvre hère » (p. 160).
15Enfin, le concept forgé par l’auteur dans la conclusion générale, celui d’« âme-semence », qui comprend habilement l’intégralité des analyses proposées précédemment, peine à convaincre de sa pertinence pour mieux comprendre les poèmes homériques. En effet, le concept révèle une dernière fois les limites de l’ouvrage : il ne convoque pas seulement des phénomènes internes à l’Iliade et l’Odyssée, mais s’appuie sur l’intégralité de la production littéraire antique ; il considère Hermès et Ulysse comme des figures mythiques unifiées, effaçant les ruptures et les variations propres à chaque texte ; il définit trop lâchement le propre du dieu Hermès, ce qui l’amène à considérer un ensemble excessivement vaste d’éléments comme « hermaïques » ; il applique de manière systématique sa grille de compréhension, quitte à forcer certaines hypothèses en dépit de la ténuité des témoignages ou de la fragilité de certaines lectures. De fait, les sections les plus convaincantes de l’ouvrage sont celles qui mettent en tension les figures d’Hermès et d’Ulysse telles qu’elles sont représentées au sein de l’Iliade et de l’Odyssée, à la fois explicitement et métaphoriquement.

