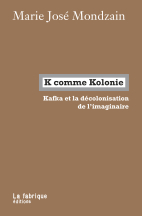
Joyeux comme Franz Kafka
L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie.
— Après-midi piscine
Franz Kafka, Journal, 3 août 1914.
« Tout est fait aujourd'hui pour identifier la radicalité aux gestes les plus meurtriers et aux opinions les plus asservies. La voici réduite à ne désigner que les convictions doctrinales et les stratégies d'endoctrinement. La radicalité, au contraire, fait appel au courage des ruptures constructives et à l'imagination la plus créatrice. […] Cette radicalité ouvre les portes de l'indétermination, celle des possibles, et accueille ainsi tout ce qui arrive, et surtout tous ceux qui arrivent, comme un don qui accroît nos ressources et notre puissance d'agir. »
Marie-José Mondzain, Confiscation. Des mots, des images et du temps,
Paris, Les Liens qui libèrent, 2017,
4e de couv. & p. 14.
1Dans une bibliothèque comme en librairie, il vous faudra courir d'un rayon à l'autre pour espérer réunir plusieurs de ses ouvrages : théoricienne de l'image et des arts mimétiques, Marie-José Mondzain est tout à la fois philosophe, historienne, anthropologue, sociologue et sémiologue1, aussi bien militante résolue de toutes les formes de « philiation » lorsqu'elle s'attache aux violations quotidiennes des lois de l'hospitalité qui sont aujourd'hui l'ordinaire des sociétés occidentales, ou aux violences qui s’exercent chaque jour dans l’usage que la langue politique et médiatique fait de certains mots2. On lui doit une quinzaine d’essais depuis la fin des années 1990, devenus très vite des ouvrages de référence dans plusieurs champs des sciences humaines, et l’on s’explique mal que Fabula, dont l’aventure a commencé dans les mêmes années, ait pu les ignorer, un titre après l’autre : le nom de la théoricienne est absent de l’index des revues Acta fabula et Fabula-LhT et n'apparaît pas davantage au sein de l’encyclopédie de l’Atelier de théorie littéraire ; c’est à peine si les plus récentes de ses publications ont été fugitivement signalées dans le flux des nouvelles parutions. On voudrait donc ici commencer à réparer un oubli qui n’a pas d’autre raison que ce cloisonnement des disciplines contre lequel Fabula n’a jamais cessé de lutter.
Décoloniser les imaginaires
2L’essai sur Kafka accueilli en 2020 aux éditions La Fabrique par le regretté Éric Hazan est l’un des plus personnels qui soit. Assez inattendu au regard des précédents ouvrages de l’autrice, il prend son point de départ très loin d’abord de l’auteur de La Métamorphose ou du Château. Marie-José Mondzain rappelle en manière de prologue « comment la question coloniale est devenue le prolongement logique et inévitable de [s]sa réflexion sur les images » : les modèles sur lesquels les conquérants ont voulu assoir leur suprématie impérialiste a infusé l'imaginaire collectif.
C’est la société occidentale dans sa totalité qui s’est imprégnée elle-même des poisons qu’elle a longuement répandus dans les territoires confisqués et exploités. Au souci de la pureté des races se joint chaque jour davantage celui de la pureté des mœurs. Le raciste est xénophobe et puritain. Les politiques de la haine s’acoquinent avec l’accroissement quotidien des gestes de censure et construisent des murs réels autant que symboliques. (p. 11-12)
3Parce que les « fantasmes de pureté alimentent une moralisation aussi grotesque qu’accablante du regard porté sur les œuvres et sur la pensée », la décolonisation de l’imaginaire concerne désormais « non seulement les populations qui furent colonisées, mais de façon plus impérative encore les peuples colonisateurs » (p. 12). C’est dire qu’il ne saurait y avoir, pour elle et en ce sens, de post-colonialisme, « sauf à reconnaître que c’est le terme qui désigne la généralisation planétaire de ce qui a été pratiqué depuis des siècles sur des territoires plus ou moins lointains » (p. 13), et qui est indissociable d’un capitalisme mondialisé, lequel a fini de coloniser l’ensemble des ressources de la planète. Marie-José Mondazain n’entend pas pour autant se situer dans le champ des études décoloniales, élargies à toutes les conditions subalternes : s’il s’agit bien d’œuvrer avec ce nouveau livre à une décolonisation de l’imaginaire en s’attachant aux « gestes qui peuvent débarrasser les regards de toute emprise hégémonique à partir d’une énergie fictionnelle », il convient d’insister sans relâche sur « la place spécifique des populations colonisées qui continuent de subir la violence du racisme et de toutes les disqualifications » (p. 15).
4Née dans un territoire colonisé, l’Algérie, où elle a vécu ses dix-sept premières années, l'essayiste s’efforce dans l’un des chapitres inauguraux de retrouver la mémoire de la façon dont le système colonial a pu imprimer sa marque sur son corps d’enfant, en lui donnant le monde comme d’emblée coupé en deux ; elle y évoque pudiquement ses premiers refus, et ses fugues vers « le labyrinthe de la casbah et le tendre abri des corps domestiques » — « le contact sécurisant des peaux, des odeurs et des saveurs qu’on [lui] apprenait à redouter et à fuir ».
5Marie-José Mondzain est ainsi bien placée pour le savoir : ces peuples qui se sont vus asservis par l’appareil colonial, et imposer jusque dans leur chair la catégorie de l’impossible, sont les mieux à-même de nous révéler ce qu’il en est de la colonisation des imaginaires aujourd’hui généralisée, comme de l’étendue de l’entreprise de décolonisation qui reste à entreprendre.
Ce que j’appelle la décolonisation de l’imaginaire […] désigne la place qu’il faut rendre à tous les gestes actifs et résistants qui font la preuve chaque jour que les images de la domination ne parviennent pas à triompher. L’existence microsismique des refus et des révoltes est présente chaque fois qu’un sujet porte sur tout autre un regard sans précédent, au sens propre. C’est tout ce qui précède qui répète et mortifie la possibilité même de tout événement. L’essence du colonialisme relève de la répétition nécrosante. Parler d’imaginaire dans ce cadre réflexif revient à faire de notre puissance fictionnelle la faculté politique par excellence. Imaginer, c’est fragiliser le réel, se réapproprier sa plasticité et faire entrer dans les mots, les images et les gestes la catégorie du possible et la force des indéterminations. (p. 16)
6Et donc Kafka, comme « indicateur exemplaire de la voie émancipatrice » (p. 15).
7Le saut du projet à l’objet peut paraître brutal, mais le petit livre signé par Marie-José Mondain est bien destiné à mettre à l’essai une lecture politique de Kafka, sinon à théoriser une politique de la lecture. Tel est le pari engagé : pour peu qu’on les lise à la lettre, en s'arrachant au confort de l'interprétation allégorique, les fictions de Kafka apparaissent comme autant de secousses susceptibles de nous arracher aux convictions que « la grande machine capitaliste mondialisée » inscrit depuis des siècles dans l’inconscient collectif pour nous plier à des lois qui finissent par nous paraître aussi inéluctables que celles de la nature.
8Kafka donc, l’auteur désespéré, pour retrouver l’espoir de parvenir un jour à déclencher « l’arrêt de la machine qui asservit, mettre en panne les rouages de la violence, cesser de croire qu’ils fonctionnent de manière inéluctable » (p. 17) ; Kafka pour continuer à croire que « la décolonisation du regard et de la parole » est possible, et apprendre de lui cette joie qui naît à la découverte d’un « geste de décolonisation quand il offre à ceux auxquels il s’adresse la possibilité de résister et la puissance d’agir » (p. 22) ; Kafka, et une imagination fictionnelle au travail dans les premières années du siècle dernier, pour comprendre que ce sont désormais « ceux qui ont dû vaincre l’esclavage et toutes les expropriations réelles autant que symboliques qui apportent pour nous tous aujourd’hui les ressources essentielles pouvant éclairer les figures de notre propre asservissement » (p. 17) ; Kafka pour nous rappeler en définitive aux devoirs de la « philiation » :
Nous ne devons pas l’hospitalité aux anciens esclaves pour seulement réparer l’irréparable ni pour nous contenter de leur offrir ce dont ils peuvent manquer, mais pour recevoir d’eux ce dont nous manquons nous-mêmes. Ce qu’ils nous apportent aujourd’hui en demandant asile excède ce que la colonisation leur a pris et que nous leur devons. Il s’agit là d’un renversement économique et politique qui exige une transformation de l’imaginaire collectif dont on a du mal à accepter l’urgence […]. (p. 18)
La machine coloniale
9L'essai de Marie-José Mondzain vient méditer un unique récit de Kafka, La Colonie pénitentiaire [In der Strafkolonie], rédigé en octobre 1914 et publié en mai 1919. L’intrigue de cette nouvelle de quelques pages présente comme la plupart des narrations de Kafka la simplicité d’une parabole : le visiteur d’une aride colonie placée sous administration militaire, petite île vraisemblablement africaine et explicitement francophone, est convié à assister en simple spectateur à l’exécution d’une peine de justice, où le condamné est livré à une machine qui grave dans sa chair, et jusqu’à ce que mort s’ensuive, le texte même de la loi (dérisoire) qu’il a enfreinte. L’appareil colonial prend donc ici la forme d’une machine véritable, dont l’officier chargé de l’exécution décrit avec minutie le fonctionnement, en regrettant que le nouveau gouverneur de l’île n’ait pas à cœur de veiller à l’entretien d’un dispositif judiciaire inventé par son prédécesseur, « l’ancien commandant » digne selon lui de tous les éloges. Méditer le fonctionnement de cette machine et prendre la mesure de la compréhension différente qu’en ont l’officier chargé de la faire fonctionner (avant de sacrifier sa personne à la poursuite de l’opération…), le prisonnier condamné à en éprouver l’efficacité (puis le dérèglement de ses rouages…) et le voyageur convoqué au spectacle de son fonctionnement (en refusant de s’en faire le témoin…)3, ce sera pour l’essayiste tenter de comprendre « la violence exercée sur l’imaginaire collectif par l’appareil impérialiste et le nouvel esclavagisme capitaliste » :
De quelle façon et par quelles voies s’inscrivent en nous les signes, les images et les mots qui donnent forme et sens à tout ce qui nous affecte et auxquels nous risquons de nous soumettre sans le savoir si nous n’en saisissons pas les mécanismes et les stratégies ? (p. 21)
10Le livre adopte ainsi « la forme d’une déambulation », où la lecture de La Colonie pénitentiaire procède « par associations multiples », « biographiques, historiques, littéraires, théâtrales et cinématographiques », qui instituent le bref récit en « scénario spectaculaire adressé aujourd’hui à notre regard de spectateur » (p. 21). On peut être dérouté par la façon de mener cette lecture d’un texte unique, en l’interrompant sans cesse pour prendre des chemins de traverse vers d'autres œuvres, d'autres auteurs et d'autres arts, sans hésiter à télescoper les époques. Le livre tient de fait dans une série courts chapitres titrés d’un simple mot, qui associent de libres réflexions à des analyses ponctuelles du texte de Kafka, sans chercher à les ordonner logiquement ou chronologiquement entre elles — la Table des matières ne permettant pas davantage d’anticiper le chemin projeté que de retrouver le souvenir des étapes une fois le parcours accompli. Il faut en accepter le principe — la quête d’une « articulation politique et poétique entre plusieurs régimes d’images » (p. 20) appariées par leur proximité avec un même appareil — et avancer en tenant ce seul fil d’Ariane : la conviction qu’avec La Colonie pénitentiaire, Kafka a voulu se saisir de la question coloniale elle-même, dont l'écrivain pragois est moins éloigné qu'on pourrait le penser.
11Depuis 1884 en effet, et jusqu'en 1916, l’Allemagne pratiquait dans le Sud-Ouest de l’Afrique (la future Namibie) une politique d’une rare violence — au vrai, un génocide contre les peuples nama et herero, orchestré par le gouverneur Heinrich Göring, le père d’Hermann Göring, qui fut l'un des principaux dirigeants du Troisième Reich nazi. Pour prendre la mesure des crimes commis, Marie-José Mondzain s'est plongée avec effroi dans le Blue Book exhumé en 2015 par Élise Fontenaille-N’Diaye4, soit l’unique exemplaire subsistant d’un rapport établi à la demande de la Grande-Bretagne par un juge irlandais sur les horreurs perpétrées par l’armée de Guillaume II dans la colonie ouest-africaine — l’Allemagne avait obtenu la destruction du document en menaçant de rendre public le White Book où se trouvaient consignés les crimes de la colonisation britannique… Comme Rosa Luxemburg en avait eu l'intuition dès 1916 en rédigeant La Brochure de Junius5, on doit penser cette entreprise de colonisation comme le laboratoire des crimes de masse perpétrés dans les décennies suivantes sur le sol européen ; « la colonisation des territoires africains a été le laboratoire effectif de la machine industrielle du nazisme », soutient Marie-José Mondzain (p. 75), en rappelant que ceux qui furent les acteurs de ce massacre se retrouvent quelques années plus tard autour d’Hitler, dont ils ont nourri les thèses racistes et les décisions génocidaires.
Le nazisme n’a nullement inventé l’antisémitisme dont le monde chrétien a fait le plus grand usage depuis des siècles en désignant à la vindicte et à l’exclusion le “peuple déicide”. Mais c’est la colonisation qui permit aux théoriciens du racisme de rassembler en plein XXe siècle, sous une même noirceur, nègres noirs et nègres blancs. Ils furent alors un même gibier destiné à l’extermination. En d’autres termes, la colonisation des territoires africains a été le laboratoire effectif de la machine industrielle du nazisme. (p. 74-75)
12Marie-José Mondzain éclaire encore sa lecture de La Colonie pénitentiaire à la lumière des travaux récents (pour le lectorat francophone) d’Ann Stoler sur la colonisation de l'intime, en l'occurrence : « l’inscription charnelle de la violence raciale » dans les territoires indonésiens sous domination néerlandaise6. Elle aurait pu rappeler encore, comme l'a fait Pierre Benetti au lendemain de la parution de son livre, et en se souvenant de la piste déjà frayée par Pascale Casanova7, que Kafka avait lu les travaux de l’africaniste Leo Frobenius, dont le premier texte sur « l’Origine des cultures africaines » date de 1898, année où il créa les « Archives africaines » à Berlin ; ce pionnier de l’ethnologie fut ensuite à l’initiative d’une douzaine d’expéditions dans les colonies africaines — la première en 1904 dans la région du Kasaï, rattachée à l’État indépendant du Congo, colonie privée du roi belge Léopold II, au terme de la partition de l’Afrique décidée par la conférence de Berlin (1885) — et d'un recueil de contes collectés en Afrique centrale, publié en 1910 sous le titre Le Décaméron noir [Der schwarze Dekameron]8. Pierre Benetti a également signalé que Kafka se trouvait lié par son histoire familiale à la colonisation du Congo : l’un de ses oncles maternels, Joseph Loewy, a travaillé pendant une douzaine d’années à dater de 1891 pour le compte de l’État indépendant du Congo, où il occupa d’importante fonctions dans une société d'investissement qui finançait la tristement célèbre Compagnie du chemin de fer du Congo9. Dans un essai déjà ancien et récemment réédité, Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie, Seloua Luste Boulbina cite une lettre de Kafka datée du 24 novembre 1912 où il dit collectionner les articles de journaux relatifs à l'Afrique et mentionne l'un d'eux paru au mois de septembre de la même année dans le Prager Tagblatt sur « la béatification des vingt-deux jeunes nègres chrétiens de l'Ouganda », morts sur le bûcher : « Presque un jour sur deux », déclare-t-il à Felice, « je découvre dans le journal une scène de ce genre qui n'est positivement destinée qu'à moi seul »10.
13Autant de raisons supplémentaires de souscrire à la thèse qui veut que Kafka se soit saisi de la question coloniale d’une main « qui n’est pas colonisée ni surtout colonisable » (p. 39). Marie-José Mondzain envisage ainsi La Colonie pénitentiaire comme une sorte d'« îlot fictionnel » qui vaut comme « la maquette théâtralisée de la scène du monde », où « le voyageur européen, étranger en mission venant du Nord, fera finalement partie de la machine et du système carcéral » (p. 51). L'hypothèse fait de Kafka l’un des premiers écrivains à décrire « comme une colossale et unique machinerie l’appareil administratif et le dispositif technique qui font du bagne et de la colonie une même réalité ». Il nous donne à comprendre que la colonisation ne passe pas par la seule force des armes, impuissantes à pérenniser la conquête des territoires, la prédation des richesses et la soumission des peuples :
Pour confisquer les biens il a fallu confisquer les âmes, et pour cela confisquer la parole en s’adressant directement aux affects. […] La démarche consista à priver symboliquement les corps conquis de toute âme puis d’en accorder une plus conforme permettant au plan économique de la prédation de coïncider avec le plan du salut. Si le colonisé n’a point d’âme, alors c’est bien pour le sortir de son animalité et de sa misère qu’il faut inscrire dans sa chair l’idiome rédempteur de la loi imposée. Pénétrer les affects, graver dans la chair les croyances et les convictions dans une langue à la fois illisible et subie, réduire la mémoire et la parole au silence ont été autant de programmes de désubjectivation. (p. 50-51)
14La problématique autorise en outre Marie-José Mondzain à faire régulièrement retour vers le premier roman entrepris par Kafka en 1911 et abandonné dès 1913, dans les mois qui précèdent donc la rédaction de La Colonie pénitentiaire, pour avancer l'idée originale que la nouvelle est à lire comme le scénario d'une possible suite de L’Amérique [Amerika ou Der Verschollene, Le Disparu]. Ce premier héros de l'exil, l'émigré Karl Rossmann, se trouvant sans ressources au terme d'une véritable descente aux enfers, ne se donne-t-il pas à lui-même le nom de « Negro » pour s'enrôler dans le plus vaste théâtre du monde, cet énigmatique « Grand théâtre d'Oklahoma » où « tout le monde a sa place » ? On se souvient que les dernières pages du roman nous montrent Karl emporté, ou plutôt déporté dans le train qui embarque tous les nouveaux embauchés : Oklahoma pourrait bien en effet être le nom d'une colonie pénitentiaire, où Negro est promis comme machiniste à l'appareil spectaculaire du Grand Théâtre. Kafka oriente ici encore notre regard autrement : « il l'oriente politiquement en nouant la condition du noir et du juif sous le signe de la prolétarisation » (p. 76).
Les nouvelles machines
15On renonce à dresser ici la liste de toutes les propositions et intuitions théoriques dont la relecture assidue de La Colonie pénitentiaire est pour Marie-José Mondzain l'occasion. Les derniers chapitres de l'essai cherchent à penser, avec Kafka toujours mais aussi James Baldwin11, Achille Mbembé12, Antonio Casilli13 ou Dénètem Touam Bona14, « le passage de l'esclavage colonial à l'esclavage planétaire ». La théoricienne se voue à décrire les « nouvelles machines » — celles dont rêvait sans doute le nouveau commandant de l'île —, qui ne punissent plus mais exploitent « en usant des images et des mots qui imposent l'idiome de l'amour et de la haine dans le commerce des choses » (p. 135). Ces machines nouvelles façonnent « l'imaginaire charnel des corps qui travaillent et consomment » en étendant à l'échelle du monde les opérations colonialistes, comme Matthias Langhoff l'avait puissamment suggéré en 1996 dans sa mise en scène de La Colonie pénitentiaire au Théâtre de la Ville sous le titre Kafka-Machine. L'île du salut15.
16Marie-José Mondzain retrouve ici par plusieurs biais également inattendus sa réflexion sur les pouvoirs propres du cinéma ou plus exactement des images cinématographiques, en évoquant dans des pages très inspirées l'invention de la caméra analytique par Yervant Gianikan et Angela Ricci Lucchi : leur travail sur les films de propagande fasciste a su « dédoubler » la machine cinématographique pour « opérer un retournement complet du regard des films qui plaidaient pour l'asservissement des peuples » (p. 201) ; les deux cinéastes sont parvenus à accorder aux corps asservis l'attention qu'on ne leur avait jamais accordée, en rendant visible la violence exercée sur eux par les corps dominants mais aussi bien, et dans le même temps de l'image, la résistance à cette violence, l'humiliation et la dignité dans cette humiliation elle-même. Si « la machine cinéma a la possibilité de désarticuler les effets colonisateurs des caméras dominantes », de telles initiatives font signe vers d'autres opérations de décolonisation des corps et des imaginaires.
17L'archipel des chapitres de K comme Kolonie vient ainsi dresser, à sa façon libératrice, la carte des territoires où de telles opérations se jouent aujourd'hui, en réhabilitant par différents biais ce que Marie-José Mondzain nomme efficacement « l’énergie constituante des opérations fictionnelles ». Si la lecture des fables de Kafka peut nous rendre joyeux, c'est à la façon dont les modernes zones se révèlent à la fois des espaces de lutte et de solidarité, des lieux de souffrance et d'espoir — de la jungle de Calais aux différentes Zones à défendre ou à la Place de la République de l'opération Nuit debout.
18Et si les seuls vrais livres sont ceux qui parviennent à « fendre la mer gelée en nous », comme le voulait Kafka dans une formule partout reprise16, toute écriture authentique nous achemine peut-être vers de telles zones, en ouvrant à notre imagination le champ des possibles.
Toute écriture part peut-être d’une blessure, d’une souffrance qui ne peut se dire qu’au prix d’un saut fictionnel vers ce lieu que j’appelle une “zone”. La zone est un espace dont l’indétermination offre le champ imaginaire de tous les possibles. Hors de tout règlement de comptes, la zone est un espace sans mur et sans frontières. Il faut l’inventer chaque jour, car c’est là que se tissent les liens où la possibilité de vivre ensemble déborde la réalité des luttes historiques pour partager l’actualité d’un même combat. (p. 33-34)
19Il faut imaginer Kafka joyeux.

