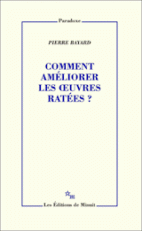
L’eau & le moulin
1Essayiste, Pierre Bayard partage avec quelques rares écrivains un véritable privilège : celui d’avoir fédéré, en sept ans et presque autant de titres, un public de fidèles qui guettent chacun de ses livres, aiment à en lire certains passages à haute voix à leurs proches, et finissent par l’offrir à leurs amis… J’attends pour ma part « le » Bayard de l’année, comme je me précipite sur le nouveau Quignard.
2Je sais que j’en lirai la quatrième de couverture debout dans une librairie, et j’en savoure d’avance l’humour – quelques phrases caustiques et patientes tout à la fois qui d’emblée viendront prendre à rebours bien des idées reçues et nombre d’habitudes institutionnelles. C’était naguère quelques interrogations sur les « longueurs » de Proust et la nécessité d’une lecture « aux ciseaux » de la Recherche du temps perdu (Le Hors-sujet. Proust et la digression, 1996), ou encore le soupçon jeté sur l’ingéniosité d’Hercule Poirot et la confiance que nous plaçons dans les romans policiers (Qui a tué Roger Ackroyd ?, 1998).
3Et j’aime par-dessus tout qu’en chacun de ses livres, ce soit d’abord comme lecteur (mon franc semblable) que Pierre Bayard prenne la parole.
4Mieux que d’autres, chacun de ses essais m’a donné, comme on dit, " du grain à moudre " : le Hors-sujet à peine refermé, je rouvrais Proust pour quelques échappées belles ; et après plusieurs relectures croisées de Qui a tué Roger Ackroyd ? et du roman d’Agatha Christie, j’entamais une longue descente dans la poétique du roman policier pour me risquer à mon tour à une manière de contre-enquête – on peut en lire les conclusions dans les pages électroniques d’Acta fabula (et nulle part ailleurs) sous le titre « Pierre Bayard contre Hercule Poirot : derniers rebondissements dans l’affaire Ackroyd. »
5Comment améliorer les oeuvres ratées ?, le dernier opus de Pierre Bayard n’échappe pas à la règle. Le titre est à lui seul tout un programme, et la quatrième de couverture a beau jeu de faire valoir que " les plus grands écrivains de notre littérature ont connu des moments de faiblesse ". Difficile de ne pas se précipiter séance tenante, guidé par une curiosité qui vaut déjà leçon de méthode, sur la table des matières de l’ouvrage – ce registre des oeuvres mortes, ce panthéon des ratés. And the loosers are… La première habileté du livre, en quoi il convainc d’abord, tient dans ce palmarès négatif auquel le lecteur peut ou non adhérer, dans lequel il peut ou non accepter de reconnaître ses propres jugements de valeurs – à partir de quoi, évidemment, le voilà « embarqué ».
6Le dirai-je ? J’ai d’abord souscrit sans tellement de réserves aux jugements de Pierre Bayard : j’ai beau idolâtrer l’auteur du Cid et celui du Misanthrope, je ne compte pas Héraclius parmi les chefs d’oeuvre de Corneille, ni Dom Garcie de Navarre parmi le trio de tête des pièces de Molière. Je crois pouvoir préférer La Recherche du temps perdu à Jean Santeuil, Candide à La Henriade, Les Mémoires d’Outre-tombe aux Martyrs, et je doute que les oeuvres complètes de René Char figureraient sur les rayons de ma bibliothèque (et moins encore sur ma table de chevet) si tous les recueils du poète eussent été de la même farine que Moulin premier… Et si Rousseau n’avait écrit que les Dialogues, serait-il bien Rousseau ? Mais au fait : quel Rousseau lisons-nous vraiment ? Et suis-je tellement sûr de savoir justifier mes préférences ?
7La leçon du livre commence ici : que valent, dans le fonds, les valeurs sûres de la littérature ? Sur quoi reposent nos certitudes et notre échelle de valeurs ? Peut-on encore, s’agissant de « classiques », faire valoir notre simple goût de lecteur – et notre relative déception devant telle ou telle oeuvre singulière d’un auteur par ailleurs adulé ? Pourquoi demander aux « grands écrivains » ce que nous sommes incapables d’obtenir de nous-mêmes : pourquoi faudrait-il que le talent soit constant ? Pourquoi faudrait-il accorder uniment notre admiration à l’ensemble d’une oeuvre, sinon au nom d’une conception romantique du « génie » qu’on peut à bon droit considérer comme dépassée ? Tout lecteur sait bien que les coups d’essais ne sont pas toujours des coups de maître ; que le meilleur auteur se rend à l’occasion coupable de livres qu’on dira pudiquement " moins achevés " ; que le génie comme l’amour a parfois la douleur de devoir se survivre.
8Ce n’est pas un des moindres mérites du livre de Pierre Bayard que d’oser ces questions en les rendant possibles en retour pour chacun d’entre nous (toute l’ambition de l’ouvrage est en quelque sorte de les « autoriser ») – et c’est en quoi l’entreprise, résolument iconoclaste, est en son principe éminemment salutaire.
9Si l’on est très vite séduit par ces questions que détaille la première partie, on est un peu surpris par les problèmes (délibérément ?) laissés en suspens, et sur lesquels les chapitres suivants ne reviennent guère – au point que le doute s’insinue peu à peu dans l’esprit du « bénévole » lecteur : tous ces « ratages » sont-ils bien des échecs au même titre ? Sur quoi s’accorde-t-on au fond ?
10Je ferai état ici des doutes qui furent les miens au cours d’une première lecture – sans viser donc à une relecture systématique, sans prétendre non plus à « améliorer » le livre (« Comment améliorer le dernier Bayard ? »), mais sans cacher plus longtemps que je ne range pas cet essai parmi les livres les plus « achevés » de l’auteur.
11Deux séries de « remarques » donc, au sens classique du terme – aussi bien la publication électronique favorise-t-elle désormais les stolons.
1. Rhétorique & herméneutique
12La démarche de Pierre Bayard n’est pas sans exemple, même s’il faut remonter trois siècles en arrière pour trouver des témoignages d’une lecture critique qui s’attache ouvertement à évaluer les mérites d’une œuvre : cette lecture a un nom, la lecture rhétorique, et se trouve avoir constitué l’unique mode de lecture des textes « littéraires » profanes à l’âge classique. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir n’importe quelle « critique » contemporaine d’un chef d’oeuvre classique que nous éditons aujourd’hui à titre de " document de réception " – Valincour sur La Princesse de Clèves ou l’abbé de Villars sur Bérénice. La lecture " classique " ne relève en rien d’une herméneutique (on ne s’interroge pas par exemple, au temps de Corneille, sur une possible " politique " cornélienne), mais participe d’une " récriture " qui évalue l’œuvre à l’aune de ce qu’elle aurait dû être, en ramenant le texte réel vers un horizon de textes possibles : Michel Charles a écrit là-dessus des lignes décisives en élaborant à partir de ce mode singulier de lecture une théorie des textes possibles (Introduction à l’étude des textes, Le Seuil, coll. " Poétique ", 1995).
13Est-ce avec un tel mode de lecture que P. Bayard nous invite à renouer, en faisant suivre ses " consternations ", ou constats de ratage, d’une série d’ "améliorations " ? À l’évidence non – pour deux raisons au moins.
14La première est qu’il manque à Pierre Bayard comme à toute notre culture ce qui définissait la possibilité même d’une lecture critique authentiquement créatrice dans la culture classique : une doctrine constituée et une poétique normative. Lorsque l’abbé de Villars suggère tel amendement aux " variantes " introduites par Racine dans le " sujet " de Bérénice, pour produire in fine et en son nom propre de nouveaux possibles, il évalue la création racinienne à l’aune de " règles " qu’il n’a pas de peine à expliciter – et que Racine lui-même ne pouvait méconnaître, si l’on ose dire, qu’en connaissance de cause
15Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’en est plus là – et il n’y a guère que les Académiciens pour le regretter. Pourtant, c’est bien l’absence d’un tel corps de doctrine que le lecteur de Pierre Bayard accuse en découvrant les " améliorations " projetées dans la troisième partie de son livre – tout en soupçonnant confusément, dans le détail des variantes imaginées, un éventail de valeurs qui n’osent pas dire leur nom. A. Wrona, dans le compte rendu qu’elle a donné ici même, l’a très vite souligné : comment définira-t-on, pour " améliorer " Moulin premier, la " clarté " qu’on attend du texte poétique ? Et au nom de quelle valeur faudrait-il remédier à " l’hétérogénéité " ?
16On peut cependant avoir une lecture plus généreuse des " récritures ", délibérément ludiques, qu’offre la troisième partie de l’essai : et si c’était précisément le manque hic et nunc d’une doctrine esthétique commune que Pierre Bayard visait à nous faire éprouver ?
17La deuxième raison est que la démarche de Pierre Bayard est en prise sur une réflexion non pas tant rhétorique qu’herméneutique : c’est en référence à la psychanalyse qu’une typologie du " ratage " est sommairement proposée.
18(Notons au passage que Pierre Bayard, dans cette section centrale, met sous le boisseau les principes qui faisaient l’originalité de ses précédents livres : loin de se demander " ce que la psychanalyse peut apprendre de la littérature ", selon le " paradoxe " stimulant qui fondait ses essais antérieurs, Pierre Bayard demande ici à la psychanalyse ce qu’elle peut nous apprendre de l’échec esthétique.)
19Je n’ai nulle compétence pour évaluer l’interprétation qui nous est donnée sur ce point de la doctrine de Freud, mais il me semble que si la psychanalyse a quelque chose à dire des conduites d’échec, il n’est pas sûr que l’échec esthétique puisse être simplement considéré comme le résultat d’une défaillance de la communication esthétique.
20Ici comme ailleurs, rhétorique et herméneutique ne font pas bon ménage : si le " ratage " est passible d’une interprétation, pourquoi faudrait-il y remédier par ailleurs ? La psychanalyse est sans doute une thérapie, mais imagine-t-on un analyste invitant son patient à " refaire " un récit de rêve parce qu’il est " mal écrit " ? Tout récit de rêve est en un sens " mal écrit ", et c’est bien pourquoi il est à interpréter et non pas à récrire ou amender : c’est qu’ici l’hétérogénéité fait sens ou symptôme ; elle fait signe vers un manque ou un trauma qu’il importe de surmonter – elle n’est en rien un " défaut " auquel il faudrait remédier. Pour l’herméneute, le texte a une profondeur ; pour le rhétoricien, il est une pure surface. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin.
2. Mauvais genres
21Il faut attendre le troisième chapitre de la seconde partie (" Le temps des oeuvres "), soit le milieu de l’ouvrage, pour lire quelques considérations historiques. Mais ces pages très brèves n’éclairent guère un partage à peu près inévitable et dont Pierre Bayard a cru pouvoir se dispenser : il est des oeuvres " ratées " qui n’ont jamais rencontré leur public, mais il est aussi des oeuvres dont les premiers succès ont sombré dans l’oubli pour nous devenir illisibles ; il en est encore qui déçurent leur premier public mais qui trouvèrent grâce aux yeux de la postérité ; il en est en outre que leur descendance étouffe, jusqu’à ce qu’une autre époque les " redécouvre " pour pouvoir s’y reconnaître ; il en est enfin dont le " grand public " se détourne durablement, mais qui font les délices de quelques " happy few ". Encore pourrait-on probablement allonger la liste : j’attendais pour ma part du livre de Pierre Bayard qu’il esquisse une telle typologie, en interrogeant les rapports qu’entretiennent les différentes catégories.
22Un tel partage eût utilement convoqué les notions de genres ou de contrat générique et celle, dialectique et désormais " classique ", d’horizon d’attente. Pour faire court : les oeuvres n’ont pas seulement affaire à un lecteur toujours singulier qui prononce un jugement de goût ; elles affrontent d’abord un public, avant d’être confrontée au passage du temps, au renouvellement des contextes et à la diversité des publics. Les contrats génériques jouent dans cette histoire un rôle évidemment capital.
23Pierre Bayard sait tout cela : " c’est par rapport à l’ensemble d’un contexte de réception, et non simplement d’un itinéraire personnel, qu’une oeuvre peut être qualifiée de ratée " (p. 99). Et il s’efforce alors de montrer que la théorie de la " distance à soi " qui doit rendre compte des ratages, est en réalité une théorie de la " double distance ", " puisque l’effectuation de cette distance à soi ne peut se faire que par le biais de l’écriture, et des différentes modalités d’adresse qu’elle établit entre l’écrivain et le lecteur de son époque " (p. 103). Mais pourquoi éprouve-t-il le besoin dans le même temps de répéter (p. 104, n. 3 ; p. 111) que, dans les exemples retenus, " la plupart " des oeuvres ratées ont été considérées comme telles depuis leur parution et continûment jusqu’à nous ? C’est que si le ratage est essentiellement affaire de distance de l’auteur à sa propre fantasmatique, on voit mal finalement comment l’échec pourrait être soumis aux aléas de l’histoire, et encore moins comment il pourrait être un effet de ce devenir… Comment poser la question de l’échec sans poser celle de la valeur ?
24En dépit des rapides suggestions de ce chapitre central, tout se passe en définitive comme si une oeuvre était ratée une fois pour toutes et pour tous ses lecteurs : P. Bayard peut, dans ma même page (104), souligner l’importance de " l’écart temporel " dans l’appréciation de l’échec esthétique, et marginaliser " l’influence du contexte dans notre cas précis " (n. 3) – sans que soit d’ailleurs vraiment explicité le biais par lequel on peut espérer articuler le hic et nunc de l’interprétation et le contexte historique de création de l’oeuvre. Pour avoir essayé de concilier courageusement explication psychanalytique et analyse historique, Pierre Bayard laisse son lecteur arbitrer seul une série de problèmes.
25Quatre rapides exemples, sur le seul terrain où j’oserai m’aventurer, celui des littératures classiques :
26– Est-ce un hasard si, sur les treize oeuvres " ratées " retenues par Pierre Bayard figurent trois épopées (La Franciade, La Henriade, Les Martyrs) ? L’épopée de Chateaubriand relève-t-elle d’ailleurs du même genre que celle de Ronsard ou de Voltaire ? Et la première réception des Martyrs fut-elle bien celle d’un " ratage " ? Qu’en est-il, au fonds, du destin de l’épopée dans la littérature française ?
27La question de la valeur s’ouvre ainsi à celle de la lisibilité : on ne prendra guère de risque en faisant l’hypothèse que la lisibilité d’un texte est assez largement fonction de la vitalité de l’hypertexte. Et c’est à une archéologie du lisible qu’il faudrait logiquement en appeler pour penser l’historicité de la valeur.
28– Peut-on imputer à Héraclius une trop grande " complexité " sans perpétuer une légende dont Racine, on voit trop bien pourquoi, est le seul responsable ? Corneille n’est devenu " complexe, qu’au lendemain de Bérénice (1670) – dont la préface ne théorise la " simplicité " d’action que pour mieux asseoir la supériorité de Racine et justifier l’abandon de la terreur et de la pitié au profit de la seule " tristesse majestueuse "… Il y a autour de ces notions de " simplicité " et de " complexité " bien des malentendus ; autant dire : une série d’enjeux qui nous mettent aux prises avec des stratégies institutionnelles, lesquelles relèvent d’une sociologie du " champ littéraire " autant que de la poétique.
29– Peut-on sérieusement lire Dom Garcie de Navarre de Molière comme s’il s’agissait d’une " comédie " ? Doit-on s’étonner encore de " l’imprécision " générique d’une pièce qui " entrecroise deux intrigues " " hétérogènes de ton " (p. 26), si l’on sait que la pièce de Molière relève d’un genre parfaitement attesté mais aujourd’hui largement méconnu : la comédie héroïque, genre inauguré par Corneille en 1647 avec Dom Sanche d’Aragon (dont Molière s’inspire largement, avec quinze ans de retard, et c’est peut-être là le problème), théorisé à nouveaux frais dans les Discours sur le poème dramatique de 1660 et renouvelé en 1670 encore avec Tite et Bérénice… Les contraintes génériques de la comédie héroïque ne se comprennent elles-mêmes qu’en regard de celles de la tragi-comédie, dont l’avènement de la doctrine classique a signé l’arrêt de mort dès 1640, mais en regard aussi des conventions propres à la tragédie " à fin heureuse " dont Corneille s’est fait également le promoteur avec Cinna… L’hétérogénité supposée de l’intrigue de Dom Garcie est peut-être imputable au seul lecteur moderne, qui se trouve avoir perdu, avec les règles du jeu générique, le bon mode d’emploi.
30Que la pièce de Molière ait été, dès sa création, un échec n’invalide en rien l’hypothèse historique : le fait invite simplement à s’interroger d’abord sur l’incapacité du dramaturge à " intégrer " un jeu de contraintes génériques historiquement datées, sur la hiérarchie des genres dans la période classique ensuite, sur la recomposition du système des genres après la " disparition " de la tragi-comédie enfin, ou encore sur la " spécialisation " progressive des troupes et des scènes parisiennes… Il serait pour le moins un peu court de soutenir que Molière n’était pas " fait pour " la comédie héroïque, qu’il avait un " génie " résolument comique (Donneau de Visé le disait dès 1662) : si Dom Garcie connaît une chute rapide, c’est aussi que le genre tombe mal en 1662…
31– Peut-on absolument exclure que tel texte aujourd’hui déconsidéré nous redevienne lisible ? Les poètes baroques donnent l’exemple de ces auteurs " redécouverts " après plusieurs siècles d’éclipse, " réinvestis " de valeurs par eux imprévues qui se trouvent être, bien sûr, celles de notre modernité poétique. Combien de commentaires de Saint-Amant parlent ainsi la langue de Mallarmé ?
32Il y a là un phénomène de recontextualisation assez efficace pour donner à tout un corpus une seconde vie. Que valent alors pour nous les formules fameuses de Boileau pour qui le " Moïse noyé " du poète baroque fait figure d’oeuvre " ratée ", ou encore l’évaluation par Racine de l’Antigone de Rotrou ? Autant de questions qui relèvent pleinement d’une archéologie du lisible.
33C’est donc bien dans la question de la valeur que la démarche de Pierre Bayard se trouve engagée, sans véritablement lui donner une assise théorique. Peut-être, comme on l’a plus haut suggéré, parce que les deuxième et troisième sections de l’ouvrage pratiquent le " grand écart " entre rhétorique et herméneutique : si l’analyse rhétorique peut dissocier la valeur et le sens, la lecture herméneutique fait tenir la valeur dans le sens.
34Il faut être cependant sensible à l’humour dont Pierre Bayard fait preuve dans ses propositions " d’amélioration " : il suffit à révéler que l’analyse pourrait bien tirer des profits insoupçonnés d’attenter ainsi, et délibérément, à l’autorité du texte littéraire.
35Reste que cette désacralisation ne peut pas s’opérer sans règles ; qu’elle suppose d’articuler une archéologie du lisible et une véritable théorie des textes possibles, qui offre aux exercices de récriture un cadre pertinent ; que toute " variante " imaginée, fût-ce pour le simple plaisir de jouer, implique non seulement une poétique, mais aussi un système de valeurs, une hiérarchie des genres, une échelle des plaisirs – en d’autres termes : une esthétique.
36Les " récritures " proposées auront par ailleurs d’autant plus de chances de se révéler convaincantes que les oeuvres retenues relèveront d’une poétique bien définie : c’est bien parce que le xviie siècle a laissé une poétique de la tragédie particulièrement complète, qu’il nous est possible de nous adonner à notre tour à l’une de ces lectures rhétoriques qui s’apparentent à des récritures – rien n’empêche par exemple de projeter une nouvelle version d’Horace qui remédierait aux défauts que confesse Corneille, vingt ans après la création de la pièce, dans l’Examen de 1660 ; d’imaginer des " variantes classiques " à l’Alcionée de Du Ryer, ou d’affabuler à nouveaux frais un apologue ésopique. Dire qu’on proposerait ainsi une Alcionée de Racine, un Horace révisé par Corneille au lendemain de la publication des Discours de 1660, ou une fable " inédite " de La Fontaine, ce n’est pas tant chercher à " autoriser " la récriture, que préciser la doctrine qui décide du travail " d’invention " et de la production de variantes.
37Pourquoi d’ailleurs ne faudrait-il " refaire " que les œuvres ratées ?

