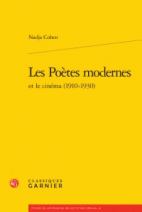
Ce je-ne-sais quoi poétique dont le cinéma est le nom : rêveries & projections fantasmatiques des poètes de la modernité sur le cinéma
Poésie & cinéma, à la recherche d’un itinéraire
1Alors que les travaux sur les relations entre la littérature et les arts fleurissent depuis quelques décennies, le cas particulier des liens entre la poésie et le cinéma a longtemps fait figure de parent pauvre. Cette lacune est en partie réparée grâce au livre de Nadja Cohen, Les Poètes modernes et le cinéma (1910-1930), dont la publication constitue un jalon décisif dans l’exploration d’un champ critique encore peu défriché.
2Malgré quelques publications stimulantes (notamment les travaux de Philippe Ortel, Olivier Belin, Catherine Soulier ou, plus précisément pour la période du début du xxe siècle, de Francis Ramirez1), les études sur la réception poétique du cinéma restent en effet « curieusement parcellaires et incomplètes2 », comme l’a fait remarquer Jan Baetens dans son compte rendu de l’ouvrage. Et si les rapports des surréalistes au cinéma ont donné lieu à plusieurs travaux, la période qui précède restait jusque-là inexplorée.
3Pour N. Cohen, c’est la jeunesse du medium cinéma qui explique, avant même 1924, la fascination des poètes pour cet « art neuf et jeune, sans reconnaissance institutionnelle, ni même critique », mais aussi le « désert critique » qui l’accompagne, sans doute entretenu par Breton qui n’hésitait pas à minorer les expérimentations menées dans les années 1910, qu’il jugeait inabouties et puériles. Prenant le contrepied de ces discours, N. Cohen montre qu’une véritable fascination pour le cinéma et une intelligence pour ce medium est sensible en amont du surréalisme, comme en témoignent notamment le scénario d’Apollinaire, La Bréhatine, écrit en collaboration avec André Billy, et les recherches d’Albert-Birot. C’est ce qui conduit la chercheuse à faire le choix d’une optique générationnelle, qui lui permet de faire entendre des voix moins connues, comme celle d’Albert-Birot ou de Benjamin Fondane, et d’intégrer dans son corpus des revues, comme Les Soirées de Paris, SIC ou Nord-Sud.
4L’ampleur et la variété du corpus pris en considération sont d’ailleurs l’un des premiers mérites de ce travail. Au corpus littéraire, mêlant des textes de nature diverse écrits par des poètes (articles théoriques, récits fictionnels, poèmes, scénarios et formes aux contours plus floues), s’ajoutent des textes d’artistes et de cinéastes écrits à la même époque (ceux de Jean Epstein notamment dont on redécouvre l’importance cruciale), mais aussi de philosophes et de sociologues de la modernité. Cette diversité permet de cerner le rôle que joua le cinéma dans « l’invention de la vie moderne » et la spécificité de cette « épistémè du cinéma » (François Albera) dans l’anthropologie de la modernité3. Cette réflexion anthropologique est en effet importante pour comprendre la façon dont le cinéma a participé au « nouveau paradigme de pensée et de représentation » qui innerve à cette époque tous les champs d’expression et dont il semble la « concrétisation la plus achevée » (Fr. Albera).
5C’est donc sous cet angle que N. Cohen choisit d’aborder la question, en interrogeant la place et les effets du cinéma dans le discours poétique de la modernité, entre le début des années 1910 et la fin des années 1930. Perspective stimulante mais qui, d’emblée, oblige l’auteur à se confronter à trois difficultés. L’ambivalence, d’abord, de ces discours, qui oscillent entre la fascination et un certain mépris pour le cinéma, lequel suscite des projections fantasmatiques parfois contradictoires. À cette multiplicité des discours s’ajoute le peu de collaborations effectives entre poètes et cinéastes. N. Cohen le souligne dès le seuil en plaçant sa réflexion sous le signe d’Apollinaire, « homme-époque », acteur et témoin des grandes mutations de la poésie du début du xxe siècle, qui à la fois sonne le glas du livre imprimé et appelle à jouir des possibilités infinies des nouveaux médias, mais qui in fine ne fait jamais à proprement parler sortir le poème du support livresque. Plusieurs poètes, mus par leur fascination pour le cinéma, ont cependant cherché à inventer de nouvelles formes hybrides, mêlant poésie et cinéma, ou se sont lancés dans l’écriture de scénarios. N. Cohen n’ignore pas ces tentatives mais elle en montre les limites (et c’est là la troisième difficulté qu’elle affronte de manière convaincante dans la dernière partie de son ouvrage), en expliquant notamment pourquoi la plupart de ces scénarios sont injouables.
6Face à ces difficultés et face à cet objet dont les contours échappent, plutôt que d’en conclure à l’aporie, N. Cohen y voit le signe d’un adynaton, c’est-à-dire d’un défi qui se serait présenté aux poètes. Et c’est précisément cela, ce qui fait défi, qu’elle questionne. Elle montre ainsi que le cinéma a pu jouer le rôle d’incitation puissante, voire de modèle pour les poètes, mais d’un modèle ambivalent porteur d’enjeux à la fois esthétiques, anthropologiques et sociologiques, qui a pesé diversement sur le devenir de la poésie.
7La singularité et la force de l’approche de N. Cohen résident aussi et surtout dans l’importance accordée à la dimension médiologique de la question, sensible notamment dans l’attention qu’elle donne aux projets de collaborations, y compris ceux qui ont échoué. Qu’est-ce qu’une œuvre mixte ? Quelle est la spécificité du travail déployé par les artistes qui s’y essaient ? Où se termine le poème, où commence le cinéma ? Comment s’articulent ou comment se contaminent les deux arts ? Et comment parler avec le plus d’acuité de ces objets qui débordent les catégories formelles et génériques répertoriées ? Voilà autant de questions auxquelles ouvre ce travail, point de départ de recherches plus larges menées depuis par N. Cohen, qui s’inscrivent dans un champ particulièrement dynamique investi par une jeune génération de chercheurs très actifs4. Tous ces travaux ont comme perspective commune la « réévaluation médiologique du fait littéraire » et la prise en compte de « l’expansion de la littérature au-delà du seul imprimé » comme le précise Jan Baetens5, ce qui ne signifie pas tant la « transition d’un médium à un autre » que la « réélaboration des usages littéraires de la parole dans un ensemble plus divers ». D’où le parti pris méthodologique adopté par N. Cohen ici, qui part non pas d’une lecture microscopique des textes mais d’une réflexion sur la façon dont l’imaginaire de la modernité s’est cristallisé autour du cinéma, en contexte de « concurrence médiologique », ce qui a certes donné naissance à de nouveaux genres hybrides, mais a peut-être plus foncièrement encore conduit les poètes à repenser le « poétique » à l’intérieur et en dehors du poème.
8On s’intéressera donc plus particulièrement ici à ce « je ne sais quoi » poétique dont le cinéma a été le nom pour les poètes modernes et que le livre de N. Cohen s’attache à ressaisir. Car finalement, ces poètes de la modernité ne cherchaient peut-être pas tant à s’approprier ou à concurrencer les nouveaux médias qu’à les découvrir, poussés par une curiosité et un esprit d’aventure qui les rendait sensibles aux innovations techniques et artistiques de leur temps, et qui les encourageait à voir la poésie comme un immense terrain d’expérimentations possibles pour faire bouger les frontières.
9Une des grandes qualités de cette étude tient à la place importante accordée à la vie culturelle de l’époque et au soin avec lequel N. Cohen replace cette rencontre entre les poètes et le cinéma dans son contexte historique, social, technologique et esthétique. Cela lui permet de prendre le pouls d’une époque. Époque caractérisée par l’entrée dans l’ère de l’image industrielle qui a imprimé sa marque profonde sur la poésie et ses représentations, comme l’a montré Ph. Ortel. Car si la révolution photographique a contribué à façonner l’imaginaire des poètes du xixe siècle et a accompagné le passage d’une culture logocentrique à une « culture technocentrique […] où la conquête du monde est d’abord visuelle » (et les travaux d’Anne Reverseau ont permis de mesurer l’importance du paradigme photographique avant même le surréalisme6), c’est bien le cinéma qui semble ensuite prendre le pas au début du xxe siècle, au point de devenir « le cadre cognitif à travers lequel le xxe siècle pense sa propre culture7 ». Ce qui ne va pas sans tension, et c’est précisément sur cette tension que repose toute la dynamique de la réflexion proposée par N. Cohen puisqu’elle parvient à montrer l’accueil ambivalent dont le cinéma est l’objet à ses débuts, qu’il soit considéré comme une curiosité scientifique qui permet de dupliquer le réel, ou comme un divertissement forain et un lieu de liesse populaire. Alors que le cinéma se voit rarement conférer la dignité d’un art et ne jouit pas, en 1910, de la reconnaissance sociale et institutionnelle des élites, l’intérêt que lui portent les poètes n’en est que plus frappant et prend une importance étonnante dans le champ culturel des années 1910-1920. La première partie de l’ouvrage, en forme de panorama de la vie culturelle des années 1910 et 1920, met au jour les raisons de cette rencontre entre les poètes de la génération d’Apollinaire et le cinéma. La deuxième partie revient plus précisément sur l’étroite association entre cinéma et modernité dans les esprits de l’époque, et en déplie les modalités multiples qui permettent de comprendre de quoi le cinéma est plus largement mais aussi plus confusément le nom pour les poètes. La troisième partie explore ce « désir de cinéma » dans son double versant : d’abord théorique, en soulignant l’écart entre ce feuilletage de discours qu’ils énoncent sur le cinéma et l’esthétique cinématographique qui est en train de se mettre en place, puis poïétique, en se penchant plus précisément sur les formes poétiques nouvelles qui résultent néanmoins de cette rencontre.
10Cet itinéraire proposé par l’ouvrage a son importance. C’est pourquoi il convenait de le rappeler en guise de préambule. Mais penchons-nous maintenant plus précisément sur les différents aspects du cinéma qui ont attiré les poètes et leur ont semblé « poétiques », par-delà la spécificité du médium. Au fil de cette enquête, il se pourrait que nous en apprenions autant sinon plus sur l’idée, au sens large, de « poésie » et sur les fantasmes que draine ce mot dans l’imaginaire des poètes du début du xxe siècle, que sur la réalité poétique et cinématographique des œuvres de cette époque.
Le je-ne-sais quoi poétique du prosaïque
11D’un point de vue socio-culturel, on pourrait donc s’étonner que les poètes du début du xxe siècle se soient passionnés pour un art né sur les champs de foire, qui suscite la méfiance et le mépris des élites. Mais N. Cohen rappelle à juste titre le goût pour le populaire et le prosaïque dans les consciences de l’époque. L’intérêt des poètes pour les arts forains, la culture populaire et tout ce qui serait susceptible de « rajeunir le “grand art”8 » n’est d’ailleurs pas nouveau, ce phénomène remontant au moins à l’époque romantique comme l’a montré Starobinski. À la suite du cirque et de la pantomime, le cinéma attire ainsi l’attention des poètes pour son caractère prétendument « naïf » et pulsionnel, au même titre que le music-hall, le jazz ou la musique dite « nègre ».
12Parallèlement, N. Cohen revient sur le rôle important joué par Baudelaire dans ce processus de « prosaïsation » de la poésie, qui se manifeste par un renouvellement des sujets poétiques, de la figure du poète mais aussi du lexique et de la forme. Ainsi la préférence affichée par Baudelaire pour la « muse familière » sur la « muse académique », corollaire d’un éloge du banal, de la grande ville et des sujets du quotidien, se double d’une contamination du vers par la prose et de l’invention d’une nouvelle forme, le poème en prose, pour rendre compte de cette poésie de la circonstance dont Baudelaire est l’initiateur. Ces développements préliminaires sur Baudelaire, qui font notamment écho aux travaux de Michel Gribenski sur la prosaïsation du livret d’opéra9 qui se produit significativement à la même époque, auraient pu sembler un peu longs, mais N. Cohen montre très bien comment cette étape annonce le mouvement de désacralisation de la poésie et, plus largement, le vaste procès intenté à l’Art par les avant-gardes des années 1910. Si tous les poètes de cette génération ne partagent pas la virulence avec laquelle Tzara rejette la « belle peinture » et le « côté précieux » attribué traditionnellement à l’art, il souffle en effet dans ces années un « esprit d’aventure », une curiosité pour les innovations techniques et un goût pour le trivial tels qu’on comprend pourquoi le cinéma passionne les poètes.
13Pour expliquer encore cette conjonction, N. Cohen rappelle à juste titre que cette valorisation de la circonstance par les poètes s’est accompagnée d’une mise à distance du lyrisme personnel. Dans le sillage de Lautréamont qui proclamait la fin de la poésie personnelle, de Rimbaud qui voulait « étreindre » la « réalité rugueuse » et de Baudelaire louant l’anonymat de la foule dans lequel le sujet poétique est appelé à se dissoudre, Apollinaire apparaît comme une figure déterminante. Lui qui appelait de ses vœux une poésie objective capable de donner l’impression de jaillir de l’immanence des choses, ne pouvait manquer d’être intéressé par le medium cinéma, qui était perçu, rappelons-le, au moment de sa naissance, non comme un art mais comme une « machine à enregistrer le réel ». Ce dispositif innovant, permettant à la fois de capter des vues animées et de les projeter ensuite sur un écran, offre un modèle esthétique idéal à qui rêve d’une poésie où le sujet lyrique disparaitrait pour laisser place aux images. En plus de bouleverser la place et le rôle de l’artiste, il offre par ailleurs un dérivatif stimulant à ce problème de la simultanéité situé au cœur des préoccupations des poètes à cette époque, qui cherchent à échapper au régime de la successivité auquel est contrainte la poésie, comme en témoignent par exemple la collaboration entre Cendrars et Sonia Delaunay ou l’écriture de calligrammes.
14Ces développements sur Apollinaire conduisent N. Cohen à mettre également en avant l’importance du lyrisme visuel à cette époque (les affiches publicitaires apparaissant comme un moyen d’élargir le champ d’action de la poésie et de mettre le poète au défi de « rivaliser avec les étiquettes des parfumeurs10 »), de l’esthétique du collage (avec une prédilection là encore pour les matériaux « pauvres ») et plus généralement des liens entre la poésie et le journalisme pour comprendre la genèse du modernisme. Peut-être aurait-il été judicieux de remonter un peu plus en amont et d’insister sur l’importance du journalisme pour Mallarmé, qui participe à une sociologie de la littérature dont l’œuvre de Mallarmé est bien plus empreinte qu’on ne le croit souvent, comme l’a montré Pascal Durand dans Mallarmé. Du sens des sens au sens des formalités (Seuil, 2008). Cette dimension sociologique, N. Cohen la met en avant un peu plus loin dans son ouvrage lorsqu’elle relaie les analyses de Michel Poivert qui insiste sur le goût des surréalistes pour la photographie « pauvre » et sur leur façon de reprendre et détourner des images « braconnées » dans l’histoire de la photographie11.
15L’attrait des poètes pour le prosaïsme s’observe aussi dans leur goût pour le cinéma populaire, ses héros et ses déclinaisons (film d’action, western, policier, film burlesque ou mélodrame), qu’ils préfèrent de loin au film expérimental. N. Cohen montre qu’il s’agit d’une constante sur toute la période et en explique très bien les ressorts, notamment dans le chapitre consacré à « l’éloge de l’idiotie » à la fin de l’ouvrage. Dans le contexte des débats moralisateurs dont le cinéma est l’objet pendant toute cette période, la défense du film populaire, qui va parfois jusqu’au plaidoyer pour l’idiotie, le grotesque et le kitsch, est non seulement une provocation à l’égard des bourgeois mais aussi une marque de résistance contre les tentatives d’anoblissement du cinéma par les premiers cinéphiles et sa ritualisation sur le modèle du théâtre qui, dans l’esprit de beaucoup d’intellectuels européens de cette époque, semble frappé de sclérose. Il s’agit là d’un exemple significatif du phénomène plus général de subversion du majeur par le mineur, particulièrement vivace depuis le milieu du xxe siècle et qui a été un grand moteur du renouvellement de la littérature. Les formalistes russes ont analysé cet intérêt pour le spectacle populaire à partir de la loi dite de la « canonisation de la branche cadette », que Victor Chklovski définit en ces termes : « quand les formes artistiques traditionnelles parviennent à un point mort, les produits de la culture populaire sont admis dans le salon, élevés à la condition d’art littéraire authentique, à savoir canonisé12 ». De la même façon que les formes dites sous-théâtrales, comme le cirque ou la pantomime, vers lesquels se sont tournés les auteurs de la fin du xxe siècle13 et dont le personnage de Charlot, célébré autant par l’avant-garde poétique que par le grand public, porte d’ailleurs les traces, le cinéma semble avoir joué ce rôle de contestation de l’art dominant et de ferment au renouvellement de la littérature. En lisant le livre de N. Cohen, on comprend en effet qu’aimer le cinéma, pour ces poètes, ce n’est pas seulement brandir les « refrains idiots » et la culture populaire contre celle des lettrés, c’est aussi instruire le procès d’une société sclérosée et célébrer le monde moderne. Si « le cinéma a toujours un air de défi lancé à la face du monde ancien » (p. 24) comme elle le souligne avec force, c’est qu’il apporte à la poésie ce que la littérature de l’époque semble ne plus être capable de lui offrir : vitesse, énergie, sensation – en un mot ce « je-ne-sais-quoi » poétique de la vie moderne.
Le je-ne-sais-quoi-poétique de la vie moderne
16Apollinaire est là encore une figure décisive. N. Cohen rappelle son enthousiasme pour la machine et pour les progrès techniques, qu’il partage avec les futuristes. Pour lui qui adhère passionnément à son temps et fustige toute forme de passéisme, la poésie ne peut méconnaître la « magnifique exubérance de vie que les hommes […] ajoutent à la nature et qui permet de machiner le monde de la façon la plus incroyable » (p. 86). Elle doit célébrer les beautés et l’énergie du monde moderne. Le cinéma en est l’une des expressions quintessenciées, lui qui appartient, par son dispositif technique, au monde moderne et semble en articuler tous les attributs : vitesse, mouvement, ubiquité, hyperstimulation visuelle, fragmentation, ces « nouvelles données anthropologiques » liées à la modernité. La valorisation du caractère « moderne » du cinéma est en effet une constante dans les débats artistiques de l’époque.
17S’appliquant à cerner cette « modernolatria » ambiante, la réflexion de N. Cohen se fonde sur l’analyse de discours divers. Cela lui permet de mettre en évidence les raisons de cette association entre cinéma et modernité, placée sous le signe de la vitesse, de la violence et de la subversion. Du côté des philosophes, elle rapporte notamment les propos de Walter Benjamin qui voit dans le cinéma une « esthétique du choc » (p. 177) et confère une vocation pédagogique à l’hyperstimulation visuelle qu’il met en œuvre. Du côté des romanciers, l’attention est portée sur Aragon qui fait un éloge de l’énergie dans Le Paysan de Paris et insiste sur la nécessité d’éprouver l’énergie, de la ressentir et d’en retranscrire la sensation.
18Place est faite aussi aux discours de l’intérieur, et en particulier aux propos du cinéaste et critique français Jean Tedesco qui souligne l’engouement des artistes et poètes pour un medium qui semble devancer l’évolution de l’appareil sensoriel humain requise par l’ère moderne mécanique et citadine. N. Cohen relaie également les réflexions du critique et futur cinéaste Jean Epstein, qu’elle contribue à faire découvrir. Le cinéma est pour lui le medium qui permet le mieux de prendre en charge l’énergie et la vitesse du monde moderne et d’en transcrire la sensation, voire la sensualité. Voilà pourquoi poésie moderne et cinéma sont faits selon lui pour s’entendre. On pourrait rappeler, pour élargir la réflexion, qu’à la même époque Honegger compose Pacific 231 (1923), tentative de « traduction » musicale de « l’impression visuelle » produite par un train prenant progressivement de la vitesse, qui fait singulièrement écho à l’arrivée du train en gare de La Ciotat filmé par les Frères Lumière trente ans plus tôt. Dans le programme pour présenter l’œuvre, le compositeur insiste sur la « jouissance physique » et « l’accroissement progressif de la vitesse » qu’il a cherché à retranscrire pour « aboutir à l’état lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes lancé en pleine nuit à 120 à l’heure14 ». La proximité avec les propos de Jean Epstein est frappante, tout en relativisant ce qu’il dit : cette fascination pour l’énergie et la vitesse du monde moderne n’appartient pas aux seuls poètes et cinéastes, le même fantasme est présent chez les compositeurs qui ont eux aussi cherché à en transcrire la sensation en exploitant les potentialités propres à leur medium.
19Au fil de ces discours, la profonde labilité des connotations associées à l’épithète « moderne » est ainsi mise en évidence. L’analyse montre en particulier le basculement qui se produit après la guerre : si le cinéma est célébré comme une merveille du monde moderne à la Belle Époque pour son caractère technique, c’est ensuite plutôt pour sa force de contestation sociale qu’il est loué, la technique, associée à la tuerie de la guerre, ne suscitant plus le même enthousiasme.
20Toute cette réflexion sur l’accointance entre le cinéma, le monde moderne et la singulière poésie qui s’en dégage est placée sous le signe de la projection et du projectile. Par ses œuvres projetées, projectiles, le cinéma restituerait à sa façon l’expérience de l’homme moderne : telle est l’hypothèse avancée par N. Cohen dans la deuxième partie de son ouvrage. Par l’idéal de rapidité, d’efficacité et l’exaltation de l’action qu’ils incarnent, les personnages de Fantômas et de Charlot semblent ainsi refléter au cinéma les différents visages de l’homme moderne, jusqu’à la caricature parfois. Les pages consacrées à ces deux héros sont savoureuses, elles révèlent à quel point ils sont célébrés par les poètes de l’époque, Max Jacob, Aragon et Michaux notamment.
21Hormis les films d’aventure et les films burlesques, ce sont aussi les westerns américains qui retiennent l’attention des poètes, mettant en scène des hommes vigoureux et pugnaces qui offrent un contrepoint vivifiant, telle une cure de jouvence, à « l’homme de lettres trop aigri » de la vieille Europe (Cendrars). Cet intérêt pour le western tient sans doute aussi à l’imaginaire de l’Amérique qu’il véhicule, terre violente, sans Histoire, ni foi ni loi, qui semble représenter pour beaucoup d’Européens une certaine idée de la modernité et une préfiguration de la société à venir. Terre d’élection pour les uns, de révulsion pour les autres (et l’opposition profonde entre Cendrars et Duhamel que fait ici entendre N. Cohen est frappante), l’Amérique fascine et le cinéma est pour une large part le vecteur de cette fascination.
Le je-ne-sais quoi poétique du subversif
22N. Cohen concentre également son attention sur la dimension subversive du cinéma, qui explique qu’il ait été pendant longtemps peu valorisé socialement, et en particulier dédaigné par les bourgeois qui lui reprochent d’être une « école du vice », selon l’expression d’Édouard Poulain, alors même qu’il exerce un fort attrait sur le public, et notamment sur les poètes.
23Ce potentiel subversif s’observe à plusieurs niveaux. D’abord sur l’écran bien sûr, en raison du caractère sulfureux ou scandaleux des fictions et des héros qu’elles mettent en scène. Musidora, dans le rôle d’Irma Vep, créature à la sexualité carnassière et muse d’un groupe de bandits dans le serial de Feuillade Vampires,est un exemple significatif : N. Cohen rappelle l’immense succès de ce film et la célébration unanime par les poètes de ce personnage, à la fois pour son audace sans borne, ses méfaits, et pour son maillot noir suggestif qui ont fait d’elle une icône sexuelle et l’incarnation de la femme moderne, sans corset ni morale.
24Au-delà du frisson érotique attisé par le statut de voyeur dans lequel le cinéma place les spectateurs qui, à heure dite, viennent assouvir leur « pulsion scopique » dans une salle obscure, le contexte de l’après-guerre est important pour comprendre le fantasme qu’a pu susciter cette « volupté noire liée au meurtre et à l’escroquerie ». N. Cohen le montre bien et, relayant le point de vue d’Aragon, elle avance aussi l’importance de ce contexte pour expliquer la fascination dont les personnages de hors-la-loi, et Fantômas en premier lieu, ont été l’objet. On pourrait en effet s’étonner d’une telle fascination pour la cruauté, le crime et la violence au lendemain de la Première Guerre mondiale : mais Fantômas, parce qu’il assume la violence comme un acte de gratuit sans la dissimuler sous un habit idéologique ou une caution morale et la dirige contre les représentants de l’État, pourrait s’apparenter à un « agent subversif de premier ordre ». Telle est l’hypothèse convaincante de N. Cohen qui insiste sur cette « jeunesse corsetée par une société fortement hiérarchisée et normée qui s’enthousiasme pour des films populaires, que l’élite bourgeoise méprise, et dont elle espère une forme de régénération ». Et en écho résonnent les discours péjoratifs des détracteurs qui, comme Édouard Poulain, « frémi[ssent] d’indignation et de honte en songeant à ces spectacles dégoûtants » et s’insurgent « contre le cinéma, école du vice et du crime », dont le « mauvais goût et l’immoralité […] distille[nt] le poison moral aux enfants et aux gens du peuple », plaidant pour un « cinéma, école d’éducation, moralisation et vulgarisation15 ».
25L’intérêt que portent les poètes, et notamment les surréalistes, à la comédie burlesque, qui est entourée elle aussi d’un mépris latent, va également dans ce sens. Rappelons avec N. Cohen que la dimension subversive du comique est une des composantes de l’humour noir auquel Breton a consacré plus tard une anthologie. Non conformisme, exaltation de la liberté individuelle, mise à mal de la morale bourgeoise, puissance du rythme : on retrouve tous ces idéaux du surréalisme dans la comédie burlesque, par exemple dans les Mack Sennett comedies où s’enchainent les gags et les tartes à la crème jetées à la figure des bourgeois, qui remportent l’adhésion générale.
26Cette attention portée au contexte de réception conduit N. Cohen à articuler la séduction exercée par ce qui se passe sur l’écran et par le lieu même du cinéma. Ces pages sont passionnantes. N. Cohen explique que la salle de cinéma est en effet en train de devenir un des lieux modernes de la rencontre amoureuse et de l’expérience érotique, si fugace soit-elle, ce dont Aragon, Breton et Desnos rendent très bien compte. Elle souligne que les poètes sont sensibles à la tension érotique attisée autant par le lieu, par les images sur l’écran, que par certains procédés inhérents à la technique cinématographique elle-même, comme le gros plan. « [Le cinéma] est sexuel avec ses belles filles et ses beaux garçons qui s’embrassent “en gros plan” avec des bouches d’un mètre cinquante16 » résume Fernand Léger.
27La salle de cinéma est par ailleurs le lieu de l’hétérogénéité sociale, là où se mêlent artistes, petit peuple et bourgeois à la faveur de l’obscurité. Elle répond à un « rêve égalitariste » largement partagé par les poètes de l’époque, à l’inverse de la bonne société plus habituée à la pompe du théâtre et de l’opéra, et à ses rituels normés qui renforcent la ségrégation sociale du lieu. L’hétérogénéité du public de cinéma séduit les poètes qui affectionnent les salles de cinéma des quartiers populaires et dénoncent parfois, comme Desnos, l’embourgeoisement de certaines salles qui ruine le charme de ce divertissement plébéien.
28Pour toutes ces raisons, on comprend pourquoi la salle de cinéma apparaît comme un « lieu aimantant » au cœur de l’espace urbain, et pour les poètes surréalistes en particulier, une « nouvelle source de merveilleux moderne » (p. 237) à laquelle la poésie devrait se désaltérer. Mais on comprend aussi que ce lieu exerce finalement un charme assez indépendant des films qui y sont projetés, la fréquentation des salles obscures devenant par exemple pour Desnos et Jacques Vaché une pratique surréaliste en tant que telle. N. Cohen insiste significativement sur l’attitude de Breton qui, indifférent lui aussi au film projeté, rejette de surcroît toute sacralisation du lieu et toute posture de recueillement qui reconduirait l’attitude bourgeoise face à l’œuvre d’art : pendant la projection, au lieu de s’abîmer dans le silence comme les autres spectateurs, il s’installe pour dîner, ouvre des boîtes et des bouteilles et discute à voix haute avec Vaché ! Derrière cette anecdote, on perçoit à nouveau tout le potentiel subversif dont le cinéma, à son corps plus ou moins défendant, est porteur à cette époque pour les poètes. À l’époque où les critiques de cinéma essaient d’éduquer les spectateurs en insistant sur l’importance du silence pendant la projection, hors de question pour Breton de participer à cette ritualisation du cinéma sur le modèle du théâtre. Hors de question aussi pour les poètes surréalistes de se faire eux-mêmes critiques de cinéma, comme en témoigne Philippe Soupault qui tourne manifestement le dos, comme par principe, à toute forme de discours critique dans ses billets-poèmes où il égrène ses souvenirs de spectateur et compare les films à de « sympathiques bibelots ».
29L’examen détaillé des discours des poètes sur le cinéma, mené par N. Cohen dans la troisième partie de l’ouvrage, est à ce sujet précieux : elle en montre la forte ambiguïté. Si les poètes de l’avant-garde (Aragon, Cendrars, les dadaïstes entre autres) ont toujours exprimé leur préférence pour un cinéma populaire, ils sont en effet allés jusqu’à cultiver ce que N. Cohen appelle un « dandysme de l’anti-culture », particulièrement marqué chez les surréalistes. Le goût des surréalistes pour le mauvais mélodrame est ainsi doublé d’un rejet violent du cinéma expérimental, souvent abstrait, dont les recherches formelles sont perçues comme gratuites. Toute tentative pour injecter artificiellement de l’art dans le cinéma est condamné avec sévérité, tel le choix de certains cinéastes d’accompagner leur film par de la musique classique. « Le jour où les gens de bonne volonté y introduiront des moyens artistiques, les rares attraits que [le cinéma] a pour nous disparaîtront » dit ainsi l’un des personnages d’Anicet d’Aragon, rejoignant le vœu de Benjamin Fondane : « qu[e] [le cinéma] ne devienne pas un art, c’est tout ce que nous exigeons de lui ». Et Breton d’aller jusqu’à cet aveu provocateur : « Je dois confesser mon faible pour les films complètement idiots. ». Sans doute faut-il en conclure, et c’est ce qu’avance fermement N. Cohen, que leur intérêt pour le cinéma, du moins en ce qui concerne Breton, relève davantage d’un attrait pour le scandale que d’un réel parti pris cinématographique.
30Dans ce sillage, elle montre aussi de manière convaincante que ces jugements sur le cinéma ont le plus souvent pour point commun « le refoulement de tout ce qui touche au médium » (J. Baetens) et que, de façon plus générale dans l’ensemble des discours de l’époque sur le cinéma, la priorité est toujours donnée à l’éthique au détriment de l’esthétique, qu’il s’agisse de louer l’effet ou le choc généré par le cinéma, ou l’affranchissement des conventions sociales et morales qu’il suggère. Ces remarques sont loin d’être anecdotiques. Elles donnent des éléments qui remettent en perspective le fait que le cinéma ait à la fois joué un rôle de stimulant fort pour la littérature et les arts, sans être lui-même, pendant longtemps, reconnu comme un art à part entière. Cela permet aussi de cerner avec plus de précision la singularité du public de cinéphiles qui émerge progressivement dans les années 1920 et dont l’ouvrage retrace en partie le portrait, offrant un complément précieux dans le champ des études culturelles aux travaux d’Antoine de Baecque sur la cinéphilie française17.
31Si les poètes du début du xxe siècle semblent avoir privilégié les films d’action pour les raisons qui viennent d’être évoquées, N. Cohen n’occulte cependant pas l’intérêt, au début des années 1910, pour la veine documentaire et réaliste dont les « vues » des Frères Lumière sont le paradigme. Présenté comme une curiosité scientifique qui permet d’enregistrer « la nature prise sur le vif » et en particulier les scènes de la vie quotidienne, le cinématographe fait écho à la passion pour le réel, pour le présent le plus prosaïque et la vie urbaine et industrielle moderne que partagent les poètes de cette époque. Parallèlement à ce type de discours sur le cinéma qui tend à valoriser le film documentaire, un discours très différent se fait cependant aussi entendre, qui privilégie au contraire l’onirisme et fait l’éloge des films de fiction riches en trucages et en illusions.
32Or ces films ont, eux aussi, tout pour passionner les poètes.
La toute-puissance poétique de l’image
33Le chapitre plus technique consacré aux « débuts du cinéma » s’avère sur ce point utile. Il rappelle les deux directions différentes prises par le cinéma à ses débuts, emblématisées d’un côté par les films documentaires des Frères Lumière et de l’autre par les fictions oniriques de Georges Méliès. Deux directions qui furent aussi deux tentations stimulantes pour les poètes, sensibles à la passion du réel et du monde moderne exaltée par le documentaire tout autant qu’à la veine fantaisiste explorée par la fiction illusionniste.
34N. Cohen ne dit pas si des poètes ont vu et apprécié les films de Méliès, ni s’il existe des textes qui en rendraient compte de façon même allusive. Une connivence est cependant frappante entre les explorations tentées par Méliès, son goût pour l’illusionnisme, le merveilleux, les trucages et le montage d’images au détriment de la logique narrative, et les recherches menées un peu plus tard par les poètes surréalistes notamment. D’ailleurs, pour les surréalistes, peu importe la qualité du film, le cinéma joue le rôle d’une corne d’abondance offrant une matière susceptible de se métamorphoser en « merveilleux surréaliste ». Il constitue une sorte de réservoir d’images au « caractère alogique et pulsionnel ». Ce qui leur a valu des reproches, notamment celui d’avoir ignoré la réalité technique et matérielle de ce nouveau medium et de s’être contenté de rêver en « consommant » de la pellicule.
35 Ces considérations amènent N. Cohen à s’interroger sur le rapport que les poètes de cette époque entretiennent plus foncièrement aux images. Ce détour argumentatif, passage obligé mais risqué, est mené assez habilement. L’hypothèse selon laquelle l’intérêt porté aux images de cinéma pourrait se comprendre corrélativement à la place essentielle accordée aux « images » poétiques à cette époque est aussi facile à avancer qu’elle est difficile à étayer. Les cas d’Apollinaire, Reverdy, des futuristes et des surréalistes sont bien sûr révélateurs, tous plaçant la question de l’image au cœur de leurs préoccupations et offrant ainsi une place de choix au cinéma, « lieu magique où le désir du spectateur se projette sur l’écran ». Pour affermir l’analyse, N. Cohen rappelle que ce discours est influencé par la réflexion sur l’inconscient et l’automatisme, le cinéma étant loué à cette époque pour sa faculté à créer des images fantasmatiques sans la médiation du langage, et des images qui ont de surcroît la qualité d’être transitoires et périssables comme l’est la beauté moderne dégagée de toute prétention à l’éternité marmoréenne.
36Si les images poétiques et cinématographiques sont de nature différente, un glissement de l’une à l’autre semble donc possible, qui explique certains rapprochements entre la poésie et le cinéma, mais aussi quelques déconvenues. Le cas du scénario d’Artaud La Coquille et le Clergyman est à cet égard significatif, comme l’atteste la violence extrême avec laquelle le poète accueillit l’adaptation de son scénario par Germaine Dulac, comme le rappelle plus loin N. Cohen dans le sillage d’Évelyne Grossman : « À la fois la technique cinématographique permet d’accéder à des profondeurs jusque là insoupçonnées, d’atteindre cette “réalité intime” voire inconsciente […] de la psychè, d’autre part il ne faut surtout pas qu’elle y parvienne sous peine d’anéantir la force de ce qu’elle révèle 18». De manière plus générale et à la suite de Laurent Jenny, N. Cohen rappelle que les poètes, et Reverdy le premier, ont été soucieux de préserver la spécificité de la littérature et d’« arracher la notion d’image à toute confusion possible avec son acceptation mimétique » en répétant que l’image poétique ne procède pas d’une ressemblance, façon « simultanément d’affirmer la spécificité poétique et de l’opposer à toute visée mimétique19 ». Ces précisions sont utiles, elles évitent tout amalgame facile, même si le lecteur aurait aimé en savoir un peu plus sur la complexité des liens entre images mentales, images poétiques et images de cinéma. Ce qui pourrait donner lieu à un travail ultérieur transversal et plus approfondi, qui serait précieux à bien des égards, avec l’aide par exemple des outils forgés par les sciences cognitives.
37Plus loin dans l’ouvrage, N. Cohen revient sur cette question cruciale de l’image, lorsqu’elle propose une recension très éclairante des réflexions théoriques et esthétiques majeures sur le cinéma formulées par plusieurs poètes qui se sont momentanément faits penseurs du cinéma. Faisant l’état des lieux de la relation pour le moins ambiguë qu’ils entretiennent avec ce nouveau medium, elle souligne que l’intérêt de ces poètes se porte d’abord sur la visualité du cinéma, qui nourrit leurs propres questionnements sur les failles du langage et vient interroger obliquement, pourrait-on dire, la « fonction imageante » de la poésie. Le cinéma dont ces poètes font l’éloge est en effet muet, la mutité permettant selon eux d’accéder plus facilement au merveilleux et, dans le même geste, de s’affranchir du logos. Rappelons qu’à la même époque, les poètes dadaïstes font le procès du langage et tentent par divers moyens de sortir de ce qu’ils appréhendent comme un carcan. Cet aspect est également sensible dans l’insistance avec laquelle les poètes reviennent constamment sur la nécessité, pour le cinéma, de s’émanciper du théâtre et des conventions de l’art dramatique. N. Cohen en rend bien compte en restituant notamment les propos d’Aragon, de Reverdy, de Soupault et de Desnos sur le sujet, et en soulignant à quel point cet appel à l’affranchissement du cinéma se double d’un « violent dénigrement du théâtre, art du passé », qui devient sous leur plume « synonyme d’emphase, d’enflure lyrique, d’artifice » (p. 305). Le chapitre intitulé « Le cinéma, une langue poétique universelle : l’image contre le logos » est sur ce point éclairant, et aborde dans le prolongement la question importante des sous-titres et du passage au parlant, perçu par la plupart des surréalistes comme une « dégénérescence du cinéma, liée à son industrialisation croissante » (p. 323) qui ouvre la voie à une représentation appauvrie du réel, plus proche de l’esthétique du roman que de celle de la poésie.
Résistance de la poésie
38Malgré leur attirance indéniable pour le cinéma, les poètes n’ont pas pour autant cherché à passer d’un art à l’autre, ou à substituer le medium cinéma au medium poétique. Comme le formule avec une grande netteté N. Cohen : le cinéma a bien été un intense objet de réflexion pour l’avant-garde poétique et un réservoir d’images puissant, mais il n’a jamais été une véritable menace pour le langage et pour l’écriture. Ce que montre très bien la dernière partie de l’ouvrage, et plus précisément le dernier chapitre consacré à la production artistique qui a résulté de cette singulière rencontre entre les poètes et le cinéma, que N. Cohen préfère envisager sous le signe de la confluence plutôt que de l’influence.
39« Comment “être poète” dans le domaine cinématographique ? Est-ce en écrivant un scénario censément poétique, c’est-à-dire témoignant d’une recherche stylistique particulière ? Est-ce au contraire en s’oubliant comme poète pour s’éveiller à une nouvelle forme de poésie, purement visuelle, cette fois […] ? » s’interroge l’auteur au seuil de ce dernier chapitre. Avec une grande maîtrise de l’analyse intermédiale, elle procède à l’étude précise d’une sélection de scenarii, poèmes cinématographiques et « ciné-poèmes », qui illustrent la véritable fièvre qui s’empara des poètes dans les années 1920 et donna lieu à une multiplication de projets qui furent publiés la plupart du temps sans réelle intention d’être tournés. Le travail auquel se livre ici N. Cohen est précieux en raison d’abord de ces textes qui sont en grande partie inconnus. On saluera l’intelligence et la clarté de la typologie proposée, qui permet de rendre compte de cette production dont la diversité pouvait sembler anarchique.
40Ce chapitre offre ainsi un contrepoint intéressant à l’analyse des discours sur le cinéma qui la précède. Contrepoint intéressant car cette production, somme toute assez déceptive, rend compte de la passion formidable que les poètes ont vouée au cinéma tout en pointant la résistance de la poésie. En parlant de résistance, on ne veut pas dire que les poètes se sont arc-boutés sur la poésie pour en faire un bastion à protéger. Ni que la poésie leur aurait résisté et qu’ils auraient été impuissants à inventer des formes véritablement hybrides. Mais plutôt, et plus simplement, que c’est avant tout comme « adjuvant du renouvellement » (p. 326) de la poésie qu’ils ont envisagé le cinéma, voire comme « simple serviteur à la disposition de [l’]imagination du poète20 ». Si ces poètes ont intensément rêvé au cinéma, s’ils ont eu ce « désir du cinéma » dont l’ouvrage souhaite rendre compte, c’est avant tout comme spectateurs, et parce que le cinéma leur semblait offrir des « conditions de représentation favorables à la projection imaginaire » et une voie d’accès potentielle à la « vraie vie ». Mais ce désir de cinéma n’a généralement pas été l’instrument d’une remise en question du primat de l’écrit sur l’image.
41C’est ce que montre très bien N. Cohen en insistant sur le « déni du médium » manifeste chez les surréalistes, et lorsqu’elle souligne que l’idéal de Breton, qui n’a jamais caché son indifférence pour les questions techniques et formelles y compris pour le domaine de la création littéraire, serait plutôt une totale transparence du medium. Façon de rappeler que pour ce poète et pour nombre de ses contemporains, la poésie à la fois est partout – et donc qu’elle excède en tant que telle le poème et son support livresque traditionnel et qu’elle migre sans difficulté d’un art à l’autre –, mais qu’ils n’en demeurent pas moins, en tant que créateurs, des poètes de l’écrit. Il n’était pas inutile dès lors, pour lever toute équivoque à ce sujet, de rappeler que lorsque Breton en 1922 affirme que « la poésie écrite perd de jour en jour sa raison d’être », il s’agit surtout pour lui de dénoncer derrière la notion de « poésie écrite » la « sacralisation fétichiste de la valeur esthétique, sociale et marchande de l’objet littéraire » (p. 282), mais certainement pas de dévaloriser l’écrit comme « medium poétique en voie de disparition ou de marginalisation21 », ni de valoriser un autre medium, appelé à le dépasser ou à le remplacer. Il n’est pas sûr qu’il en soit encore tout à fait ainsi aujourd’hui, comme le suggère Catherine Soulier dans son article récent « “Une poésie sous influence” ? (ou quand la poésie fait son cinéma)22 » où elle examine des œuvres d’Ariane Dreyfus et de Jérôme Game dans lesquelles le poème, en plus de se dégager des clichés idéalisants ou esthétisants qui restent souvent associés au mot « poétiques » (et sur ce point on renverra à la remarquable étude de N. Cohen et A. Reverseau23), se détache du support livre et brouille la distinction entre mots et images. Ce qui équivaut, selon C. Soulier, à « redéfinir la notion de poésie. Ou, si l’on veut, à déstabiliser le sens du mot. “Pour ne pas trop savoir ce qu’est la poésie”, telle est l’incertitude que Francis Ponge avouait naguère. » Incertitude dont la fécondité ne se tarit pas.

